[ p. 107 ]
ARRIVÉE DES TRAVAILLEURS DE SILEX PRÉ-CHELLÉENS PENDANT LE TROISIÈME INTERGLACIAIRE — GÉOGRAPHIE, CLIMAT ET DÉRIVATIONS FLUVIALES — INDUSTRIE DU SILEX PRÉ-CHELLÉEN — LA RACE DE PILTDOWN — VIE DES MAMMIFÈRES — INDUSTRIES CHELLÉENNES ET ACHEULÉENNES — L’UTILISATION DU FEU — LA DEUXIÈME PÉRIODE DE CLIMAT ARIDE — LA RACE NEANDERTHIENNE DE KRAPINA, CROATIE
L’époque géologique de l’arrivée des silexiers pré-chelléens en Europe occidentale est de loin la plus importante et la plus intéressante pour les préhistoriens. Elle détermine la durée de l’âge de la pierre ancienne, la date d’apparition des races de Piltdown et de Néandertal, ainsi que toute la séquence des changements climatiques et géographiques qui ont marqué les débuts de l’humanité. Après avoir soigneusement pesé tous les éléments, l’opinion générale semble soutenir l’idée que cette époque doit être située après la fin de la troisième glaciation et avant l’avènement de la quatrième, c’est-à-dire durant le troisième interglaciaire.
Penck a estimé que le troisième interglaciaire chaud* s’est ouvert il y a environ 100 000 ans et a duré entre 50 000 et 60 000 ans. Selon la théorie adoptée dans cet ouvrage, le troisième interglaciaire et le quatrième glaciaire ont englobé toute la période du Paléolithique inférieur, soit une période de 70 000 à 100 000 ans, bien plus longue que celle du Paléolithique supérieur, estimée entre 16 000 et 25 000 ans.
¶ Antiquité géologique du début de l’âge de pierre
Il convient tout d’abord d’attirer l’attention sur le fait qu’avant l’époque où nous sommes entrés, les forces glaciaires et interglaciaires [ p. 108 ] agissant sur la grande péninsule d’Europe occidentale avaient laissé leur empreinte principalement sur les zones glaciaires et seulement dans une moindre mesure sur les zones libres, non glaciaires. Jusqu’à la fin du troisième interglaciaire, aucune trace de forêts et d’animaux nordiques, et encore moins arctiques, n’a été découverte nulle part, sauf le long des frontières des champs de glace. Il semblerait que la vie animale et végétale d’Europe n’ait été, dans l’ensemble, que légèrement affectée par les trois premières glaciations. Nous ne pouvons pas envisager un seul instant de croire qu’à l’époque glaciaire, toute la flore et la faune chaudes aient migré vers le sud puis soient revenues, car il n’existe pas la moindre preuve à l’appui de cette théorie. Il est bien plus conforme aux faits connus de croire que toutes les formes de vie du sud et de l’est sont devenues très résistantes, car nous savons avec quelle facilité les animaux vivant aujourd’hui dans les zones chaudes de la Terre s’acclimatent aux conditions nordiques.
¶ Étapes culturelles de l’époque glaciaire Types humains
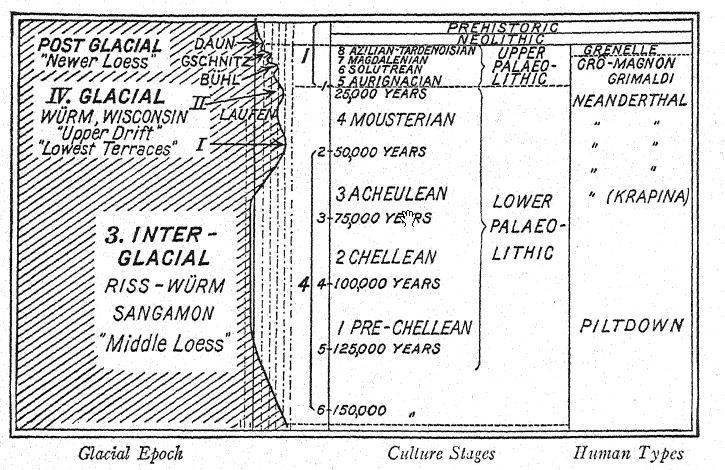
Si, par contre, nous nous appuyons uniquement sur le témoignage des conditions de vie, nous pourrions conclure que les silexiers pré-chelléens ont atteint l’Europe occidentale soit au cours du deuxième interglaciaire [ p. 109 ], soit pendant la troisième glaciation, soit encore pendant le troisième interglaciaire. Examinons de plus près ces témoignages de mammifères fossiles.
Français En faveur de la théorie selon laquelle la culture pré-chelléenne est aussi ancienne que le Second Interglaciaire, nous devons considérer le fait que dans plusieurs localités, des palasolithes de type pré-chelléen, sinon de type chelléen, ont été enregistrés en association avec les restes d’un certain nombre de mammifères plus primitifs que nous avons décrits ci-dessus comme caractéristiques du Second Interglaciaire. Par exemple, à Torralba, province de Soria, en Espagne, on a découvert1 un ancien campement chelléen typique, contenant d’abondants restes de rhinocéros à nez large et de mammouth du sud, mêlés aux restes d’autres mammifères de type très ancien, identifiés comme le rhinocéros étrusque et le cheval de Sténon. De plus, le long de la Somme, près d’Abbeville, dans le gisement du Champ de Mars,2 on dit que des outils pré-chelléens et ghéhéens ont été trouvés en association avec le rhinocéros étrusque, le cheval de Sténon et de très nombreux spécimens du tigre à dents de sabre et de la hyène rayée. De plus, à Piltdown, dans le Sussex, des silex pré-chelléens et le crâne de Piltdown se seraient trouvés dans une couche contenant un rhinocéros qui peut être identifié avec l’Étrusque. Si ces espèces animales très anciennes sont correctement reconnues et déterminées, et si elles sont réellement trouvées comme rapporté en étroite association dans les mêmes couches avec des silex pré-chelléens et chelléens, les preuves peuvent être considérées comme assez solides que le début de la culture chelléenne date du deuxième interglaciaire ; À moins, en effet, qu’il ne soit prouvé que ces espèces primitives de mammifères aient survécu jusqu’au Troisième Interglaciaire dans certaines régions privilégiées. Il faudrait également envisager la possibilité que ces animaux plus anciens, le tigre à dents de sabre, le cheval de Sténon, le rhinocéros étrusque et le castor géant, n’appartiennent pas réellement à la même couche que ces anciens palasolithes, mais y aient été accidentellement entraînés depuis d’autres dépôts plus anciens. En règle générale, ce sont les animaux les plus récents qui établissent une datation préhistorique, car nous savons qu’un paléolithe ne peut être plus ancien que le mammifère le plus récent avec lequel il est associé.
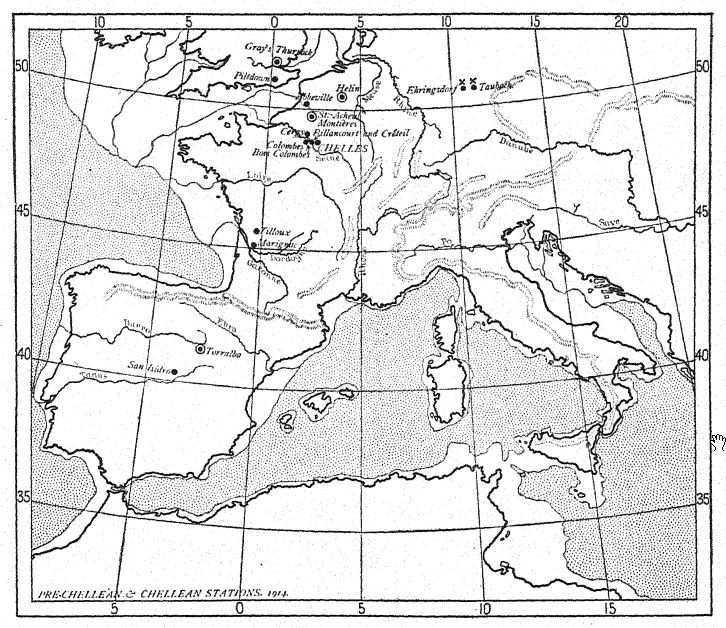
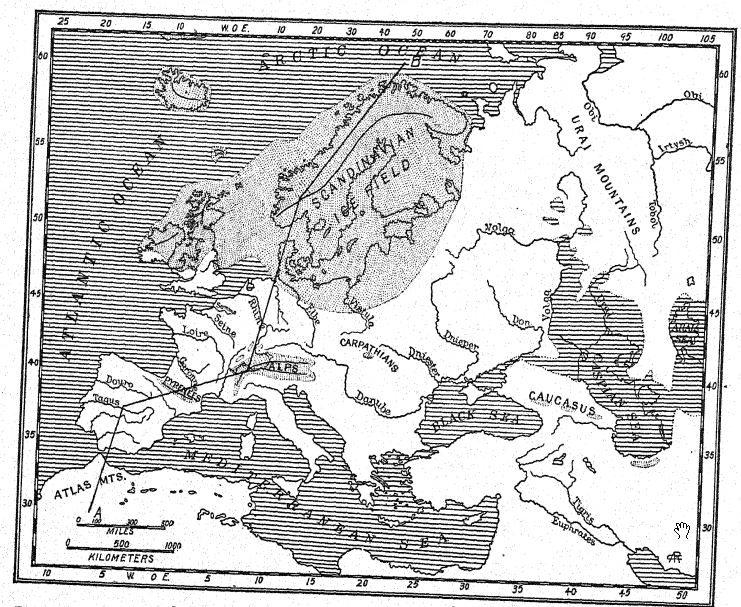
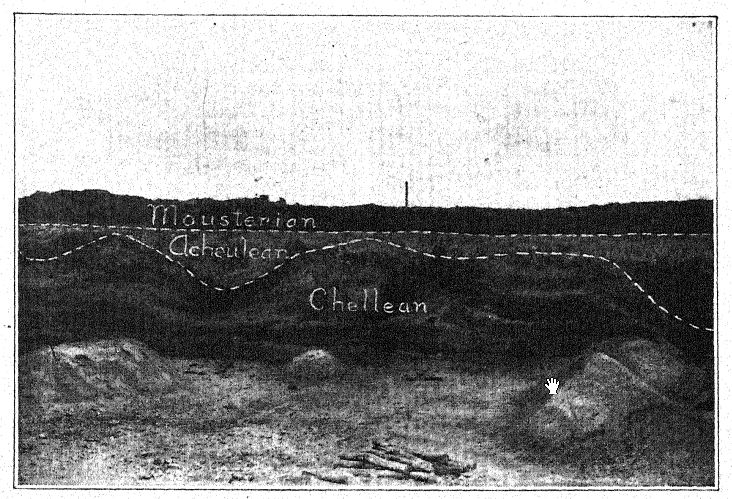
Les traces des trois premières glaciations ne sont pas entièrement consignées dans la faune et la flore, mais elles semblent se retrouver dans les lits des rivières. En Angleterre comme en France, ces lits témoignent de conditions d’inondation lors des premières glaciations, au cours desquelles de grandes quantités de graviers et de sables ont été transportées, et c’est avec ces matériaux que les « hautes terrasses » ont été construites. Ce sont principalement les preuves géologiques qui établissent la datation pré-chelléenne.
Les données géologiques et climatiques en France indiquent que la culture pré-chelléenne est apparue pour la première fois au début du Troisième Interglaciaire. C’est l’avis de Boule, Haug, Obermaier, Breuil, Schmidt et de nombreux autres géologues et archéologues. Le fait que les premiers tailleurs de silex paléolithiques aient pénétré l’Europe occidentale au début du Troisième Interglaciaire concorde avec nos observations sur la séquence climatique, sur la formation des « basses terrasses fluviales », où se trouvent les paléolithes les plus anciens, ainsi qu’avec la succession générale de la vie mammifère tout au long des changements climatiques de cette période interglaciaire. Il semblerait, pour expliquer les faits cités ci-dessus concernant les mammifères fossiles, que lorsque les ouvriers du silex pré-chelléens ont établi leurs camps le long de la vallée de la Somme dans le nord de la France, un climat très clément régnait dans cette région, favorable même, comme nous le verrons, à la survie de certains types de mammifères du Pliocène, tels que le tigre à dents de sabre et le rhinocéros étrusque.
Au début du troisième interglaciaire, le climat, si l’on en juge par l’état inchangé de la vie animale, est resté de même nature tempérée chaude. Seules deux des espèces pliocènes survivantes, à savoir les tigres à dents de sabre et les rhinocéros étrusques, sont devenues rares ou ont disparu. D’après les preuves recueillies à Kent’s Hole, dans le Devonshire, Dawkins est amené à penser que le tigre à dents de sabre a survécu en Grande-Bretagne jusqu’à l’époque postglaciaire. Le reste du monde animal, mammifères d’Afrique-Asie et d’Eurasie, a continué à prospérer dans toute l’Europe occidentale.
Ce n’est qu’à la fin de l’Acheuléen que nous découvrons des preuves d’un changement radical de climat ; à l’approche de conditions arides semblables à celles des steppes de l’Asie occidentale, il y eut un renouvellement des grandes tempêtes de poussière et des dépôts de « loess », comme cela s’était produit auparavant vers la fin du deuxième interglaciaire ; cela fut suivi par le climat encore plus froid de la quatrième glaciation, qui correspond à la période finale de la culture pahcolithique inférieure.
L’évolution du Pré-Chellen au Chellen, puis à l’Acheuléen inférieur, a certainement occupé une très longue période si l’on se contente des 50 000 ou 60 000 ans attribués au Troisième Interglaciaire ; mais même cette durée paraît bien trop longue si l’on observe la profondeur relativement limitée des dépôts fluviaux où se succèdent ces cultures de silex. On ne peut qu’être impressionné par la succession régulière, très serrée et ininterrompue des couches géologiques contenant les artefacts chelléens et acheuléens. (Voir Fig. 55.)
Il s’ensuit néanmoins qu’un long laps de temps doit être accordé à chaque période culturelle et au progrès de la technique.3 C’est cette large distribution qui a permis aux de MortiUlets (père et fils), Capitan, Rivière, Reboux, Daleau, Peyrony, Obermaier, Commont, Schmidt et d’autres d’établir dans diverses parties de l’Europe les principales étapes de l’évolution industrielle de l’âge de la pierre ancienne, ou Paléolithique inférieur.
¶ Subdivisions des cultures du Paléolithique inférieur4
MOUSTÉRIEN. Industrie tardive des Néandertaliens. Utilisation extensive du terme « éclat ».
- Moustérien supérieur. Grattoirs de La Quina, petits coups de poing et enclumes en os, se terminant par la culture d’Abri Audit.
- Moustérien moyen. Point culminant de la « pointe » moustérienne, finement écaillée et ébréchée sur une face, les meilleurs exemples approchant la perfection technique solutréenne.
- Moustérien ancien. Coups de poing cordiaux, pointes d’éclats et grattoirs à éclats moustériens.
ACHEULÉEN. Industrie primitive des Néandertaliens. Utilisation intensive du noyau nodulaire.
- Acheuléen récent. Pointes de lance miniatures de type La Micoque, coups de poing triangulaires et éclats de silex de type Levallois.
- Acheuléen moyen. Coups de poing ovales pointus, beaucoup plus légers que les types chelléens, et petits instruments similaires à ceux-ci, mais de facture nettement supérieure.
- Acheuléen ancien. Coups de poing ovales larges, beaucoup plus symétriques que le Chellen, mais encore assez lourds. Petits types.
[ p. 114 ]
CHELLÉEN.
- Chellean récent. Coups de poing longs et pointus, le plus souvent écaillés des deux côtés, avec peu de croûte adhérente et des bords encore asymétriques. Première apparition des coups de poing ovales.
- Chellean ancien. Première apparition de « coups de poing » en forme d’amande. Petits outils, dont grattoirs, rabots et forets. Tous les outils sont asymétriques et à bords irréguliers.
- Pré-Cheeleen. Industrie probable des races de Piltdown et de Heidelberg (prénéandertaliennes). Emploi de formes fortuites et accidentelles. Formes partiellement accidentelles ; retouche limitée aux quelques coups nécessaires pour donner une pointe ou un tranchant à l’outil, ou pour permettre une prise du bras (retouche protectrice). Prototypes de « coup de poing » formés de nodules de silex dont la croûte n’était que partiellement enlevée.
Si l’on suppose que les silexiers pré-chelléens ne sont pas arrivés en Europe avant le troisième interglaciaire, on peut expliquer toutes les gradations dans l’évolution de leurs outils en rapport avec les changements de climat et de vie animale que révèlent les dépôts géologiques et fossiles, notamment dans les vallées de la Somme et de la Tamise.
Si, en revanche, le Pré-Chellen est daté du Second Interglaciaire[2], cela fait remonter cette culture à cent mille ans en arrière et pose de graves difficultés à notre préhistoire. Premièrement, rien ne prouve que les silexiers pré-Chellen et chelléen aient vécu à l’époque de la formation des « hautes terrasses fluviales » de la Troisième Glaciation, car aucun silex paléolithique n’a jamais été trouvé enfoui dans les sables ou les graviers de ces « hautes terrasses ». La présence de silex archaïques sur les « hautes terrasses » de la Somme et de la Seine se trouve dans des lits de gravier superficiels, déposés longtemps après le creusement de ces « terrasses » par l’action fluviale ; c’est dans la Somme que l’on observe le mieux ce phénomène, où l’on trouve des silex archaïques dans les graviers déposés sur les « basses », « moyennes » et « hautes terrasses ». Deuxièmement, rien ne prouve que les silexiers pré-chelléens et chelléens aient traversé la période climatique froide de la troisième glaciation ; nulle part en Europe on n’a trouvé de traces de leurs camps ou stations en lien avec la faune ou la flore froide de la troisième glaciation. Troisièmement, les preuves géographiques sont tout aussi contradictoires avec la théorie selon laquelle les silexiers pré-chelléens seraient entrés en Europe pendant la deuxième période interglaciaire, car nous savons avec certitude que dans de nombreuses grandes vallées fluviales d’Europe, en particulier celles qui entourent les Alpes, les rivières étaient à des niveaux beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui et qu’elles transportaient les matériaux à partir desquels les « hautes terrasses » se formaient ou qu’elles les découpaient par érosion.
En d’autres termes, la géographie de l’Europe aux premier et deuxième interglaciaires était très différente de ce qu’elle est aujourd’hui ; la plupart des vallées fluviales étaient plus larges et moins profondes ; certaines d’entre elles avaient été érodées jusqu’à un point inférieur à leur niveau actuel et avaient commencé à s’envaser sous les alluvions. Au troisième interglaciaire, la géographie fluviale de l’Europe était sensiblement la même qu’aujourd’hui, même si les côtes étaient encore très différentes.
Lors de l’apparition de l’homme pré-chelléen, nous verrons que les vallées fluviales de la Somme et de la Marne, dans le nord de la France, ainsi que celles de la Tamise, dans le sud-est de l’Angleterre, étaient très semblables à ce qu’elles sont aujourd’hui en ce qui concerne leurs niveaux d’eau ; autrement dit, la géographie intérieure de l’Europe du Nord à l’époque cheléenne et du centre et du sud de la France à l’époque acheuléenne qui lui a immédiatement succédé était très semblable à celle d’aujourd’hui. Les caractéristiques superficielles des vallées étaient différentes ; les cours d’eau à l’époque chelléenne coulaient à travers des graviers et des sables, participant d’un aspect glaciaire ; une ou plusieurs des « terrasses fluviales » composées de sables et de graviers étaient encore nettement définies, car la couverture meuble de « limon » et de sols alluviaux des hautes terres et collines environnantes n’avait pas encore été emportée par les eaux pour adoucir les contours des « terrasses ». Ces « terrasses » n’étaient pas non plus recouvertes de dépôts plus récents de « loess ».
[ p. 116 ]
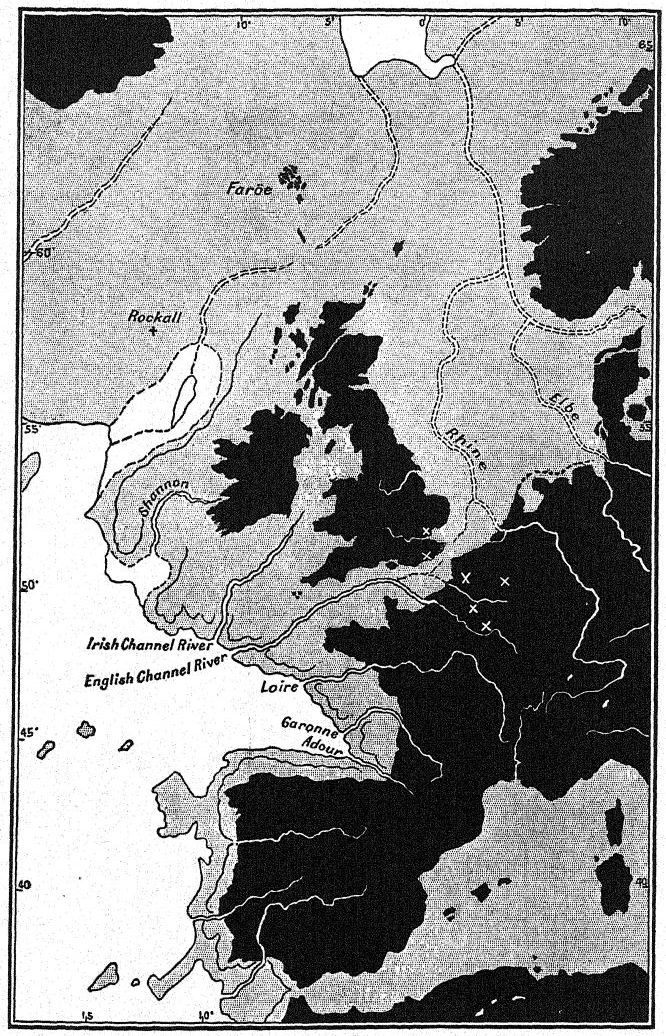
[ p. 117 ]
¶ Changements séculaires du climat au Paléolithique inférieur
Nous trouvons des preuves de quatre phases climatiques et biologiques au cours de la longue période d’évolution du Pahéolithique inférieur, comme suit :
4. Climat froid et humide. — Début de la quatrième glaciation. Arrivée de la culture « moustérienne » et de la race néandertalienne en Belgique et en France. Installation des hommes dans les abris, grottes et entrées des cavernes plus chauds. Disparition définitive du robuste rhinocéros de Merck et de l’éléphant à défenses droites. Arrivée de la faune de la toundra, du renne, du mammouth laineux et du rhinocéros laineux. Refroidissement de l’Europe occidentale jusqu’au nord de l’Espagne et de l’Italie. Large répartition des mammifères froids des Alpes, de la toundra et des steppes dans toute l’Allemagne et la France, ainsi que dans le nord de l’Espagne. Flore de la toundra froide dans la vallée de la Tamise et à Hoxne, dans le Suffolk. Migration des mammifères de la toundra, du renne, du mammouth et du rhinocéros dans tout le sud de la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, l’Allemagne et l’Autriche.
3. Climat aride en Europe occidentale. — Période de la fin de la culture acheuléenne ; certains tailleurs de silex recherchent l’abri des falaises et s’approchent des entrées des grottes pendant la saison froide. Climat de steppe sèche, vents d’ouest dominants et dépôts de lœss dans tout le nord de la France et en Allemagne. Apparition des premiers Néandertaliens à Krapina, en Croatie. Flore forestière fraîche dans la région de La Celle-sous-Moret, près de Paris, suivie de dépôts de lœss et d’un climat de plus en plus frais et aride. Industrie du Moustérien ancien. Disparition d’abord du couple de mammifères asiatiques les plus sensibles, l’hippopotame et le mammouth du sud (E. trogontherii) ; persistance de l’éléphant (E. antiquus), plus robuste et aux défenses droites, et du rhinocéros à nez large (D. merckii).
2. Suite de la période tempérée chaude. — Époque de la culture chelléenne découverte à Chelles, Saint-Acheul, Gray’s Thurrock, Ilford, Essex et, plus au sud, à Torralba, en Espagne. Abondance d’hippopotames, de rhinocéros, de mammouths du sud et d’éléphants à défenses droites dans le nord de l’Allemagne à Taubach, Weimar, Ehringsdorf et Achenheim. Apparition rare de tigres à dents de sabre. Flore forestière tempérée et alpine de Dürnten et d’Utznach, en Suisse. Culture acheuléenne ancienne largement répandue dans toute l’Europe occidentale.
1. Début de la période tempérée chaude. — Le climat chaud de la période pré-chelléenne, observé dans les vallées de la Somme, de la Tamise et de la Seine près de Paris, est favorable au mammouth du sud et à l’hippopotame. Survivance apparente du tigre à dents de sabre et du rhinocéros étrusque dans les régions favorisées. Flore forestière tempérée chaude à La Celle-sous-Moret près de Paris et en Lorraine. Arrivée des silexiers pré-chelléens et de la race Piltdowh dans le sud de l’Angleterre.
[ p. 118 ]
Français On pense que le climat du troisième interglaciaire, lorsqu’il a atteint sa chaleur maximale, était à nouveau un peu plus doux que le climat actuel dans la même région. Dans les Alpes, les glaciers et la limite des neiges ont reculé à nouveau jusqu’à leurs niveaux actuels. La période a commencé avec des conditions continentales humides. Les zones laissées nues par la glace ont été progressivement reboisées. Une image du climat de cette période chaude est présentée dans la région proche de Paris dans ce qu’on appelle le tuf de La Celle-sous-Moret (Seine-et-Marne). Ce tuf, qui est un dépôt de sources chaudes, recouvre des graviers de rivière du Pléistocène7. Les niveaux inférieurs du tuf contiennent l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), les saules et le pin noir d’Autriche, indiquant un climat tempéré. Plus haut dans les mêmes dépôts, nous trouvons des preuves de températures de plus en plus douces avec la présence du buis (Buxus) et assez fréquemment du figuier ; Le laurier des Canaries (Laurus nobilis) est un peu plus rare et, tout comme le figuier, il indique que les hivers étaient doux, car ces plantes ont la particularité de fleurir pendant la saison hivernale ; nous en déduisons donc que le climat était un peu plus doux et plus humide qu’il ne l’est actuellement dans la même région. Les mollusques indiquent également une plus grande uniformité climatique. On pense que ces dépôts correspondent à la période d’industrie chelléenne et acheuléenne primitive.
Les plantes des niveaux les plus élevés du même tuf témoignent cependant de l’avènement d’un climat plus froid et le relient également à la culture acherdéenne par la présence de silex ikcheuléens. Le gisement de tuf est recouvert d’une couche de lœss correspondant au retour d’une période aride à l’Acheuléen récent, en plein cœur du nord de la France. Ainsi, dans la région proche de l’actuelle ville de Paris, nous disposons d’un enregistrement de trois phases climatiques, qui sont également plus ou moins complètement indiquées dans les gisements situés au nord, le long de la Somme et dans la vallée de l’ancienne Tamise.
Dans l’ouest de la France, nous interprétons à nouveau la flore fossile de Lorraine comme appartenant à la période de fermeture plus fraîche du troisième interglaciaire [ p. 119 ] et à l’avènement de la quatrième glaciation, car ici prédominent les variétés les plus septentrionales du mélèze (Larix) et du pin de montagne (Pinus lambertiana).
Français La vue la plus claire des forêts alpines contemporaines se trouve près de Zurich dans les dépôts magmatiques de Dürnten et d’Utznach, qui sont si caractéristiques de la période tempérée du troisième stade interglaciaire que Geikie a proposé d’appeler cet étage le Durntenien.8 C’est, rappelons-le, à Dürnten que Morlot9 a trouvé les premières preuves d’une flore interglaciaire chaude ou tempérée, entre les dépôts d’un glacier en retrait et ceux d’un glacier en progression ; car Dürnten se trouve bien dans la région qui était couverte par les vastes champs de glace des troisième et quatrième glaciations. Les forêts qui y prospéraient au troisième interglaciaire étaient semblables à celles que l’on trouve aujourd’hui dans la même région, composées d’épicéas, de sapins, de pins de montagne, de mélèzes, de hêtres, d’ifs et de sycomores, avec des sous-bois de noisetiers. À cette flore robuste sont associés les restes de l’éléphant à défenses droites, du rhinocéros de Merck, du bétail sauvage et du cerf ; une autre preuve de notre opinion selon laquelle tous ces mammifères asiatiques s’étaient habitués au climat tempéré frais du nord.
¶ La vie sur la Somme, du pré-chelléen au néolithique
Les rives de la Somme à Saint-Acheul nous offrent un aperçu de toute l’histoire de la succession des événements géologiques : les grands changements climatiques, le développement de la vie animale, la succession des races et des cultures humaines. Commont10 a trouvé ici la clé de l’histoire de tout ce pays et nous a permis de comparer les événements d’ici à ceux qui se sont produits plus loin, à Taubach, aux confins de la forêt de Thuringe, et à Krems en Basse-Autriche, étudiés par Obermaier. En effet, les périodes de loess « anciennes » et « plus récentes », la succession des climats et des mammifères, et le développement des cultures humaines ne furent pas des événements locaux, mais continentaux. Les événements purement locaux se retrouvent dans les types de graviers et de sols qui ont été charriés sur les terrasses.
[ p. 120 ]
Il est très important d’abord de se représenter clairement et de comprendre la géographie de la Somme à l’époque de l’arrivée des silexiers pré-chelléens. Il semble certain que les trois anciennes terrasses fluviales, composées de calcaire, avaient été creusées bien avant et que la rivière avait déjà atteint le niveau inférieur de la roche calcaire sous-jacente.11 La terrasse supérieure, alors comme aujourd’hui, se trouvait à 30 mètres au-dessus de la Somme, la terrasse intermédiaire à environ 21 mètres, et la terrasse la plus basse s’étendait d’une hauteur de 40 mètres environ sous le niveau actuel de la rivière (voir Fig. 59).
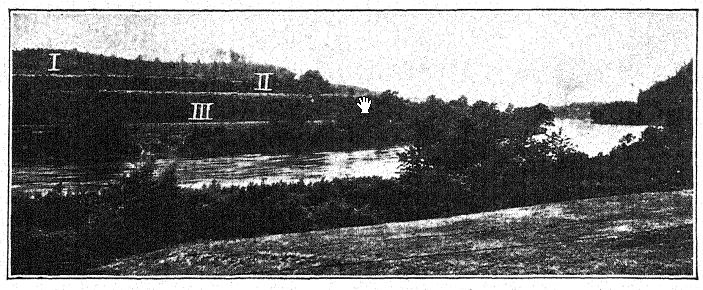
Les silex pré-chelléens les plus primitifs se trouvant dans les graviers grossiers qui recouvrent le sol de ces terrasses, immédiatement au-dessus de la craie, prouvent que l’excavation de la vallée était entièrement achevée à l’arrivée des ouvriers pré-chelléens. Commont pense que telle était la topographie réelle de la vallée durant le troisième interglaciaire. La présence de silex chelléens dans les sables blancs recouvrant les graviers grossiers des terrasses moyennes et supérieures n’indique pas que les ouvriers silex campaient ici pendant que ces terrasses étaient creusées par la Somme, mais plutôt qu’ils recherchaient ces falaises propices à l’exploitation de leurs carrières pendant que ces sables et graviers étaient charriés des flancs des vallées et des plateaux supérieurs.
[ p. 121 ]
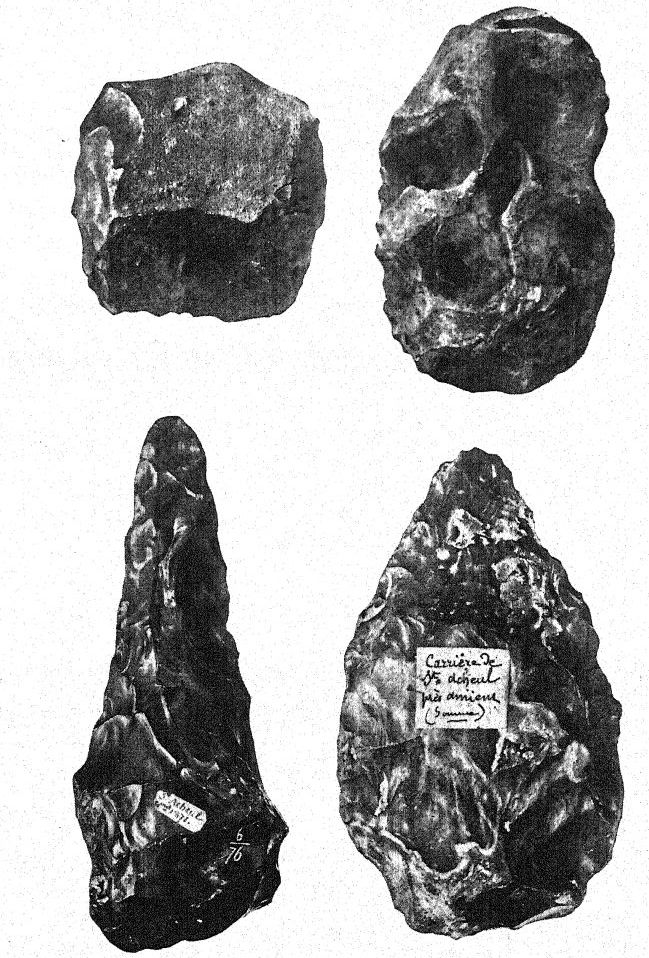
a. En forme de disque — en haut à gauche. c. En forme de poignard — en bas à gauche.
b. Ovale — en haut à droite. d. En forme d'amande — en bas à droite.
Dans la collection du Musée américain d'histoire naturelle.
[ p. 122 ]
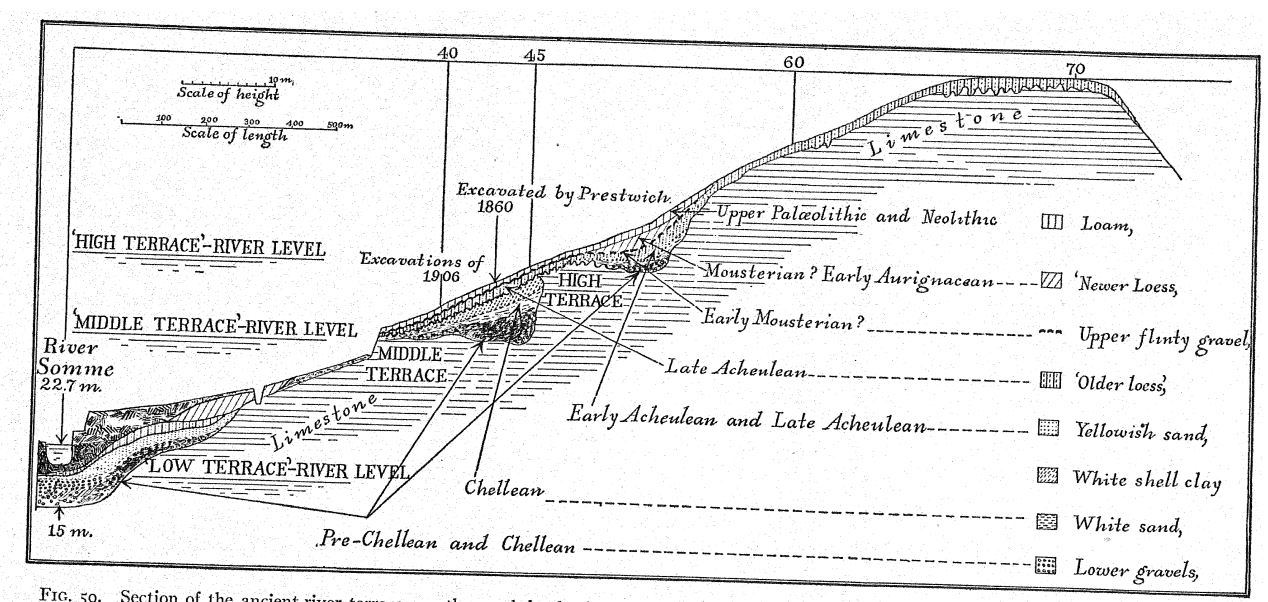
[ p. 123 ]
L’histoire des changements climatiques dans l’ancienne vallée de la Somme est clairement illustrée par ces dépôts successifs, épais de 4,5 mètres, au-dessus des graviers de la Tour à Saint-Acheul. Aux côtés des silex pré-chelléens et chelléens présents dans les « vieux graviers » et les « sables blancs », on trouve des traces du climat tempéré chaud et humide qui régnait alors dans le nord de la France et qui était sans doute le plus favorable aux hippopotames, aux rhinocéros et aux éléphants de cette époque. Les mollusques fluviaux découverts avec les silex chelléens récents sont un autre indice du climat forestier tempéré qui a perduré jusqu’au début de l’Acheuléen.
À l’Acheuléen moyen se trouvent les dépôts les plus anciens de « loess ancien », témoignant d’un climat encore tempéré mais aride, datant du milieu du Troisième Interglaciaire. Au Moustérien, on trouve d’importants dépôts de graviers correspondant au climat froid et humide du Quatrième Interglaciaire, suivis à l’Aurignacien moyen par des couches fraîches de « loess récent », signe du retour d’un climat sec. Enfin, les couches de loam, charriées sur les flancs de la vallée et où se trouvent les vestiges des camps solutréens et aurignaciens, témoignent du retour de conditions humides et probablement forestières.
Français Ainsi, deux périodes de loess sec sont indiquées dans cette vallée, la première ou « loess plus ancien » appartenant à la Troisième Interglaciaire, et la seconde ou « loess plus récent » à la Postglaciaire ; et nous percevons clairement que dans les couches culturelles ici il n’y a aucune preuve de plus d’une étape glaciaire précédée d’une période climatique sèche et de dépôts de loess. Si les silexiers pré-chelléens étaient arrivés dans cette vallée fluviale dès la Deuxième Interglaciaire, nous trouverions des preuves de trois périodes de climat aride et de dépôt de loess et de deux glaciations.
PRÉHISTOIRE DE SAINT-ACHEUL
- NÉOLITHIQUE.
- Campignien, terre récente et limon.
- PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR.
- Solutreau.
- Aurignacien supérieur, limon.
- Aurignacien moyen, ‘loess plus récent’ et graviers.
- PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR.
- Moustérien supérieur, graviers ‘loess plus récent’.
- Moustérien ancien, base ‘l’ergeron’.
- Acheuléen moyen, ‘loess ancien’ et dérive.
- Acheuléen inférieur, graviers sous ‘lœss plus ancien’ (E. anliquus).
- Chellean supérieur, sables fluviatiles et faune de mollusques.
- Chellean ancien, premiers coups de poing ; anciens ‘sables blancs’ (E. antiquus).
- Pré-Chellen, prototypes de coup de poing ; anciens ‘graviers inférieurs’ (E. anliquus).
À partir de l’Acheuléen moyen, les silex se trouvent dans des dépôts de graviers, de limons, de terres à briques et de « loess ancien », qui appartiennent tous à un étage géologique ultérieur et sont plus récents que les graviers et sables inférieurs des terrasses qu’ils recouvrent et dissimulent. Des dépôts de ce type ont également été entraînés depuis les niveaux les plus élevés vers le fond de la vallée, et Commont distingue trois dépôts ou couches différents de « loess limon », dont les plus bas ou les plus anciens contiennent des silex acheuléens, tandis que les limons moyens contiennent des outils moustériens.
Même vers la fin du troisième interglaciaire, il y eut des périodes de chaleur, peut-être au plus fort de la saison chaude de l’été, lorsque les animaux de la faune chaude migraient du sud. Ainsi, Commont a récemment découvert dans la vallée de la Somme une station de tailleurs de silex moustériens, dont l’industrie est associée aux restes des trois animaux typiques de la phase climatique plus chaude : l’éléphant à défenses droites, le rhinocéros à nez large et l’hippopotame. Il a réaffirmé sa conviction que la majeure partie de ce chapitre de la préhistoire humaine, tant en ce qui concerne la topographie de surface de la vallée de la Somme que l’évolution des cultures de silex du pré-chelléen au moustérien, s’est déroulée pendant le troisième interglaciaire.
¶ La période tempérée chaude précoce de la culture pré-chelléenne
Nous avons observé que, de Torralba, dans la province de Soria, en Espagne, jusqu’à Abbeville, près de l’embouchure de la Somme, dans le nord de la France, trois types d’animaux entrés en Europe dès le Pliocène supérieur, à savoir le rhinocéros étrusque, le cheval de Sténon et le tigre à dents de sabre, seraient présents en relation avec des artefacts chelléens anciens. Les deux premières espèces peuvent être confondues avec les formes anciennes du rhinocéros de Merck et les véritables chevaux des forêts d’Europe, mais il ne fait aucun doute que le tigre à dents de sabre, dont un certain nombre ont été trouvés par M. d’Ault du Mesnil, à Abbeville, dans la Somme, est identifié avec des silex chelléens anciens.
La vie mammifère de la Somme à cette époque, telle qu’elle est découverte dans le gisement du Champ de Mars près d’Abbeville, est très riche.
Parmi les plus grandes formes, on trouve certainement le grand mammouth du sud (E. meridionalis trogontherii), et peut-être aussi l’éléphant à défenses droites (E. antiquus). Il existe incontestablement deux espèces de rhinocéros, dont le plus petit est reconnu par Boule comme étant le rhinocéros étrusque, et le plus grand comme le rhinocéros de Merck. On dit que le cheval de Sténon est présent ici, et il y a d’abondants restes du grand hippopotame (H. major) ; les tigres à dents de sabre étaient très nombreux, comme l’atteste la découverte des mâchoires inférieures d’une trentaine d’individus ou plus. On trouve également l’hysène à face courte (H. hrevirostris), et il y a plusieurs espèces de cerfs et de bovins moyens.
Cette collection remarquablement riche de mammifères est associée à des silex de type chelléen primitif ou, peut-être, de type pré-chelléen.^^ À Torralba, en Espagne, les mêmes animaux très anciens sont présents, et il semble possible que ce soit la vie mammifère dominante de l’époque pré-chelléenne.
Nous pouvons donc conclure qu’il existe des preuves considérables, bien que pas encore tout à fait convaincantes, que les premiers ouvriers du silex chelléens sont arrivés en Europe occidentale avant la disparition du rhinocéros étrusque et du tigre à dents de sabre.
Faune pré-chelléenne
- Mammouth du Sud.
- Rhinocéros étrusque.
- Hippopotame.
- Cheval primitif (Equus stenonis) ?
- Tigre à dents de sabre.
- Rhinocéros à nez large.
- Éléphant aux défenses droites.
- Castor géant (Trogontherium cuvieri) .
- Hysène à face courte.
- Faune typique des forêts et des prairies eurasiennes, comprenant des cerfs, des bisons et des bovins sauvages.
[ p. 126 ]
¶ Les stations pré-chelléennes (Voir Fig. 53 et 56.)
L’aube du Paléolithique est indiquée dans diverses stations fluviales par l’apparition d’armes et d’outils en silex rudimentaires, en plus des outils supposés de l’Éolithique. On observe un effort indéniable pour façonner le silex selon une forme précise et une fonction précise : il ne peut plus être question d’intervention humaine. Ainsi apparaissent progressivement divers types de silex, chacun évoluant vers une forme plus parfaite. Naturellement, les ouvriers de certaines stations étaient plus habiles et inventifs que d’autres. Néanmoins, les stades primitifs d’invention et de technique se sont transmis d’une station à l’autre ; ainsi, pour la première fois, nous sommes en mesure d’établir l’âge archéologique de diverses stations d’Europe occidentale.
Seules quelques stations ont été découvertes où les hommes du Paléolithique façonnaient pour la première fois leurs silex en prototypes des formes chelléennes et acheuléennes. En ce qui concerne la théorie selon laquelle ces tailleurs de silex primitifs auraient pénétré en Europe par la côte nord de l’Afrique, nous observons que ces stations se limitent à l’Espagne, au sud et au nord de la France, à la Belgique et à la Grande-Bretagne. Aucune station pré-chelléenne ou chelléenne d’authenticité incontestable n’a été découverte en Allemagne ou en Europe centrale, et, pour autant que les preuves actuelles le permettent, il semblerait que la culture pré-chelléenne ne soit pas entrée en Europe directement par l’est, ni même par la côte nord de la Méditerranée, mais plutôt par la côte nord de l’Afrique[4], où la culture chelléenne est attestée en association avec des restes de mammifères appartenant au Pléistocène moyen.
Les stations cheléennes les plus méridionales actuellement connues en Europe sont celles de Torralba et de San Isidro, dans le centre de l’Espagne. Dans le département de la Gironde se trouve la station cheléenne de Marignac, et il n’est pas improbable que d’autres stations soient découvertes [ p. 127 ] dans la même région, car les races paléolithiques favorisaient fortement les vallées de la Dordogne et de la Garonne. Il s’agit donc de la seule station connue dans le sud de la France qui représente cette période de l’aube de la culture humaine.
Les principales stations pré-chelléennes et chelléennes étaient regroupées le long des vallées de la Somme et de la Seine. Parmi les rares sites présentant une culture pré-chelléenne typique, on peut citer les stations voisines de Saint-Acheul et de Montières, toutes deux situées dans les faubourgs d’Amiens sur la Somme, et la station d’Hélin, près de Spiennes, en Belgique, explorée par Rutot. Une culture très primitive, peut-être pré-chelléenne, a été découverte sur le site du Champ de Mars, à Abbeville. Cette culture s’étendait également vers l’ouest, à travers la vaste plaine qui constitue aujourd’hui le détroit du Pas-de-Calais, jusqu’à la vallée de la Tamise, sur la rive nord de laquelle se trouve l’importante station de Gray’s Thurrock, tandis que plus au sud se trouve le site récemment découvert de PiltdowTi, dans la vallée de l’Ouse, dans le Sussex.
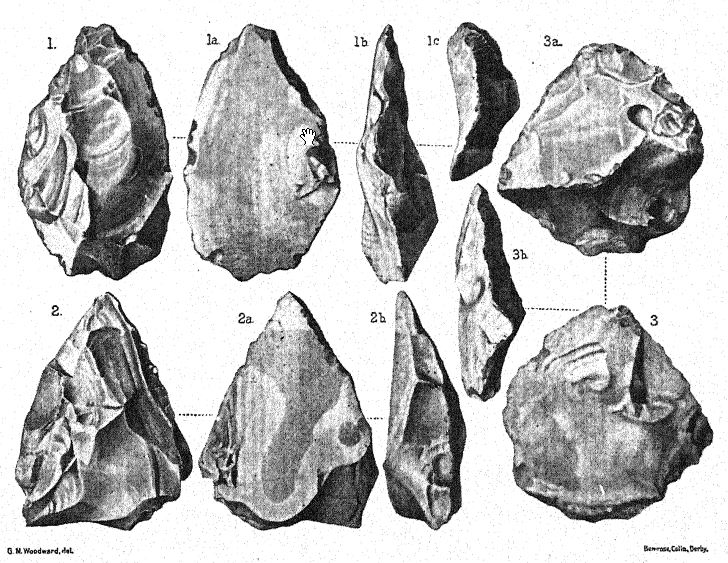
Les outils en silex (fig. 60) découverts dans la couche immédiatement au-dessus du crâne de Piltdown sont extrêmement primitifs et indiquent que les artisans de Piltdown n’avaient pas atteint le niveau de savoir-faire décrit par Commont comme « pré-chelléen » à Saint-Acheul. « Parmi les silex », observe Dawson, « nous avons trouvé plusieurs outils en silex incontestables, ainsi que de nombreux éolithes. La facture des premiers est similaire à celle des stades chelléen ou pré-chelléen ; mais dans la majorité des spécimens de Piltdown, le travail apparaît principalement sur une seule face des outils. »
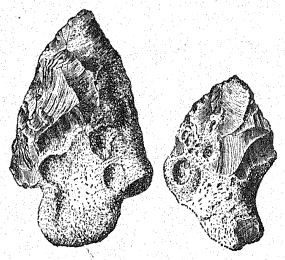
Dans la carrière d’Hélin, près de Spiennes13, on trouve des prototypes bruts du coup de poing paléolithique, associés à de nombreux éclats qui ne diffèrent guère de ceux des graviers fluviaux les plus bas de Saint-Acheul ; la qualité de fabrication des deux sites est étroitement liée, ce qui permet de considérer le Mesvinien de Rutot[5] comme un stade culturel équivalent au Pré-Chellen. Les graviers fluviaux et les sables d’Hélin qui contiennent les outils ressemblent également à ceux de Saint-Acheul par leur ordre de stratification. Il est particulièrement intéressant de noter qu’un silex primitif de cette carrière d’Hélin, appelé « foret », présente une ressemblance frappante avec le foret « éolithique » découvert dans la même couche que le crâne de Piltdown, dans le Sussex. Grâce à de telles indications, renforcées par d’autres preuves du même type, nous pourrions éventuellement établir la datation de cette culture pré-Chellenienne ou Mesvinienne et de la race de Piltdown.
En examinant les outils pré-chelléens découverts à Saint-Acheul en 1906, nous remarquons14 qu’à ce stade naissant de l’invention humaine [ p. 129 ], les tailleurs de silex ne concevaient pas délibérément la forme de leurs outils, mais travaillaient plutôt sur les formes aléatoires de blocs de silex brisés, cherchant par quelques coups bien dirigés à produire une pointe acérée ou un bon tranchant. Ce fut le début de l’art de la « retouche », qui se faisait au moyen de légers coups avec une seconde pierre au lieu du marteau avec lequel les éclats bruts étaient d’abord détachés. La retouche avait un double objectif : son objectif premier et le plus important était d’aiguiser davantage la pointe ou le tranchant de l’outil. Cela se faisait en ébréchant de petits éclats sur la face supérieure, de manière à donner au silex un tranchant semblable à celui d’une scie. Son second objectif était de protéger la main de l’utilisateur en émoussant les arêtes vives ou les pointes qui pourraient empêcher une prise ferme de l’outil. Souvent, l’extrémité lisse et arrondie du nodule de silex, dont la croûte est intacte, est soigneusement préservée à cet effet (fig. 61). C’est à cette prise en main de l’outil primitif que font référence les termes « coup de poing », « Faustkeil » et « hand-axe ». « Handstone » est peut-être la désignation la plus appropriée dans notre langue, mais il semble préférable de conserver la désignation française originale, « coup de poing ».
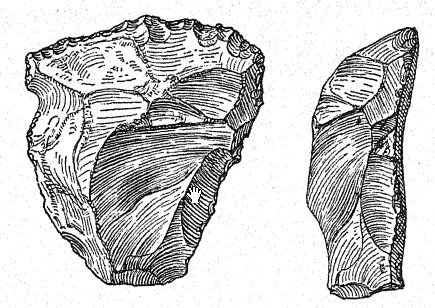
Français La forme du silex étant purement due au hasard, ces outils pré-chelléens sont interprétés par les archéologues principalement en fonction de la manière dont ils ont été retouchés. Déjà [ p. 130 ] ils sont adaptés à des usages très divers, aussi bien comme armes de chasse que pour tailler et façonner des outils en bois et préparer les peaux. Ainsi, Obermaier observe que les bords concaves et dentelés caractéristiques de certains de ces outils pourraient bien avoir été utilisés pour gratter l’écorce des branches et les lisser pour en faire des perches ; que les coups de poing rugueux seraient bien adaptés à la division de la chair et à la préparation des peaux ; que les fragments pointus pourraient être utilisés comme perceurs, et d’autres, plus grossiers et plus lourds, comme rabots (voir Fig. 62).
L’inventaire de ces formes ancestrales d’outils pré-chelléens, utilisés dans la vie industrielle et domestique, dans la chasse et
en temps de guerre, c’est comme suit :
| Grattoir, | outil de rabotage. |
| Perforateur, | foret, aléseuse. |
| Coutean, | couteau. |
| Percuteur, | marteau-pilon. |
| Pierre de jet ? | jeter une pierre ? |
| Prototypé de coup de poing, | pierre à main. |
Il comprend cinq, voire six, types principaux. Le véritable coup de poing, un outil combiné de l’époque chelléenne, n’est pas encore développé à l’époque pré-chelléenne, et les autres instruments, bien que de forme similaire, sont plus primitifs. Ils sont tous à un stade expérimental de développement.
Des indications selon lesquelles cette industrie primitive s’est également répandue dans le sud-est de l’Angleterre, et qu’une succession de la culture pré-chelléenne à la culture chelléenne peut être démontrée, apparaissent en rapport avec la découverte récente de la très ancienne race de Piltdown.
¶ La course de Piltdown 15
L’« homme de l’aube » est le type humain le plus ancien dont la forme de la tête et la taille du cerveau soient connues. Son anatomie, ainsi que son ancienneté géologique, sont donc d’un profond intérêt et méritent une étude approfondie. Nous pouvons d’abord passer en revue le récit des auteurs de cette découverte remarquable et l’histoire des opinions à son sujet.
Piltdown, dans le Sussex, se situe entre deux bras de l’Ouse, à environ 56 kilomètres au sud et légèrement à l’est de Gray’s Thurrock, la station chelléenne de la Tamise. À l’est se trouve le plateau du Kent, où de nombreux silex de type éolithique ont été découverts.
[ p. 131 ]
La couche de gravier dans laquelle se trouvait le crâne de Piltdown se trouve sur un plateau bien défini de grande superficie, à environ 24 mètres au-dessus du niveau du cours principal de l’Ouse. Des vestiges de graviers et de galeries contenant du silex se trouvent sur le plateau et sur les pentes qui descendent vers la rivière et les ruisseaux. Cette région était sans aucun doute propice aux tailleurs de silex des époques pré-chelléenne et chelléenne. Kennard16 estime que les graviers sont du même âge que ceux de la « haute terrasse » de la basse vallée de la Tamise ; la hauteur au-dessus du niveau du cours d’eau est pratiquement la même, soit environ 24 mètres. Un autre géologue, Clement Reid17, soutient que le plateau, composé de craie du Weald, traversé par le ruisseau transportant les graviers de Piltdown, appartient à une période postérieure à celle de la dépression maximale [ p. 132 ] . de Grande-Bretagne ; que les dépôts sont d’âge préglaciaire ou du début du Pléistocène ; qu’ils appartiennent à l’époque postérieure à la période froide de la première glaciation, mais se trouvent à la base même de la succession de dépôts portant des outils dans le sud-est de l’Angleterre.
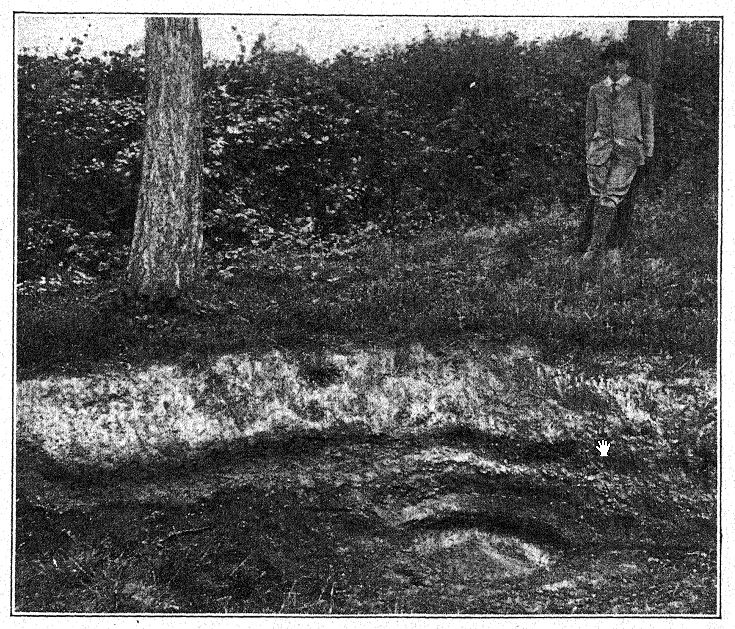
D’autre part, Dawson18, le découvreur du crâne de Piltdown, déclare dans sa première description : « D’après ces faits, il apparaît probable que le crâne et la mandibule ne peuvent être décrits avec certitude comme datant d’une époque antérieure à la première moitié du Pléistocène. L’individu a probablement vécu pendant le cycle chaud de cette époque. »
La section du lit de gravier (fig. 64) indique que les restes de l’Homme de Piltdown ont été emportés avec d’autres fossiles par un ruisseau peu profond chargé de gravier brun foncé et de silex bruts ; certains de ces fossiles dataient du Pliocène et provenaient des strates de la partie supérieure du ruisseau. Dans ce chenal ont été découverts les restes de plusieurs animaux du même âge que l’Homme de Piltdown, quelques silex ressemblant à des éolithes, et un silex travaillé très primitif de type pré-chelléen, qui pourrait également avoir été emporté par des dépôts plus anciens. Ces précieux documents géologiques et archéologiques constituent le seul moyen dont nous disposons pour déterminer l’âge d’Eoanthropus, l’« homme de l’aube », l’une des découvertes les plus importantes et significatives de toute l’histoire de l’anthropologie. Nous sommes redevables au géologue Charles Dawson et au paléontologue Arthur Smith Woodward d’avoir préservé ces archives anciennes et de les avoir décrites avec beaucoup de complétude et de précision comme suit (pp. 132 à 139) :
Il y a plusieurs années, Dawson découvrit un petit fragment d’un os pariétal humain d’une épaisseur inhabituelle, prélevé dans un lit de gravier creusé pour la construction d’une route dans une ferme près de Piltdown Common. À l’automne 1911, il ramassa parmi les tas de déblais de la même gravière, emportés par la pluie, un autre fragment osseux, plus gros, appartenant à la région frontale du même crâne et comprenant une partie de la crête s’étendant au-dessus du sourcil gauche. Immédiatement impressionné par l’importance de cette découverte, Dawson demanda la coopération de Smith Woodward, et une recherche systématique fut menée dans ces tas de déblais et graviers, à partir du printemps d’Igia ; tout le matériel fut examiné et soigneusement tamisé. Il semble que la totalité, ou une grande partie, du crâne humain ait été dispersée par les ouvriers, qui en avaient jeté les morceaux sans s’en apercevoir. Une recherche approfondie au fond du lit de gravier lui-même a révélé la moitié droite d’une mâchoire, trouvée dans une dépression de gravier finement stratifié et intacte, identique, autant qu’on puisse en juger sur place, à celle d’où les premières parties du crâne ont été exhumées. À un mètre de la mâchoire, un important morceau de l’os occipital du crâne a été découvert. Les recherches ont été reprises en 1913 par le père P. Teilhard, de Chardin, un anthropologue français, qui a heureusement récupéré une seule canine, puis une paire d’os nasaux, dont tous les fragments [ p. 134 ] sont d’une très grande importance pour la restauration du crâne.
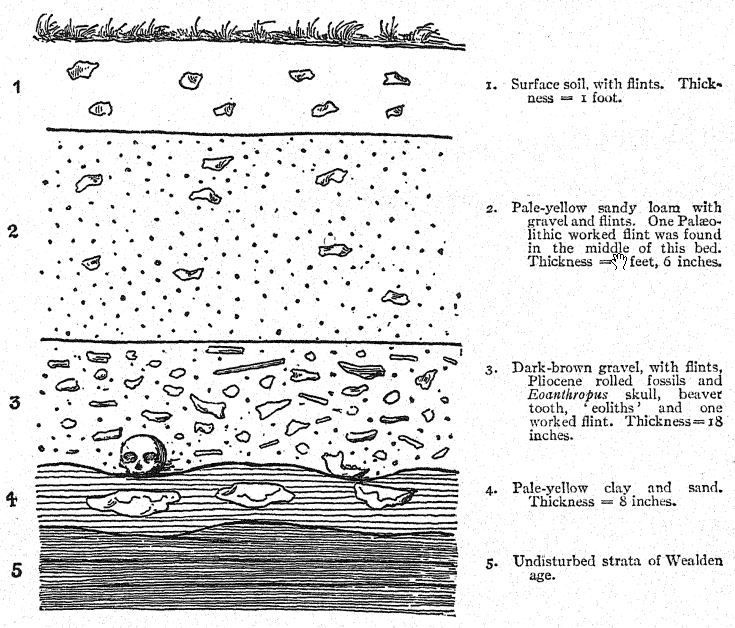
1. Sol superficiel, avec silex. Épaisseur : 30 cm.
2. Loam sableux jaune pâle avec gravier et silex. Un silex paléolithique travaillé a été trouvé au milieu de ce banc. Épaisseur : 60 cm.
3. Gravier brun écorce, avec silex, fossiles roulés du Pliocène et crâne d'Eoanthropus, dent de castor, « éolithes » et un silex travaillé. Épaisseur : 45 cm.
4. Argile et sable jaune pâle. Épaisseur : 20 cm.
5. Strates intactes de l'époque wealdienne.
La mâchoire semble avoir été brisée au niveau de la symphyse et légèrement abrasée, peut-être après avoir été coincée dans le gravier avant d’être entièrement recouverte de sable. Les fragments du crâne ne présentent que peu ou pas de traces de roulis ou d’autres abrasions, à l’exception d’une incision causée par le pic de l’ouvrier.
L’analyse des os a montré que le crâne était dans un état de fossilisation, qu’il ne restait plus de gélatine ni de matière organique et qu’une proportion considérable de fer était mélangée à une grande proportion des phosphates présents à l’origine.[6]
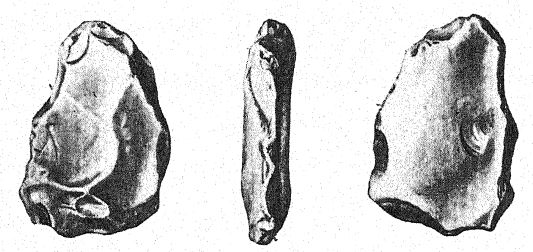
Français Le lit de gravier sombre (fig. 64, couche 3), d’une épaisseur de 45 cm, au fond duquel le crâne et la mâchoire ont été découverts, contenait un certain nombre de fossiles qui n’étaient manifestement pas du même âge que le crâne, mais provenaient certainement de dépôts pliocènes en amont ; ceux-ci comprenaient le campagnol aquatique et des restes de mastodonte, de mammouth méridional, d’hippopotame, ainsi qu’un fragment de dent broyeuse d’éléphant primitif, ressemblant à un stégodon. Dans les terrils, d’où l’on pense que le crâne de l’homme de Piltdown a été prélevé, on a trouvé une dent supérieure de rhinocéros, du type étrusque ou de Merck ; une dent de castor et d’hippopotame, ainsi qu’un os de patte de cerf, qui pourrait avoir été coupé ou incisé par l’homme. Beaucoup plus distinctif était un [ p. 135 ] silex unique (Fig. 65), travaillé d’un seul côté, de type très primitif ou pré-chelléen. Les outils de cette étape, comme l’observe l’auteur, sont difficiles à classer avec certitude, en raison de la grossièreté de leur fabrication ; ils ressemblent à certains outils grossiers que l’on trouve occasionnellement à la surface des dunes de craie près de Piltdown. La majorité des silex trouvés dans le gravier n’ont été travaillés que sur une seule face ; leur forme est épaisse et le débitage est large et épars ; la surface originale du silex est laissée dans un état lisse et naturel à la pointe saisie par la main ; l’ensemble de l’outil a donc une forme très grossière et massive. Ces silex semblent être d’une forme encore plus primitive que ceux de Saint-Acheul décrits comme pré-chelléens par Commont.
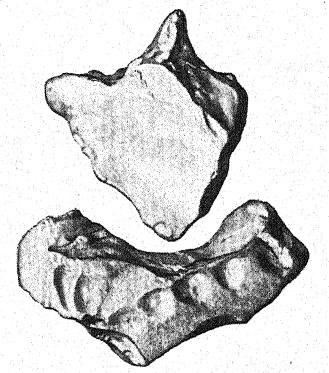
a. Perceuse (en haut).
b. Grattoir courbé (en bas).
Les éolithes découverts dans la gravière et les champs adjacents sont de forme « foreuse » et « grattoir creux » ; certains sont également de forme « grattoir en croissant », la plupart roulés et usés par l’eau, comme transportés de loin. Il s’agit du lit d’un ruisseau ou d’une rivière, et non d’une carrière paléolithique.
Il ne fait cependant guère de doute que l’Homme de Piltdown appartenait à une période où l’industrie du silex était encore très primitive, antérieure au véritable Chellen. On a observé par la suite que les couches de gravier (3) contenant l’Homme de Piltdown étaient plus profondes que les couches supérieures contenant des silex plus proches du type Chellen.
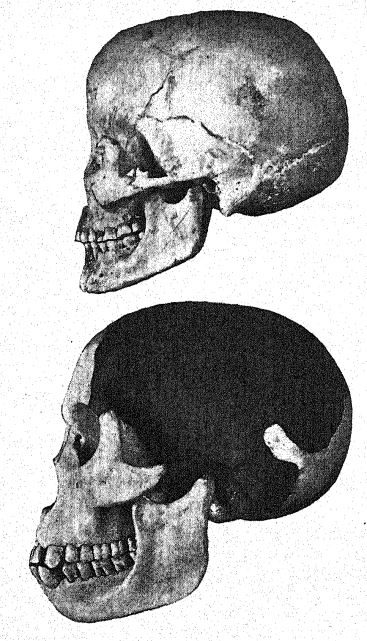
La découverte de ce crâne a suscité un intérêt aussi grand, voire plus grand, que celui des deux autres races « dérivantes », les Trinil et les Heidelberg. Les anatomistes les plus éminents de Grande-Bretagne, Arthur Smith Woodward, Elliot Smith et Arthur Keith, ont pris part à cette discussion, et les pièces originales ont finalement été réexaminées par trois anatomistes de ce pays.[7]
Il est important de présenter intégralement les opinions originales de Smith Woodward, qui a consacré une étude très minutieuse à la première reconstruction du crâne (fig. 67), un modèle qui a ensuite été modifié par la découverte d’une canine. Dans sa description originale, il est observé que les morceaux de crâne préservés se distinguent par la grande épaisseur de l’os, soit 11 à 12 mm, contre 5 à 6 mm, l’épaisseur moyenne du crâne européen moderne, ou 6 à 8 mm, l’épaisseur du crâne des Néandertaliens et de l’Australien moderne ; l’indice céphalique est estimé à 78 ou 79, ce qui signifie que le crâne était proportionnellement bas et large, presque brachycéphale ; il ne présentait apparemment aucune crête proéminente ou épaissie au-dessus des orbites, caractéristique qui distingue immédiatement ce crâne de celui des Néandertaliens ; les différents os de la boîte crânienne sont typiquement humains et ne ressemblent en rien à ceux des singes anthropoïdes ; la capacité cérébrale a été initialement estimée à 1070 cm³, ce qui n’égale pas celle de certains des types cérébraux les plus bas des races australiennes existantes et nettement [ p. 137 ] inférieure à celle de l’homme de Néandertal de Spy et de La Chapelle-aux-Saints ; les os nasaux sont typiquement humains mais relativement petits et larges, de sorte que le nez était aplati, ressemblant à celui de certaines des races malaises et africaines existantes.
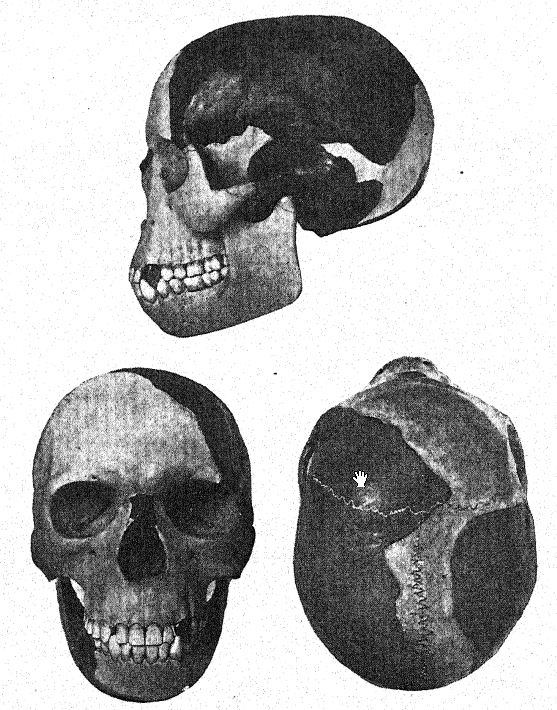
La mâchoire présente des caractères profondément différents ; l’ensemble de l’os préservé ressemble étroitement à celui d’un jeune chimpanzé ; ainsi, la pente du menton osseux tel que restauré se situe entre celle d’un singe adulte et celle de l’homme de Heidelberg, avec un menton extrêmement fuyant ; la partie ascendante de la mâchoire, où s’insèrent les muscles temporaux, est large et épaissie antérieurement. Deux molaires allongées étaient associées à la mâchoire, usées par l’usage à un tel point que l’individu ne pouvait pas avoir moins de trente ans et était probablement plus âgé. Ces dents sont relativement plus longues et plus étroites que celles de la mâchoire humaine moderne. La canine, identifiée par Smith Woodward, comme appartenant à la mâchoire inférieure, renforcée par la preuve fournie par la mâchoire elle-même, prouve que le visage était allongé ou prognathe et que les canines étaient très proéminentes comme celles des singes anthropoïdes ; elle fournit une preuve définitive que les dents de devant de l’homme de Piltdown ressemblaient à celles du singe.
L’auteur conclut que, si le crâne est essentiellement humain, il se rapproche de celui des races humaines inférieures par certains caractères du cerveau, l’insertion des muscles du cou, l’étendue des muscles temporaux attachés à la mâchoire et la taille probablement imposante du visage. La mandibule, en revanche, ressemble exactement à celle du singe, sans aucun élément humain, à l’exception des molaires, qui même se rapprochent de la dentition des singes par leur forme allongée et leur cinquième cuspide intermédiaire postérieure bien développée. Ce type d’homme, caractérisé par son front lisse, ses bords supraorbitaires et sa mâchoire simiesque, représente un nouveau genre appelé Eoanthropus, ou « homme de l’aube », tandis que l’espèce a été nommée Dawsowi en l’honneur de son découvreur, Charles Dawson. Ce type d’homme très ancien se caractérise par un menton simiesque et la jonction des deux moitiés de la mâchoire, par une série de dents broyeuses parallèles, avec des molaires inférieures étroites, dont la taille ne diminue pas vers l’arrière, et par un front abrupt et un développement léger des arcades sourcilières. La mâchoire diffère manifestement de celle de l’homme de Heidelberg par sa finesse relative et son approfondissement relatif vers la symphyse.
La discussion de cet article très important de Smith Woodward et Dawson s’est centrée sur deux points. Premièrement, la mâchoire simiesque appartenait-elle réellement au crâne humain plutôt qu’à celui d’un singe anthropoïde qui se serait retrouvé dans la même strate ; et deuxièmement, l’estimation initiale extrêmement faible de la capacité cérébrale, soit 1 070 cm³, n’était-elle pas due à un ajustement ou une reconstruction incorrecte des différentes parties du crâne ?
Keith,19 le chef de file de la critique de la reconstruction de Woodward, soutenait que lorsque les deux côtés du crâne étaient correctement restaurés et rendus approximativement symétriques, la capacité cérébrale serait égale à 1 500 cm³ ; le moulage du cerveau du crâne, même tel que reconstruit à l’origine, s’est avéré proche de 1 200 cm³. Cet auteur a convenu que le crâne, la mâchoire et la canine appartenaient à l’Eoanthropus, mais qu’ils ne pouvaient pas appartenir au même individu.
Français La reconstruction de Woodward reçut le puissant soutien d’Elliot Smith.20 Il maintint que les preuves apportées par le réexamen des os corroboraient dans l’ensemble l’identification du plan médian du crâne par Smith Woodward ; de plus, que la reconstruction originale du visage prognathe était confirmée par la découverte de la canine, et qu’il ne subsistait aucun doute quant à la justesse de l’association du crâne, de la mâchoire et de la canine. La partie postérieure du crâne est nettement asymétrique, une condition que l’on retrouve aussi bien chez les races humaines inférieures que supérieures. Un léger réarrangement et un élargissement des os le long de la ligne médiane supérieure du crâne portent l’estimation de la capacité cérébrale à 1100 cm³ comme maximum probable.
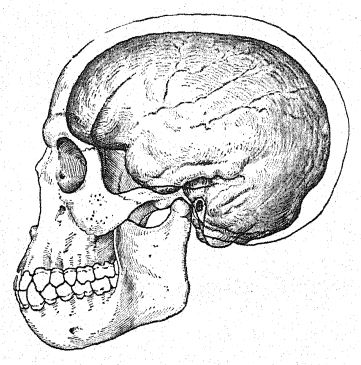
Elliot Smith a poursuivi en affirmant qu’il considérait le cerveau comme plus primitif que tout autre cerveau humain qu’il ait jamais observé, mais qu’il pouvait néanmoins être qualifié d’humain et qu’il présentait déjà un développement considérable des parties que, chez l’homme moderne, nous associons à la parole ; il ne faisait donc aucun doute sur l’importance unique de ce crâne, représentant un type entièrement nouveau d’« homme en devenir ». Concernant la forme de la mâchoire inférieure, on a observé qu’à l’aube de l’existence humaine, les dents adaptées aux armes d’attaque et de défense étaient conservées longtemps après que le cerveau ait atteint son statut humain. Ainsi, la forme simiesque du menton ne signifie pas une incapacité à parler, car la parole a dû apparaître alors que les mâchoires étaient encore simiesques. [ p. 140 ] et les changements osseux qui ont produit la récession de la ligne dentaire et la forme du menton étaient principalement dus à la sélection sexuelle, à la réduction de la taille des dents qui broyaient et, dans une moindre mesure, à la croissance et à la spécialisation des muscles de la mâchoire et de la langue utilisés dans la parole.
À première vue, la boîte crânienne ressemble à celle du crâne néandertalien découvert à Gibraltar, supposé être celui d’une femme ; elle est relativement longue, étroite et particulièrement plate, mais elle est plus petite et présente des caractéristiques plus primitives que celles de tout cerveau humain connu. Compte tenu de toutes ces caractéristiques, nous devons considérer ce cerveau comme le plus primitif et le plus simiesque jamais enregistré ; un cerveau que l’on pourrait raisonnablement associer à une mâchoire présentant des caractéristiques simiesques aussi distinctives. Le cerveau, cependant, est bien plus humain que la mâchoire, ce qui nous permet de déduire que l’évolution du cerveau a précédé celle de la mandibule, ainsi que le développement de la beauté du visage et le développement des caractéristiques corporelles humaines en général.
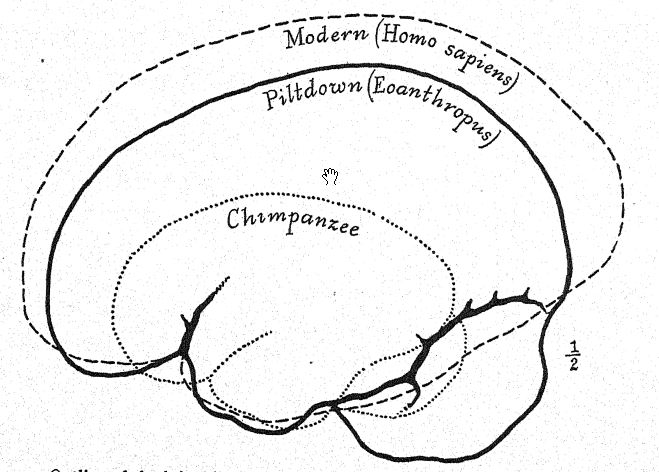
L’opinion la plus récente de Smith Woodward[8] est que le cerveau, bien que le plus primitif qui ait été découvert, avait une masse de près de 1300 cm³, égalant celle des cerveaux humains plus petits d’aujourd’hui et surpassant celle des Australiens, qui dépasse rarement 1250 cm³.
Les vues originales de Smith Woodward et d’Elliot Smith concernant la parenté de la race de Piltdown avec les races de Heidelberg et de Néandertal sont également d’un grand intérêt et peuvent être citées. Premièrement, le fait que les races de Piltdown et de Heidelberg soient presque du même âge géologique prouve qu’à la fin du Pliocène, les représentants de l’homme en Europe occidentale s’étaient déjà divisés en groupes très divergents : l’un (Heidelberg-Néandertal) caractérisé par un front très bas et saillant, avec une tête sous-humaine de contour néandertalien ; l’autre avec un front aplati et une mâchoire simiesque de contour de Piltdown. Il ne faut pas oublier que, dans le crâne de Piltdown, l’absence de crêtes proéminentes au-dessus des yeux pourrait être due dans une certaine mesure au fait que le crâne type pourrait appartenir à une femme, comme le suggèrent certains caractères de la mâchoire ; Français mais parmi tous les singes existants, le crâne au début de la vie a la forme arrondie du crâne de Piltdown, avec un front haut et « presque aucune arcade sourcilière ». Il semble donc raisonnable d’interpréter le crâne de Piltdown comme présentant une ressemblance plus étroite avec les crânes de nos ancêtres humains du milieu du Tertiaire que n’importe quel crâne fossile découvert jusqu’à présent. Si ce point de vue est accepté, nous pouvons supposer que le type de Piltdown s’est progressivement modifié en type néandertalien par une série de changements similaires à ceux subis par les premiers singes lors de leur évolution vers les singes modernes typiques, avec leurs sourcils bas et leurs arcades sourcilières proéminentes. Ceci [ p. 142 ] tendrait à soutenir la théorie selon laquelle les hommes de Néandertal étaient des ramifications dégénérées de la race tertiaire, dont le crâne de Piltdown fournit la première preuve découverte – une race avec un front simple et aplati et des arcades sourcilières développées.
Elliot Smith a conclu que les membres de la race de Piltdown pourraient bien avoir été les ancêtres directs de l’espèce humaine actuelle (Homo Sapiens), offrant ainsi un lien direct avec les singes tertiaires non découverts ; tandis que les hommes fossiles plus récents de type néandertalien, avec des arcades sourcilières proéminentes ressemblant à celles des singes actuels, pourraient avoir appartenu à une race dégénérée qui s’est éteinte plus tard. Selon ce point de vue, l’Eoanthropus représente un descendant persistant et très légèrement modifié du type d’homme tertiaire qui était l’ancêtre commun d’une branche donnant naissance à l’Homo sapiens, d’une part, et d’une autre branche donnant naissance à l’Homo neanderthalensis, d’autre part.

Une autre théorie sur les relations de l’Eoanthropus est celle de Marcelin Boule,21 qui est enclin à considérer les mâchoires des races de Piltdown et de Heidelberg comme d’âge géologique similaire, mais de type racial différent. Il poursuit : « Si le crâne et la mâchoire de Piltdown appartiennent au même individu, et si les mandibules des hommes de Heidelberg et de Piltdown sont du même type, cette découverte est très précieuse pour établir la structure crânienne de la race de Heidelberg. Mais il semble plutôt que nous ayons ici deux types d’hommes qui existaient à l’époque chelléenne, tous deux distingués par des caractères crâniens très bas. Parmi ceux-ci, la race de Piltdown nous semble [ p. 144 ] l’ancêtre probable dans la lignée directe de l’espèce humaine rétentrice, Homo sapiens ; tandis que la race de Heidelberg peut être considérée, jusqu’à ce que nous ayons de plus amples connaissances, comme un précurseur possible de Homo neanderthalensis. »
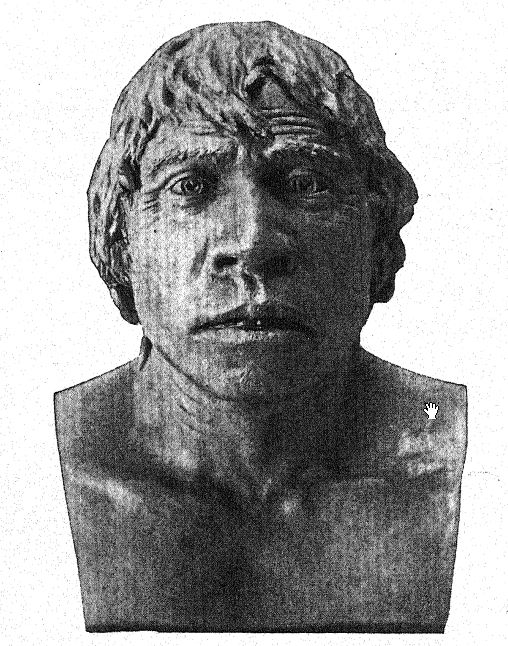
L’opinion la plus récente de l’anatomiste allemand Schwalbe22 est que la restauration correcte de la région du menton chez l’Homme de Piltdown pourrait permettre d’attribuer cette mâchoire à l’Homo sapiens, mais cela prouverait simplement que l’Homo sapiens existait déjà au début du Pléistocène. Le crâne de l’Homme de Piltdown, poursuit Schwalbe, correspond à celui d’un crâne bien développé et de bonne taille d’Homo sapiens ; la seule particularité réside dans l’épaisseur remarquable de l’os[9].
Enfin, nous pensons que la race de Piltdown n’est pas l’ancêtre des Heidelbergiens ni des Néandertaliens. Très récemment[10], la mâchoire de l’homme de Piltdown a été réétudiée et plusieurs experts l’ont comparée à celle d’un chimpanzé adulte. Cela laisse planer un doute quant à l’âge géologique exact et aux liens de parenté de l’homme de Piltdown (voir annexe, note IX), que nous continuons de considérer comme une branche secondaire de la famille humaine, comme le montre l’arbre généalogique de la page 491.
¶ La vie des mammifères des temps chelléens et acheuléens23
La vie mammalienne que nous retrouvons avec les outils les plus avancés de l’époque cheléenne n’inclut apparemment pas les anciens mammifères du Pliocène, tels que le rhinocéros étrusque et le tigre à dents de sabre. À cette exception près, elle est si semblable à celle du deuxième interglaciaire qu’elle pourrait servir à prouver une fois de plus que la troisième glaciation était un épisode local et non une influence climatique généralisée. Cette vie est partout la même, depuis le [ p. 145 ] [ p. 146 ] [ p. 147 ] vallée de la Tamise, comme en témoignent les graviers fluviaux bas de Gray’s Thurrock et d’Ilford, jusqu’à la région des forêts thuringiennes actuelles près de Weimar, où on la trouve dans les dépôts de Tauhach, Ehringsdorf et Achenheim, dans lesquels les mammifères appartiennent à la période plus récente de la culture acheuléenne ancienne. La vie de cette grande région pendant les périodes chelléenne et acheuléenne ancienne était un mélange de la faune caractéristique des forêts et des prairies de l’Europe occidentale avec les descendants des envahisseurs afro-asiatiques de la fin du Pliocène et du début du Pléistocène.
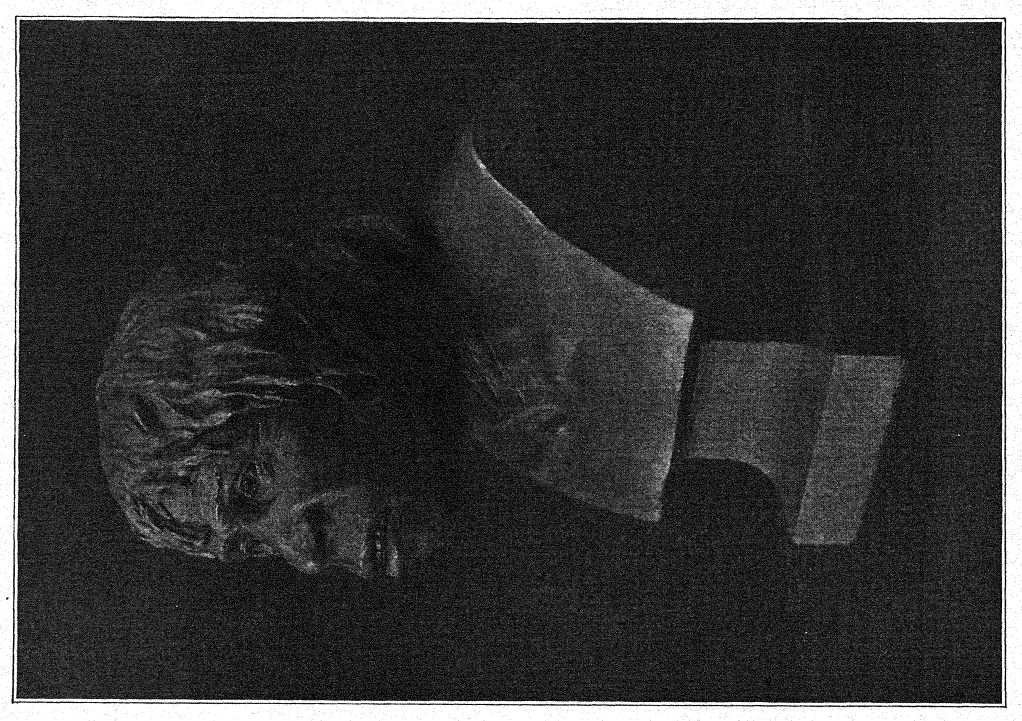
Les forêts étaient peuplées de cerfs élaphes (Cervus elaphus), de chevreuils (Cervus capreolus) et de cerfs géants (Megaceros), ainsi que d’une espèce primitive de sanglier (Sus scrofa ferus) et de chevaux sauvages représentant probablement plusieurs variétés. L’ours brun (Ursus arctos) d’Europe est maintenant identifié pour la première fois ; il existait également une espèce primitive de loup (Canis suessi).
Les petits carnivores des forêts et des cours d’eau sont tous considérés comme étroitement apparentés aux espèces existantes, à savoir le blaireau (Meles taxus), la martre (Mustela martes), la loutre (Lutra vulgaris) et le campagnol amphibie (Arvicola amphihius). Le castor préhistorique d’Europe (Castor fiber) remplace désormais le castor géant (Trogontherium) du Second Interglaciaire.
- Mammouth du Sud.
- Hippopotame.
- Éléphant aux défenses droites.
- Rhinocéros à nez large.
- Hyène tachetée.
- Lion.
- Bison et bœuf sauvage.
- Cerf rouge.
- Chevreuil.
- Cerf géant.
- Ours brun.
- Loup.
- Blaireau.
- Martre.
- Loutre.
- Castor.
- Hamster.
- Campagnol aquatique.
Parmi les grands carnivores, le lion (Felis leo antiqua) et l’hysne tachetée (H. crocuta) ont remplacé le tigre à dents de sabre et l’hyène rayée du début du Pléistocène. Quatre grands mammifères asiatiques, dont deux espèces d’éléphants, une espèce de rhinocéros et l’hippopotame, parcouraient les forêts et les prairies de cette région tempérée chaude. Le cheval de cette période est considéré comme appartenant au type forestier ou nordique, dont descendent nos chevaux de trait modernes. Les lions et les hysènes qui abondaient à l’époque chelléenne et à l’époque acheuléenne ancienne sont en partie les ancêtres des types de grottes qui apparaissent à la période du renne ou de la caverne qui suit. En général, cette vie mammalienne des temps chelléens et acheuléens primitifs en Europe fréquentait les rives des fleuves et les forêts et prairies avoisinantes favorisées par un climat tempéré chaud aux hivers doux, comme l’indique la présence du figuier et du laurier des Canaries dans la région du centre-nord de la France près de Paris.
Sans aucun doute, les chasseurs chelléens et acheuléens avaient commencé la chasse au bison, ou bison d’Amérique (B. priscus), et au bétail sauvage, ou aurochs.[11]
Cette vie mammalienne tempérée chaude s’est largement répandue dans toute l’Europe du Nord, comme le montre notamment la répartition (Fig. 44) de l’hippopotame, de l’éléphant à défenses droites et du rhinocéros de Merck. Ces derniers étaient des compagnons constants et semblent avoir une aire de répartition très similaire et un peu plus septentrionale que l’hippopotame, qui est plutôt le compagnon climatique du mammouth du Sud et dont l’aire de répartition est plus méridionale. Ces animaux, présents dans les couches de gravier et de sable le long des pentes et des « terrasses » fluviales, ont mêlé leurs restes aux artefacts des tailleurs de silex. Par exemple, dans les « terrasses » de gravier de la Somme, on trouve les ossements de l’éléphant à défenses droites et du rhinocéros de Merck dans les mêmes couches de sable que les silex chelléens. Ainsi, les hommes de l’époque cheléenne ont peut-être bien poursuivi cet éléphant géant (E. antjquus) et ce rhinocéros (D. merckii) comme leurs successeurs tribaux dans la même vallée chassaient le mammouth laineux et le rhinocéros laineux.
¶ Distribution ou les implémentations chelléennes
Partout dans le monde, on trouve des traces d’un âge de pierre, ancien ou moderne, des outils primitifs en pierre et en silex analogues à ceux de la véritable période cheléenne d’Europe occidentale, mais pas vraiment identiques lorsqu’on les compare de très près. Ceux-ci représentent les premières tentatives de la main humaine, dirigée par l’esprit primitif, pour façonner des matériaux durs en formes adaptées aux besoins de la guerre, de la chasse et de la vie domestique. Il en résulte une série de parallèles de formes qui relèvent du principe évolutif de convergence. Ainsi, sur tous les continents sauf l’Australie — en Europe, en Asie et même en Amérique du Nord et du Sud — les races primitives ont traversé une étape industrielle similaire à la période cheléenne typique d’Europe occidentale. Nous devrions plutôt attribuer cela à une similitude dans l’invention humaine et dans les besoins humains qu’à la théorie selon laquelle l’industrie cheléenne serait née dans un centre particulier et aurait voyagé dans une vague s’élargissant lentement sur le monde entier.
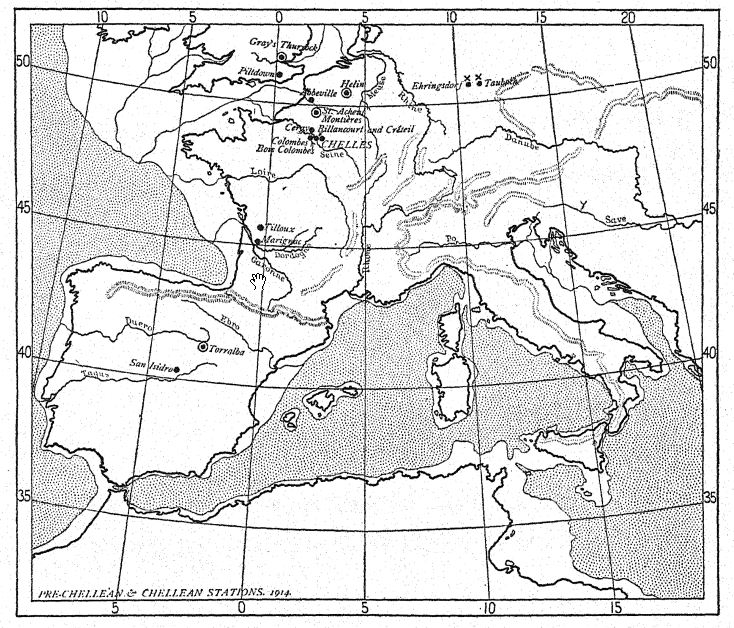
[ p. 150 ]
En Europe occidentale, la culture cheléenne a certainement connu un développement propre, adapté à une race de chasseurs audacieux vivant en plein air et dont l’industrie entière s’est développée autour des produits de la chasse. Pour eux, le silex et le quartzite ont remplacé le bronze, le fer ou l’acier. Cette culture a marqué une époque distincte et probablement très longue, au cours de laquelle les inventions et la multiplication des formes se sont progressivement propagées d’une tribu à l’autre, exactement comme les inventions modernes, généralement issues d’un point unique et souvent de l’esprit d’un individu ingénieux, se sont progressivement répandues à travers le monde.
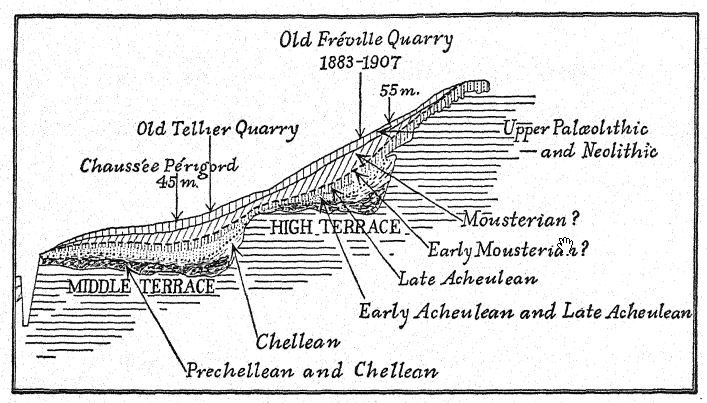
Les exemples les plus clairs de l’évolution des sept ou huit outils de la culture chelléenne à partir des cinq ou six types rudimentaires du Pré-chelléen ont été découverts à Saint-Acheul par Commont. L’abondance et la variété du silex de cette grande station de la Somme en ont fait un centre industriel depuis l’aube de l’Âge de la pierre ancienne jusqu’à sa fin. C’était probablement une région propice à toutes sortes de gibier, gros et petit. Les recherches de Commont montrent qu’à l’exception de Castillo, dans le nord de l’Espagne, aucune autre station d’Europe n’a été occupée aussi continuellement. [ p. 151 ] Du Pré-chelléen au Néolithique, les hommes de tous les stades culturels, à l’exception du Magdalénien et de l’Azilien-Tardenoisien, ont trouvé leur chemin ici, et le site de Saint-Acheul présente ainsi un résumé de toute l’industrie préhistorique. Même pendant les périodes climatiques les plus froides, cette région a continué d’être visitée, peut-être pendant les périodes chaudes des étés. À Montières, le long de la Somme, on trouve des gisements de culture moustérienne, généralement caractéristique de la période climatique froide, mais associée ici à une faune tempérée, notamment l’hippopotame, le rhinocéros de Merck et l’éléphant à défenses droites. De grands changements géographiques et climatiques ont eu lieu dans la vallée de la Somme au cours de cette longue période d’évolution humaine. Les ouvriers pré-chelléens ont d’abord établi leur industrie sur les « terrasses » moyennes et hautes, à l’époque où la Somme était visitée par l’éléphant à défenses droites et d’autres mammifères beaucoup plus primitifs de la faune asiatique chaude. Les premiers campements acheuléens sur ces mêmes terrasses étaient installés dans les graviers sous des couches de « loess », signe d’un changement climatique complet. La quatrième glaciation est passée, et le silex du Paléolithique supérieur [ p. 152 ] les ouvriers revinrent et laissèrent les débris de leur industrie dans les couches de terreau qui dévalaient les pentes de la vallée depuis les collines environnantes. Cette succession sera étudiée plus en détail en rapport avec l’industrie.
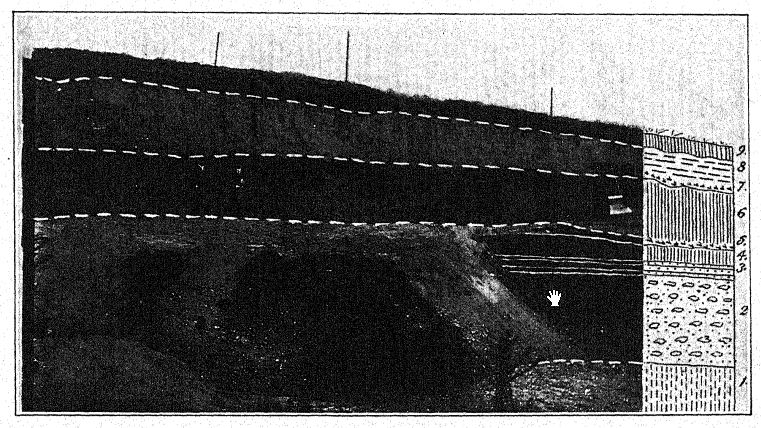
Contrairement aux quatre stations pré-chelléennes ou plus déjà connues, à savoir Saint-Acheul, Montières, Hélin, Gray’s Thurrock et peut-être Abbeville et Piltdown, il existe au moins seize stations en Europe occidentale qui sont typiquement chelléennes. Outre les sites mentionnés ci-dessus, qui présentent tous des dépôts d’outils chelléens typiques au-dessus du Pré-chelléen, on peut citer les importantes stations chelléennes de San Isidro et Torralba, en Espagne centrale ; Tilloux et Marignac, dans le sud-ouest de la France ; Créteil, Colombes, Bois-Colombes et Billancourt sur la Seine, à proximité immédiate de Paris ; Cergy sur l’Oise ; la station type de Chelles sur la Marne ; Abbeville, sur la rive nord de la Somme ; et la célèbre station de Kent’s Hole, dans le Devon, sur la côte sud-ouest de l’Angleterre. Jusqu’à présent, aucune station chelléenne typique n’a été découverte au Portugal, en Italie, en Allemagne ou en Autriche, ni d’ailleurs dans aucune partie de l’Europe centrale. Cela laisse l’habitat d’origine des tribus qui ont apporté la culture cheléenne en Europe occidentale encore un mystère ; mais, comme déjà observé, l’emplacement des stations favorise la théorie d’une migration à travers l’Afrique du Nord plutôt qu’à travers l’Europe de l’Est.
Français Comparés aux ouvriers du silex pré-chelléens, les artisans chelléens ont progressé à la fois par l’amélioration des anciens types d’outils et par l’invention de nouveaux25. Comme l’a observé Obermaier, l’ouvrier du silex dépend encore de la forme fortuite des fragments de silex brisés qu’il n’a pas encore appris à façonner symétriquement. Dans la recherche expérimentale de la forme de silex la plus utile et pouvant être saisie par la main, le coup de poing chelléen très caractéristique a été développé à partir de son prototype pré-chelléen. Cet outil était fait d’un nodule allongé, soit de quartzite, soit, de préférence, de silex, et taillé au marteau des deux côtés en une forme plus ou moins en amande ; en règle générale, la pointe et ses bords adjacents sont affûtés ; le [ p. 153 ] [ p. 154 ] l’autre extrémité étant arrondie et émoussée. Comme la plupart, sinon la totalité, des instruments chelléens, il était conçu pour être saisi à main nue et n’était pas muni d’un manche ou d’une poignée en bois. Il n’est pas impossible que certaines des formes pointues aient été encastrées dans un manche en bois, mais rien ne le prouve. La taille du coup de poing varie de 4 à 8 pouces de longueur, et des exemples ont été trouvés jusqu’à 9,5 pouces. Qu’il ait servi à des fins diverses est indiqué par l’existence de quatre formes différentes et bien définies : premièrement, une forme primitive en amande ; deuxièmement, une forme ovaloïde ; troisièmement, une forme de disque ; et quatrièmement, une forme pointue ressemblant à une pointe de lance. De Mortilleff26 en parle comme du seul outil des tribus cheléennes, mais sous ses diverses formes, il servait à toutes les fins de hache, de scie, de ciseau et d’alène, et était en réalité un outil combiné. Capitan27 soutient également que le coup de poing n’est pas un outil unique mais est conçu pour répondre à de nombreux besoins variés. Les formes primitives en amande et ovaloïdes étaient conçues pour être utilisées le long des bords, soit pour le hachage lourd, soit pour le sciage ; les formes discoïdes ont pu être utilisées comme haches ou comme pierres de fronde ; les formes plus arrondies servaient de couteaux et de grattoirs ; tandis que les formes pointues en forme de lance pouvaient être utilisées comme poignards, à la guerre comme à la chasse.
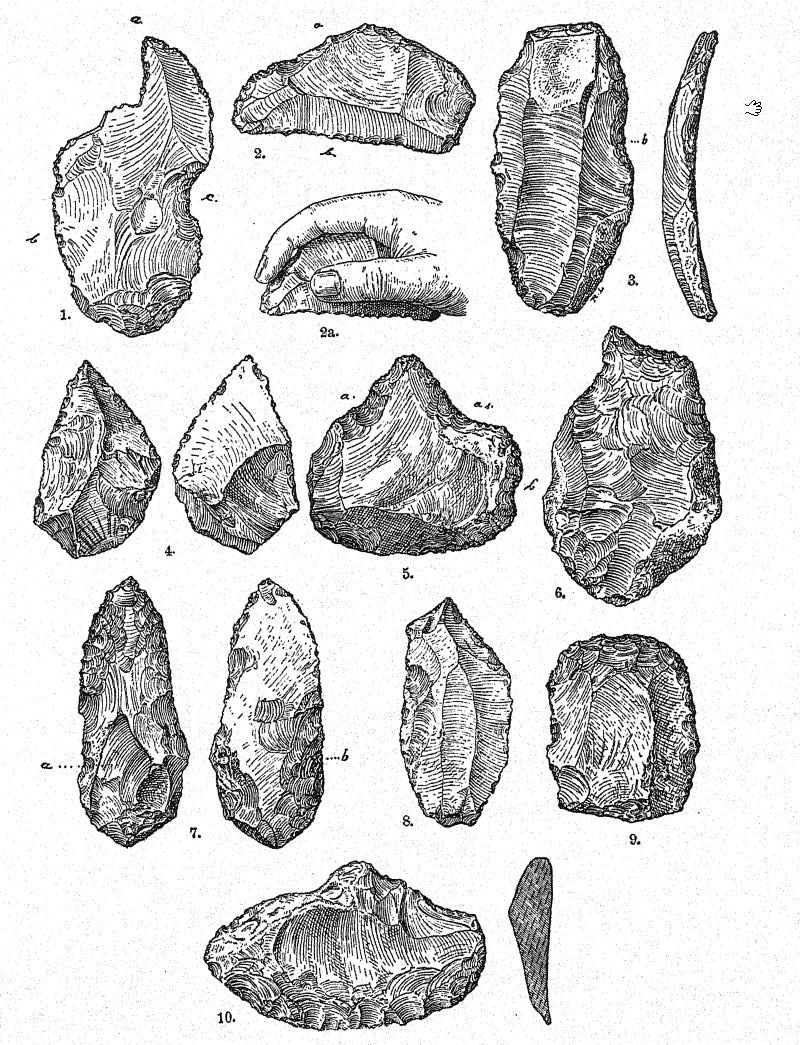
Les silexiers chelléens ont également développé un certain nombre de petites formes pointues à partir de fragments de silex façonnés accidentellement, présentant des pointes courtes et longues soigneusement taillées et ébréchées. Ainsi, à partir des petits types pré-chelléens, une grande variété d’outils adaptés aux usages domestiques, militaires et de chasse a évolué.
¶ Géographie chelléenne en Angleterre et en France
La station de la culture cheléenne se situe quelque peu à l’est de la ville actuelle de CheUes. À l’époque cheléenne, les larges crues de l’ancienne Marne transportaient ici de grandes quantités de sable et de débris, produits des premières périodes pluviales du troisième interglaciaire ; et ici, sur la rive droite, enfouis dans des sables et des graviers de 7,3 mètres d’épaisseur, se trouvent les outils chelléens typiques, mêlés à des restes d’hippopotames, d’éléphants à défenses droites, de rhinocéros de Merck, de castors géants, d’hyènes et de nombreux membres de la faune des forêts et des prairies asiatiques.
Les ateliers de silex de Saint-Acheul se trouvaient sur des falaises situées entre 12 et 24 mètres au-dessus du niveau actuel de la Somme. L’industrie chelléenne, puis acheuléenne, y était pratiquée à grande échelle. En une seule année, Rigollot a récolté jusqu’à 800 coups de poing dans les anciennes carrières ; à proximité se trouvent d’autres carrières tout aussi riches en matériaux, et l’on peut imaginer que les produits de l’industrie du silex de cette localité favorable étaient exportés au loin dans d’autres régions du pays.
Aux environs de Paris, puis à Arcy, dans la vallée de la Bièvre, les chercheurs de silex chelléens, acheuléens et moustériens ont successivement recherché les anciens graviers fluviaux des niveaux inférieurs ; ces « basses terrasses » ne dépassent que de 4,5 mètres le niveau actuel du fleuve et sont encore parfois inondées par les hautes eaux de la Seine, ce qui indique que les rives de la Seine n’ont pas altéré leur niveau. La faune y était identique à celle de la Somme et de la Tamise, et comprenait l’hippopotame, le rhinocéros de Merck et l’éléphant à défenses droites.
Il semble donc que, pour ce qui est des cours d’eau et des collines qu’ils traversent, la topographie et le paysage du nord de la France et du sud de la Bretagne soient partout les mêmes qu’aujourd’hui. Les forêts qui couvraient les collines n’étaient pas très différentes d’aujourd’hui, à l’exception de quelques arbres d’un climat plus chaud, et la plupart des animaux qui erraient dans les forêts et les prairies ne présentaient rien d’étrange ou d’inconnu. Les trois principaux éléments archaïques résidaient dans la présence de deux races humaines très anciennes et de leur stade de culture rudimentaire, dans les grandes formes de vie asiatiques et africaines qui se mêlaient aux types indigènes plus familiers, et dans les vastes étendues de terre continues qui s’étendaient sans interruption vers l’ouest et le sud-ouest.
Car à cette époque, l’Europe, bien que n’étant guère plus qu’une grande péninsule, s’étendait bien au-delà de ses limites actuelles. L’Angleterre et l’Irlande faisaient encore partie du continent, et de grands fleuves [ p. 156 ] coulaient dans les larges vallées qui constituent aujourd’hui la mer d’Irlande, la mer du Nord et la Manche – des fleuves qui comptaient la Seine, la Tamise, la Garonne et même le Rhin comme de simples affluents. Le détroit de Gibraltar était alors l’isthme de Gibraltar – un étroit pont terrestre reliant l’Europe à l’Afrique. La Méditerranée était alors un lac intérieur, ou plutôt deux lacs intérieurs, car l’Italie et la Sicile s’étendaient en une large masse irrégulière pour rejoindre la côte nord de l’Afrique, tandis que la Corse et la Sardaigne formaient une longue péninsule s’étendant du continent italien et atteignant presque, sinon tout à fait, la côte africaine.
¶ La vallée de la Tamise à l’époque chelléenne
L’interprétation des caractéristiques de la stratification dans la vallée de la Somme est particulièrement intéressante car elle nous donne une clé pour comprendre une séquence similaire d’événements préhistoriques dans la vallée de la Tamise.
La station de Gray’s Thurrock, dans cette vallée, est à peine distante de 190 kilomètres de la station cheléenne d’Abbeville, dans la vallée de la Somme. Il est évident que les anciens tailleurs de silex parcouraient librement le vaste territoire qui les séparait, échangeant idées et inventions. Ainsi, des outils chelléens identiques, voire étroitement apparentés, aux types de la vallée de la Somme furent façonnés dans tout le sud de la Grande-Bretagne, de la Tamise à l’Ouse. L’ancienne Tamise (Lyell28 Geikie29) coulait alors sur un lit d’argiles à blocs déposé lors des glaciations précédentes. Son cours large et rapide charriait d’importants dépôts de graviers ocres et de sables interstratifiés de limons et d’argiles. Ce sont ces anciens graviers de rivière qui présentent leur plus grande épaisseur aux niveaux les plus bas de la Tamise et qui sont en grande partie constitués de matériaux bien stratifiés et nettement érodés par l’eau. À ces niveaux inférieurs, les tailleurs de silex cherchaient leurs matériaux, et y laissèrent derrière eux les outils chelléens archaïques que l’on retrouve aujourd’hui enfouis dans ces graviers fluviaux plus anciens, tout comme on les trouve dans les graviers charriés sur les trois terrasses de la Somme et de la Marne. Dans la Tamise, ce vieux ravin de gravier semble avoir été [ p. 157 ] en aval, tandis que sur les terrasses moyennes et supérieures de la Somme, le ravin de gravier descendait directement sur les flancs de la vallée, sauf peut-être lors de très fortes crues. Ces couches profondes de gravier, de sable et de limon se situent pour la plupart au-dessus de l’actuelle plaine de débordement de la Tamise, bien qu’à certains endroits elles descendent en dessous ; ce qui prouve que le paysage principal de la Tamise, hormis les changements de la flore et de la faune, était le même aux époques pré-chelléenne et chelléenne qu’aujourd’hui. Ainsi, la Somme, la Tamise et la Seine avaient toutes creusé leurs cours jusqu’à leur niveau actuel, voire à un niveau inférieur, lors de l’apparition des chasseurs pré-chelléens. Depuis l’époque chelléenne, ces trois fleuves ont ensablé leurs cours.
Les changements survenus depuis lors le long de la Tamise se situent dans les couches superficielles apportées des flancs de la vallée, qui ont adouci les contours des anciennes terrasses et ont également enseveli les phases ultérieures de la préhistoire de la vallée.
Des coupes réalisées sur la rive sud à Ilford, dans le Kent, et sur la rive nord à Gray’s Thurrock, dans l’Essex, confirment cette hypothèse. À cette dernière station, dans des couches basses de terre à briques, de limon et de gravier, telles que celles formées par l’envasement du fond d’un ancien lit de rivière, se trouvent les restes de l’éléphant à défenses droites, du rhinocéros à nez large et de l’hippopotame. Toutes les découvertes de ces dernières années conduisent à la conclusion que les anciens graviers fluviatiles contenant ces anciens mammifères et silex se limitent aux niveaux inférieurs de la vallée de la Tamise, tandis que les graviers et limons des niveaux supérieurs sont plus récents. D’anciens silex chelléens sont également présents occasionnellement sur les niveaux supérieurs, mais il semblerait qu’ils aient été entraînés par les eaux des anciennes surfaces terrestres supérieures, car ils sont mêlés à des silex de l’industrie de l’Acheuléen supérieur et du Moustérien inférieur.
¶ L’Angleterre au début du Paléolithique
C’est sur les niveaux supérieurs de la Tamise, comme de la Somme, et dans les dépôts superficiels recouvrant les flancs de la vallée que l’on lit l’histoire des cultures paléolithiques ultérieures et d’un climat tempéré chaud primitif suivi d’un climat froid [ p. 158 ] avec sous-sol gelé appartenant à la quatrième glaciation et à l’industrie du silex moustérienne contemporaine. L’histoire paléolithique de la Tamise30 n’a pas encore été complètement interprétée, mais il semblerait que les vestiges des anciennes stations du Kent et du Norfolk livreront toutes les formes d’outils chelléens et acheuléens, et probablement aussi ceux du Moustérien qui ont été découverts dans la vallée de la Somme, prouvant ainsi que les races du Paléolithique inférieur de cette région ont suivi le même développement culturel que les tribus voisines de France et de Belgique, ainsi que celles d’Espagne, jusqu’à la fin de l’Acheuléen moyen.
Une séquence d’événements similaire semble se produire à Hoxne, dans le Suffolk, où des paléolithes archaïques furent découverts dès 1797. Cette découverte fut négligée pendant plus de soixante ans, jusqu’à ce qu’en 1859, ces silex soient réexaminés par Prestwich et Evans après leur visite aux stations de la Somme (Geikie, Avebury). Ce site se trouvait dans le creux d’une surface d’argile à blocs, recouverte par le dépôt d’un ruisseau d’eau douce ; dans le lit de son étroit chenal, outre des outils en silex de type acheuléen ancien, d’abondants restes végétaux ont été découverts qui nous offrent une vision intéressante de la flore de l’époque.
Ces plantes sont nettement caractéristiques d’un climat tempéré, comprenant des arbres tels que le chêne, l’if et le sapin, et principalement des espèces que l’on trouve encore dans les forêts de la même région. Cette vie a fait place, comme l’indiquent les dépôts végétaux d’un niveau plus élevé, à une flore arctique, correspondant probablement au climat de toundra du Moustérien, période de la quatrième glaciation. Au-dessus de celles-ci se trouvent à nouveau des couches de plantes et de mollusques qui indiquent le retour d’un climat tempéré.
¶ Diffusion de l’industrie acheuléenne
Il est remarquable qu’aucune station fluviatile, pré-chelléenne ou chelléenne, n’ait été découverte en Allemagne ou en Suisse, ni même dans toute l’Europe centrale, dans la région située entre les glaciers alpins et scandinaves. Soit cette région était défavorable à l’habitat humain, soit les vestiges de ces stations ont été ensevelis ou emportés par les eaux.
Il est significatif que la première preuve de migration humaine dans cette région, que ce soit de l’est ou de l’ouest, nous ne le savons pas avec certitude, coïncide avec le climat sec de l’époque acheuléenne. Les conditions de « lœss » du climat semblent coïncider avec les premières stations acheuléennes en Allemagne, comme Sablon. Le dépôt de « lœss » n’est en aucun cas la preuve d’un climat froid, mais plutôt d’un climat aride, en particulier dans les régions où les zones de sol finement érodé étaient susceptibles d’être soulevées par le vent ; de telles zones ont été trouvées sur toute la région récemment glaciaire au nord des Alpes et au sud de la péninsule scandinave.
Les sites de découverte paléolithique d’Allemagne sont principalement regroupés dans trois régions33 comme suit :
Au sud, le long des sources du Rhin et du Danube, parmi les roches uméennes de Souabe et du Jura, se sont formées les cavernes recherchées par l’homme moustérien primitif. À l’ouest de celles-ci se trouvaient de nombreuses stations plus anciennes dans les dépôts de lœss du Rhin supérieur, entre les crêtes des Vosges et de la Forêt-Noire. Plus près encore des sources du Rhin, s’étendant au-delà de la frontière suisse, se trouvent plusieurs sites de grottes célèbres dans les vallées creusées par le Rhin et ses affluents dans le calcaire blanc du Jurassique. À l’ouest se trouve le groupe du Rhin moyen et de Westphalie, qui comprend les camps acheuléens ouverts dans les dépôts de lœss en amont du fleuve et plusieurs stations de grottes. Au nord se trouve le groupe dispersé de stations, tant acheuléennes que moustériennes, de l’Allemagne du Nord. Ici, les sites sont rares et dispersés. Les camps de campagne furent principalement établis dans la vallée de l’Ilm et près des grottes du Harz, dans les environs de Gera. Aucune découverte de date certaine ou d’authenticité incontestable n’a été signalée dans l’est de la Gerwawy.
Le long du Rhin supérieur, les silexiers de l’Acheuléen établissaient leurs anciens campements, la plupart du temps à ciel ouvert, sur les larges nappes de « lœss inférieur », qui, constamment emportées par le vent, recouvraient et préservaient les stations. Ces stations sont [ p. 160 ] [ p. 161 ] largement dispersées, mais fréquentées dès les premiers temps de l’Acheuléen, et la région fut revisitée jusqu’à la fin du Paléolithique supérieur.
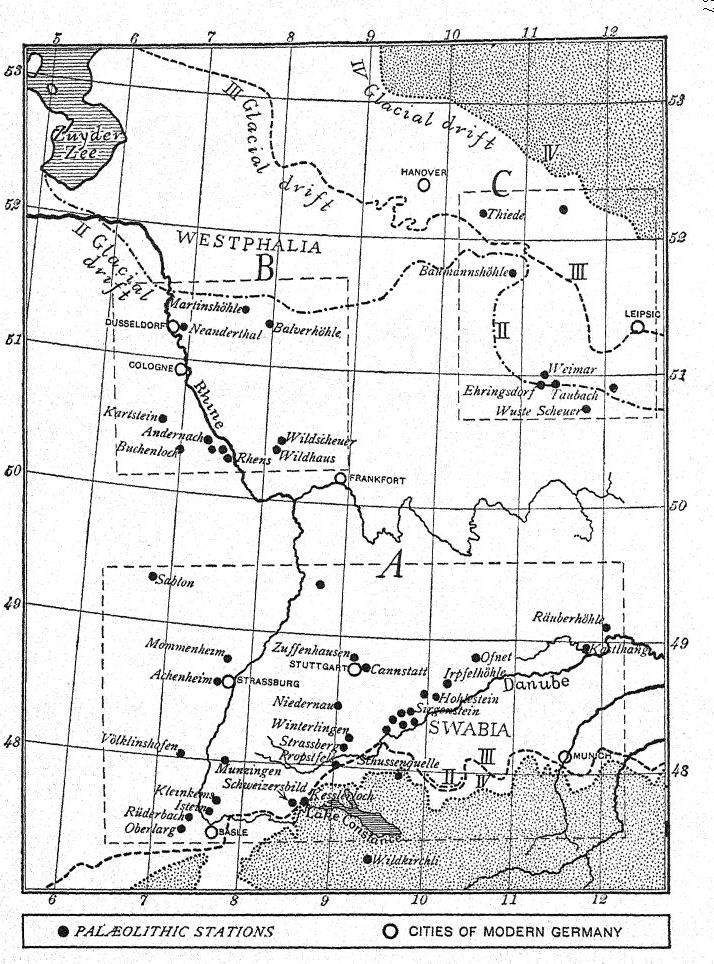
Dès le début de l’Acheuléen, l’importante station de lœss d’Achenheim fut établie. Ce site, très célèbre, revêt une importance particulière car il est le seul en Allemagne à avoir été fréquenté sans interruption de la fin de l’Acheuléen jusqu’au début du Paléolithique supérieur, tout au long du Paléolithique inférieur. Le lœss ancien du troisième interglaciaire y a fourni une industrie acheuléenne typique.
Jusqu’à présent, la région du Rhin moyen et de Westphalie n’a révélé aucun signe de culture acheuléenne. Les stations d’Allemagne du Nord, en revanche, ont été exploitées à l’Acheuléen, et les principales stations ouvertes de cette région se situent le long de la vallée de l’Ilm. Ici, à Taubach, Ehringsdorf et Weimar, on trouve des outils de forme typiquement acheuléenne appartenant à l’Acheuléen tempéré chaud précoce. Les stations de la vallée de l’Ilm, au sud-ouest de Leipzig, sont également d’une grande importance en raison des riches témoignages qu’elles contiennent sur la faune tempérée chaude de l’Acheuléen précoce ; la culture du silex est typiquement acheuléenne, et les conditions climatiques se lisent à la fois dans les travertins et dans les dépôts ultérieurs du « loess inférieur », qui appartiennent à la période froide et sèche de l’Acheuléen récent. C’est ici que se sont attardés l’éléphant à défenses droites et le rhinocéros de Merck, contemporains des ouvriers travaillant les silex acheuléens.
On observera qu’en Germanie, l’Acheuléen ancien fut une période chaude, parfois aride et sujette à de fortes tempêtes de poussière. À cette époque, les camps se trouvaient pour la plupart en rase campagne. À la fin de la période, également aride et soumise à des vents violents, mais avec un climat plus frais, les silexiers continuèrent à fréquenter les stations acheuléennes ouvertes du lœss. S’il existait des abris et des cavernes dans cette région, ils n’ont pas encore été découverts. Cela semble indiquer que le climat n’était pas encore devenu rigoureux.
On trouve un témoignage similaire dans la grande rareté des grottes et des abris à l’époque acheuléenne dans toute l’Europe occidentale ; [ p. 162 ] cependant, les tribus se réfugiaient parfois à proximité de falaises abritées, comme le long de la Vézère. Dans quelques localités dispersées, elles recherchaient les grottes, comme à Krapina, en Croatie, à Spy, sur la Meuse en Belgique, et à Castillo, dans le nord de l’Espagne. Ces rares exceptions aux camps ouverts tendraient à prouver que les grottes étaient plutôt recherchées pour se protéger des ennemis et comme abris contre la pluie que comme refuges contre un climat glacial.
Dans la vallée de la Beune, petit affluent de la Vézère, en Dordogne, on trouve une véritable station acheuléenne, tout près des rives du fleuve. Ceci prouve qu’à l’époque acheuléenne, cette vallée était déjà aussi creusée qu’aujourd’hui. Dans la vallée de la Somme, la culture acheuléenne s’étend de la « plus haute terrasse » jusqu’en dessous du niveau actuel du fleuve, qui s’est créé un nouveau lit majeur. La présence de deux stations acheuléennes sur la haute Garonne, bien au-dessus du niveau actuel, importe peu, car à cette époque, le niveau de l’eau était également élevé.
En général, les ouvriers acheuléens du silex préféraient les stations ouvertes tout au long de la période acheuléenne, et leurs camps se trouvent sur les plateaux ouverts entre les rivières ou sur les différents niveaux de « terrasses », comme sur les « terrasses » supérieures, moyennes et inférieures de la Somme à Saint-Acheul, ou encore à proximité des bords des rivières et des ruisseaux, comme dans la région de la Dordogne.
Dès l’Acheuléen ancien, un climat sec avait commencé à régner dans certaines régions d’Allemagne. Près de Metz se trouve la station de loess « ancien » de Sablon, occupée au début de l’Acheuléen, ce qui témoigne d’une période chaude et aride propice au transport du loess transporté par le vent ; cette fine poussière emplissait sans doute parfois toute l’atmosphère et obscurcissait le soleil, comme c’est le cas aujourd’hui dans les hautes steppes et les déserts d’Asie orientale.
Français Une exception à la vie en pleine campagne préférée par les ouvriers du silex acheuléens se trouve dans la grande grotte[12] de Castillo, près de Puente Viesgo, dans la province de Santander, au nord de l’Espagne. [ p. 163 ] Les dépôts qui remplissaient cette grotte sur une épaisseur de 45 pieds du sol au toit ont été explorés par Obermaier, qui les a trouvés divisés en treize couches, couvrant onze périodes d’industrie et présentant le plus merveilleux résumé de la préhistoire de l’Europe occidentale depuis l’époque acheuléenne jusqu’à l’âge du bronze, en Espagne (Fig. 79).
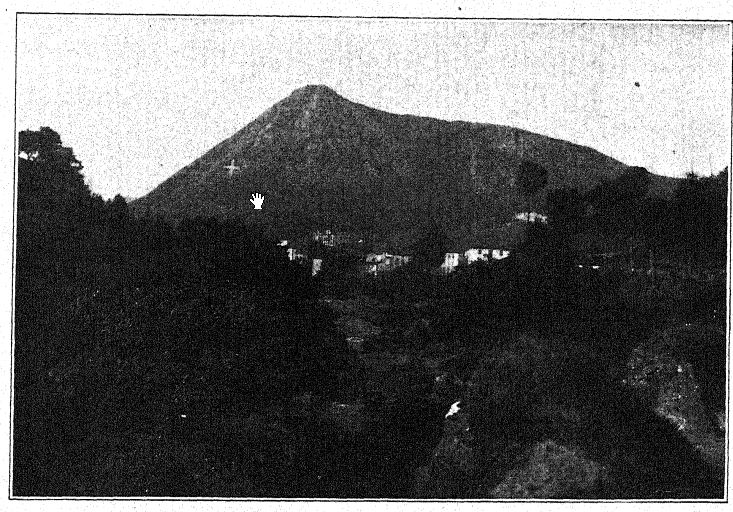
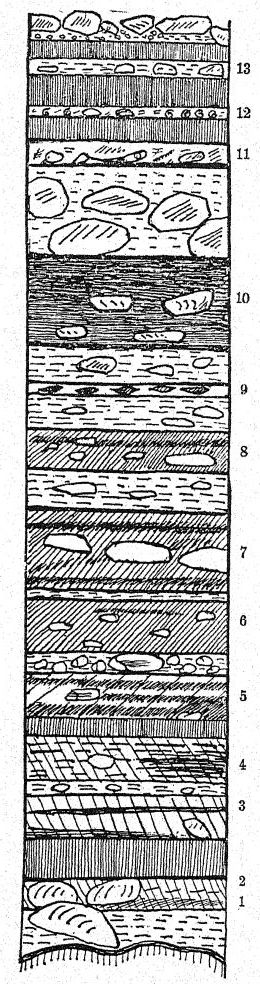
Dès 1908, Breuil34 découvrit à l’intérieur de la caverne, au fond de la grotte, des quartzites taillés en types acheuléens, prouvant que la caverne était fréquentée à l’époque acheuléenne. Obermaier35, au cours de trois années de travail, a découvert que le sol de la grotte avait peut-être servi de station de fabrication de silex à l’époque acheuléenne et, peut-être, à l’époque chelléenne. La section culturelle qu’il a révélée ici sous la direction de l’Institut de Paléontologie humaine ne peut être comparée qu’à celle que Commont a trouvée sur les « terrasses » de la Somme à Saint-Acheul. La différence est qu’à l’abri de la grotte du Castillo [ p. 164 ], le climat n’est enregistré qu’à travers les formes changeantes de la vie animale qui se mêlent autour des foyers et aux silex des niveaux ascendants.
(13) Âge énéolithique. Petit poignard triangulaire en cuivre.
(12) Azilien. Industrie du silex — L’âge du cerf.
(11) Magdalénien supérieur. Gravures artistiques sur bois de cerf.
(10) Magdalénien inférieur. Silex et fines gravures sur os. Bâton de renne.
(9) Solutréen archaïque. Feuilles de laurier, retouchées sur une seule face.
(8, 7, 6) Aurignacien supérieur en trois couches. Restes du renne et des burins.
(5) Aurignacien inférieur. Instruments en pierre et en os. Restes d’un nourrisson.
(4) Moustérien supérieur. Riche en petits et grands outils en quartzite. Le rhinocéros de Merck est très abondant.
(3) Silex et quartzites typiques du Moustérien. Rhinocéros de Merck.
(2) Industrie du Moustérien ancien. Os d’ours des cavernes et de rhinocéros de Merck.
(i) Silex acheuléens.
L’entrée de cette grotte se trouve sur le flanc d’une haute colline dominant la vallée et aurait facilement pu être barricadée contre toute attaque. Au début de l’Acheuléen, lorsque les tailleurs de silex travaillaient au fond de la grotte, l’entrée inférieure de la caverne était encore ouverte, menant loin au cœur de la montagne. Les accumulations successives de débris, de terre glaise, de pierres à feu, d’ossements et d’innombrables silex, ainsi que d’énormes blocs s’écroulant sur l’entrée de la caverne, ont atteint une hauteur de 14,7 mètres, de sorte qu’au Paléolithique supérieur, seule l’entrée supérieure de la caverne était utilisée par les artistes du Magdalénien [ p. 165 ]. Les cultures aziliennes et énéolithiques ultérieures se sont regroupées sous le toit même de la grotte, sur les côtés.
Cette station, réparée puis abandonnée par tribu après tribu sur une période estimée aujourd’hui à pas moins de 50 000 ans, est un volume monumental de préhistoire, lu et interprété par l’archéologue presque aussi clairement que si l’ensemble des archives était écrit.
Les premières preuves positives de l’utilisation du feu sont les couches de bois carbonisé et d’os fréquemment retrouvées dans les gisements industriels du début de l’Acheuléen.
¶ Changements géographiques et climatiques
Durant les premiers temps du développement de l’industrie acheuléenne, la géographie, le climat, la faune et la flore continuèrent à présenter exactement le même aspect qu’à l’époque cheléenne. Les mammifères que l’on trouve en Thuringe dans les travertins inférieurs de la vallée de l’Ilm, à Taubach, près de Weimar, et à Ehringsdorf, mêlés aux silex de l’industrie acheuléenne ancienne, appartiennent à la même espèce que ceux trouvés dans la vallée de la Somme, mêlés aux outils de l’industrie cheléenne. Le mammouth du sud est présent à Taubach, et l’on trouve l’éléphant à défenses droites (E. antiquus), le rhinocéros de Merck, l’hippopotame, le lion et l’hysène représentant les anciens migrants afro-asiatiques, tandis que la vie nord-européenne et asiatique est représentée par le cerf géant, le chevreuil, la chèvre sauvage, l’ours brun, le loup, le blaireau, la martre, la loutre, le castor, le hamster des prés et la musaraigne. Dans les prairies paissaient des aurochs (bœufs sauvages) et des bisons (bisons d’Amérique). Il y avait une variété de chevaux, probablement de type forestier. Ainsi, la faune compte six types asiatiques, ou huit si l’on inclut les bisons et les bovins sauvages. La faune forestière compte neuf espèces, dont le sanglier (Sus scrofa ferns), non mentionné.
Français Les couches de travertin sont révélatrices de changements géographiques très importants qui se sont produits en Europe centrale et méridionale au milieu du troisième interglaciaire. Les [ p. 166 ] travertins de l’Ilm et d’autres parties de l’Allemagne centrale étaient dus à des perturbations et éruptions volcaniques de grande ampleur, accompagnées du dépôt de travertins, de gypses et de tufs. À cette perturbation volcanique dans le centre de la France est attribué le dépôt du tuf de La Celle-sous-Moret, près de Paris, qui témoigne du climat tempéré chaud de l’Acheuléen ancien, ainsi que du climat légèrement plus frais qui lui a succédé à l’Acheuléen tardif. Ce soulèvement au centre de l’Allemagne et de la France a apparemment laissé la région entre la France et la Grande-Bretagne intacte, car il existe des preuves d’une libre migration continue des tribus et des cultures achéidées ; Français mais il semble y avoir eu un affaissement généralisé des côtes du sud de l’Europe par lequel les îles de la Méditerranée se sont isolées du continent, et les routes migratoires entre l’Europe et l’Afrique à travers la région centrale de la Méditerranée ont été coupées. Ainsi, l’Italie, la Sicile et la Sardaigne ont été séparées du continent après avoir reçu un important contingent de mammifères des continents du nord et du sud. Bien que des descendants des mammifères africains et asiatiques, ainsi que des types de forêts et de prairies d’Europe du Nord, survivent sur ces îles, il n’y a, jusqu’à présent, aucune indication qu’elles aient été envahies par des chasseurs portant les outils de la culture acheuléenne, bien que ces travailleurs du silex acheuléens se soient répandus dans toutes les parties de la péninsule italienne (Fig. 80), comme l’indique la découverte de neuf stations.
¶ Distribution des stations acheuléennes
Les stations acheuléennes sont largement réparties le long de la Seine, de la Marne et de la Somme, dans le nord de la France, où le silex est abondant et bien adapté à l’artisanat de précision. Dans le centre et le sud de la France, où les grands silex sont rares, les tribus acheuléennes ont été contraintes d’utiliser du quartz, qui se façonne en formes plus grossières. Au nord, les ouvriers acheuléens ont continué à exploiter les anciens sites chelléens de Chelles, Saint-Acheul, Abbeville et Hélin. À la fin de l’Acheuléen furent établies les nouvelles stations de [ p. 167 ] Wolvercote sur la Tamise, près d’Oxford, et de Levallois sur la Seine, près de Paris, toutes deux célèbres pour leurs couteaux ou lames en silex « Levallois ». Près de Levallois se trouve la station acheuléenne tardive de Villejuif, au sud de Paris, où les silex sont enfouis dans des galeries de loess. En Normandie, les importantes stations de Frileuse, Bléville et La Mare-aux-Clercs illustrent l’ensemble du développement acheuléen, ancien et récent. Dans une petite vallée tributaire de la Vézère, en Dordogne, s’est établie à la fin de l’Acheuléen la station de La Micoque, qui donne son nom à plusieurs silex miniatures de forme particulière, découverts pour la première fois à cet endroit et connus sous le nom de « type de La Micoque ». D’autres stations, comme Combe-Capelle, présentent également des exemples de ce travail acheuléen « miniature ».
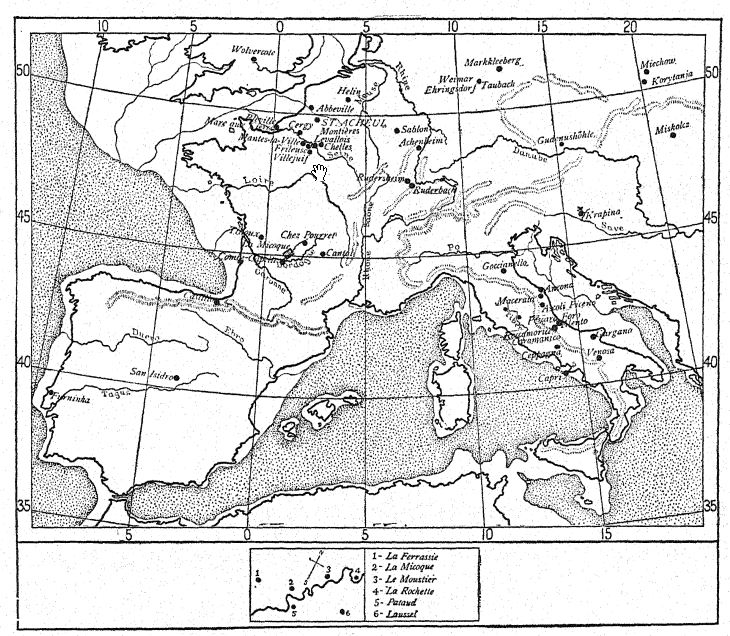
Français Au total, plus de trente stations acheuléennes ont été découvertes en France, deux — Castillo et San Isidro — dans le nord et le centre de l’Espagne, la seule station de Furninha au Portugal, plus de huit en Allemagne, trois en Autriche et trois en Pologne russe. La large répartition de cette culture dans toute l’Italie est particulièrement remarquable, où des explorations loin d’être exhaustives ont abouti à la découverte d’au moins neuf ou dix stations très prolifiques s’étendant de Goccianello au nord à Capri au sud, mais pas en Sicile pour autant que l’on sache actuellement. Ainsi, toute l’Europe occidentale, à l’exception de la zone couverte par les champs de glace scandinaves au nord et par les champs de glace alpins au sud, a été pénétrée par les travailleurs des silex acheuléens, probablement des membres, pour la plupart, de la race néandertalienne.
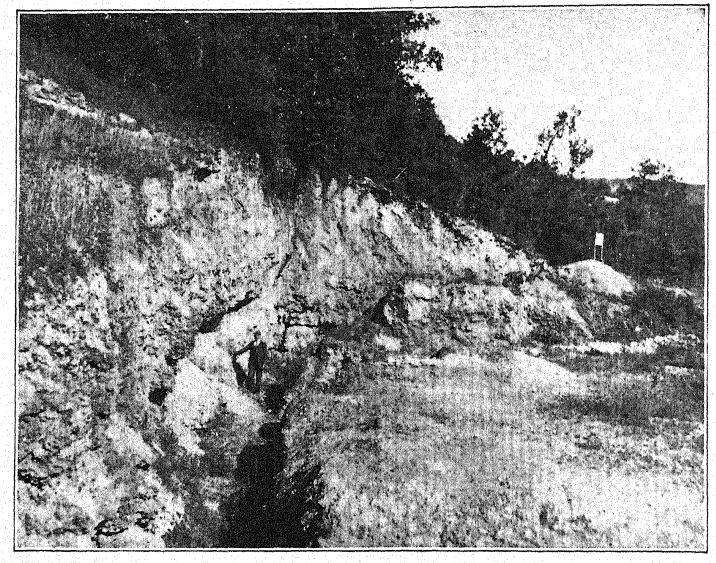
Français L’uniformité générale de l’artisanat acheuléen dans toutes les parties de l’Europe occidentale indique que ces tribus néandertaliennes étaient plus ou moins migratrices et que les inventions d’outils nouveaux et utiles, tels que le coup de poing pointu de La Micoque et les éclats de silex de Levallois, qui ont probablement trouvé leur origine dans un centre particulier, ou peut-être même dans l’esprit inventif d’un seul ouvrier, se sont largement répandues et ont été très distinctives de certaines périodes. Le développement des outils dans différentes régions est si uniforme qu’il prouve que l’évolution des premières cultures paléolithiques s’est étendue à toute l’Europe occidentale et que les différents types ou stades étaient essentiellement contemporains.
Illustrant la méthode de « découpage » d’outils en silex par un coup direct ou indirect avec un marteau.
¶ Formes d’instruments acheuléens
Il existe une succession étroite entre le coup de poing des ouvriers chelléens et son évolution vers les formes plus fines et plus symétriques de l’Acheuléen. Ce dernier, selon Obermaier,36 se distingue par l’écaillage de toute la surface, par un façonnage beaucoup plus habile et par la forme en amande véritablement symétrique obtenue par la retouche de la surface et des bords. Cette retouche plus raffinée permet de produire des instruments symétriques, aux tranchants droits, convexes ou concaves, ainsi que des outils plus fins et plus légers.

L’industrie de l’Acheuléen ancien appartient à une période climatique tempérée chaude et succède directement à celle du Chellen, comme le montrent de manière très parfaite les carrières de la station type de Saint-Acheul, dans la Somme, dans [ p. 170 ] carrières de la station type de Saint-Acheul, dans la Somme. Dans ces couches antérieures, les formes de coup de poing prédominantes sont l’« ovale pointu » et le « en pointe de lance », ce dernier présentant un ébrèchement très simple, une pointe large et une base épaisse. Les coups de poing ovales sont plus petits que les outils chelléens du même type, soigneusement façonnés sur tous les côtés et autour de la base, et très symétriques ; il en existe quatre variétés distinctes : le type en amande, l’ovale en amande, l’ovale allongé et le subtriangulaire — ce dernier évoluant vers le type finement modelé de l’Acheuléen récent. C’est peut-être à partir de ces types ovales que la forme discoïde a finalement évolué.
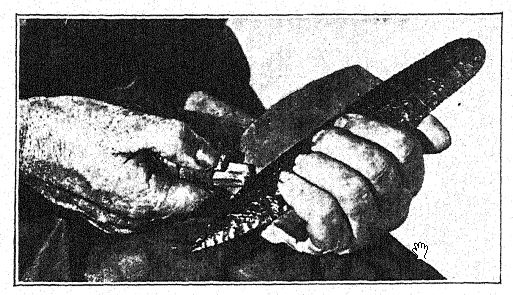
Il existe une grande divergence d’opinions concernant l’utilisation de ces formes ovales, triangulaires et discoïdes minces. Obermaier estime qu’elles auraient pu être fixées dans du bois ou munies d’une hampe, formant ainsi une pointe de lance. Une autre suggestion est qu’elles étaient utilisées avec une garde en cuir pour protéger la main ; et il ne fait aucun doute que, dans les deux cas, elles auraient servi d’armes efficaces à la chasse ou à la guerre. Un autre point de vue est celui de Commont37, qui estime qu’aucun instrument, jusqu’à la toute fin de l’époque acheuléenne, ne peut être considéré comme une arme de guerre ; cet auteur soutient que nombre de ces instruments, y compris ceux taillés sur les deux bords, étaient encore saisis de diverses manières par la main, bien qu’ils ne présentent pas la prise ferme et émoussée des coups de poing antiques.
On note également le développement d’un type de coup de poing, avec une lame coupante façonnée droite à l’extrémité : cet outil primitif en forme de ciseau ou d’herminette a pu être utilisé comme hachoir, ou comme hache, pour façonner des outils en bois.
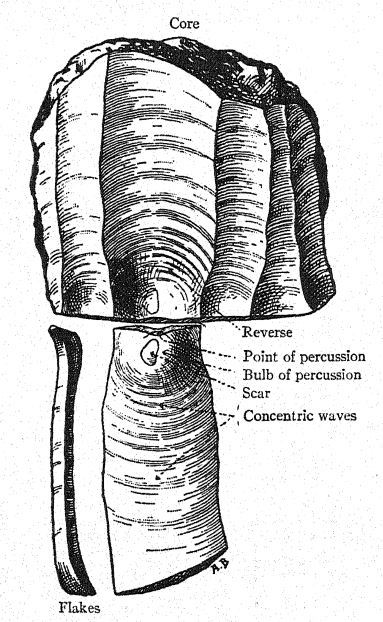
Dans le coup de poing en pointe de lance, de forme étroite et allongée, le débitage est très simple et les bords se prolongent dans la base courte, généralement très épaisse, et laissant souvent apparaître une partie de la croûte originelle du nodule de silex, bien adaptée à la prise en main. Cet instrument, qui correspond à l’idée originale du coup de poing, évolue vers les formes à pointe ronde et à pointe de lance. Il ne fait aucun doute que, que ce soit dans l’usage industriel, à la guerre ou à la chasse, ces instruments n’étaient tenus que par la main.
Les petits outils de l’Acheuléen ancien comprenaient une grande variété de modèles, dérivés d’outils beaucoup plus primitifs des époques chelléenne et pré-chelléenne, à savoir le rabot, le grattoir, le perceur et le couteau. Chacun de ces types développe sa propre variété, souvent façonnée avec le plus grand soin : lames primitives, outils coupants à tranchant droit, au dos arrondi ou émoussé pour la prise des doigts, grattoirs à bords droits ou courbes, et perceurs. Les outils de raclage et de rabotage, sans doute utilisés pour le traitement des peaux, sont aujourd’hui façonnés avec plus de soin. On observe également le racloir et le grattoir terminés en pointe, précurseurs de l’outil de gravure du Pahéolithique supérieur38.
Industriel.
- Coup de poing.
- Ovaloïde.
- À double tranchant.
- Subtriangulaire.
- Lame de coupe droite sur toute l’extrémité.
- En forme de disque.
- Triangulaire — très fin et plat.
- Hachette, hachoir.
- Grattoir, outil de rabotage.
- Racloir.
- Pergoir, foreuse, tarière.
- Couteau, couteau.
- ‘Pointe’ (lame Levallois).
- ‘Pointe’, pointe — ovale et en forme de ciseau.
Guerre et poursuite.
- Coup de poing.
- De types pointus et en pointe de lance.
- Pierre de jet.
- Couteau, couteau.
- Pointes, dards et pointes de lance.
La caractéristique de cette étape est l’utilisation systématique de grands « éclats » ou morceaux périphériques de silex détachés du noyau, qui servaient de grattoirs ou de rabots, ou se développaient en petites « haches » ou coups de poing.
Le noyau ou centre du rognon de silex constitue toujours le matériau à partir duquel sont façonnés les grands outils typiques ; mais l’éclat commence à se prêter à une grande variété de formes, comme en témoignent l’évolution des couteaux Levallois de l’Acheuléen supérieur et les outils à éclats très variés des industries moustérienne et aurignacienne.
La « pointe » est un instrument spécial taillé [ p. 173 ] dans un éclat court et fortement convexe, prenant la forme d’une fléchette émoussée ou d’une pointe de lance, pointue à une extrémité et ovale ou plate à l’autre.
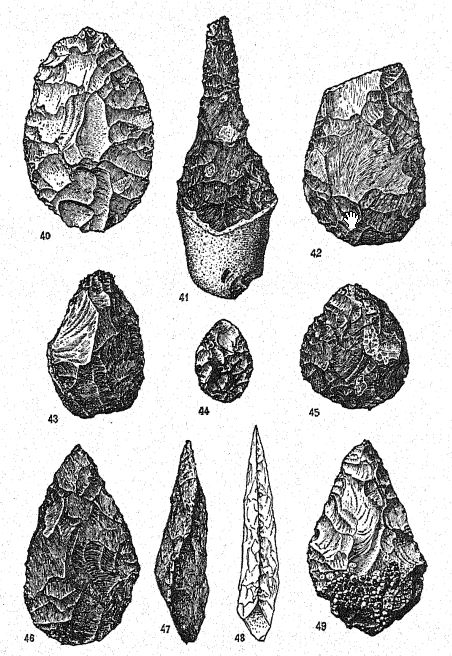
¶ Climat de l’Acheuléen tardif
L’industrie acheuléenne s’est poursuivie sur une très longue période et, lorsque la culture acheuléenne tardive fut atteinte, un changement climatique radical s’est produit en Europe occidentale. Le long des rives du Danube et du Rhin, dans la vallée de la Somme, et même dans le centre et le sud de la France, on observe des indices d’un climat continental frais et sec, semblable à celui que l’on trouve aujourd’hui dans les steppes méridionales de la Russie, dans les montagnes de l’Oural et aux abords de la mer Caspienne. Des indices de ce climat ont été mentionnés plus haut, comme on le voit dans la flore du tuf de La Celle-sous-Moret, près de Paris, où l’on trouve des preuves que des arbres de climat tempéré frais ont remplacé les forêts tempérées chaudes du début de l’Acheuléen.
Le fait que le climat doive être considéré comme frais et aride plutôt que comparable au climat glacial de la période du « loess supérieur », lorsqu’une véritable faune steppique est entrée en Europe pour la première fois, est également indiqué par le fait que les outils de l’Acheuléen tardif sont plus fréquemment trouvés dans le centre et le nord de la France que dans le sud.
À l’extrême nord, avant la fin de l’Acheuléen, les champs de glace scandinaves avaient recommencé à progresser vers le sud ; la région bordant les glaciers était froide et humide et favorisait la migration des mammouths et des rhinocéros laineux des régions de toundra vers la localité encore fréquentée par les silexiers acheuléens, car on dit39 que des silex acheuléens sont parfois associés même aux restes de ces mammifères de la toundra. À la même époque, les silexiers acheuléens de la Somme bénéficiaient peut-être d’un climat plus clément.
C’est seulement par cette interprétation des différentes zones chimiques et biologiques de l’Europe occidentale que l’on peut expliquer la survie sur la Somme, ou le retour à cette rivière par le sud, d’une faune tempérée chaude, hippopotames, rhinocéros et éléphants, à l’époque moustérienne, qui est même postérieure à la fin de l’Acheuléen.
Français Les vallées des deux grands systèmes fluviaux du sud-ouest de la France, la Dordogne drainant le plateau central et la Garonne drainant les Pyrénées orientales, étaient désormais recherchées par les silexiers acheuléens. La vallée de la Vézère, affluent septentrional de la Dordogne, traverse un large plateau calcaire dans lequel les ruisseaux ont creusé des lits profonds aux parois verticales. Ici, le paysage de l’Acheuléen tardif présentait le même aspect général qu’aujourd’hui40. Des preuves d’un changement de climat sont observées même dans les vallées abritées où les silexiers recherchaient les versants plus chauds et plus ensoleillés des rivières. Les lits des rivières étaient les mêmes qu’aujourd’hui, et les carrières des premiers silexiers acheuléens se trouvent tout près des ruisseaux ; mais à mesure que la période avançait, ils se rapprochaient des falaises et des abris. Ici aussi, il existe des preuves de la prédominance d’un climat continental sec. Sur les niveaux supérieurs des anciens plateaux de Dordogne, on trouve encore assez fréquemment le Quercus ilex, un arbre qui appartient aux régions relativement sèches et qui, dans le sud de la Russie, est considéré comme faisant partie de la flore des steppes. Cependant, la plus grande aridité vers la fin de l’Acheuléen n’était probablement pas de nature à empêcher la croissance des forêts le long des cours d’eau. Ainsi, dans la vie des mammifères de cette période, il y avait peut-être une division entre les formes plus rustiques qui fréquentaient les plateaux secs situés au-dessus et les formes forestières et moins rustiques qui fréquentaient les vallées fluviales.
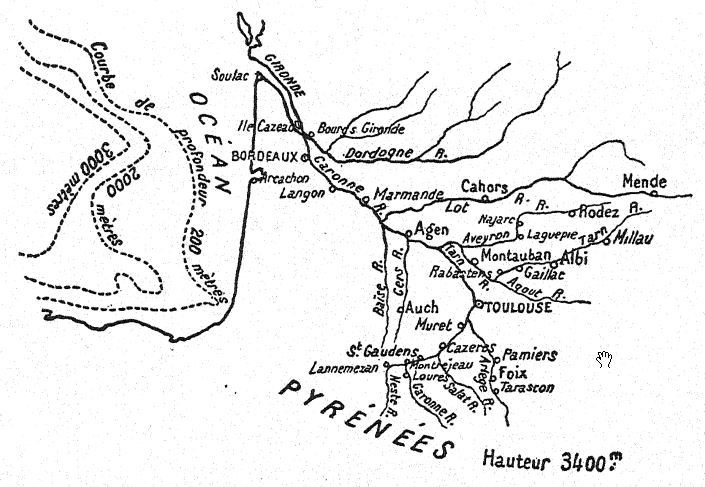
La preuve la plus convaincante d’un climat aride dans le nord de la France, avec des vents d’ouest dominants, se trouve dans les couches [ p. 176 ] de « lœss » qui se trouvent sur les « terrasses » de la Somme, de la Seine, du Rhin et du Danube. Ces couches de « lœss inférieur » du Troisième Interglaciaire contiennent fréquemment des outils de l’industrie acheuléenne récente. Ainsi, à Villejuif, au sud de Paris, des outils de l’acheuléen récent sont trouvés enfouis dans des galeries de « lœss ». Dans la vallée de la Somme, des silex de l’étage acheuléen moyen sont également trouvés dans le « lœss ancien » et les « galeries fluviales ». Dans le tuf de La Celle-sous-Moret, la couche de « loess » recouvre immédiatement la couche de tuf contenant des outils de l’Acheuléen tardif et des preuves d’un climat plus frais.
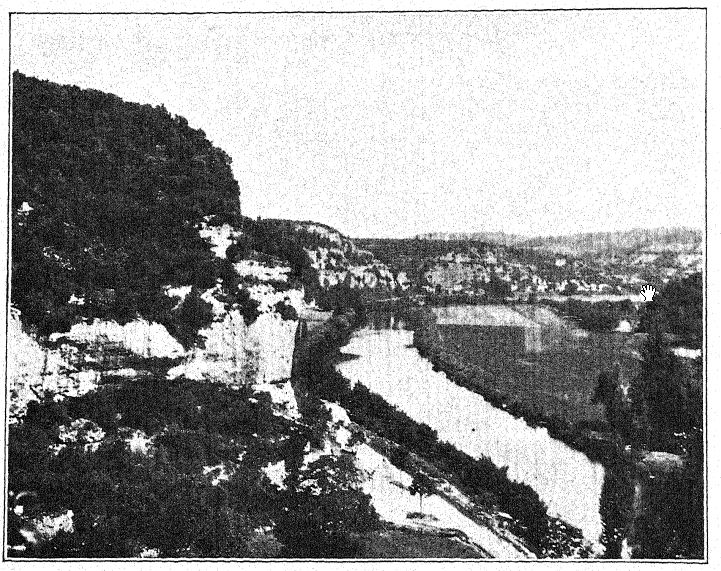
Parmi les stations de lœss les plus célèbres de l’Acheuléen tardif figure celle d’Achenheim, sur le Rhin supérieur, à l’ouest de Strasbourg. Le lœss ancien abrite ici une culture acheuléenne typique.
[ p. 177 ]
Avec cette période prolongée de températures plus fraîches, l’hippopotame et le mammouth du sud se sont retirés vers les régions plus chaudes du sud de l’Europe, et leurs restes ne sont plus associés aux silex de l’Acheuléen tardif. L’éléphant à défenses droites, plus robuste, et le rhinocéros de Merck ont subsisté dans le nord, apparemment bien adaptés à une baisse considérable des températures.
¶ Formes d’instruments de l’Acheuléen tardif
Les coups de poing de l’Acheuléen récent présentent une avancée considérable par rapport à ceux de l’Acheuléen chelléen, étant façonnés en forme de poignard ou de lance, dont tous les bords sont soigneusement taillés. Les instruments ovaloïdes de l’Acheuléen récent sont souvent façonnés en lames fines et tranchantes, qui ont pu être utilisées comme des couteaux de boucher pour démembrer les carcasses de gibier et découper les peaux, tandis que les fines formes en amande et en disque ont pu servir de grattoirs pour découper les tissus des surfaces internes des peaux, qui étaient ensuite rabotées au grattoir, ou outil à raboter le silex. En bref, le coup de poing atteint son apogée à l’Acheuléen récent, tant par la finesse du débitage et des retouches que par la symétrie de ses formes. L’utilisation de grands éclats de silex et la retouche des bords et des extrémités de ces éclats témoignent d’une technique en constante amélioration. C’est dans les lames minces, plates et triangulaires, et dans les formes en pointe de lance, que le coup de poing atteint son apogée ; mais on observe encore le développement des formes ovales ou en amande et des disques aplatis. Les outils de cette époque atteignent leur plus grande perfection dans le nord de la France, où le silex est si abondant.
L’Acheuléen récent se distingue également par une avancée dans la fabrication d’outils plus fins et plus petits. Les couteaux sont aujourd’hui très fins et parfaits, bien qu’ils conservent la forme large et épaisse du fragment de silex d’origine et atteignent rarement la forme symétrique qui caractérise les lames du Paléolithique supérieur41. Les « pointes » sont également d’une technique plus fine, leurs bords convergeant d’une base large vers une pointe bien formée. On suppose généralement qu’elles étaient tenues à main nue, mais il est tout aussi probable qu’elles étaient fixées à des manches en bois et utilisées comme pointes de fléchettes ou de lances. Les plus nombreux et les plus variés des petits outils étaient les racloirs, ou grattoirs, qui furent sans doute développés par l’utilisation croissante des peaux pour se protéger du climat plus rigoureux de l’Acheuléen récent. Il est probable que les femmes de la tribu étaient employées à préparer les peaux au moyen de ces grattoirs, qui étaient soit plats et larges avec des bords en forme de croissant, soit plats et étroits, soit à double tranchant avec des extrémités arrondies. Le développement d’autres outils raffinés – forets, petits disques, formes triangulaires et ovaloïdes, coups de poing miniatures et bien d’autres formes encore – est particulièrement visible à la station de La Micoque, près du confluent de la Vézère et de la Dordogne. Ces instruments miniatures pourraient bien avoir été utilisés pour la finition des peaux destinées à la confection de vêtements, pour la chasse au petit gibier ou lors de festins pour fendre les os à moelle.
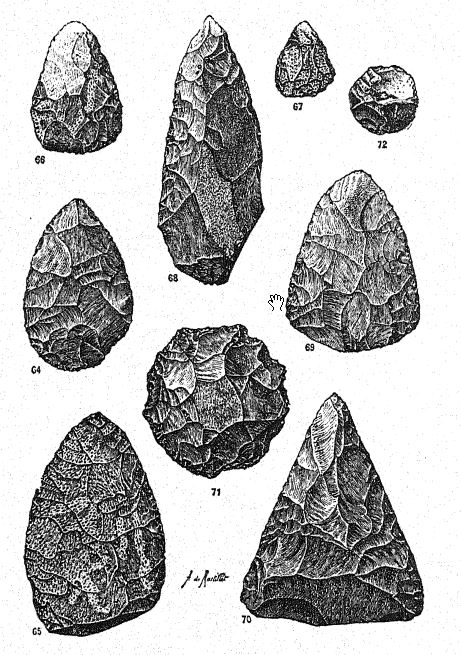
Aucun outil en os n’a été trouvé, même avec ces silex de l’Acheuléen récent, mais il est important d’observer que la majorité de ces stations sont ouvertes et exposées aux intempéries et que les outils en os ne seraient pas conservés ici comme ils le seraient dans les grottes et cavernes abritées où les ouvriers du silex se rendaient au Moustérien et aux époques suivantes.
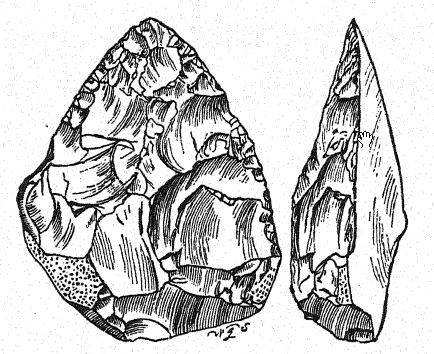
En ce qui concerne la finition de ces outils en silex, il est important de noter qu’elle n’est belle que par comparaison avec le travail grossier de l’Acheuléen ancien ou les types encore plus grossiers de l’époque cheléenne et que le travail le plus fin de l’époque acheuléenne apparaît épais et maladroit lorsqu’il est contrasté avec le travail plus fin du Paléolithique supérieur.
Le chef-d’œuvre de l’industrie acheuléenne tardive est l’éclat de Levallois, découvert pour la première fois à Levallois-Perret, près de Paris. De Mortillet pensait qu’il était façonné à partir d’un coup de poing divisé [ p. 180 ] à face inférieure plate, mais qui pourrait provenir des très grands éclats primitifs pré-chelléens. Ces éclats sont antérieurs au coup de poing chelléen, mais ont continué à être utilisés après son invention et pourraient avoir été grandement perfectionnés pour donner le type Levallois. Ce type de couteau est un grand éclat large et fin, de forme assez symétrique, avec un dos plat formé par la surface lisse d’origine de l’éclat. Ces instruments sont pointus, de forme ovale ou nettement rectangulaire et constituent l’outil le plus caractéristique de la dernière étape de l’industrie acheuléenne.
Il est très intéressant à ce stade d’observer les deux modes d’évolution qui semblent imprégner toute la nature : premièrement, la perfection et la modification graduelles de la taille et des proportions d’une certaine forme plus ancienne ; deuxièmement, le changement soudain ou la mutation en une nouvelle forme, qui à son tour entre dans la phase d’amélioration graduelle.
L’Acheuléen tardif est considéré comme le point culminant d’un développement progressif et ininterrompu des industries et des idées chelléennes primitives ; et à notre avis, cela suggère fortement une évolution correspondante des compétences manuelles et du développement mental des ouvriers eux-mêmes, qui étaient peut-être en partie de race pré-néandertalienne.
L’étape industrielle suivante, le Moustérien, qui représente certainement la fin de l’art néandertalien, montre une régression technique marquée, contrastant avec la progression constante observée jusqu’à présent. Nous avons en effet assisté à plusieurs étapes successives de progression, suivies au Moustérien d’une étape de régression. Une telle régression du développement industriel peut, pour des raisons connues ou inconnues, se produire au sein d’une même race. Il est intéressant de noter qu’au Paléolithique supérieur, où la culture solutréenne représente l’apogée et la perfection du travail du silex, le Magdalénien qui lui succède montre une régression marquée dans la technique de retouche du silex.
[ p. 181 ]
¶ Les Néandertaliens de Krapina
Dans le nord de la Croatie, près de la petite ville de Krapina, dans la vallée de la rivière Krapirdca, se trouve la désormais célèbre grotte de Krapina. C’est là qu’a été découverte en 1899 la quatrième découverte de restes d’hommes de la race néandertalienne en Europe occidentale, douze ans après la découverte des hommes de Spy, en Belgique, et quarante-trois ans après celle de l’homme de Néandertal. Aujourd’hui encore, les avis sont partagés quant à l’âge des restes humains trouvés dans cette grotte. Le découvreur, le professeur Gorjanovic-Kramberger d’Agram, considérait que les outils et éclats de pierre étaient d’âge moustérien, et Breuil les attribue toujours au Moustérien ancien, dit moustérien chaud ; cette opinion est partagée par Dechelette. Schmidt, cependant, considère Krapina comme une véritable station acheuléenne, dépourvue de certains outils typiques, et du même âge que la station « loessique » d’Ehringsdorf.
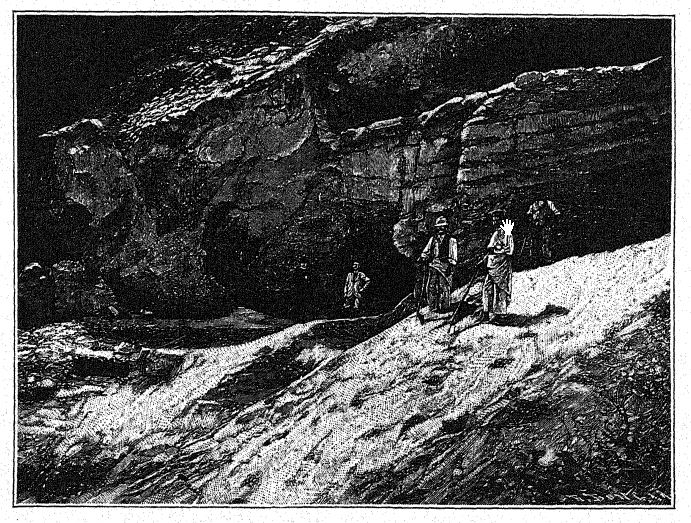
[ p. 182 ]
Les mammifères trouvés dans la caverne appartiennent certainement à la période acheuléenne très tardive et comprennent le rhinocéros de Merck, l’ours des cavernes, l’urus, une espèce de cheval, le cerf géant (Megaceros), le castor et la marmotte (Arctomys marmotta).
La caverne fut à l’origine emportée par la rivière, mais elle se trouve aujourd’hui à 25 mètres au-dessus du niveau actuel de l’eau. Lorsqu’elle fut découverte, elle était entièrement comblée par des dépôts de sable et de gravier, des fragments érodés du toit et des murs, ainsi que des pierres et des rochers.42 Enfermés dans cette masse, en strates distinctes parfaitement distinctes, gisaient, diversement répartis dans les différentes couches, des milliers d’ossements d’animaux, mêlés à des centaines d’ossements humains, et des centaines d’outils et d’éclats de pierre.
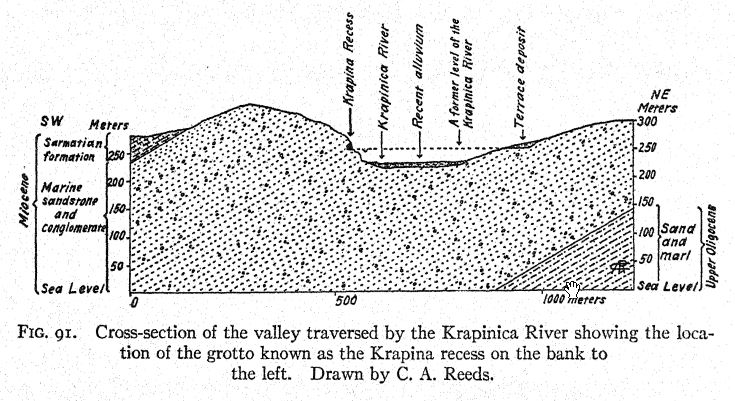
Français Durant les années 1899-1905, Gorjanovic-Kramberger a exploré minutieusement le contenu de cette caverne et a publié un compte rendu complet de ses recherches en 190643. On y a trouvé environ trois cents morceaux d’ossements humains, parmi lesquels de nombreux petits fragments, ainsi que de nombreux morceaux de crâne de taille importante et plusieurs os de tête entiers parfaitement conservés. Les os sont d’un type fortement caractérisé, et les mâchoires inférieures, les os du visage, les os de la cuisse et du bras, les dents et les os de nombreux enfants établissent que la race Ehapina appartient incontestablement au même groupe que celui des Néandertaliens et de Spy.
[ p. 183 ]
Le crâne de l’homme de Krapina (Fig. 93) est légèrement plus large ou plus brachycéphale que celui de tous les autres membres de la race néandertalienne. En général, la race est quelque peu rabougrie, sa tête est plus large et ses processus supraorbitaires sont moins proéminents. L’espèce est incontestablement Homo neanderthalensis, dont les hommes de Krapina constituent une race locale. Schwalbe et Boule observent que la plus grande largeur du crâne de Krapina est en partie due à la manière dont les os ont été assemblés44, et ils ne considèrent pas que l’homme de Krapina représente une sous-race différente (Homo neanderthalensis krapinensis), comme le prétendait le découvreur. L’indice céphalique d’un crâne d’Elrapina est enregistré à 83,7 % (?), contre 73,9 %, l’indice céphalique du véritable H. neanderthalensis, une différence qui, comme indiqué précédemment, pourrait être en partie due à la restauration. Français Les os sont dans un état si fragmentaire qu’il est impossible d’estimer correctement la capacité cérébrale des mâles ou des femelles de cette race ; il n’est pas non plus possible d’estimer la stature. L’espace entre les yeux est le même que chez la race néandertalienne [ p. 184 ] ; l’angle de recul du front (52°) est presque le même que dans le crâne de la femme néandertalienne de Gibraltar (50°), ce front haut étant dû au moindre développement des crêtes supraorbitaires. Que le cerveau soit de type néandertalien bas et à tête plate est démontré par l’étroite similitude de l’indice de la hauteur du crâne (42,2) avec celui de l’un des hommes de Spy (44-3) comparé à l’indice le plus bas parmi les races humaines existantes (48,9) ; pourtant l’homme de Krapina présente une avancée considérable sur le Pithécanthrope, chez lequel l’indice de la hauteur du crâne n’est que de 34,2.
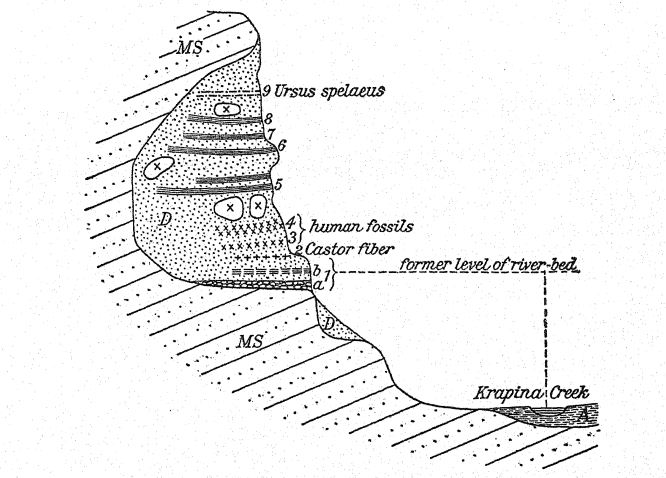
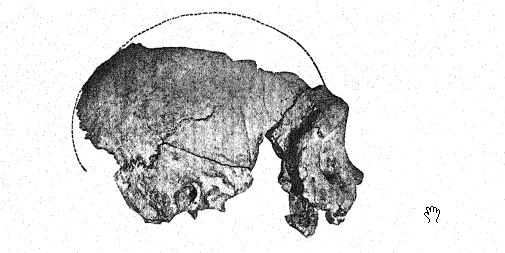
La mâchoire est plus fine que celle de l’homme de Heidelberg mais reste épaisse et massive ; le menton est fuyant, caractéristique de toutes les races néandertaliennes.
L’état de décomposition de tous les ossements humains de cette caverne, ainsi que les nombreuses traces de feu, ont conduit à l’hypothèse selon laquelle les Néandertaliens de Krapina étaient cannibales, et que ces restes mélangés seraient des ossements d’animaux et d’hommes recueillis ici lors de festins cannibales. Breuil contredit cette hypothèse en soulignant qu’aucun des ossements humains n’est fendu longitudinalement, comme c’est la pratique courante pour extraire la moelle osseuse, mais qu’ils sont brisés transversalement. C’est la seule preuve d’une telle pratique trouvée durant tout le Paléolithique, et nous hésiterions à l’accepter, sauf si elle est corroborée par d’autres sites.
Les différentes couches indiquent que la grotte a été successivement occupée par l’homme ; dans ou à proximité des foyers, on trouve des outils en pierre, des os brisés et incinérés, et des morceaux de charbon de bois, ce qui peut indiquer que cette grotte n’était visitée qu’à intervalles, peut-être pendant les saisons les plus froides de l’année.
¶ Bibliographie
(1) Harlé, 1910.1,
(2) d’Auit du Mesnil, 1896.1, pp. 284-296.
(3) Obermaier, 1912.1, p. 146.
(4) Schmidt, 19 1 2.1, pp. 118-126.
(5) Boule, 1888.1.
(6) Obermaier, 1912. i, pp. 327-329.
(7) Haug, 1907.1, vol. II, p. 327-329
(8) Geikie, 1914.1, p. 262.
(9) Morlot, 1854.1.
(10) Commune, 1906.1.
(11) Geikie, 1914.1, pp. 107-111.
(12) d’Ault du Mesnil, op. dt.
(13) Schmidt, 19 1 2.1, pp. 124, 125.
(14) Obermaier, 1912.1, p. 118.
(15) Dawson, 1913.1; 1913.2; 1913.3.
(16) Kennard, 1913.1.
(17) Reid, 1913. 1.
(18) Dawson, 1913.x, p. 123; 1914.1, pp. 82-86.
(19) Keith, A., 1913-1; 1913-2; 1913-3
(20) Smith, GE, 1913. i; 1913-2; 1913.3; 1913.4
(21) Boule, 1913.1, pp. 245, 246.
(22) Schwalbe, 1914.1, p. 603.
(23) Osborn, 1910.1, pp. 404-409.
(24) Ewart, 1904.1; 1907.1; 1909. 1.
(25) Obermaier, 1912.1, p. 120.
(26) de Mortillet, 1869.1.
(27) Obermaier, op. cit., p. 116.
(28) Lyell, 1863.1, p. 164.
(29) Geikie, 1914.1, 99. 119, 263, 264.
(30) Schmidt, 1 91 2.1, pp. 125, 126.
(31) Geikie, op. cU.y p. 228.
(32) Avebury, 1913. i, p. 342, Fig. 236.
(33) Schmidt, op. cit., pp. 17-105.
(34) Breuil, 1912.5, p. 14.
(35) Obermaier, 1912. i, p. 164.
(36) Obermaier, op. cir., p. 124, 125, 127, 130.
(37) Commune, 1908.1.
(38) Dechelette, 1908.1, vol. I, pp. 80-90.
(39) Geikie, 1914.1, p. 255.
(40) Hilzheimer, 1913.1, p. 145.
(41) Obermaier, 19 1 2. 1, p. 127.
(42) Fischer, 1913.1.
(43) Gorjanovic-Kramberger, 1901.1 ; 1903.1 ; 1906.1.
(44) Schwalbe, 1914.1, p. 597.
¶ Notes de bas de page
Modifié d’après Schmidt. ↩︎
La faiblesse de l’argument de Penck pour placer le Chellen dans le Second Interglaciaire a été exposée par des observations précises de Boule^ et Obermaier® dans les Alpes, le Jura et les Pyrénées. ↩︎
L’auteur est redevable à M. Marcelin Boule et à M. l’Abbé Henri Breuil pour leurs observations sur cette période de faune et de culture. ↩︎
Une industrie similaire à celle de Chellen, mais pas nécessairement du même âge, est répartie dans toute l’Afrique de l’Est, de l’Égypte au Cap. ↩︎
Schmidt considère les instruments strepyens, considérés par Rutot et d’autres comme étant de transition, entre le Mesvinien et le Chellen, comme étant très similaires au Pré-Chellen de France et probablement du même âge. ↩︎
L’article original décrivant cette découverte remarquable a été lu devant la Geological Society of London en décembre 1912 et publié sous forme de brochure séparée en mars 1913. Une discussion sur l’âge géologique par Kennard, Clement Reid et d’autres a eu lieu au moment de la lecture de l’article original. ↩︎
Par l’auteur de cet ouvrage, ainsi que par le professeur J. Howard McGregor de l’Université de Columbia et le docteur William K. Gregory de l’Université de Columbia et du Musée américain d’histoire naturelle. ↩︎
Guide des restes fossiles de l’homme, 1915.1 . ↩︎
La reconstruction (Fig. 68) du crâne de Piltdown réalisée par le professeur J.H. McGregor présente une capacité crânienne d’environ 1 300 cm³. Le cerveau (Fig. 70) apparaît très étroit et bas dans la zone préfrontale, siège des facultés mentales supérieures. Dans la reconstruction, la région crânienne est globalement très semblable à la seconde restauration du docteur Smith Woodward, mais les mâchoires diffèrent sur certains points. La dent jusqu’alors considérée comme une canine inférieure droite est désormais placée comme canine supérieure gauche, conformément aux conclusions de l’auteur de cet ouvrage et des docteurs Matthew et Gregory de l’American Museum of Natural History. ↩︎
Voir Annexe, Note IX, p. 512. ↩︎
Les premiers noms teutoniques de ces animaux étaient les suivants : bison, « wisent », bœuf sauvage, « auerochs », « urochs » (l’« urus » de César). L’urus a survécu en Allemagne jusqu’au XVIIe siècle, tandis que quelques bisons ou « wisent » survivent encore aujourd’hui. Le bison était un animal à tête courte, tandis que son contemporain, l’urus, avait une tête longue et moins agile. À Duniten, près de Zurich, des restes d’urnes ont été retrouvés associés à ceux de l’éléphant robuste aux défenses droites et du rhinocéros de Merck (voir annexe, note IV). ↩︎
L’auteur a été guidé à travers cette station par le docteur Hugo Obermaier à l’été 1912. ↩︎