[ p. 260 ]
OUVERTURE DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR — LA RACE DES GRIMALDI — ARRIVÉE DE LA RACE CRO-MAGNON ET DE L’INDUSTRIE AURIGNACIENNE — CONDITIONS GÉOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES — VIE DES MAMMIFÈRES — CARACTÉRISTIQUES ET HABITUDES DES CROMAGNONS — DISTRIBUTION DE L’INDUSTRIE AURIGNACIENNE — NAISSANCE DE L’ART — ORIGINE ET DISTRIBUTION DE L’INDUSTRIE SOLUTRÉENNE — RAGE DE BRÜNN — INDUSTRIE ET ART SOLUTRÉENS.
Dans toute l’histoire raciale de l’Europe occidentale, il ne s’est jamais produit de changement aussi profond que celui qui a entraîné la disparition de la race néandertalienne et l’apparition de la race Crô-Magnon. Il s’agissait du remplacement d’une race inférieure à tout type humain existant par une race se classant parmi les plus importantes en termes de capacités et d’intelligence. Les Crô-Magnons appartenaient à l’Homo sapiens, la même espèce humaine que nous, et semblent avoir été la race dominante du Paléolithique supérieur jusqu’à la fin du Magdalénien, après quoi ils ont apparemment connu un déclin.
Bien qu’une ou plusieurs autres races aient influencé le développement industriel de l’Europe occidentale, les Crô-Magnons étaient assurément dominants, comme le montrent l’abondance de leurs restes squelettiques et la large diffusion de leur industrie et de leur art ; le Paléolithique supérieur peut presque être considéré comme la période des Crô-Magnons, tout comme le Paléolithique inférieur est celui des Néandertaliens et des Pré-Néandertaliens. Leur arrivée vers la fin du Moustérien a entraîné un changement social et industriel, ainsi qu’un remplacement racial si profond qu’il serait certainement légitime de séparer le Paléolithique supérieur du Paléolithique inférieur par une rupture égale à celle qui sépare le Paléolithique supérieur du Néolithique.
Français L’arrivée des Crô-Magnon et l’introduction de l’industrie aurignacienne sont les premiers événements de la préhistoire de l’Europe auxquels nous pouvons assigner une date avec un certain degré de confiance ; ils correspondent géologiquement à la fin de la quatrième glaciation et au début de la période postglaciaire, dont la durée a été estimée par les géologues à partir de preuves de différentes sortes, mais qui nous amènent néanmoins à des conclusions sensiblement similaires. Il semble que 25 000 ans soit une estimation prudente de la durée de la période postglaciaire ; cela est confirmé par les observations indépendantes de Lyell, Taylor, Penck et Bruckner, et Goleman ; cela se situe dans les estimations faites par Chamberlin et Salisbury, Fairchild, Sardeson et Spencer ; il est un peu plus grand que les estimations de Gilbert et Upham.[1] Ainsi, avec une confiance considérable, nous pouvons enregistrer l’homme du type moderne d’Homo sapiens comme étant entré en Europe occidentale il y a entre 25 000 et 30 000 ans.
Le cycle industriel du Paléolithique inférieur, comprenant le Chellen, l’Acheuléen et le Moustérien, semble avoir connu une évolution similaire sur les côtes méditerranéennes et dans les régions septentrionales de l’Europe. L’arrivée des Crô-Magnons avec l’industrie aurignacienne semble indiquer qu’ils ont traversé la Phénicie et les côtes méridionales de la Méditerranée, puis Tunis, pour atteindre l’Espagne ; peut-être aussi le long des côtes septentrionales de la Méditerranée, via l’Italie. Leur évolution s’est probablement déroulée quelque part sur le continent asiatique, car leur structure physique est entièrement de type asiatique, et non le moins du monde africaine ou éthiopienne ; autrement dit, ils ne présentent aucun caractère négroïde. Si Breuil considère que l’Aurignacien n’est pas arrivé par l’Europe centrale ou orientale, c’est parce qu’il n’existe aucune station aurignacienne ancienne dans ces deux régions, alors que l’Aurignacien est abondamment développé le long des côtes méditerranéennes, tant européennes qu’africaines. Le passage des Crô-Magnons le long de ces côtes fut donc semblable à la vague ultérieure de la véritable race méditerranéenne, peuple aux cheveux noirs, à la tête longue et au visage étroit, qui suivit cette côte au début du Néolithique, ou encore à la vague de l’avancée arabe ou musulmane, qui s’avança le long de la côte nord de l’Afrique et dans le sud-ouest de l’Europe.
Cette théorie de la migration le long de la côte nord de l’Afrique est corroborée par la présence des squelettes de deux membres d’une race entièrement distincte, communément appelés « négroïdes de Grimaldi » en raison de leur découverte dans les grottes de Grimaldi, près de Menton, et parce qu’ils sont les seuls, parmi toutes les races du Paléolithique supérieur découvertes jusqu’à présent en Europe, à présenter de nombreuses ressemblances avec la race négroïde africaine. Anatomiquement, ils ne sont apparentés ni aux Néandertaliens ni aux Crô-Magnons. Leur âge archéologique semble être l’Aurignacien inférieur, car ils se trouvent immédiatement au-dessus de la couche qui marque la fin du Moustérien et le dernier climat favorable à la faune chaude des mammifères.
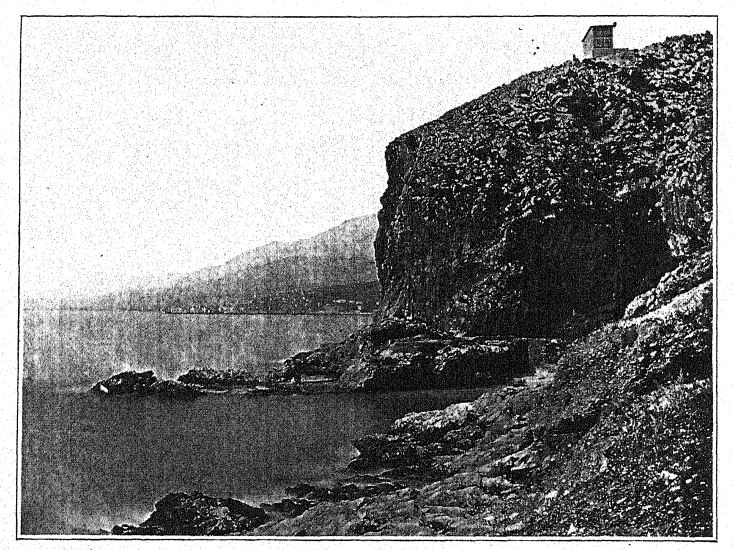
[ p. 263 ]
Cette côte ensoleillée, où la France moderne rejoint l’Italie, a fourni certains des témoignages les plus précieux de la transition raciale et industrielle du Paléolithique inférieur au Paléolithique supérieur. Des neuf grottes de Grimaldi, trois au moins témoignent d’une occupation à la fin du Moustérien, probablement par des Néandertaliens, bien qu’aucun squelette de Néandertalien n’y ait été découvert. Quatre de ces grottes, à savoir la grotte des Enfants, la grotte de Cavillon, la Barma Grande et le Baousso da Torre, ont livré au total les restes squelettiques de seize individus, tous associés à des outils de la culture aurignacienne et représentant manifestement plusieurs sépultures cérémonielles. Quatorze de ces squelettes sont attribués par Verneau à la race de Crô-Magnon ; les deux autres sont les « Négroïdes de Grimaldi » mentionnés plus haut. Il s’agit donc d’un témoignage préhistorique de la plus haute importance, que nous allons maintenant examiner plus en détail.
¶ Succession raciale le long de l’ancienne Riviera
Là où les contreforts méridionaux des Alpes plongent dans la Méditerranée et séparent la France de l’Italie, se trouve un promontoire calcaire, connu sous le nom de Baoussé Roussé, qui s’avance en un long promontoire, sous lequel le rivage rocheux descend brusquement dans la mer. S’ouvrant vers le sud, et à intervalles réguliers le long de la base de ce promontoire, se trouvent les neuf grottes de Grimaldi. Sans doute les Néandertaliens ont-ils migré le long de ces rivages à une époque où l’hippopotame, l’éléphant à défenses droites (E. antiquus) et le rhinocéros de Merck (R. merckii) abondaient encore, derniers représentants de la grande faune afro-asiatique. Ces chasseurs de l’époque moustérienne pénétraient dans le fond marin de la grande grotte du Prince[2] (fig. 131), dont la hauteur sous plafond dépassait peut-être alors 24 mètres, transportant leur gibier jusqu’aux foyers et laissant des outils moustériens dans les dépôts accumulés. Dans les couches successives de cette grotte, l’évolution des formes de vie animale témoigne de l’effet de la quatrième glaciation [ p. 264 ] et du refroidissement du climat vers la fin de l’époque moustérienne.
La grotte des Enfants, plus petite (fig. 132), située à l’ouest de la grotte du Prince, semble avoir été occupée à une époque plus récente, car les foyers les plus bas contiennent, avec les outils moustériens, les restes du seul rhinocéros de Merck – apparemment le dernier survivant ici, comme dans d’autres régions d’Europe occidentale, de la faune chaude afro-asiatique. L’hippopotame et l’éléphant à défenses droites avaient disparu ou avaient été repoussés plus au sud lorsque les himters ont occupé cette grotte pour la première fois. Dans les couches sus-jacentes de cette grotte et de plusieurs autres, les foyers contiennent les restes d’une riche faune forestière comprenant sangliers, cerfs, chevreuils, chevaux sauvages, loups et ours. Les premiers signes d’un froid croissant dans les montagnes du nord sont l’apparition de restes de chamois et de bouquetins chassés des hauteurs alpines. Puis, dans des couches encore plus hautes, apparaît le renne, annonciateur du climat de toundra.
¶ La Course Grimaldi
Verneau est enclin à considérer les Grimaldi comme une race très ancienne, antérieure aux Crô-Magnon. Il croit qu’ils appartiennent à un nouveau type ethnique qui a joué un rôle important en Europe et jouissait d’une vaste répartition géographique. Cette opinion ne semble cependant pas très bien étayée, car, contrairement à d’autres races, aucune trace des Grimaldi n’a été trouvée ailleurs, et il semble plus probable qu’ils aient été, comme l’indiquent leurs caractéristiques squelettiques, de véritables négroïdes venus peut-être d’Afrique, mais qui ne se sont jamais établis en tant que race en Europe occidentale.
Le type consiste en deux squelettes trouvés dans la Grotte des Enfants par Verneau en 1906. L’un est celui d’une femme d’âge moyen ; l’autre est celui d’un jeune homme de seize ou dix-sept ans. Tous deux se rapportent à l’espèce humaine actuelle, Homo sapiens. La couche qui les contenait se trouve à un niveau deux pieds [ p. 265 ] [ p. 266 ] plus bas que toutes celles qui contenaient des Crô-Magnons, et immédiatement au-dessus de la couche culturelle de l’époque moustérienne.
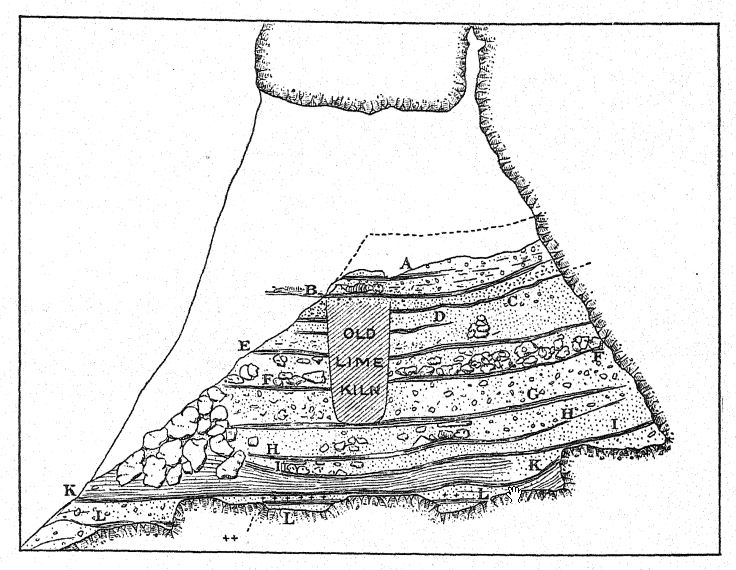
A. Sépulture de deux squelettes d'enfants. Restes de mammifères forestiers et alpins (bouquetins).
B. Sépulture du squelette d'une femme Crô-Magnon. Restes de mammifères forestiers et alpins.
C. Foyers contenant des mammifères forestiers — le sanglier, ainsi que le renne.
D. Foyers avec des silex de type aurignacien. Restes de faune forestière : la martre.
E. Couche contenant un cairn ou un amas de pierres artificiel. Restes de bouquetin, de cheval, de loup, de lion des cavernes et de renard.
Couche intermédiaire. Restes d’âne sauvage, peut-être de type steppique, et de renne ; également de bouquetin, de cheval sauvage et de faune forestière : le sanglier.
F. Gros fragments tombés du plafond de la grotte. Aucune trace d’habitation.
G. Foyers. Restes d’élan, de chevreuil, de daim, de cerf, de bovin sauvage, de bouquetin, de renard, de léopard et de lapin.
H. Sépulture d’un squelette de très grande taille de la race Crô-Magnon (voir fig. 144, p. 297). Foyers contenant des restes de faune forestière, ainsi que de chamois alpin et de marmotte, de hyène des cavernes et de léopard.
I. Sépulture de deux squelettes de la race Grimaldi (voir fig. 133, p. 267). Silex de type aurignacien et vestiges d'une faune forestière comprenant le cerf, le cheval sauvage, le bouquetin des Alpes et l'hyène.
K. Traces de charbon de bois et de foyers perturbés.
KL. Restes de rhinocéros de Merck et d'hyène. Faune forestière alpine (Thcx) et tempérée.
L. Traces de foyers avec des outils moustériens, principalement en quartzite, probablement laissés par des Néandertaliens sur le sol ancien de la grotte, après le retrait de la mer. Preuve d'une occupation antérieure par des hyènes.
Les personnages de Grimaldi contrastent fortement avec ceux de Crô-Magnon. Les deux squelettes connus, une femme et un jeune homme, sont de taille inférieure, ne dépassant pas 1,60 m.
Femelle Grimaldi estimée à 1,57 m. 5 pi. 2 po.
“ jeunesse “ “ 1,55 m. 5 pi. 1 po.
Ces mensurations, cependant, ne sont que légèrement inférieures à celles de la femme et du jeune homme de Crô-Magnon, qui atteignent 1,65 m. On trouve de nombreux caractères négroïdes dans le crâne, dans la structure de la ceinture lombaire et dans les proportions des membres ; il y a aussi quelques caractères communs avec les singes anthropoïdes, à savoir, l’avant-bras long, le fémur courbé et le prognathisme marqué, ou projection de la rangée de dents ; le visage est bas et large, et extrêmement prognathe ; le nez est platyrhinien, ou large et plat ; la mâchoire est lourde, avec de grandes dents et sans proéminence du menton ; la forme de la tête, comme celle des Crô-Magnon, est dochocéphalique et quelque peu disharmonique ; c’est-à-dire que tandis que la tête est longue, le visage est court et relativement large. Pourtant, la capacité crânienne est relativement élevée, étant estimée à 1 580 cm³. Contrairement aux Crô-Magnons, les Grimaldi possèdent un avant-bras relativement long et des pieds de type négroïde. Les proportions de la jambe sont cependant assez similaires à celles de la jambe du Crô-Magnon, le fémur étant court et le tibia long, l’indice étant de 83,8 %. Outre le long avant-bras, dont la forme se rapproche de celle des singes anthropoïdes actuels, on trouve un fémur courbé, caractéristique des singes anthropoïdes.
« Par ses caractères corporels et dentaires », observe Verneau3, « cette race négroïde présente à bien des égards une plus grande ressemblance avec les singes anthropoïdes que la race néandertalienne. » Il poursuit : « Il n’en demeure pas moins qu’à une époque très reculée du Pléistocène, il existait en Europe, à côté de la race néandertalienne, un type d’homme qui, par nombre de ses caractères céphaliques, par la structure de son bassin et par les proportions de ses membres, présentait des analogies frappantes avec le nègre d’aujourd’hui. Dans leurs proportions remarquables, ils exagèrent certaines des particularités des nègres récents ; les dents ressemblent à celles des types australiens. »
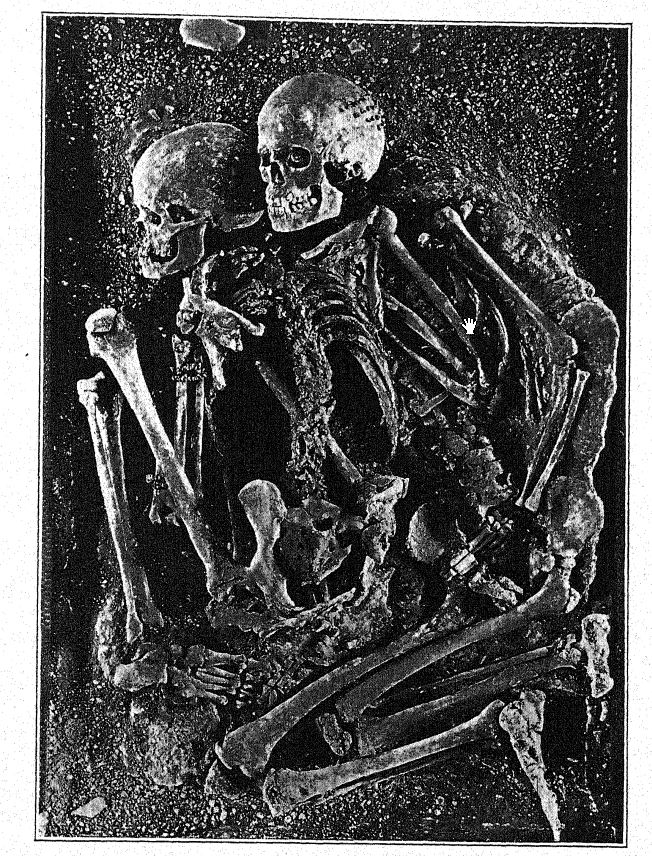
Il existe des preuves de l’établissement et de la propagation de la race Grimaldi dans toute l’Europe occidentale, notamment dans des cas de réversion partielle à ce type parmi les restes squelettiques du Néolithique, de l’Âge du Bronze et du début de l’Âge du Fer en Bretagne, en Suisse et dans le nord de l’Italie. Un prognathisme extrême est la caractéristique la plus fréquente, et dans certains cas, on retrouve un nez large, avec les mêmes particularités ostéologiques que celles qui caractérisent le type Grimaldi. Dans tous les cas, ces individus présentent une dolichocéphalie, presque toujours associée à un visage court et large. Jusqu’à la découverte du type Grimaldi, nous étions incapables d’expliquer l’existence de ces individus au sein d’une population dont ils différaient si radicalement.
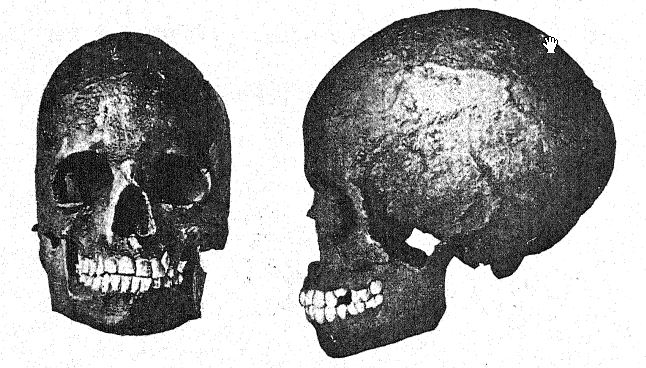
À l’encontre de cette opinion de Verneau, il convient de mettre en balance l’absence totale de toute trace de cette race Grimaldi en Europe occidentale parmi toutes les sépultures et autres restes humains du Paléolithique supérieur connus à ce jour. Mis à part ces documents dont l’authenticité est douteuse ou difficiles à diagnostiquer en raison de leur nature fragmentaire, il reste un certain nombre de fossiles humains représentant au moins quatre-vingt-dix individus, découverts dans plus de quinze localités largement dispersées. Aucun d’entre eux ne présente de caractéristiques de la race Grimaldi.
Français En décrivant les squelettes de Grimaldi, Keith4 convient qu’ils sont d’un type mixte ou négroïde ; la partie incisive peu profonde et saillante de la mâchoire supérieure et les caractères du menton sont des caractéristiques des races négroïdes récentes ; il en va de même pour la large ouverture du nez, les pommettes proéminentes, le visage plat et court. Pourtant, l’arête [ p. 269 ] du nez n’est pas plate comme chez les nègres, mais plutôt proéminente comme chez les Européens, et la capacité du crâne chez la femme (1 375 cm³) est ample. Chez le garçon, les dents sont grandes et de type nègre ; il présente une ressemblance frappante avec la femme, et sa capacité crânienne (1 580 cm³) indique un cerveau nettement moderne ; les proéminences du front ne se rejoignent pas sur la ligne médiane comme chez certains négroïdes et chez les Néandertaliens. Keith conclut que le peuple Grimaldi représente un type intermédiaire dans l’évolution des races blanches et noires typiques.
¶ PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE TOUTE L’HISTOIRE DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
Ayant maintenant considéré l’ouverture du Paléolithique supérieur, ainsi que l’apparition unique de la race Grimaldi dont on ne connaît plus aucune trace, il est souhaitable de passer brièvement en revue toute l’histoire du Paléolithique supérieur avant de tenter de suivre en détail ses phases successives à partir de l’apparition de l’industrie aurignacienne.
Français Il existe des preuves de divers types que les Crô-Magnons sont arrivés en Europe occidentale, apportant leur industrie aurignacienne, alors que les Néandertaliens étaient encore en possession du pays et pratiquaient leur industrie moustérienne. Ainsi, dans la vallée de la Somme, Commont croit avoir reconnu un niveau de silex, présentant la « retouche » aurignacienne primitive de la Dordogne, mais se trouvant sous un niveau moustérien récent. Des preuves supplémentaires d’un contact entre les industries de ces deux races se trouvent aux stations de La Ferrassie, des Boufiia, et surtout de l’Abri Audit, où il y a une période de transition distincte, dans laquelle les types caractéristiques du Moustérien récent se trouvent mélangés à un certain nombre de silex suggérant l’Aurignacien ancien. Il semblerait qu’ici, le développement de l’Aurignacien soit en partie une évolution locale, et non une invasion de types d’outils entièrement nouveaux. Breuil6 suggère que ces couches mixtes peuvent peut-être s’expliquer par la supposition [ p. 270 ] qu’il s’agit ici d’outils moustériens dégénérés ou modifiés, plus ou moins influencés par le contact avec l’industrie aurignacienne de la race Crô-Magnon.
LES OUTILS EN PIERRE CARACTÉRISTIQUES DU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR
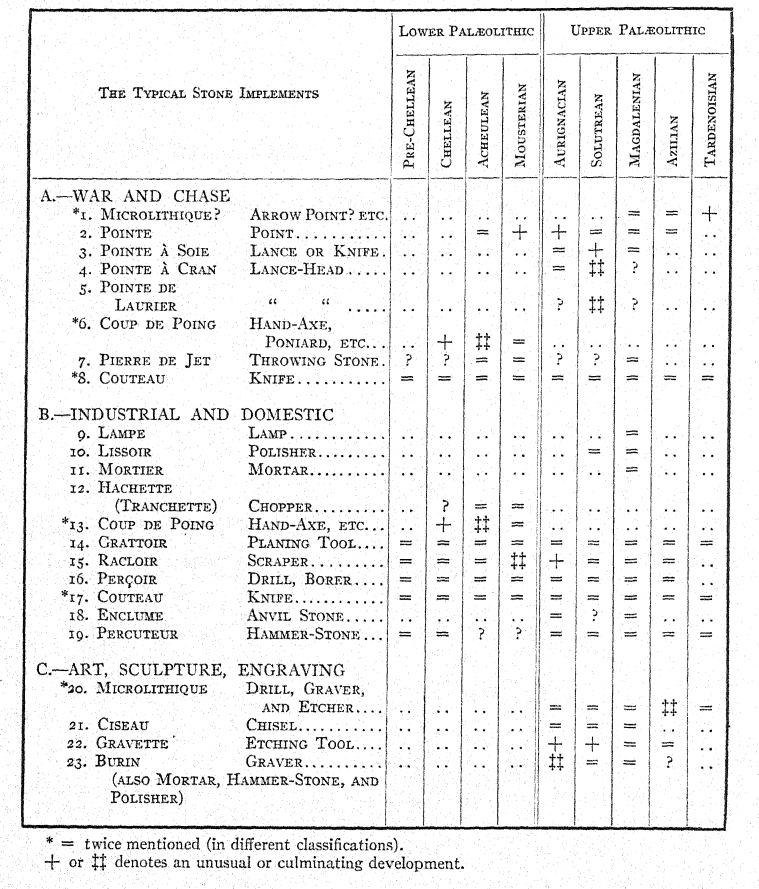
De nouveau, les coutumes funéraires des Néandertaliens étaient à bien des égards suivies par les Crô-Magnons ; ils choisissaient, en fait, le même type de sites funéraires, à savoir, à l’entrée des grottes [ p. 271 ] ou à proximité des abris. Un certain degré de cérémonie a dû marquer ces sépultures, car avec les restes étaient enterrés des instruments d’industrie et de guerre ainsi que des offrandes de nourriture. La plupart des sépultures néandertaliennes se déroulaient avec le corps étendu ; les deux sépultures de la race Grimaldi se déroulaient avec les membres en position fléchie et étroitement liés au corps, probablement avec des vêtements de peau ou des lanières. Les sépultures de Crô-Magnon se déroulent soit avec le corps étendu, comme dans les grottes de Grimaldi, soit avec les membres fléchis, comme dans la sépulture aurignacienne de Laugerie Haute.
LES OUTILS EN OS APPARAISSENT À LA FIN DU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR ET SONT TRÈS CARACTÉRISTIQUES DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
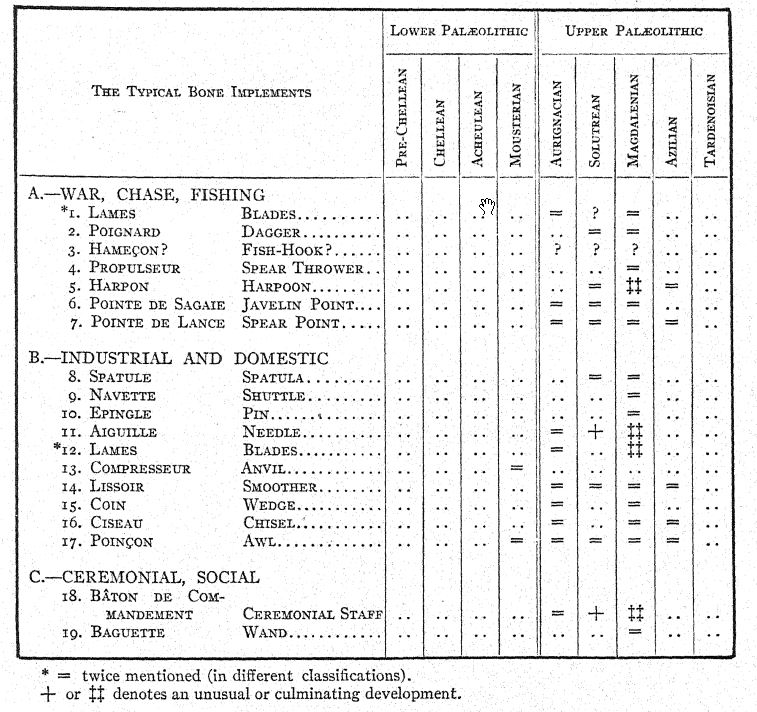
[ p. 272 ]
On ignore si les Néandertaliens furent entièrement exterminés ou chassés du pays ; la rencontre eut certainement lieu entre un peuple très supérieur, tant physiquement que mentalement, qui possédait peut-être l’usage de l’arc et des flèches, et un peuple très inférieur et quelque peu dégénéré, déjà réduit physiquement et peut-être numériquement par les rudes conditions climatiques de la quatrième glaciation. Les Néandertaliens furent dépossédés de tous leurs lieux d’habitation et de leurs installations industrielles par cette nouvelle race vigoureuse, car en pas moins de dix-huit points, l’Aurignacien succède immédiatement à l’industrie moustérienne et, dans quelques cas, des sépultures de Crô-Magnon se trouvent à proximité immédiate des sites néandertaliens.
Dans les remplacements raciaux des peuples sauvages comme des peuples historiques, les hommes sont souvent tués et les femmes épargnées et prises dans les familles des guerriers, mais aucune preuve n’a été trouvée jusqu’à présent que même les femmes néandertaliennes aient été épargnées ou autorisées à rester dans le pays, car dans aucune des sépultures de l’époque aurignacienne, il n’y a de preuve du croisement ou du mélange des Crô-Magnons et des Néandertaliens.
La principale source du changement qui a balayé l’Europe occidentale résidait dans la puissance cérébrale des Crô-Magnons, comme en témoignent non seulement la grande taille de leur cerveau dans son ensemble, mais surtout leur front et leur cerveau antérieur presque modernes. C’était une race qui avait évolué en Asie et qui n’était en aucun cas liée par des liens ancestraux aux Néandertaliens ; une race dotée d’un cerveau capable d’idées, de raisonnement, d’imagination, et d’un sens et d’aptitudes artistiques plus développés que n’importe quelle race non civilisée jamais découverte. Aucune trace d’instinct artistique n’a été trouvée chez les Néandertaliens ; nous avons vu se développer chez eux seulement un sens de la symétrie et des proportions dans la fabrication de leurs outils. Après une étude approfondie des œuvres des Crô-Magnons, on ne peut s’empêcher de conclure que leurs capacités étaient presque, sinon tout à fait, aussi élevées que les nôtres ; qu’ils étaient capables d’une éducation avancée ; qu’ils avaient un sens esthétique et religieux très développé ; que leur société était très différenciée [ p. 273 ] [ p. 274 ] [ p. 275 ] selon le talent pour des œuvres de différents genres. Cette impression découle notamment des conditions de développement de leur art, qui restent encore mystérieuses et dont nous tenterons de donner une interprétation dans le chapitre suivant.
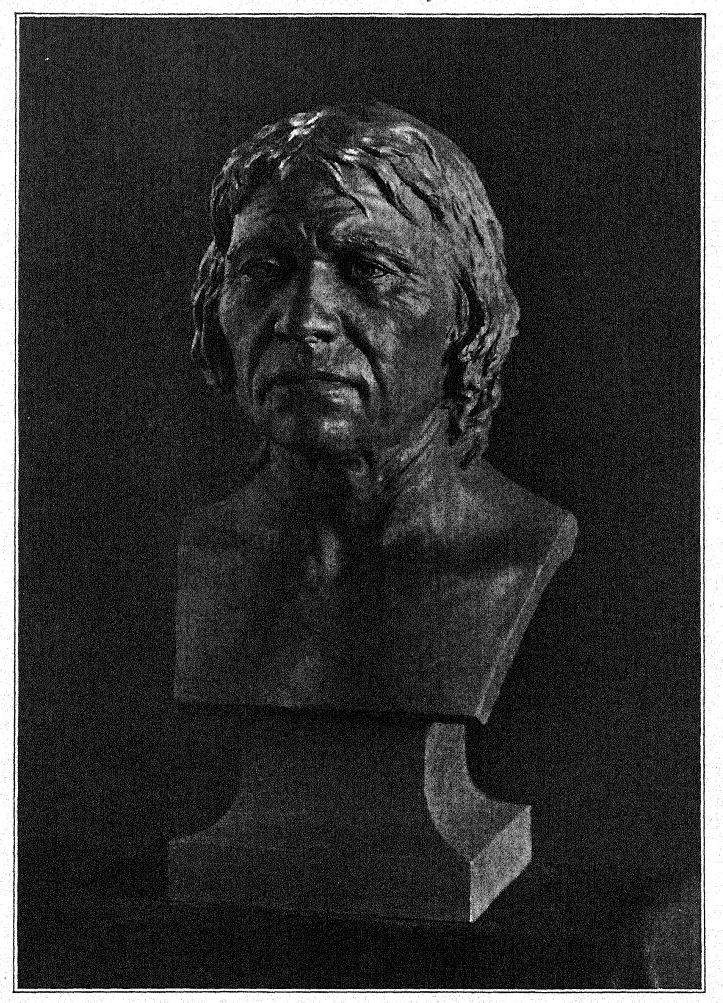
¶ Divisions culturelles, raciales et climatiques
Le Paléolithique supérieur couvre la plus grande partie de « l’Époque du Renne » telle que la concevaient Lartet et Christy, qui commencèrent leur étude et exploration systématiques des grottes de Dordogne en 1863. Ils furent bientôt rejoints par Massenat et le Marquis de Vibraye, tandis que Dupont reprit le travail en Belgique et que Piette fit du développement artistique, notamment dans les Pyrénées, son domaine de prédilection.
Français Lartet fut le premier à percevoir que la culture de la grotte d’Aurignac était tout à fait distincte de celle du Paléolithique inférieur dans le nord de la France ; il reconnut également dans l’abri de Laugerie Haute, en Dordogne, qu’il existait encore une autre culture, qui est maintenant connue sous le nom de Solutréen ; également que dans l’abri de Laugerie Basse, en Dordogne, il existait encore une autre industrie, celle que nous connaissons maintenant sous le nom de Magdalénien. M. de Mortillet fut le premier à reconnaître la supériorité de l’industrie solutréenne de la pierre, qui à cette période atteignit son apogée, et sa succession par la période magdalénienne, dans laquelle l’industrie de l’os et de la corne atteignit un apogée ; mais il ne reconnut pas la position antérieure très importante de l’Aurignacien, et ce n’est qu’en 1906 que la présentation claire par Breuil de l’entière distinction de l’industrie aurignacienne conduisit à l’adoption par le Congrès archéologique de Genève de trois divisions culturelles du Paléolithique supérieur. Entre-temps, Piette avait découvert qu’au Mas d’Azil il y avait une phase culturelle distincte, l’Azilien, suivant le Magdalénien, et ainsi une division quadruple du Paléolithique supérieur (Breuil, Obermaier) fut établie, comme suit :
AZILIEN . — Industrie des Crô-Magnon survivants et d’autres races résidentes, et des races brachycéphales et dolichocéphales nouvellement arrivées en [ p. 276 ] Europe occidentale ; formes décadentes de travail du silex et de l’os ; absence totale d’art. Daun stade de retrait postglaciaire ; Europe avec un climat plus doux et une faune de forêt et de prairie comme celle des premiers temps historiques.
MAGDALÉNIEN . — Fin de l’industrie et de l’art de la race de Crô-Magnon ; outils en os très développés ; déclin marqué de l’industrie du silex. Fin de la période postglaciaire ; climat alternativement froid et humide (correspondant aux avancées postglaciaires de Bühl et de Gschnitz dans la région alpine), ou froid et aride ; Europe couverte de faune de toundra et de steppe ; vie principalement dans les abris et les grottes.
SOLUTREAX . — Stade culminant de l’industrie du silex ; invasion apparente en Europe de l’Est de la race Brünn (Brüx, Predmost et [?] Galley Hill). Industrie du silex hautement développée des types solutréens ; développement artistique de la race Crô-Magnon partiellement suspendu. Climat sec et froid ; vie en grande partie en plein air.
AURIGNACIEN . — Apparition de la race Crô-Magnon dans le sud-ouest de l’Europe, succédant à l’industrie moustérienne ; l’art de la gravure, du dessin et de la sculpture de formes humaines et animales se développe. La vie animale est la même que pendant la quatrième glaciation ; le climat est froid et de plus en plus sec ; la vie se déroule principalement dans les grottes et les abris.
Les phases successives du développement de l’industrie et de l’art du Paléolithique supérieur ont été retracées avec une précision extraordinaire en Dordogne, dans les Pyrénées, dans le nord de l’Espagne, ainsi que le long du Danube et du Rhin supérieur, par une multitude de chercheurs talentueux : Cartailhac, Capitan, Peyrony, Bouyssonnie, Lalanne et d’autres. Breuil s’est particulièrement spécialisé dans l’Aurignacien et a succédé à Piette comme grand historien de l’art du Paléolithique supérieur. Le principal mérite d’Obermaier a été la comparaison du Paléolithique supérieur de la région danubienne avec celui de la Dordogne et du nord de l’Espagne, tant en ce qui concerne l’âge géologique que la succession archéologique et raciale. Les travaux de Schmidt le long du Rhin supérieur et du Danube ont non seulement établi une relation préhistorique certaine entre cette région et la Dordogne et les Pyrénées, mais nous ont également fourni la preuve la plus claire de la relation entre le développement humain et industriel et la succession des phases climatiques en Europe du Nord. Enfin, les explorations de Commont le long de la Somme ont prouvé que cette région, elle aussi, fut fréquentée pendant toute la période du Pahéolithique supérieur, durant laquelle elle présente un développement industriel à peine moins important que celui du Paléolithique inférieur.
[ p. 277 ]
Il existe deux courants de pensée bien distincts chez ces archéologues : le premier se manifeste par la tendance à considérer les industries comme principalement autochtones, ou suivant des lignes de développement locales ; les tenants de cette théorie insistent particulièrement sur les transitions entre les industries moustériennes, aurignaciennes et solutréennes. Par exemple, l’objectif principal de la tournée de Schuchhardt9 à travers les stations paléolithiques de Dordogne était d’observer les transitions d’une période à l’autre et les preuves des changements successifs de climat. L’auteur est impressionné par ces transitions ; il note que les couteaux courbes typiques de l’Abri Audit constituent une transition entre les grattoirs moustériens et les « pointes » aurignaciennes de La Gravette et de La Font Robert ; que le Solutréen reprend tous les fils fins de la culture aurignacienne et les prolonge jusqu’au Magdalénien. On obtient ainsi un cycle industriel aurignacien-solutréen-magdalénien comparable au cycle chelléen-acheuléen-moustérien.
Breuil, en revanche, du point de vue de l’archéologue – car il ne s’intéresse pas particulièrement à la question du développement racial – est un fervent défenseur de l’idée d’invasions culturelles successives, venues soit du sud (région méditerranéenne), soit de la région centrale de l’Europe, qu’il appelle « Atlantique ». Il distingue nettement ces deux grandes zones d’évolution du Paléolithique supérieur, à savoir l’Europe méridionale et l’Europe centrale, soulignant que ce n’est qu’après l’établissement de conditions climatiques plus clémentes, comme celles des temps modernes, qu’est venu s’ajouter un élément d’invasion nordique ou balte. Les témoignages archéologiques corroborent certainement cette hypothèse d’invasion culturelle, et elle semble être renforcée dans une certaine mesure par l’étude des types humains, bien que cette étude n’ait pas dépassé le stade de l’hypothèse. Lorsque les races du Paléolithique supérieur auront été étudiées avec autant d’attention que celles du Paléolithique inférieur, nous serons peut-être en mesure d’établir positivement la relation entre ces types humains et le progrès de certaines cultures et industries.
[ p. 278 ]
¶ Répartition des fossiles humains du Paléolithique supérieur
Notre point de vue actuel, tel que tiré d’un examen des faits qui nous sont présentés, est que l’Europe occidentale à l’époque du Paléolithique supérieur a été envahie par quatre ou cinq races distinctes, toutes appartenant à l’Homo sapiens, dont seulement trois se sont établies.
5. La race Furjooz (Ofnet et [?] Grenelle), à la tête extrêmement large, pénétrant en Europe centrale, probablement depuis l’Asie centrale, apportant une culture Aziiian, sans art ni industrie Hint développée. (Type alpin.)
4. Une race dolichocéphale à face étroite, associée à la race Furfooz, soit liée aux Brünn et aux Brüx, soit à une vague avancée d’une des races dolichocéphales néolithiques. (Type méditerranéen.)
3. La race Brünn (Brüx, Predmost et [?] Galley Hill), à tête longue, au visage étroit et court, entrant probablement en Europe centrale directement depuis l’Asie par la Hongrie et le long du Danube ; apportant une culture solutréenne perfectionnée ; inférieure en développement cérébral aux Crô-Magnons, en contact industriel avec eux mais ne les déplaçant pas.
2. La race Crô-Magnon, à tête longue et visage très large, entrant en Europe à la fin du Moustérien ou au début de l’Aurignacien, probablement du sud le long de la côte méditerranéenne, et apportant une industrie du silex aurignacien et un esprit artistique caractéristiques surtout des époques aurignacienne et magdalénienne ; considérablement réduite en nombre à la fin du Magdalénien, mais laissant des descendants dans diverses colonies d’Europe occidentale.
1. La race Grimaldi, dans la transition entre le Moustérien et l’Aurignacien ; de caractère négroïde ou africain ; apparemment jamais établie comme une race d’influence en Europe occidentale.
Français La présence de ces cinq races, et peut-être d’une sixième si l’« Homme aurignacien » de Klaatsch s’avère distinct du Crô-Magnon, est fermement établie par l’anatomie. Il est de la plus haute importance de garder constamment à l’esprit certains grands principes de l’évolution raciale : (1) que le développement d’un type racial, qu’il ait la tête longue ou large, le visage étroit ou large, de grande ou de petite taille, doit nécessairement être très lent ; (2) que ce développement des races qui ont envahi l’Europe occidentale s’est déroulé pour la plupart vers l’est, dans le vaste continent d’Asie et d’Europe orientale ; (3) qu’une fois établis par un long processus d’isolement et d’évolution séparée, ces types raciaux sont extrêmement stables et persistants ; leur forme de tête, leurs caractères corporels, et surtout leurs caractères et tendances psychiques ne sont pas facilement modifiés ou altérés ; Ils ne sont pas non plus issus d’un croisement à un degré marqué. Les croisements ne produisent pas simplement des mélanges ; ils produisent principalement une mosaïque de caractères distincts dérivés d’une race ou de l’autre.
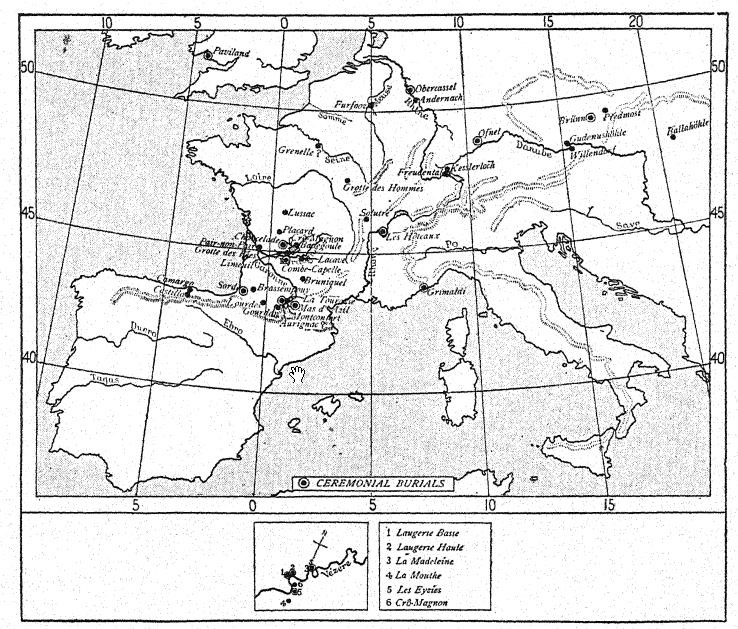
Il faut donc imaginer l’Europe occidentale du Paléolithique supérieur comme une région terminale ; une grande péninsule vers laquelle les migrants humains venus de l’est et du sud sont venus se mêler et superposer leurs cultures. Ces races ont emprunté les grandes routes migratoires qui avaient été suivies par d’autres vagues de vie animale avant elles ; elles ont été poussées à l’arrière par les populations croissantes de l’est ; elles ont été attirées par l’Europe occidentale comme une terre de gibier fraîche et merveilleuse, où la nourriture dans les forêts, dans les prairies et dans les ruisseaux abondait en une profusion sans précédent. Les Crô-Magnons en particulier [ p. 280 ] étaient un peuple nomade de chasseurs, parfaitement adapté par leur structure physique à la chasse et développant une appréciation extraordinaire de la beauté et de la majesté des formes variées de vie animale qui n’existaient dans aucune autre partie du monde à l’époque. Entre les glaciers alpins et scandinaves en retrait, l’Europe était librement ouverte vers les plaines orientales du Danube, s’étendant jusqu’à l’Asie centrale et méridionale ; au nord, cependant, le long de la Baltique, le climat était encore trop rude pour permettre la migration humaine, et il n’y a aucune trace d’homme le long de ces rives septentrionales jusqu’à la fin du Paléolithique supérieur, ni d’aucune résidence humaine dans la péninsule scandinave jusqu’à ce que la grande vague de migration néolithique s’établisse dans cette région.
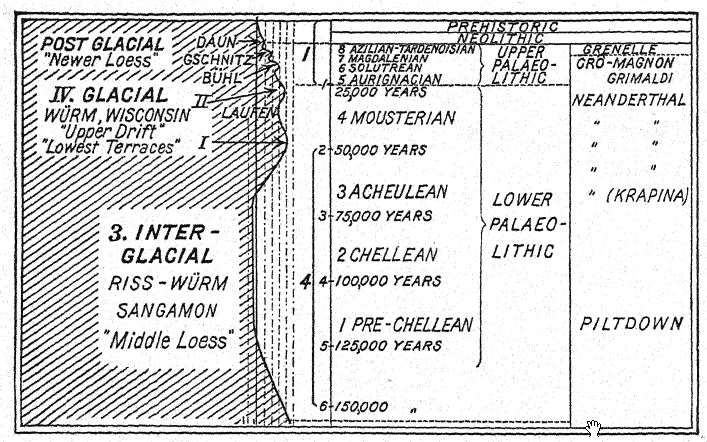
Les relations climatiques et culturelles du Paléolithique supérieur peuvent être corrélées[3] par ordre décroissant comme suit :
[ p. 281 ]
6. Le Daun ou avancée postglaciaire finale des glaciers des Alpes, estimée à 7 000 av. J.-C. L’Europe avec sa faune forestière moderne ou préhistorique, le lion persistant dans les Pyrénées, l’élan en Espagne. L’Aztlien-Tardenoisien, stade final de la culture paléolithique supérieure ; l’Europe occidentale peuplée par la race à tête large des Furfooz et des Ofnet, ainsi que par une race à tête étroite. Migration baltique, culture MAGLEMOSE.
5. L’étape de Gschnitz dans les Alpes ou deuxième avancée postglaciaire. Le climat est encore froid et humide, mais s’atténue progressivement. Déclin du Magdalénien. Période de retrait des animaux de la toundra et des steppes ; les mammouths, les cerfs et les rongeurs arctiques se raréfient ; les mammifères des forêts eurasiennes deviennent plus abondants.
Fin de la période steppique. La race Crô-Magnon est encore dominante en Europe occidentale au Magdalénien tardif.
4. Intervalle entre les avancées postglaciaires de Bühl et de Gschnitz dans les Alpes. Steppe et période de Toess renouvelées. Climat froid et sec. Mammouths et rhinocéros laineux, rennes, faune de toundra et de steppe très abondante. Race Crô-Magnon au stade de culture du MAGDALÉNIEN MOYEN.
3. Le stade Bühl de l’avancée postglaciaire dans les Alpes ; renouvellement des conditions sévères du climat froid et humide, et propagation dans toute l’Europe occidentale des lemmings arctiques rubanés et Obi de la couche supérieure des rongeurs. Les moraines Bühl du lac des Quatre-Cantons sont estimées avoir été déposées entre 16 000 et 24 000 ans avant J.-C. La race Crô-Magnon est dominante au stade culturel du MAGDALÉNIEN ANCIEN.
2. Période du premier intervalle postglaciaire ou retrait Achen des glaciers dans la région alpine, climat froid et sec. Les races Crô-Magnon et Brünn sont au stade de la culture SOLUTRÉENNE.
1. Fin de la quatrième glaciation, entre 24 000 et 40 000 ans avant J.-C. Climat froid et humide, mais de plus en plus sec, succédant à la quatrième glaciation et au dépôt de la Couche Inférieure des Rongeurs, ou première invasion des rongeurs de la toundra arctique. Race Crô-Magnon et peut-être Aurignacienne au stade de culture AURIGNACIENNE.
¶ DÉBUT DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
¶ L’industrie aurignacienne
Nous nous intéressons maintenant à l’Europe occidentale telle qu’elle était il y a 25 000 à 30 000 ans, au début du Paléolithique supérieur.
Français À l’époque aurignacienne, la France était encore largement reliée à la Grande-Bretagne11. Les îles britanniques n’étaient pas seulement unies entre elles, mais aussi au continent, tandis que l’élévation de la péninsule scandinave transformait la mer Baltique en un grand lac d’eau douce, dont les anciennes rives sont facilement retracées. Geikie soutient également que l’élévation des terres en Écosse après la quatrième glaciation s’est accompagnée d’une amélioration du climat et de l’avènement de conditions plus clémentes ; une forte croissance forestière couvrait les basses terres, d’où le nom d’étape du Forestien inférieur de l’histoire physiographique du nord de la Grande-Bretagne ; elle correspond à la période temporaire de retrait des glaciers dans la région alpine, que Penck a nommée Achenschwankung. Ce dernier auteur n’est pas enclin à relier une augmentation marquée de la température dans la région alpine à cet intervalle de temps ; À notre connaissance, aucun gisement fossile de plantes n’a été préservé qui nous fournirait de telles indications, et la vie animale, comme nous le verrons, n’offre certainement qu’une très faible indication d’une augmentation de température lors du retrait vers le nord de certains lemmings de la toundra et des steppes nordiques friands de neige ; la plupart des formes de toundra ont subsisté. L’élévation continentale du littoral nord de l’Europe expliquerait l’avènement d’un climat continental sec et le retour de vents dominants forts, au moins pendant les saisons estivales plus chaudes et plus sèches, car il est certain que des conditions atmosphériques telles que celles qui ont provoqué les grandes tempêtes de poussière et le dépôt de « loess » après les deuxième et troisième glaciations ont de nouveau prévalu en Europe occidentale après la quatrième glaciation. Cela a donné naissance à des dépôts de ce que les géologues appellent le « loess récent », et nous trouvons ces nappes de « loess récent » s’étendant immédiatement au-dessus de la culture moustérienne en plusieurs points de l’Europe occidentale.
Lorsque la race de Crô-Magnon pénétra dans cette partie de l’Europe, le climat devenait plus sec et plus stimulant ; les étés étaient chauds ou tempérés, les hivers très rigoureux. De grandes calottes glaciaires s’étendaient encore sur la péninsule scandinave et aussi sur les Alpes, mais les limites des champs de glace n’atteignaient plus les plaines ; en un sens, l’époque glaciaire n’était pas encore terminée, car pendant toute la période postglaciaire, les glaciers des Alpes, à partir du début du Magdalénien, connurent trois nouvelles avancées, chacune un peu moins vigoureuse que la précédente, avec des étapes intermédiaires de climat plus sec.
La plupart des stations aurignaciennes, comme celles de l’époque moustérienne, se trouvaient sous les abris ou à l’entrée des grottes et des cavernes ; toutes les stations du sud-ouest de la France présentent ce caractère. Il existait cependant un grand camp ouvert à Solutré, qui était une station de chasse au cheval sauvage très réputée à l’époque aurignacienne. Dans le nord de la France, il existe plusieurs stations ouvertes, comme celles de Montières et de Saint-Acheul, le long de la Somme, et à l’est, [ p. 284 ] le long du Rhin moyen, il existe plusieurs stations ouvertes sur le lœss, comme celles d’Achenheim, Volklinshofen, Rhens et Metteriiich. Il se peut fort bien que ces stations ouvertes n’étaient visitées que pendant la douce saison estivale. Le choix constant des sites offrant naturellement la meilleure protection contre les intempéries, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et tout au long du Danube, ainsi que dans la région clémente de la Riviera, est un indice certain d’un climat rigoureux. Il est cependant difficilement possible que les stations fermées ou protégées aient été les seules résidences de ces populations ; elles indiquent simplement les points d’activité continue de l’industrie du silex, ainsi que les vastes foyers et lieux de rassemblement. Mais il ne fait guère de doute, d’après les traces laissées sur les parois des cavernes, appelées « tectiformes », que des huttes et de grands abris construits en rondins et recouverts de peaux étaient regroupés autour de la plupart de ces stations et disséminés à travers le pays aux endroits propices à la chasse et à la pêche. C’étaient les seules habitations possibles dans des camps aussi vastes et ouverts, comme celui de Solutré, par exemple.
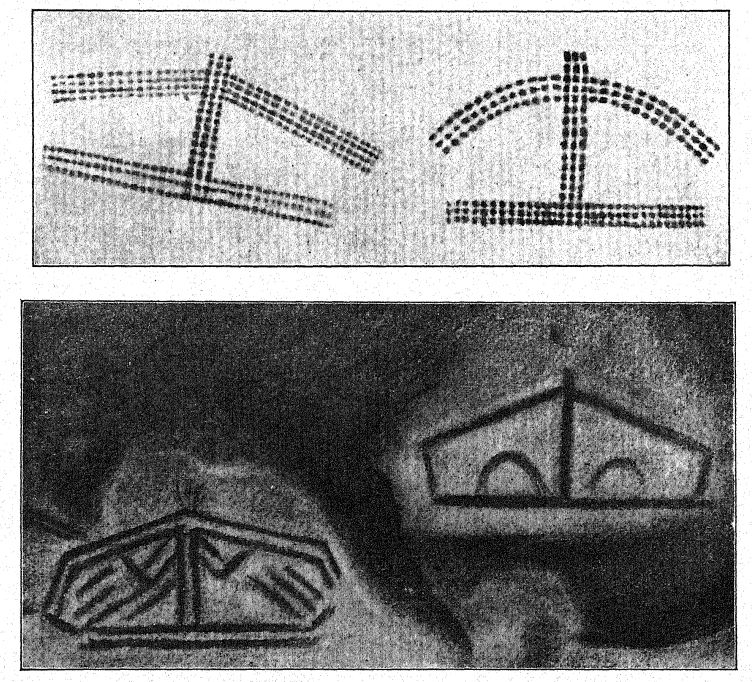
¶ Climat et vie à l’époque aurignacienne
3. Premier retrait postglaciaire, Achenschwankheim, dans la région alpine. Période d’industrie solutréenne. Climat froid et sec, avec tempêtes de poussière et dépôts de loess étendus en Europe occidentale. Les silexiers recherchent de nombreux postes ouverts. Chevaux et ânes sauvages nombreux dans les prairies ; rennes et bovins sauvages très abondants.
2. Retrait des glaciers de la Quatrième Glaciation. Période d’industrie aurignacienne. Climat froid et de plus en plus sec ; renouvellement des tempêtes de poussière et des dépôts de « nouveau loess ». Industrie du silex dans les cavernes, grottes, abris et quelques stations ouvertes. Ouverture du Paléolithique supérieur. Arrivée de la race de Crô-Magnon.
1. Étape finale de la Quatrième Glaciation. Fin de la culture moustérienne du Paléolithique inférieur. Extinction progressive de la race néandertalienne.
L’arrivée de la race de Crô-Magnon et le début de l’industrie aurignacienne ont eu lieu pendant la période de retrait des glaciers de la quatrième glaciation. En passant des niveaux de l’industrie aurignacienne ancienne à ceux de l’Aurignacien moyen et supérieur, nous constatons que la vie mammifère du Moustérien [ p. 285 ] s’est poursuivie à son apogée dans toute l’Europe occidentale, avec l’ajout, une à une, de nouvelles formes venues des toundras, comme le bœuf musqué, et l’arrivée successive, depuis les montagnes et les steppes d’Asie occidentale, d’espèces caractéristiques telles que le mouton argali et l’âne sauvage, ou kiang.
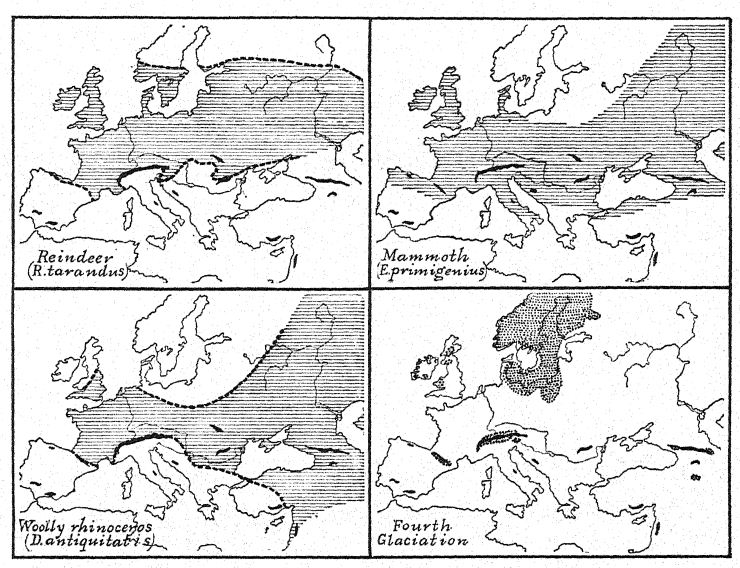
Le climat extrêmement froid et humide de la quatrième glaciation était révolu, et un climat légèrement plus sec, mais toujours extrêmement froid, régnait dans toute l’Europe occidentale. Au début de l’Aurignacien, les deux types de lemmings nordiques, le lemming rayé (Myodes torquatus) et le lemming obi (Myodes obensis), étaient encore présents le long du Danube supérieur, notamment dans les grottes de Sirgenstein, d’Ofnet et de Bockstein. De l’Aurignacien moyen jusqu’au Solutréen, ces habitants de l’extrême nord disparaissent de cette région d’Europe. Plus loin [ p. 286 ] La preuve d’un climat sec et froid se trouve dans la récurrence des tempêtes de poussière et dans les grands dépôts de « lœss plus récent » commençant dans certaines parties de l’Europe à la fin de l’industrie moustérienne et s’étendant à la fois à l’Aurignacien moyen et supérieur et au Solutréen dans toute la région du Rhin supérieur, le long des deux rives du Danube, et vers l’ouest dans la vallée de la Somme, dans le nord de la France. On pense donc que cette période correspond au retrait d’Achen des grands glaciers qui couvrent encore la région alpine.
Une autre preuve frappante de l’amélioration du climat est le retour des silexiers dans de nombreuses stations ouvertes, anciennes et nouvelles, en diverses régions d’Europe occidentale, le climat y étant plus supportable car moins humide. À l’époque moustérienne, les stations ouvertes étaient très rares et n’étaient peut-être visitées que pendant la saison estivale ; à l’époque aurignacienne, elles étaient plus abondantes, avec douze stations ouvertes sur une soixantaine découvertes à ce jour ; à l’époque aurignacienne et solutréenne, la station type de Solutré était très fréquentée, et de nombreux autres camps ouverts se trouvent en diverses régions d’Europe occidentale.
Nous sommes encore à l’époque du renne ; en fait, c’est l’« époque du renne » typique de Lartet, et les formes de vie prédominantes sont le mammouth laineux et le rhinocéros laineux ; mais pendant un temps, le renne semble avoir été moins abondant, et l’Aurignacien est marqué apparemment par une augmentation considérable du nombre de chevaux. La faune conserve partout son caractère nordique ou arctique ; les espèces de la toundra prédominent, suivies par les formes rustiques des forêts et des prairies d’Eurasie, puis par quelques formes steppiques, avec çà et là des formes caractéristiques des Alpes. La faune de l’Aurignacien peut se résumer ainsi :
Français L’âne sauvage, ou kiang, des déserts asiatiques apparaît à la fin de l’Aurignacien dans la région du Rhin supérieur et du Danube supérieur, comme on le voit dans les gisements de Wildscheuer, Thaingen, Kesslerloch et Schweizersbild, et c’est aussi probablement à cette époque qu’est arrivé en Europe l’Elasmothere (E. sibericum), un rhinocéros gigantesque, qui se distingue de tous les autres que nous avons considérés par l’absence totale de corne antérieure et par la possession d’une énorme corne unique située sur le front au-dessus des yeux, ainsi que par les plis élaborés de l’émail dentaire, auxquels le nom ‘Elasmo there’ fait référence ; ses dents étaient particulièrement adaptées à un régime herbeux ; il semble qu’il soit arrivé en Europe depuis les plaines herbeuses arides d’Asie centrale et occidentale, et son apparition est liée à la déforestation extensive accompagnant les périodes de toundra et de steppe de la vie des mammifères.
La vie dans la toundra.
- Renne, mammouth laineux, rhinocéros laineux, bœuf musqué (rare), renard arctique, lièvre arctique, carcajou arctique, lagopède arctique.
- Lemmings bagués et Obi de l’Aurignacien inférieur uniquement.
La vie alpine.
- Mouflon Argali, bouquetin, lagopède alpin.
La vie dans les steppes.
- Cheval des steppes, kiang, âne d’Asie centrale.
La vie en forêt.
- Cerf élaphe, chevreuil, cerf géant, ours brun, ours des cavernes, chat sauvage, loup, renard, loutre, lynx, belette.
La vie dans les prés.
- Bison, bétail sauvage.
La vie asiatique.
- Hyène des cavernes, lion des cavernes, léopard des cavernes.
Ces arrivées périodiques en provenance d’Asie centrale suggèrent l’existence de routes migratoires qui ont peut-être également été suivies par des tribus d’anciens paléolithiques.
Français Il n’y a aucune preuve à cette époque de la présence des animaux les plus caractéristiques des steppes, tels que l’antilope saïga, la gerboise et le hamster des steppes, qui sont entrés en Europe au cours de la période tardive de la culture magdalénienne. Comme indication, peut-être de la sécheresse du climat, nous observons que l’élan (Alces) n’est plus répertorié, bien qu’il réapparaisse en Europe occidentale à la fin de l’époque magdalénienne. Le cerf géant (Megaceros) apparaît dans le sud de l’Allemagne avec la culture aurignacienne ancienne, mais cela semble être l’époque de son extinction, car il n’est associé à aucune des industries ultérieures. Pendant un certain temps, le bison en Dordogne, dans le sud de l’Allemagne et en Autriche semble être beaucoup plus abondant que le bétail sauvage ; ces derniers animaux ne sont enregistrés ni par Schmidt ni par Dechelette en association avec la culture aurignacienne, mais ils réapparaissent dans la période plus humide du Magdalénien.
Les restes de mammifères similaires de la fin du Pléistocène sont dispersés sur une vaste zone en Grande-Bretagne, et nous devons conclure de leur présence, obsen’es Dawkins12, que la Grande-Bretagne était encore largement reliée au continent européen. Ceci est prouvé par la présence de la faune de mammouths dans divers endroits aujourd’hui recouverts par la mer, comme dans le port de Holyhead, au large des côtes du Devonshire et du Sussex, et dans la mer du Nord. Sur le Dogger Bank, l’accumulation d’os, de dents et de bois est telle que les pêcheurs de Yarmouth ont collecté dans leurs filets et leurs dragues plus de trois cents spécimens. Ils appartiennent à l’ours, au loup, à l’hysène des cavernes, au cerf géant, à l’élan d’Irlande, au renne, au cerf, au bison, à l’urus, au cheval, au rhinocéros laineux, au mammouth et au castor, et doivent être considérés comme les restes d’animaux déposés par les courants fluviaux, comme dans le cas d’accumulations similaires sur terre. S’ils avaient été déposés par la mer, ils auraient été tamisés par l’action des vagues, les plus petits étant entassés à un endroit et les plus gros à un autre. Les carcasses avaient manifestement été ramassées dans les remous d’une rivière qui a contribué à former le Dogger Bank, qui s’élève aujourd’hui à moins de huit brasses du niveau de la mer.
L’un des animaux les mieux connus de l’Aurignacien est le « cheval de Solutré ». Autour du grand camp aurignacien de Solutré s’accumulaient les restes d’un grand nombre de chevaux, estimés à pas moins de 100 000 ; les ossements, répartis en un large cercle autour de l’ancien camp, consistent en squelettes brisés ou entiers compactés en un véritable magma, parmi lesquels se trouvent également des restes de rennes, d’urus et de mammouths, entrecoupés de tous les types d’outils aurignaciens. La majorité de ces chevaux appartiennent au type forestier ou nordique, à la tête trapue et aux membres courts, mesurant 137 cm (13,2 mains) au garrot et à peu près la taille du poney actuel. Les articulations et les sabots étaient particulièrement larges, et [ p. 289 ] les longues dents et les mâchoires puissantes étaient adaptées à l’alimentation d’herbes grossières ; la plupart des restes sont ceux de chevaux de cinq à sept ans. Il n’y a aucune preuve que les hommes de l’époque aurignacienne aient élevé ces animaux ; ils les chassaient uniquement pour se nourrir. La découverte que le cheval pouvait être utilisé comme animal de transport semble avoir été faite en Extrême-Orient, et non en Europe occidentale.
La faune et la flore de la station aurignacienne près de Krems, sur le Danube, au-dessus de Vienne,14 comprennent une forte proportion d’espèces de la toundra : le renard arctique, le carcajou, le mammouth, le rhinocéros, le bœuf musqué, le renne, le lièvre et le lagopède. La faune steppique, en revanche, est rare, ne comprenant que le souslik, mais pas l’antilope saïga ni aucun autre type steppique caractéristiques. Les principaux animaux recherchés étaient non seulement le mammouth, extraordinairement abondant, mais aussi le renne et les chevaux sauvages ; le bouquetin est rare.
Obermaier observe que la carte de la distribution géographique de l’Aurignacien montre que cette culture appartient essentiellement aux provinces entourant toute la Méditerranée, de la Syrie (les grottes du Liban) à l’Espagne en passant par l’Afrique du Nord (Alger). Elle connaît également un fort développement dans toute la France, pénétrant en Allemagne centrale et méridionale et longeant le Danube jusqu’en Autriche, en Pologne et en Russie continentale (Mezine), au nord de Kiev. Il ne fait aucun doute que les chasseurs de mammouths de Krems appartenaient à cette vaste distribution ; les coquillages utilisés pour les ornements, qui rappellent indéniablement ceux de la Riviera, ne sont qu’en partie originaires des environs de Vienne ; la plus grande partie provient de la Méditerranée. On peut imaginer que ces coquillages sont passés entre plusieurs mains chez cette race de chasseurs nomades, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la ceinture que l’Aurignacien étendait autour de toute la mer Méditerranée.
¶ Découverte de la race Crô-Magnon
Français La première découverte d’un membre de cette race fut celle de Buckland, dans la grotte de Paviland, qui s’ouvre sur la face d’une falaise calcaire abrupte, à environ un mile à l’est de Rhossilliy, sur la côte de Gower, au Pays de Galles.15 Comme décrit par SoUas, un squelette peint, longtemps connu sous le nom de « Dame rouge », a été trouvé dans le fourneau de cuisine qui forme le sol de cette grotte ; une enquête récente a prouvé que ce squelette appartient à un homme de la race Crô-Magnon ; les outils associés sont de type aurignacien. La grotte de Paviland est donc la première station aurignacienne découverte en Grande-Bretagne et marque l’avant-poste le plus occidental de la race Crô-Magnon.
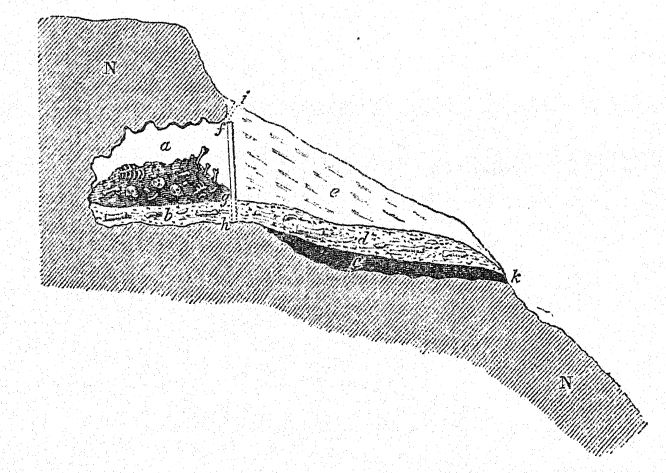
En 1852, la grotte sépulcrale d’Aurignac, sur le contrefort le plus proche des Pyrénées, en Haute-Garonne, fut découverte par hasard par un ouvrier. Elle était presque remplie d’ossements, parmi lesquels deux crânes entiers et de nombreux fragments, soit pas moins de dix-sept squelettes des deux sexes et de tous âges. Le maire d’Aurignac ordonna que tous les ossements soient retirés et réinhumés au cimetière paroissial. Ainsi, en 1860, lorsque Lartet visita cette grotte et la détermina comme le site type d’une industrie distincte, tous les restes humains avaient été perdus, irrécupérables, et avec eux toute possibilité de savoir à quelle race, culture et époque géologique ils appartenaient. Sur une terrasse en pente devant la grotte se trouvait le foyer contenant une centaine d’outils en silex, mêlés aux restes d’une faune typique des rennes.
En 1868, Lartet explora une grotte dans le petit hameau de Crô-Magnon, près des Eyzies, sur la Vézère, où il trouva cinq squelettes, devenus le type de la grande race Crô-Magnon du Paléolithique supérieur. La grotte fut découverte par hasard par des ouvriers construisant une route dans la vallée de la Vézère. Lartet y trouva le squelette d’un vieillard, aujourd’hui connu sous le nom de « vieil homme de Crô-Magnon », puis celui d’une femme dont le front portait la marque d’une blessure causée par un coup violent ; près d’elle gisaient les fragments du squelette d’un enfant et, non loin, ceux de deux jeunes hommes. Des outils en silex et des coquillages perforés furent retrouvés avec ces squelettes.
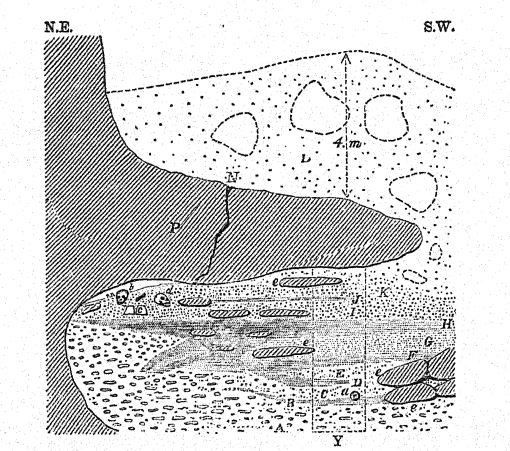
Français En mai 1868, le matériel fut décrit pour la première fois par Broca16, son excellent compte rendu étant plus tard réimprimé et amplifié dans les Reliquiae Aquitanicae de Lartet et Christy17. Broca fit référence à [ p. 292 ] ces squelettes comme des preuves incontestables de l’existence contemporaine de l’homme et du mammouth. La vie mammalienne associée était celle du renne et l’industrie est maintenant connue pour être de l’étage aurignacien. Dans sa description originale classique de ce type, Broca remarque la grande stature, le visage très large par rapport à sa taille, avec des orbites très longues et très étroites ; le crâne large et nettement dolichocéphale, avec une capacité cérébrale inhabituellement grande, notant que la capacité cérébrale de la femme de Crô-Magnon surpasse celle de l’homme moyen d’aujourd’hui ; le front proportionnellement large, vertical, convexe sur la ligne médiane ; les os des membres robustes et les tibias aplatis transversalement ; dans l’ensemble, un type racial très élevé de squelette appartenant à l’espèce Homo sapiens.

[ p. 293 ]
Verneau18, dans sa description du type Crô-Magnon, souligne la forme disharmonieuse de la tête, car la forme dolichocéphale du crâne se combine avec un visage très large pour sa taille, et c’est, en fait, le trait unique et le plus distinctif de la race Crô-Magnon. Les pommettes sont à la fois larges et hautes. Il est curieux que dans ce visage, si large au niveau des pommettes et des arcades pectorales, l’espace entre les yeux soit petit, le nez étroit et aquilin, et la mâchoire supérieure sensiblement étroite ; il n’est pas moins remarquable que cette mâchoire supérieure soit projetée en avant, tandis que la partie supérieure du visage est presque verticale, comme chez les types les plus élevés d’Homo sapiens. Les orbites, qui sont remarquablement larges, sont plutôt peu profondes, et leurs angles ne sont que légèrement arrondis, de sorte que la forme suggère un très long rectangle ; la mandibule est épaisse et forte, et le menton massif, [ p. 294 ] triangulaire et très proéminent ; les marques d’attache musculaire dénotent un grand développement musculaire autour des mâchoires épaisses et fortes, dans lesquelles les parties d’attache des muscles verticaux sont inhabituellement grandes. J’ajouterais, dit Verneau, à ces caractères essentiels la capacité surprenante du crâne, que Broca estimait à au moins 1 590 cm³. La plupart de ces caractères se retrouvent dans presque tous les crânes de la race Crô-Magnon des grottes de Grimaldi. La vue de dessus [ p. 295 ] du crâne est inhabituelle en raison de l’extrême proéminence des éminences des pariétaux, qui donnent au crâne un effet pentagonal lorsqu’il est vu de dessus. Les arcades sourcilières présentent des proéminences marquées au-dessus des orbites mais disparaissent complètement dans la ligne médiane et sur les côtés et diffèrent ainsi totalement de celles de la tête du Néandertalien.
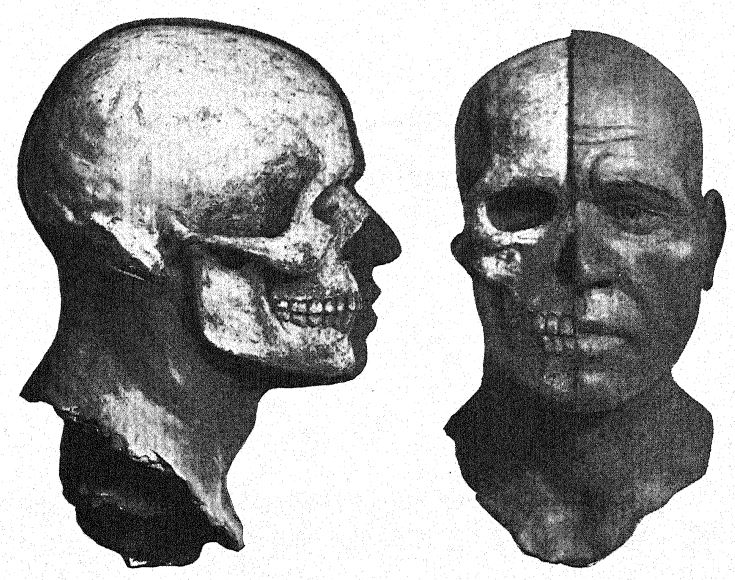
DÉCOUVERTES PRINCIPALEMENT DES RACES CRO-MAGNON ET GRIMALDI[4]
Référé à l’époque aurignacienne
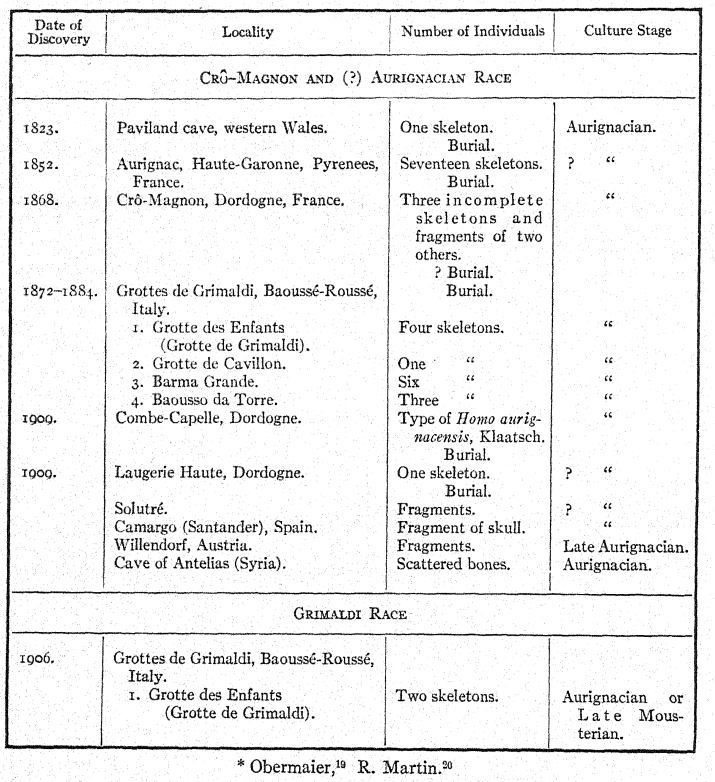
Français Des nombreux squelettes trouvés dans les Grottes de Grimaldi, ou Baousse-Roussé, près de Menton, le premier découvert est le plus connu sous le nom d’« homme de Menton », qui a été trouvé dans la Grotte de Cavillon, en 1872, par Rivière ; c’est pourquoi on parle parfois de la race de Menton ; mais, comme le montre Verneau, bien que les mesures des crânes de Baousse-Roussé montrent une certaine variété, elles ne dépassent pas ce que l’on pourrait attendre en termes de variation individuelle, et nous concluons que tous les hommes de grande taille trouvés dans les Grottes de Grimaldi appartiennent à la race Crô-Magnon, qui ne doit pas être confondue avec la race naine très distincte Grimaldi découverte dans les Grottes de Grimaldi par Verneau, en 1906, à un niveau inférieur à celui de tous les squelettes du type Crô-Magnon.
À l’époque aurignacienne, la haute stature semble avoir été une caractéristique générale de cette race, mais il semble y avoir eu une diminution progressive de la taille, de sorte qu’à l’époque industrielle ultérieure, la race en général est un peu plus petite en taille. Les tailles sont les suivantes :
| Type Crô-Magnon de Dordogne | 1,80 m. | 5 pi 10 3/4 po |
| “ femme légèrement inférieure en taille. | ||
| Baousse-Roussé, Grottes de Grimaldi. | ||
| Mâles adultes de | ||
| Cavillon | 1,79 m. | 5 pi 10 po et demi |
| Barma Grande II | 1,82 m. | 5 pi 11 po |
| Baousso de Torre II | 1,85m. | 6 pi 3/4 po. |
| Barma Grande I | 1,93 m | 6 pi 4 po |
| Grotte des Enfants | 1,94 m. | 6 pieds 4 et demi; dans. |
| Moyenne | 1,87 m. | 6 pi 1 ½ po. |
| Femme de Barma Grande estimée à | 1,65 m. | 5 pi 5 po. |
| Jeune de 15 ans, Barma Grande, estimé à | 1,65 m. | 5 pi 5 po. |
La femme n’avait pas atteint son développement complet. Comme il existe une variation de 6 pouces dans la taille des différents squelettes masculins, il est évident que nous ne pouvons pas tirer de conclusion fiable à partir d’un seul sujet ; mais il semblerait qu’il y ait une disparité de taille assez importante entre les sexes.
Français Le très grand squelette de la Grotte des Enfants, mesurant 6 pieds 4 pouces et demi, a été trouvé associé aux restes du renne, à 15 pieds sous la surface, d’où il semblerait probable que le squelette soit antérieur au squelette aurignacien de Laugerie Haute, et même de Crô-Magnon. Ainsi, le soi-disant homme de Menton pourrait être un ancêtre de la race qui a été trouvée à Crô-Magnon et dans d’autres régions de la Dordogne. Ce sont ces hommes de grande taille, trouvés à Barma Grande et à la Grotte des Enfants, que Verneau choisit pour sa description des membres primitifs de la race Crô-Magnon, qui vivaient à cette époque le long de la Riviera et dans la vallée de la Vézère et se sont ensuite répandus sur une vaste zone en Europe occidentale. Il est probable que dans le climat clément de la Riviera ces hommes ont obtenu leur plus beau développement ; Le pays était admirablement protégé des vents froids du nord, les refuges abondaient et le gibier était loin d’être rare, à en juger par la quantité d’ossements d’animaux trouvés dans les grottes. Dans de telles conditions de vie, la race jouissait d’un excellent développement physique et se dispersait largement.
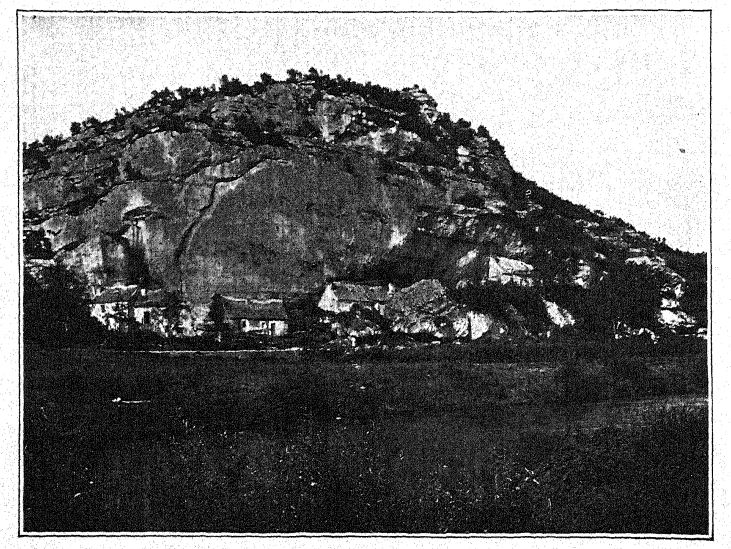
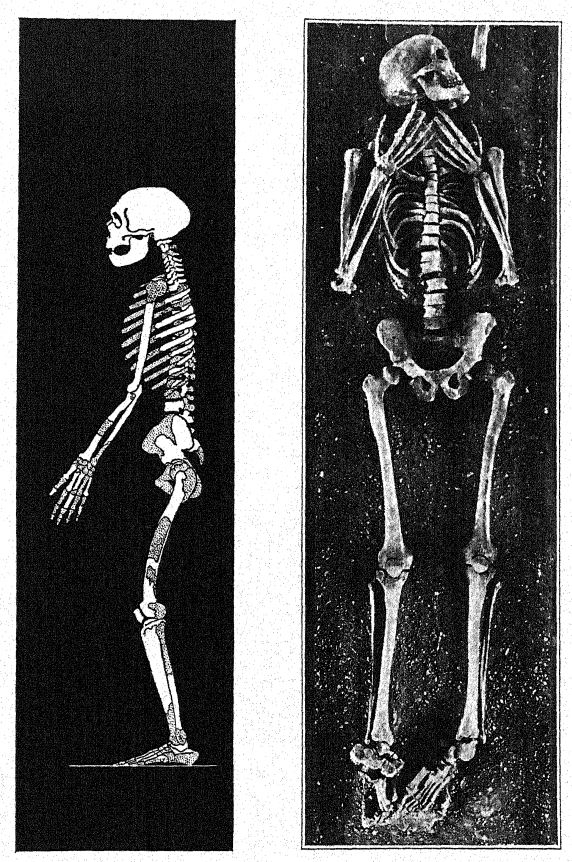
Avec une taille moyenne de 1,95 m, ces hommes des cavernes présentent l’un des traits les plus marquants de la race de Crô-Magnon. Par les proportions de leurs membres et par la grande taille de la partie supérieure de leur poitrine, ces hommes s’éloignent du type européen moderne et se rapprochent de certains types négroïdes africains, bien qu’il n’y ait aucune ressemblance avec le type nègre au niveau du crâne ou de la dentition. Les membres présentent trois caractères différents de ceux des Néandertaliens : la jambe était très longue par rapport au bras ; ils présentent un allongement remarquable de l’avant-bras par rapport au bras et un allongement encore plus remarquable de la jambe inférieure ou du tibia par rapport au fémur ; le tibia présente un indice de 81 à 86 % par rapport au fémur, ce qui est relativement supérieur à celui de l’Européen moderne moyen, avec un indice tibio-fémoral de 79,7 %. Ce long tibia indique que ces hommes avaient le pied rapide, ce qui correspond parfaitement à leurs habitudes nomades incontestables et à leur large répartition. La planéité du tibia, fortement marquée chez 62 % des squelettes, pourrait bien être due à l’habitude de s’accroupir lorsqu’ils travaillaient à façonner des silex et à d’autres occupations industrielles. La jambe, longue par rapport au bras, et le fémur, fortement développé, sont tous deux des caractères d’une race de chasseurs. Le pied a un talon très proéminent, mais la plante du pied et les orteils sont de longueur modérée. La ceinture lombaire est d’un type qui n’a rien de négroïde, mais est aussi fine que celle des Blancs les plus civilisés ; elle se caractérise par sa force, l’augmentation de tous les diamètres verticaux et transversaux, et la réduction des diamètres antéropostérieurs. Les épaules sont exceptionnellement larges. Le fait que les bras soient relativement courts par rapport aux jambes est également un trait caractéristique de la race. Le bras supérieur est très robuste, et dans certains cas, le bras gauche est plus développé, dans d’autres, le bras droit.
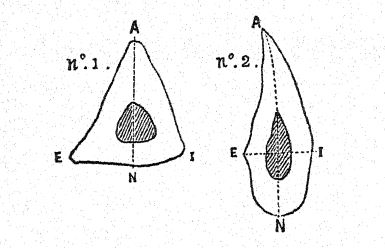
Dans tous les crânes de ces grottes près de Menton, le visage présente les traits essentiels de la race Crô-Magnon, sa largeur étant due au développement des pommettes et des arcades zygomatiques, car les mâchoires supérieures sont étroites et le nez fin ou leptorhinien. À la racine, le nez présente une dépression marquée, mais il s’élève immédiatement et devient considérablement proéminent ; il avait donc sans aucun doute un profil aquilin. Les orbites présentent toujours la forme d’un long rectangle, si caractéristique de la race de la Vézère. Tous ces caractères ne laissent aucun doute sur l’affinité raciale des squelettes des grottes de Grimaldi avec le type Crô-Magnon originel. Il faut donc conclure que certains traits particuliers relevés dans le type du « vieillard de Crô-Magnon » sont purement individuels, et que nous ne sommes pas fondés à supposer l’adjonction d’un élément étranger pour rendre compte de la faiblesse de certains caractères que nous remarquons dans la majorité des sujets de Crô-Magnon des grottes de Grimaldi.
Français Les caractères hautement évolués du squelette de cette race sont en accord avec l’extraordinaire capacité crânienne. Broca estimait que le « vieil homme de Crô-Magnon » avait une capacité crânienne de 1 590 cm³, et chez la femelle, le cerveau est estimé à 1 550 cm³. Vemeau estime que les cinq grands crânes masculins de type Crô-Magnon à Grimaldi avaient une capacité moyenne de 1 800 cm³, le plus bas étant de 1 715 cm³ et le plus haut de 1 880 cm³. Cette race, observe Keith,21 était l’une des plus belles que le monde ait jamais vues. Le visage large et court, les pommettes extrêmement saillantes, l’étalement du palais et [ p. 300 ] une tendance des dents coupantes et des incisives supérieures à se projeter vers l’avant, et le menton étroit et pointu rappellent un type facial que l’on observe surtout aujourd’hui chez les tribus vivant en Asie au nord et au sud de l’Himalaya. En ce qui concerne leur stature, la race Crô-Magnon rappelle les Sikhs vivant au sud de l’Himalaya. Par les proportions disharmonieuses du visage, c’est-à-dire la combinaison de pommettes larges et d’un crâne étroit, ils ressemblent aux Esquimaux. La somme des caractères Crô-Magnon est certainement asiatique plutôt qu’africaine, tandis que chez les Grimaldi, la somme des caractères est décidément négroïde ou africaine.
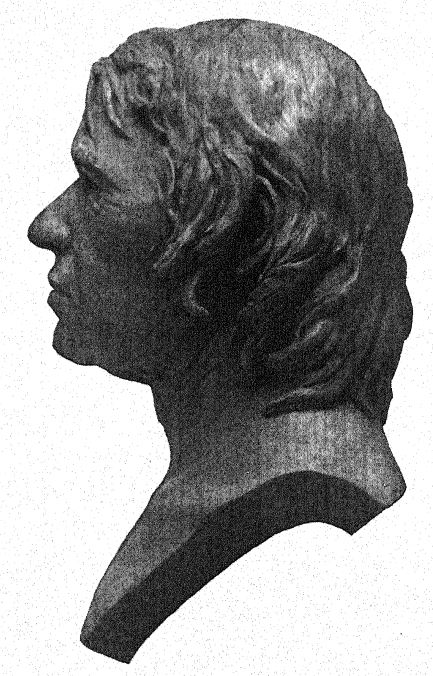
Nous retracerons l’histoire de cette grande race à travers les stades solutréen et magdalénien du Paléolithique supérieur, et nous examinerons sa disparition et sa possible répartition à la fin du Magdalénien. Il sera ensuite intéressant d’examiner les preuves de la survie des descendants de cette race dans diverses régions d’Europe occidentale, et peut-être parmi les habitants primitifs des îles Canaries, connus sous le nom de Guanches.
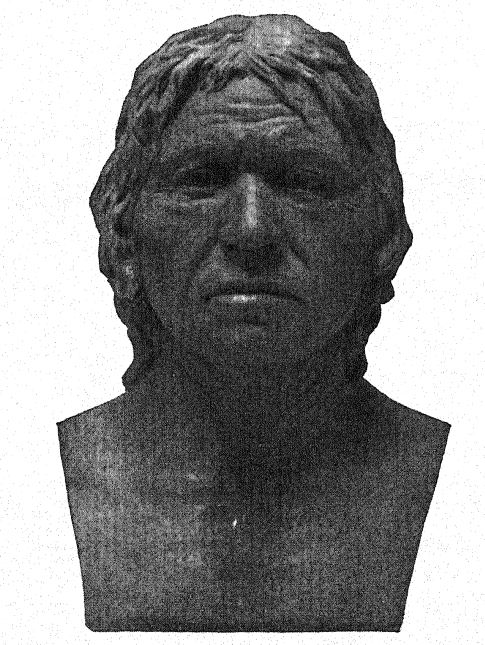
¶ Preuves d’autres races
La question de savoir si les Crô-Magnons étaient les seuls habitants de l’Europe au début de l’Aurignacien ou s’il existait également deux autres races, les Grimaldi et les Aurignaciens, est controversée. Comme nous l’avons vu dans les pages précédentes, rien ne prouve que la race négroïde des Grimaldi se soit jamais établie en Europe ; l’idée de la présence d’une race négroïde a séduit des archéologues comme Breuil et Rutot, cherchant une analogie africaine, égyptienne ou bochimane dans certaines phases de l’art aurignacien ancien ; mais elle ne repose que sur les maigres preuves fournies par les squelettes isolés d’une femme et d’un garçon.
Le cas de la race x\urignacienne est différent ; des anatomistes compétents (Klaatsch22, Keittf23) la considèrent distincte de la race Crô-Magnon et comme présentant une certaine ressemblance avec la race Brünn (Bribe, Predmost, [?] Galley Hill) qui, nous le savons, s’est établie en Europe centrale certainement dès l’époque solutréenne, sinon avant.
La race dite aurignacienne (Homo sapiens aurignacensis), décrite comme une sous-espèce de l’homme actuel, est basée sur un type découvert dans l’abri de Combe-Capelle près de Montferrand, en Périgord, durant l’été 1909 par O. Hauser24. Il est communément connu sous le nom d’homme de « Combe-Capelle » d’après le lieu de sa découverte, ou sous le nom d’homme aurignacien (Homo aurignacensis) ; s’il s’agit d’une sous-espèce, il appartient certainement à l’Homo sapiens. Le squelette d’un mâle adulte a été découvert intact dans la couche la plus basse d’une industrie aurignacienne et a été soigneusement exhumé par Klaatsch et Hauser. Il s’agissait apparemment d’une sépulture cérémonielle ; un grand nombre de silex exceptionnellement fins de type aurignacien ancien ont été trouvés avec lui, ainsi qu’un collier de coquillages perforés (Littorina, Nassa) ; les membres étaient pliés.25 De l’eau saturée de chaux avait coulé sur la sépulture, ce qui a permis la remarquable conservation du squelette. Ce squelette est comparé par Klaatsch à celui de Brünn, en Moravie, et de Galley Hill, près de Londres, d’où il conclut qu’il représente un type distinct, la race aurignacienne ; la taille est de 5 pieds 3 pouces, contre 6 pieds 1 pouces, la moyenne des cinq mâles Crô-Magnon de Grimaldi ; la boîte crânienne est bien arquée et se situe dans les limites de variation de l’Homo sapiens. Le crâne est très long et étroit, l’indice céphalique étant de 65,7 % ; sur certains points, il présente une ressemblance frappante avec celui de Brünn, sur d’autres, il s’en écarte dans le sens de la forme européenne récente ; le visage n’est ni étroit ni prognathe ; la mâchoire inférieure est petite avec un [ p. 303 ] menton bien développé. Klaatsch trouve de nombreuses caractéristiques ressemblant à celles de la race Crô-Magnon, y compris le type Chancelade qui est un Crô-Magnon tardif. Il suggère que le type Crô-Magnon peut être considéré comme un développement ultérieur de l’Aurignacien. Il semble probable que l’homme aurignacien soit un membre de la véritable race Crô-Magnon et que des preuves supplémentaires soient nécessaires pour l’établir comme distinct. Schliz26 considère que ce crâne est une forme intermédiaire entre celui de la race Crô-Magnon et de la race Brünn, une indication que ces deux races ont subi un développement parallèle.
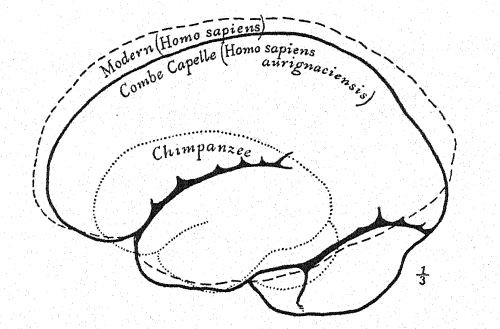
¶ Coutumes funéraires
Des coutumes funéraires similaires prévalaient largement à l’époque aurignacienne, comme l’ont montré l’utilisation de la couleur dans les sépultures de Paviland, dans l’ouest du Pays de Galles, et de Brünn, en Moravie. C’est une caractéristique rarement observée dans les sépultures néandertaliennes, bien que ces dernières soient accompagnées de signes de grande vénération et d’une abondance d’ornements et de silex finement travaillés. Jusqu’à présent, les races du Paléolithique supérieur ont été étudiées avec beaucoup moins de précision anatomique que celles du Paléolithique inférieur, et l’attribution de nombreuses sépultures à la race Crô-Magnon reste à vérifier.
[ p. 304 ]
Nous disposons de peu de traces de la sépulture de Paviland, si ce n’est que le squelette était celui d’un homme de la race Crô-Magnon, de couleur rouge. De la sépulture d’Aurignac, nous n’avons aucune trace, si ce n’est que dix-sept squelettes étaient placés les uns à côté des autres ; il semblerait que cette sépulture composée ait pu être la conséquence d’une bataille ou, moins probablement, d’une épidémie. Les squelettes types de la race Crô-Magnon reposaient simplement à la surface d’un abri profond ; ainsi, un doute a toujours plané quant à leur âge archéologique exact ; un grand nombre de coquillages perforés ont été retrouvés parmi les ossements, ainsi que des pendentifs en ivoire.
Les sépultures de Crô-Magnon les plus remarquables, d’âge aurignacien incontestable, sont celles des grottes de Grimaldi ; les squelettes d’enfants découverts ici ne sont ni colorés ni décorés, mais accompagnés d’un grand nombre de petites coquilles perforées (Nassa), formant manifestement une sorte de manteau funéraire. De même, le squelette féminin était enveloppé dans un lit de coquilles non perforées ; les jambes étaient étendues, tandis que les bras étaient étendus le long du corps ; on y trouvait quelques coquilles percées et quelques fragments de silex. L’un des grands squelettes masculins de la même grotte avait les membres inférieurs étendus, les membres supérieurs repliés, et était décoré d’un gorgerin et d’une couronne de coquilles perforées ; la tête reposait sur un bloc de pierre rouge. Chez « l’homme de Menton », découvert en 1872, le corps reposait sur le côté gauche, les membres légèrement fléchis et l’avant-bras replié ; de lourdes pierres protégeaient le corps des perturbations ; La tête était décorée d’un cercle de coquillages perforés colorés en rouge, et des instruments de divers types étaient soigneusement placés sur le front et la poitrine. De même, dans la sépulture de Barma Grande, trois squelettes ont été retrouvés placés côte à côte dans une couche de terre rouge contenant une grande quantité de peroxyde de fer ; deux des squelettes reposaient sur le côté gauche, les membres étendus ou légèrement fléchis ; le front, la poitrine et l’un des membres étaient entourés de coquillages.
Dans la sépulture de l’Aurignacien de Combe-Capelle, décrite plus haut, les membres étaient tendus et le corps était décoré d’un collier de coquillages perforés et entouré d’un grand nombre de silex aurignaciens fins. Il apparaît que dans toutes les nombreuses sépultures de ces grottes, d’époque aurignacienne et d’industrie de la race de Crô-Magnon, nous retrouvons les normes funéraires qui prévalaient en Europe occidentale à cette époque.
Il faut en déduire que la conception de la survie après la mort faisait partie des croyances primitives, attestée par le dépôt auprès des morts d’ornements, d’armes et, dans de nombreux cas, d’objets de nourriture. Il est intéressant de noter que les grottes et les abris étaient fréquemment utilisés comme lieux de sépulture, et que la position fléchie ou allongée du corps prévalait dans toute l’Europe occidentale jusqu’au Néolithique, de même que l’usage de la couleur du Solutréen au Magdalénien. Il est probable, compte tenu de leur goût pour la couleur dans les décorations pariétales et de l’apparition de matières colorantes dans de nombreuses sépultures, que la décoration du corps vivant était largement pratiquée, et que la couleur était appliquée fraîchement, sous forme de pigment ou de poudre, sur les corps des morts afin de les préparer à un renouveau.
¶ Industrie du silex et de l’os aurignacien
Comme souligné dans l’introduction de ce chapitre, la répartition géographique de l’industrie aurignacienne ancienne est particulièrement intéressante dans son influence sur les voies par lesquelles la race de Crô-Magnon est entrée en Europe. « Nous pouvons difficilement envisager une origine directement orientale », dit Breuil,27, « car ces phases antérieures de l’industrie aurignacienne n’ont pas encore été rencontrées en Europe centrale ou orientale. » Une origine méridionale semble plus probable, car les colonies aurignaciennes semblent entourer toute la périphérie de la Méditerranée, se trouvant en Afrique du Nord, en Sicile et dans les péninsules italienne et ibérique, d’où elles s’étendaient sur la plus grande partie du sud de la France. À Tunis, nous trouvons un Aurignacien très primitif comme celui de l’Abri Audit de Dordogne, avec des outils sans doute similaires à ceux de Châtelperron, en France. Même loin jusqu’à la [ p. 306 ] À l’est, dans la grotte d’Antélias, en Syrie, ainsi que dans certaines stations de Phénicie,28, on trouve des dépôts culturels typiquement aurignaciens. De plus, dans le sud de l’Italie, des outils de forme typiquement aurignacienne, tendant vers le stade supérieur, ont été découverts dans la grotte de Romanelli, à Otrante.
En revanche, la succession directe, décrite ci-dessous, de prototypes aurignaciens et d’outils aurignaciens anciens au-dessus des couches moustériennes plus anciennes dans les différentes stations de Dordogne plaide en faveur de la théorie de l’évolution locale ou autochtone de cette culture. En fait, la relation entre l’industrie aurignacienne et le Moustérien précédent est l’une des plus importantes de l’histoire de l’archéologie paléolithique, en raison du changement de race qui s’est produit à cette époque. Dans quelle mesure est-elle dérivée et autochtone, dans quelle mesure est-elle nouvelle et influencée par l’invasion et l’artisanat d’une nouvelle race supérieure ?
Premièrement, en ce qui concerne la transition avec la culture plus ancienne, il est important de noter que la « retouche aurignacienne » est identique à celle du Moustérien ; cette retouche ne se trouve que sur un seul côté de l’éclat et lui confère un bord court, abrupt et émoussé. Comme nous le verrons, elle est essentiellement différente de celle découverte par les silexiers solutréens et employée à l’époque solutréenne, une technique supérieure qui produisait un bord tranchant et fin, de nombreux outils étant taillés sur les deux côtés. D’autre part, Breuil conclut que l’industrie aurignacienne ancienne ne peut dériver qu’en partie du Moustérien récent et qu’elle est en partie due à l’invasion d’une race dont l’intelligence est bien supérieure à celle des Néandertaliens.
Art.
- Microlithique, microlith.
- Burin, burin (première apparition).
Industriel.
- Coup de poing, main-pierre (rare et dégénéré).
- Pointe, pointe.
- [4:1]Chatelperron (courbé).
- à double pointe.
- Racloir.
- convexe.
- concave.
- droit.
- à double tranchant.
- à triple tranchant.
- Grattoir, outil de rabotage.
- Pergoir, foreuse, tarière.
- Couteau, couteau, lame.
- Enclume, pierre enclume.
- Percuteur, marteau-pilon.
Guerre et poursuite.
- Pointe, pointe.
- Pierre de jet.
- Couteau, couteau, lame.
- Pointe de lance, têtes de lance en os.
L’industrie aurignacienne ancienne pure est visible en Dordogne et dans les Pyrénées, dans les couches de Châtelperron, Germohes, Roche-au-Loup, Haurets et Gargas. La grotte de Gudenushöhle, près de Krems, en Basse-Autriche, présente une phase très primitive de l’Aurignacien ancien. On y a trouvé de nombreux petits silex, semblables à ceux trouvés à Brive par les abbés Bardon et Bouyssonie ; des microlithes similaires se trouvent également à Pair-non-Pair, en Gironde, dans diverses stations de Dordogne et aux grottes de Grimaldi, sur la Côte d’Azur, dans des couches d’âge correspondant.
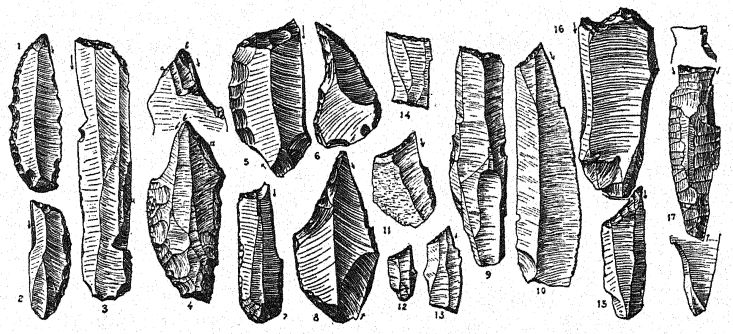
L’invention principale de cette étape est la « pointe de Châtelperron » (fig. 149), une évolution directe de la pointe courbe de l’Abri Audit (fig. 151) et un type dominant de la culture aurignacienne ancienne. De petits « coups de poing » en forme d’amande sont encore présents à Châtelperron et dans quelques autres localités, mais Breuil suggère qu’il ne s’agit peut-être pas de véritables exemples d’industrie aurignacienne, mais d’outils emportés dans des stations plus anciennes.
L’utilisation d’éclats allongés est une autre caractéristique de cette industrie ancienne, mais la retouche des bords n’est pas comparable à la fine « retouche cannelée » de l’Aurignacien moyen ; les éclats sont encore épais et larges. Nombre de grattoirs sont carénés.
Aux éclats de silex triangulaires et allongés taillés en pointes et en grattoirs de formes s’ajoute un instrument entièrement nouveau : c’est le burin primitif, assez rare au début, mais dont on sait qu’il fut conçu par les artistes de Crô-Magnon pour leurs premières gravures sur pierre (fig. 149).
Une quatrième caractéristique très distinctive de l’Aurignacien ancien est l’utilisation d’une variété d’outils en os et en corne, constitués principalement de pointes de javelot et de forets, ainsi que d’outils grossiers ressemblant à des spatules.
Français À l’Aurignacien moyen, l’industrie des éclats atteint sa perfection de forme et de technique ; les bords des éclats sont façonnés tout autour avec la « retouche rainurée », ce qui donne des formes symétriques telles que les « pointes » ovales à double extrémité, les « pointes » en forme de feuille et les doubles grattoirs ; c’est en fait le point culminant de la « retouche aurignacienne », qui commence ensuite à décliner. La retouche des éclats longs est [ p. 309 ] fine et parallèle, mais jusqu’à présent les éclats eux-mêmes sont généralement épais et lourds, de sorte que leurs extrémités sont, par nécessité, beaucoup plus larges que celles de la mode solutréenne et magdalénienne. L’une des formes les plus caractéristiques de cette industrie de l’Aurignacien moyen est le grattoir caréné à retouche brusquement rainurée (Fig. 150).
Outils d’art.
- Microlithique, microlithe.
- Burin, gravé [5]
- Ciseau, ciseau
- Gravette outil de gravure (première apparition). [5:1]
Nouveaux outils industriels.
- Pointe, pointe (en forme de feuille).
- Grattoir caréné, grattoir caréné. [5:2]
- Percoir, forer, trépaner.
- courbé (première apparition). [5:3]
- Couteau, couteau, lame.
- bords incurvés. [5:4]
- Poinçon, poinçon (os).
Nouveaux instruments de guerre et de chasse.
- Pointe à cran, pointe épaulée (pierre).
- Pointe de sagaie, pointe de javelot (os).
Plus significatif encore, en lien avec le rapide développement artistique de ces peuples, est l’augmentation remarquable du nombre et de la variété des outils de gravure, notamment de nombreux burins courbes. Presque tous les principaux types de burins ont été inventés, et les outils en os sont devenus extrêmement nombreux et variés. À la gravure et au dessin linéaire se sont ajoutés l’art de la sculpture et l’utilisation primitive de la couleur (Breufl, Schmidt, etc.).
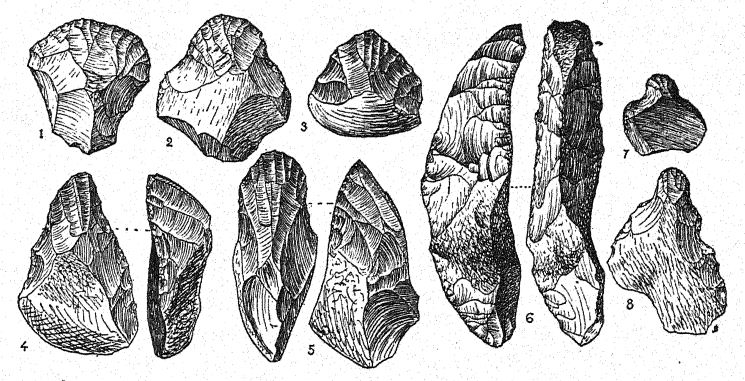
D'après Breuil. Environ deux cinquièmes de la taille réelle. 1, 2, 3. Types courts et larges de l'Aurignacien moyen. 4, 5. Types plus allongés de l'Aurignacien moyen avancé, de Crô-Magnon, en Dordogne. 6. Type allongé (pic) de la fin de l'Aurignacien moyen. 7, 8. Petits graitoirs à manche, adaptés à la sculpture.
En Dordogne, cette évolution de l’Aurignacien moyen est illustrée au Ruth, au Roc de Combe-Capelle et dans les principales couches de l’abri Audit, ainsi qu’à l’abri de Laussel. Elle est également bien développée au Trilobite, en amont de la Seine.
[ p. 310 ]
Art.
- Microlithique, microlith.
- Burin, burin.
- Ciseau, burin (de pierre et d’os)
- Gravette, outil de gravure.
- Pic, pioche (triangulaire ou quadrangulaire, pour sculpture).
Cérémonial.
- Bâton de commandement, bâton de cérémonie (première apparition).
Nouveaux outils industriels.
- Grattoir, outil de rabotage
- long mais pas épais. [6]
- Aiguille, aiguille (os, première apparition).
Nouveaux instruments de guerre et de chasse.
- Types de lances et de pointes de lance, en pierre :
- (a) Pointe à cran, pointe épaulée.
- (b) Pointe à soie, pointe languetée (type Font Robert).
- (c) Pointe de laurier-feuille de laurier(?), pointe(?).
- Couteau, lame (os, première apparition).
À l’Aurignacien récent (Breuil, Obermaier), on observe une nette déviation de la technique moustérienne de taille des éclats ; même la « retouche émoussée » caractéristique de l’Aurignacien est quelque peu atténuée ; mais en même temps, le travail sur les éclats allongés devient plus aisé et plus habile. Pour les travaux délicats et artistiques, on trouve des instruments extrêmement petits, ou « microlithes », de formes variées.
La pointe et le grattoir de l’Aurignacien ancien et moyen, taillés sur tout leur pourtour, ainsi que l’éclat incurvé, deviennent plus rares. Les grattoirs, ou outils à raboter, sont légèrement plus hauts et plus étroits que ceux de l’Aurignacien ancien, mais leur forme n’est pas très différente ; on distingue deux formes de grattoirs : l’un long et peu épais, l’autre haut et caréné.
Parmi les perfoirs une forme courbe est très caractéristique, et on note également une variété de petits couteaux, ou couteaux.
Le génie inventif de ce peuple se manifeste par la variété croissante d’outils en silex destinés à la pêche ou à la chasse. Vers la fin de l’Aurignacien supérieur apparaissent la pointe à cran, ainsi qu’une forme de lance dont les types les plus parfaits ont été découverts à Wniendorf, en Autriche, et à Grimaldi, sur la Côte d’Azur. Plus ou moins sporadiquement, apparaissent des spécimens de pointes à soie, comme celles que l’on trouve à Spy, Font Robert et Laussel. Ce type de silex est constamment associé à des prototypes grossiers de la pointe en feuille de laurier du Solutréen.
L’art décoratif est devenu une passion, et les outils de gravure de formes très variées, courbes, droites, convexes ou concaves, diversifiés tant par leur taille que par leur style technique, sont très nombreux. On peut imaginer que les longues périodes de froid et de mauvais temps ont été mises à profit dans ces occupations. L’utilisation de la corne de renne se développe, et la décoration de l’os par des lignes très fines dessinées par les outils microlithiques est parfois très remarquable. On y trouve les premiers exemples du bâton de commandement, censé avoir servi de bâton ou de baguette cérémonielle ; il est fait de bois de renne et percé d’un grand trou à l’endroit où la dent frontale rejoint la poutre principale ; certains de ces bâtons sont ornés de gravures grossières, mais pas encore de sculpture.
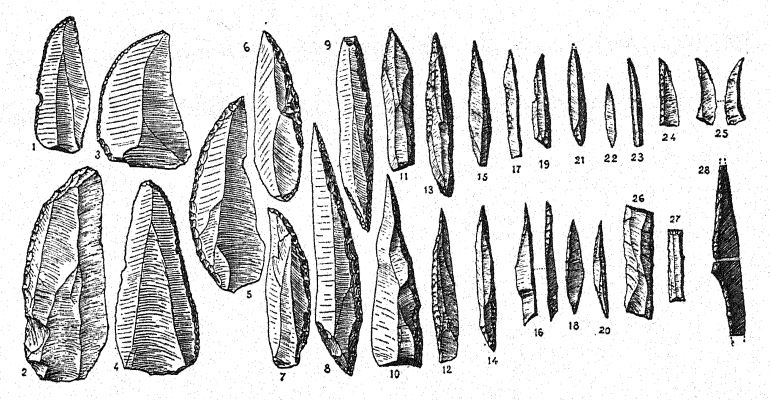
[ p. 312 ]
Des outils de gravure robustes et très tranchants étaient également nécessaires pour la sculpture en ivoire et en stéatite de figures et figurines humaines, telles que les statuettes découvertes dans les grottes de Grimaldi et à Willendorf, et d’outils encore plus puissants pour des œuvres telles que les grands bas-reliefs en pierre de Laussel. À cette époque, les Crô-Magnon fabriquaient également des outils plus robustes pour la gravure d’animaux dans la pierre, pour les bas-reliefs superficiels sur les parois des grottes et pour d’autres silhouettes animales. Les figures animales les plus évoluées de cette période évoquent l’art magdalénien à ses débuts.
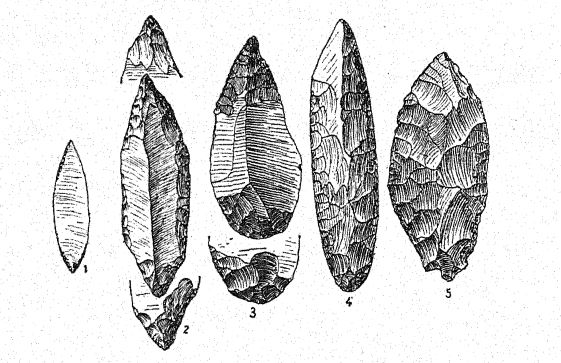
À mesure que cette évolution industrielle s’étend, il apparaît clairement que nous n’assistons pas à l’évolution locale d’un seul peuple, mais plutôt à l’influence et à la collaboration de nombreuses colonies réagissant plus ou moins les unes sur les autres et diffusant leurs inventions et découvertes. Ces peuples étaient essentiellement nomades et transportaient sans doute les outils les plus récents d’un point à un autre ou les échangeaient. Ainsi, il existe non seulement une succession certaine dans des endroits comme la Dordogne, mais dans des régions plus éloignées, la forme des outils peut prendre d’importantes différences.33 Il existe également d’autres localités où l’industrie semble temporairement suspendue ; ainsi, dans les Aurignaciens cantabriques d’Espagne, nous ne trouvons que l’Aurignacien ancien et récent.
Des stations de culture similaire à celle de la Dordogne s’étendent vers le nord en Allemagne et en Belgique, et vers l’est en Autriche et en Pologne. Ainsi, les pointes de lance en silex caractéristiques, connues sous le nom de pointe à soie et pointe à cran, s’étendent de Laussel le long de la Vézère jusqu’à Wiliendorf, en Autriche ; et les figures féminines de Baoussé-Roussé (Grimaldi) et de Wiliendorf représentent le même stade d’évolution que le grand bas-relief en pierre de Laussel. On observe également des relations entre les cultures aurignaciennes d’Autriche et de la péninsule italienne, comme la pointe à cran, dérivée de la gravette et retrouvée à la fois dans diverses stations du nord de l’Italie et à Wiliendorf. En Russie occidentale, la station aurignacienne de Mézine (Tchernigov) montre clairement les types de l’Aurignacien supérieur dans les gravures sur os et sur ivoire, dans les petits bâtons rappelant ceux de Spy, en Belgique, et de Brassempouy, dans le sud-ouest de la France, dans les grands perceurs en os perforés à la tête, suggérant les aiguilles primitives de l’abri de Blanchard, et dans les statuettes dégénérées ressemblant au type de Brassempouy.
¶ Répartition de l’industrie aurignacienne
Français Lorsque l’on compare la répartition géographique générale de l’Aurignacien (Fig. 153) à celle du Moustérien (Fig. 125), on est surpris de constater combien de stations sont identiques ; il semblerait que les Crô-Magnons aient chassé les Néandertaliens de leurs principales stations dans toute l’Europe occidentale pour se consacrer à leurs propres industries et à la chasse. Nous avons déjà parlé de l’invasion des stations moustériennes le long de la Riviera, dans les Pyrénées, dans les Alpes cantabriques, et le long de la Dordogne et de la Somme ; cette occupation s’étend également le long de la Meuse, du Rhin et du Danube ; mais, alors qu’il n’y a que six stations dans toute l’Allemagne d’âge moustérien incontestable, il y en a plus du double à l’époque aurignacienne. Français Les Crô-Magnons pénétrèrent dans les grottes de Sirgenstein et de Rauberhöhle, près des sources du Danube ; au nord-ouest de Sirgenstein, ils établirent la station de lœss ouverte d’Achenheim, à l’ouest de Strasbourg ; dans les couches inférieures du lœss plus récent se trouvait également la station de Volklinshofen, au sud d’Achenheim ; le long du Rhin moyen se trouvaient les stations de lœss de Rhens et de Metternich, et à l’extrême nord, près des limites du glacier scandinave, se trouvait la station aurignacienne quelque peu douteuse de Thiede. Les hommes de Crô-Magnon pénétrèrent dans la grotte de Sirgenstein et éparpillèrent les instruments de leur culture au-dessus de la « couche inférieure des rongeurs », composée du lemming Obi, et laissèrent également des restes de rhinocéros laineux, de mammouth laineux, de cerf et de renne sur le sol de [ p. 315 ] la caverne. L’Aurignacien supérieur s’étend également le long du Danube jusqu’à Willendorf, et peut-être jusqu’à Brünn, en Moravie, ce dernier étant toutefois peut-être d’âge solutréen. Au total, entre dix-sept et vingt stations aurignaciennes ont été découvertes dans la région au nord du Danube et le long du Rhin.
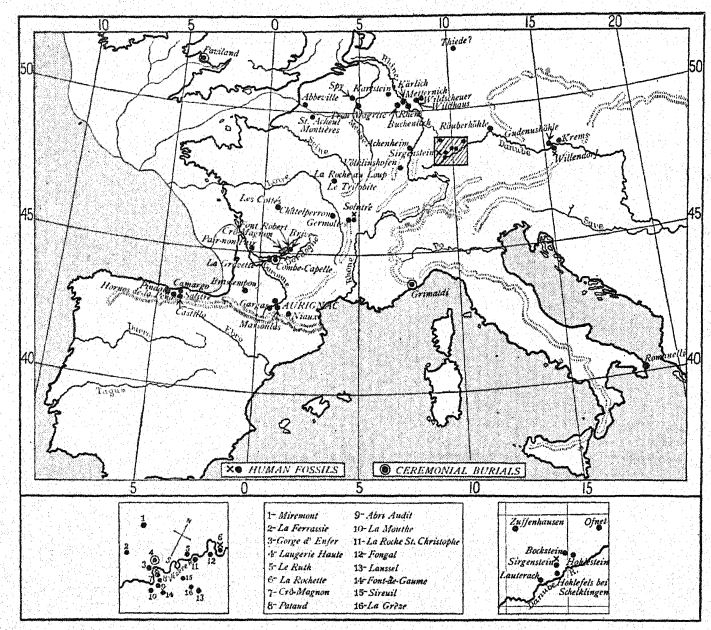
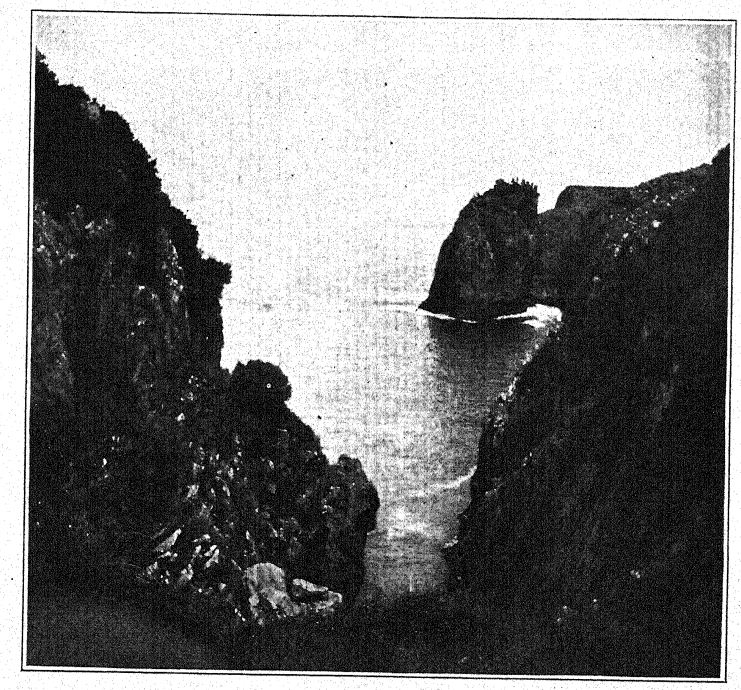
¶ Art aurignacien
La preuve la plus convaincante de l’unité héréditaire, telle qu’elle s’est manifestée chez la race dominante des Crô-Magnons en Europe, du début de l’Aurignacien jusqu’à la fin du Magdalénien, est l’unité de leur impulsion artistique. Cela témoigne d’une unité d’esprit et d’âme. C’est quelque chose qui ne pouvait leur être transmis par une autre race, comme une invention industrielle, mais qui était innée et créatrice. Ces peuples étaient les Grecs du Paléolithique ; l’observation et la représentation artistiques, ainsi qu’un véritable sens des proportions et de la beauté, leur étaient instinctifs dès le début. Leur industrie de la pierre et de l’os peut témoigner de vicissitudes et de l’influence des invasions, du commerce et de l’introduction de nouvelles inventions, mais leur art témoigne d’une évolution et d’un développement continus du début à la fin, animés par un seul motif : l’appréciation de la beauté des formes et leur représentation réaliste.
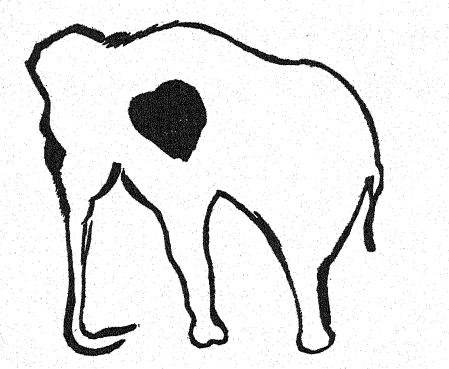
Cet art, découvert par Lartet et révélé par les brillantes études de Piette et Breuil, est industriel (l’art mobilier), consistant en la décoration de petits objets personnels, d’ornements et d’instruments en pierre, en os et en ivoire. Selon les recherches ultérieures de Sautuola, Rivière, Cartailhac, Capitan et Breuil, il est également mural ou pariétal (l’art pariétal), consistant en dessins, gravures, peintures et bas-reliefs sur les parois des cavernes et des grottes. Il restait surtout à Breuil à démontrer que l’art mobile et l’art pariétal sont identiques, l’œuvre d’une même race artistique, se développant selon des lignes très similaires, étape par étape. Ainsi, cet art devient un nouveau moyen non seulement d’interpréter la psychologie de la race, mais aussi d’établir la chronologie préhistorique.
¶ Rencontres avec l’art
L’une des premières questions qui nous vient à l’esprit est la suivante : comment cet art est-il daté ? Comment ces étapes peuvent-elles être déterminées de manière positive ?
Français L’âge de ces motifs gravés ou peints sur les parois des cavernes est déterminé de plusieurs manières décrites par Breuil36. La méthode la plus simple consiste à recouvrir les motifs muraux d’une période par les couches archéologiques des périodes suivantes. Cela a été observé dans quatre cas, comme à Pair-non-Pair, en Gironde, où des gravures primitives de chevaux, de capridés et de bovidés sont enfouies sous des silex caractéristiques de l’Aurignacien récent mêlés à des os de mammouth, de rhinocéros, de lion, d’hyène, de bison et de renne. De même, le bison profondément gravé sur la paroi de la grotte de La Grèze, en Dordogne, se trouve sous un talus de silex solutréens associé à des restes de bison, de renne et de rhinocéros. Dans la grotte de la Mairie, en Dordogne, on trouve plusieurs figures animales du Magdalénien moyen finement gravées, enfouies sous des outils du Magdalénien récent associés à la faune du renne.
L’âge des sculptures et bas-reliefs découverts à Laussel est particulièrement important. Les sculptures humaines sont datées de l’Aurignacien récent, car elles sont enfouies dans un talus du Solutréen ancien. Les splendides sculptures murales de la série de chevaux de l’abri du Cap-Blanc, près de l’abri de Laussel, sont datées du Magdalénien moyen, en raison des couches du Magdalénien supérieur qui les recouvraient et les dissimulaient en partie.
Français Dans d’autres cas, nous pouvons dater un dessin dans une caverne par la période à laquelle l’ouverture a été fermée ; par exemple, la grotte de La Mouthe, en Dordogne, était fermée par une couche de silex magdaléniens qui touchait le plafond et scellait fermement l’entrée jusqu’à une époque récente. De même, à Gargas, dans les Hautes-Pyrénées, nous savons que la dernière occupation par les Crô-Magnon remonte à la fin de l’Aurignacien, comme l’indique un foyer rempli de silex de l’Aurignacien récent et des restes d’un ours, d’une hyène, d’un cheval et d’un renne ; l’ouverture de la grotte était enfouie sous ces foyers, qui obstruaient l’entrée jusqu’à la redécouverte de la grotte à une date relativement récente. Également [ p. 319 ] à Marsoulas, en Haute-Garonne, il existe deux foyers, l’un aurignacien récent, l’autre magdalénien récent ; la grotte a alors été fermée jusqu’à une époque récente. La grotte de Niaux, sur l’Ariège, qui contient de beaux exemples de dessins du Magdalénien moyen à 550 mètres de l’entrée, a été longtemps protégée par un lac de 2 mètres de profondeur et de plusieurs centaines de mètres de longueur. À Altamira, près de Santander, le superbe plafond à fresques a été enseveli, bien avant le Néolithique, par la fermeture de l’entrée, redécouverte il y a seulement une trentaine d’années.
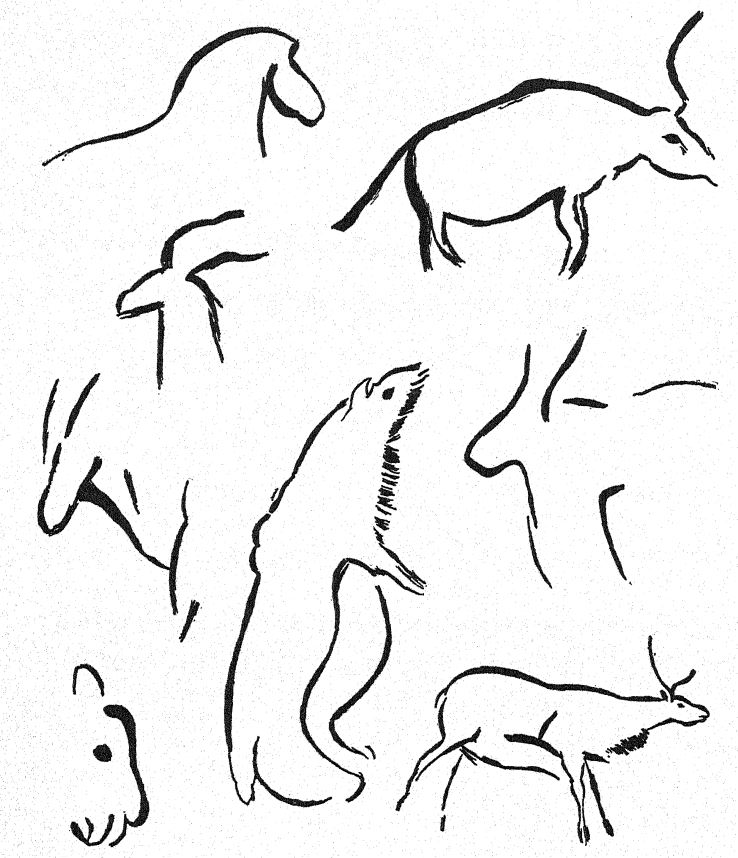
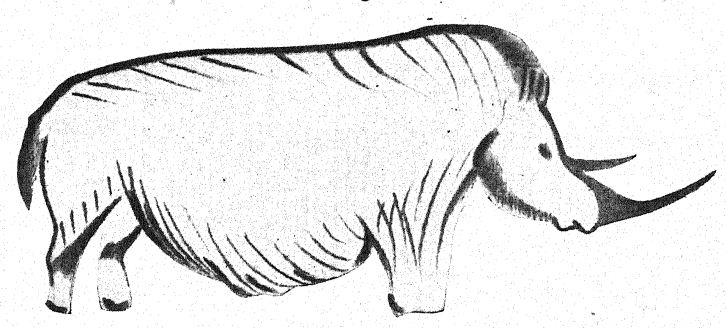
Une troisième méthode de datation de l’art est encore plus significative ; elle repose sur la similitude des gravures sur os, trouvées dans les anciens foyers associés à des silex, avec les décorations murales qui ornent les parois. Ainsi, à Altamira, des gravures sur os associées à des silex solutréens et magdaléniens ont permis à Alcalde del Rio et Breuil de dater les gravures sur les parois calcaires. Ainsi, dans les grottes qui n’ont jamais été fermées et qui ont été fréquentées à différentes époques, du Paléolithique à nos jours, on observe que les motifs muraux des cavernes sont invariablement accompagnés d’outils du Paléolithique supérieur présentant un style de décoration similaire ; c’est le cas à Font-de-Gaume, Combarelles, Portel, Mas d’Azil, Castillo, Pasiega et Hornos de la Peña. Les gravures sur os [ p. 320 ] des cerfs femelles trouvés à Altamira sont identiques dans leur période artistique à ceux trouvés sur les parois de la même grotte. Les fouilles de Castillo, où de nombreuses omoplates de cerf ont été trouvées gravées dans le même style que celles d’Altamira, prouvent que toutes ces gravures et dessins doivent être attribués au Magdalénien ancien plutôt qu’au Solutréen supérieur. Les gravures sur les parois de la grotte de Hornos de la Peña, d’époque aurignacienne, sont datées grâce à la découverte à la base de la couche de silex aurignaciens d’une figure équine gravée similaire aux gravures d’Altamira.
Une quatrième méthode s’applique aux cas assez fréquents où deux ou trois dessins se superposent, d’où il résulte nécessairement que les dessins sous-jacents doivent être antérieurs à ceux qui précèdent.
Grâce à l’application de ces quatre méthodes, Breuil a réussi à dater toutes les étapes de l’évolution de l’art depuis l’Aurignacien jusqu’au Magdalénien.
¶ Gravure, peinture et sculpture

Dans les dessins archaïques des cavernes de Pair-non-Pair, de La Grèze et de La Mouthe, la plupart des figures animales sont assez lourdes et profondément gravées ; les proportions sont inexactes ; la tête est généralement trop petite, avec un corps large et court, souvent légèrement modelé, reposant sur des extrémités fines. Les quadrupèdes sont fréquemment représentés avec seulement deux pattes, comme dans le cas du mammouth. Que les capacités d’observation ne se soient développées que progressivement, c’est ce que montre le fait que des détails bien observés dans les dessins ultérieurs sont ici négligés ; les dessins de profil des animaux, avec une patte antérieure et une patte postérieure représentées, ressemblent beaucoup à ceux des enfants.
Les progrès vers une représentation fidèle de la forme animale dans le dessin commencent très tôt ; même à l’Aurignacien moyen, le dessin et la gravure primitifs commencent à remplacer la sculpture. Les burins en silex et les gravures sur les parois des grottes montrent que les débuts du dessin peuvent être [ p. 321 ] retracent le début de l’Aurignacien. Alors que les artistes paléolithiques du début de l’Aurignacien avaient acquis une certaine aisance dans le travail plastique, leurs dessins, qui ne sont que des contours — des lignes quelque peu imparfaites et profondément gravées — montrent un développement progressif. Le degré d’habileté atteint à la fin de l’Aurignacien est connu par la gravure d’un cheval sur un fragment de pierre de Gargas, et par un croquis de l’arrière-train d’un cheval trouvé dans la grotte de Hornos de la Peña, qui est gravé sur l’os frontal de l’un des chevaux sauvages ; cette dernière présente une ressemblance frappante avec l’une des gravures trouvées à l’entrée de la même grotte. Les gravures sur une dalle d’ardoise représentant les têtes de deux rhinocéros laineux37 (fig. 161) appartiennent probablement à l’Aurignacien récent. Des tentatives similaires se trouvent à l’abri Lacoste. L’ornementation se développe à l’Aurignacien moyen, mais conserve un caractère géométrique simple.
L’art pariétal des parois des cavernes, principalement des gravures profondes, consiste en des profils rigides en traits simples, de couleur rouge ou noire. Les animaux représentés sont le bouquetin, le cheval, le bison et, plus rarement, le mammouth. Les grottes où l’on trouve ces animaux sont Pair-non-Pair, La Grèze, La Mouthe, Bernifal, Font-de-Gaume, Altamira et Marsoulas. Des creusets permettant de moudre la couleur se trouvent dans la grotte de Marsoulas, la couleur étant obtenue par broyage d’oxydes de fer rouges et jaunes.
Le développement de l’art pendant tout l’Aurignacien est continu et est sans doute l’œuvre d’une seule race ; Breuil le considère comme l’œuvre certainement soit des grands Crô-Magnon, soit des petits Grimaldi ; il n’y a cependant aucune preuve de la survie de la race Grimaldi, et nous pouvons sans risque attribuer tout ce développement artistique aux Crô-Magnon.
[ p. 322 ]
L’esprit créatif s’est manifesté de multiples façons. Avec le façonnage de l’os, au début de l’Aurignacien, naît une nouvelle industrie aux possibilités immenses ; des combinaisons de lignes donnent naissance à des figures géométriques ; chez les figures animales, on tente des relations symétriques simples, mais sans parvenir à une composition libre et complète. Par la suite, avec le travail de l’os et de l’ivoire, on trouve, à l’Aurignacien moyen, les premières représentations plastiques de la figure humaine en ronde-bosse.
L’artiste de Crô-Magnon a entrepris cette œuvre pieuse, choisissant principalement comme sujet la figure féminine. Ces petites figurines en plastique sont probablement conçues comme des idoles ; les figures sont souvent difformes ; sur le visage, les yeux sont souvent absents ; dans certains cas, l’oreille est indiquée ; elles rappellent le style des cubistes modernes. La sculpture du corps est plus soignée que celle du visage. La statue en ivoire connue sous le nom de Vénus de Brassempouy se situe à la base de l’Aurignacien moyen ; de la même époque sont les statuettes féminines de Sireuil et le torse de Pair-non-Pair, tandis que la figurine en stéatite de Menton et les statuettes en ivoire de Trou Magrite, en Belgique, appartiennent à l’Aurignacien récent. La diffusion de ces idoles, caractéristiques de la période antérieure du Paléolithique supérieur, est retracée vers l’est jusqu’à Willendorf, en Autriche, et à Brünn, en Moravie.
La principale affirmation de Breuil est une certaine similitude avec l’art nord-africain, ce qui semblerait concorder avec sa théorie selon laquelle le peuple de Crô-Magnon a suivi les rives méridionales de la Méditerranée, apportant avec lui l’industrie aurignacienne et l’art glyptique des statuettes féminines semblables à celles en terre cuite [ p. 323 ] que l’on trouve le long de la vallée du Nil. Ces figurines ont en commun le grand développement de toutes les parties liées à la maternité et, dans certains cas, une coiffure ou une coiffe très semblable à celle que l’on trouve dans les œuvres égyptiennes les plus primitives. L’extrême corpulence de toutes les figurines a été comparée à la « stéatopygie », ou développement de ce que l’on appelle poliment les « courbes postérieures », de la femme dans de nombreuses races africaines. Mais une seule de ces figurines aurignaciennes est véritablement « stéatopyge » ; les autres sont simplement corpulents, un état dû à une consommation importante de graisse et de moelle osseuse, et probablement à une vie très sédentaire. Il est à noter qu’aucune des figures masculines dessinées et sculptées n’est corpulente. Si l’art des statuettes semble s’être arrêté à la fin de l’Aurignacien, il pourrait s’étendre au Solutréen à Brünn, en Moravie, et à Trou Magrite, en Belgique. Compte tenu des analogies, il semble plutôt probable que cette sculpture archaïque soit autochtone.


[ p. 324 ]
L’art de la gravure et du dessin était presque certainement autochtone, car on en retrouve la trace dès ses débuts les plus rudimentaires. Cet art nordique s’est développé dès le début du Paléolithique supérieur sur tout le sud-ouest de la France et le nord-ouest de l’Espagne, contemporain de l’arrivée de la faune alpine des Pyrénées et des Alpes et de la présence de la faune de la toundra dans toute l’Europe occidentale. Il s’agissait, par préférence, d’un art animalier, initié par les Aurignaciens, mais largement suspendu au Solutréen.
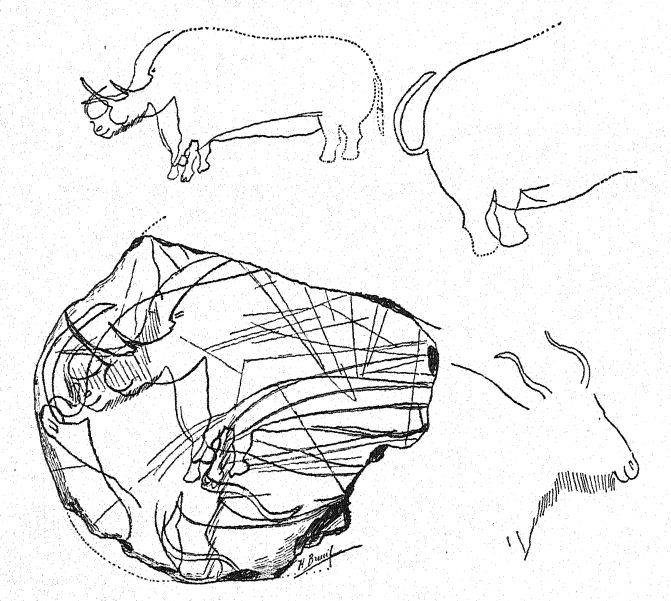
La peinture38 a également vu le jour à l’Aurignacien, avec les contours simples de la main pressée contre une surface murale ou soulignée de couleur, accompagnés de tentatives primitives de dessin linéaire en couleur et de groupements peints ; par exemple, les contours bruts du bison de la grotte de Castillo sont d’âge aurignacien, ainsi que les [ p. 325 ] dessins linéaires noirs du cerf et du bouquetin de la caverne de Font-de-Gaume, en Dordogne, le dessin linéaire rouge saisissant du mammouth de la grotte de Pindal, dans le nord de l’Espagne, représentant l’animal comme avec deux membres, et les contours rouges du bétail sauvage de Castillo. Breuil attribue également à l’époque aurignacienne la figure fougueuse du rhinocéros laineux en ocre rouge de la grotte de Font-de-Gaume, ainsi que le contour du cerf en rouge.
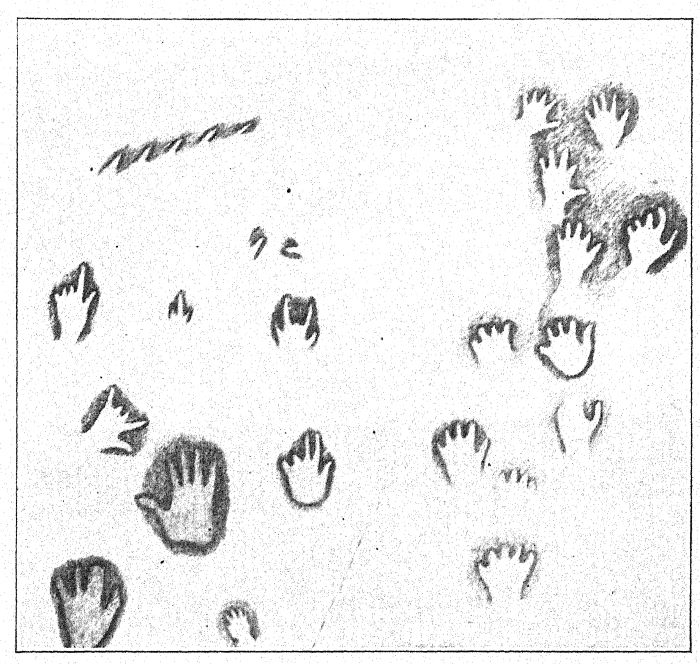
Nous sommes impressionnés par trois qualités dans ce dessin aurignacien : premièrement, l’observation très précise de la forme animale ; deuxièmement, la tentative d’effet réaliste produite avec très peu de lignes ; troisièmement, l’élément de mouvement ou de mouvement [ p. 326 ] chez ces animaux. Par exemple, les deux têtes du rhinocéros laineux dans les gravures sur dalle de la grotte des Trilobites (Fig. 161) sont remarquablement correctes en proportion ; il y a une tentative avec des lignes fines pour indiquer la laine qui pend le long de la surface inférieure de la tête ; derrière ces deux figures se trouve la croupe d’un éléphant avec la queue relevée, une adaptation de l’artiste à la forme du fragment d’ardoise ; les contours des pieds du rhinocéros et du mammouth sont des représentations remarquablement précises de ces pachydermes.
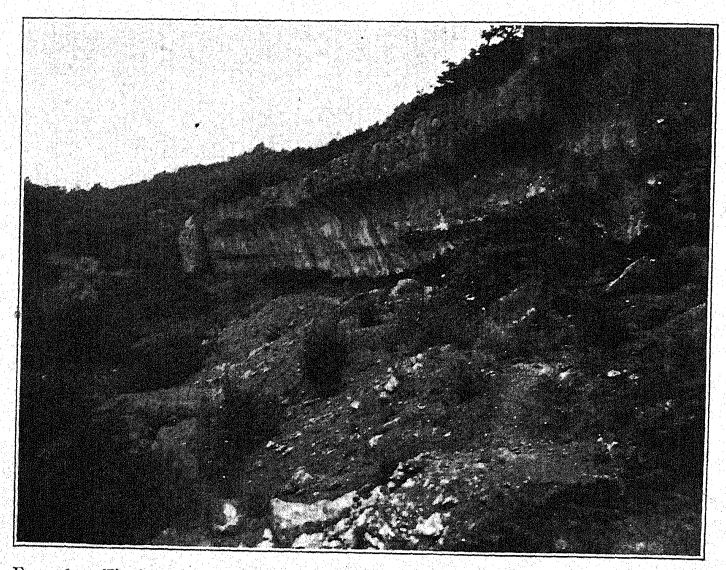
Dans le développement plus avancé du dessin à la fin de l’Aurignacien, les gravures de ces animaux non seulement se rapprochent de la vérité, mais les traits caractéristiques sont représentés de manière frappante ; et avec quelques lignes sûres, les proportions du corps dans son ensemble sont mieux préservées, tandis que les courbes compliquées des sabots et de la tête montrent une observation très attentive.
[ p. 327 ]
Dans la grotte de La Grèze, surplombant la Beune, petit affluent de la Vézère, on a découvert une silhouette aurignacienne archaïque de bison, profondément incisée sur les parois de pierre. La grotte de Gargas[8], dans les Hautes-Pyrénées[39^], est l’une des stations les plus célèbres ; on y a pénétré à la fin du Moustérien et on l’a occupée par intermittence pendant l’Aurignacien. Sous la couche moustérienne se trouve un dépôt profond de squelettes entiers d’ours des cavernes, sans aucune trace d’activité humaine. Ces couches se trouvent au-delà de la grotte, dans le vaste foyer qui s’ouvre au-dessus sur une grande cheminée, ce qui en fait l’une des véritables habitations cavernicoles. Les dessins le long des parois de la grotte comprennent un grand nombre de figures de style très inégal, qui appartiennent principalement à l’Aurignacien moyen et supérieur. Parmi celles-ci figurent deux figures d’oiseaux, plusieurs mammifères, quelques dessins primitifs de bovins sauvages, de bisons, de bouquetins et de nombreuses représentations de chevaux. Une longue bande colorée serpente parmi certains de ces dessins. Les silhouettes de la main, en noir et rouge, obtenues en la pressant contre le mur de calcaire et en recouvrant la surface environnante de couleur, sont particulièrement intéressantes. Il semblerait que les doigts aient été mutilés ou coupés au niveau de l’articulation médiane, car un, deux, trois et quatre doigts manquent, mais le pouce n’est jamais mutilé. Cette mutilation de la main peut être comparée à des pratiques similaires pratiquées dans certaines tribus australiennes.
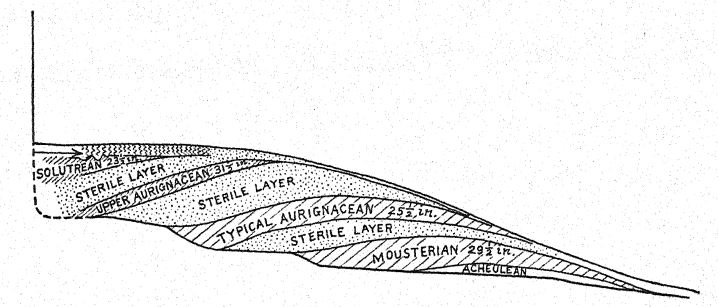
Dans la grotte de Marsoulas, à la source de la Garonne, les conditions sont tout à fait différentes ; l’art pariétal y représente deux stades culturels : l’Aurignacien récent et le Magdalénien récent. Une petite grotte d’entrée, dotée de deux foyers, correspond à ces deux industries. L’entrée de la grotte est située en hauteur, à flanc de colline, et les dessins appartenant à la culture aurignacienne supérieure sont quelque peu endommagés. On retrouve également des motifs qui s’étendent le long de la paroi, sous les dessins. On y trouve de nombreux contours du bison en noir, le côté entier du corps étant recouvert de taches rouges.

Le grand abri de Laussel, sur la Beune, fut visité pour la première fois par les Néandertaliens. On y trouve deux niveaux moustériens, surmontés de deux niveaux aurignaciens : le niveau inférieur appartient à l’industrie aurignacienne moyenne et le niveau supérieur à la fin de l’Aurignacien. Cette longue falaise en surplomb de Laussel est un abri typique, d’abord recherché à l’Acheuléen, revisité au Moustérien, puis à nouveau à l’Aurignacien moyen ou récent, au Solutréen, et enfin au Magdalénien. À mesure que ces niveaux s’élèvent, ils se rapprochent de l’abri de la falaise, de sorte que les silexiers magdaléniens se trouvaient directement sous l’abri sous-roche, ouvert vers l’extérieur et le soleil.
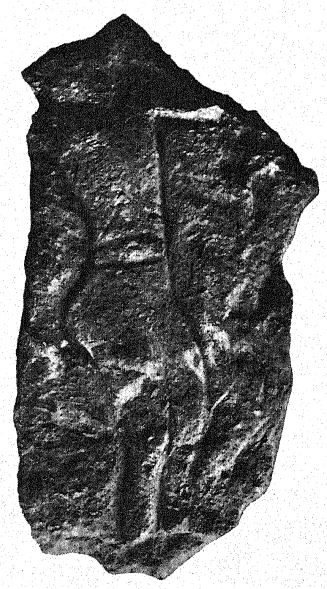
Dans la couche aurignacienne supérieure, Lalanne a découvert deux bas-reliefs représentant les figures d’un homme et d’une femme. Le bas-relief de la femme représente une figure nue tenant la corne d’un bison dans la main droite ; il est taillé dans un bloc de calcaire avec un relief d’environ deux centimètres, et il mesure quarante-six centimètres de haut ; à l’exception de la tête, le corps entier est poli, et à certains endroits il reste des traces de coloration rouge. Un peu plus loin, l’artiste avait modelé la figure d’un homme de trois quarts dans l’attitude de lancer une lance ou d’un archer bandant l’arc ; le sommet de la tête et les extrémités des membres ont été arrachés ; la figure mesure quarante centimètres de haut. Ces bas-reliefs de Laussel sont considérés comme des représentations sincères, car l’artiste a représenté aussi fidèlement que possible la figure humaine contemporaine ; L’homme et la femme sont tous deux représentés en mouvement. Concernant la technique employée dans cette sculpture primordiale, le docteur Lalanne observe que l’on trouve à Laussel une série d’outils parfaitement adaptés pour obtenir ce résultat, dont beaucoup auraient été inexplicables s’ils n’étaient pas liés à la sculpture elle-même. Il est curieux de constater le nombre d’analogies entre les ustensiles en silex du sculpteur primitif et ceux des sculpteurs d’aujourd’hui. On trouve d’abord des outils destinés à enlever la roche, des pointes, des pioches, des hachoirs pour façonner la roche, des scies et des rabots grossiers ; tous ces outils sont parfaitement adaptés à la main, ce qui nous permet de conclure que notre artiste était droitier. Il existe un grand nombre d’outils à graver, ou burins, toutes formes étant représentées : simples, doubles, fins, grossiers, et des combinaisons du burin et du grattoir. Certains burins présentent la pointe à angle aigu centrée à l’extrémité d’une lame ; ce sont les types courants ; mais dans beaucoup, la lame se termine par une retouche terminale, qui peut être transversale, oblique, concave ou convexe, la pointe étant orientée d’un côté. Les grattoirs, ou rabots, sont tout aussi nombreux, avec des exemples de toutes les formes connues. Nombre d’entre eux sont formés à l’extrémité d’une lame ; quelques-uns sont circulaires, et d’autres se trouvent à l’extrémité opposée d’une lame pointue ; ces derniers sont particulièrement fins et sont retouchés sur tout le pourtour. Mais l’artiste ne se contentait pas de sculpter ses sujets ; il les enduisait également d’une peinture à base d’ocre et de manganèse ; il écrasait sa matière colorante sur une palette de schiste, et nous en avons retrouvé une intacte, portant encore les couleurs rouge et ocre. Cette palette mesure 25,4 cm de long et 15,2 cm de large ; elle est de forme oblongue.
¶ Répartition de l’industrie solutréenne
La période de l’industrie solutréenne est l’une des plus difficiles à interpréter de toute la préhistoire de l’Europe occidentale. Les vestiges de cette industrie se situent, en plusieurs endroits, directement entre ceux de l’Aurignacien et du Magdalénien ; dans d’autres, comme à Solutré, ils suivent directement l’Aurignacien. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une époque très longue et très importante du développement du Paléolithique supérieur. Du point de vue culturel, elle représente un apogée pour l’industrie du silex, mais une période de suspension ou d’arrêt du développement artistique.
Un coup d’œil sur les cartes des stations culturelles du Moustérien (Fig. 125), de l’Aurignacien (Fig. 153) et du Solutréen (Fig. 167) montre que la répartition géographique du Solutréen est tout à fait unique ; alors que la culture aurignacienne ceinture la Méditerranée, tant sur ses côtes sud que nord, la culture solutréenne est absente de toute cette région. L’interprétation de cet étrange phénomène proposée par Breuil, selon laquelle la culture solutréenne est entrée en Europe directement par l’est et non par le sud, peut être liée à la théorie [ p. 331 ] selon laquelle, vers la fin de l’Aurignacien, une nouvelle race venue du centre-est avançait vers l’ouest, à travers la Hongrie et le Danube. Cette race, au type mental inférieur, était extrêmement experte dans la fabrication des lances et des épieux en silex avec ce que l’on appelle la « retouche » solutréenne. Il pourrait s’agir de la race de Brünn, de Bribe et de Predmost, dont les vestiges ont été retrouvés dans deux localités associées à ces pointes de lance en silex hautement perfectionnées. Soit par l’invasion de cette race, soit, plus probablement, par l’invasion de l’industrie elle-même, hautement perfectionnée, de la pointe de lance, la station type de Solutré, sur la Saône, fut établie et la région de Dordogne fut atteinte, où cette industrie progressa en douze stations différentes.
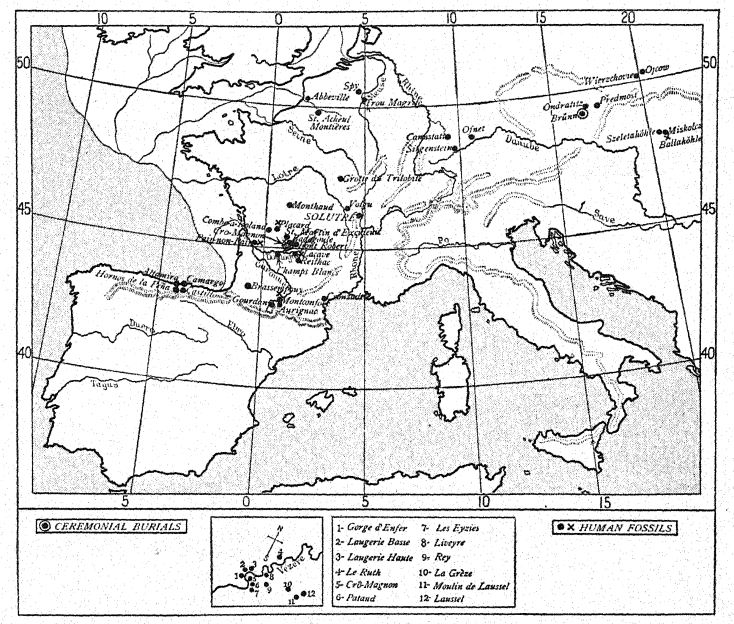
Il ne fait aucun doute que la nouvelle et entièrement distincte race Brünn a pénétré la région danubienne à cette époque, [ p. 332 ], mais rien ne prouve, à partir de restes squelettiques, qu’elle ait atteint la France. Il est fort possible que certains des ouvriers forestiers experts dans la « retouche » solutréenne aient migré vers les stations les plus occidentales de la Dordogne, apportant avec eux leur belle technique, mais sans laisser de traces de leurs restes squelettiques lors des funérailles cérémonielles. Ce problème non résolu constitue l’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’anatomie de tous les hommes du Paléolithique supérieur d’Europe occidentale devrait être étudiée et comparée avec la plus grande attention.
Un autre mystère de l’époque solutréenne réside dans l’arrêt de l’élan artistique qui avait animé les Crô-Magnons tout au long de l’Aurignacien. Les traces d’activité artistique à l’époque solutréenne sont très rares, et certains dessins attribués au Solutréen, comme à Altamira, sont aujourd’hui attribués au Magdalénien. Est-il possible que les Crô-Magnons aient suspendu temporairement leur activité artistique pour la reprendre dans les conditions environnementales différentes de l’époque magdalénienne ? Malheureusement, les sépultures solutréennes n’apportent que peu de preuves à ce sujet. Une interprétation possible est que le Solutréen fut manifestement une période de vie en plein air, et que les nouveaux instruments de chasse de type solutréen absorbèrent l’énergie industrielle de ces peuples, car les armes furent fabriquées en très grand nombre. Cette théorie de l’influence climatique est corroborée par le fait que le retour du climat rigoureux de l’époque magdalénienne, qui a de nouveau entassé les hommes dans les abris et les grottes, s’est accompagné d’un renouveau du développement artistique, qui a repris là où il avait été interrompu à la fin de l’époque aurignacienne. Que l’art aurignacien et magdalénien soit l’œuvre d’une seule et même race, cela ne fait aucun doute ; que cette race était celle des Crô-Magnon est désormais absolument démontré.
On pense généralement que le climat de l’époque solutréenne était froid et sec. Dans la région de la Dordogne, tout au long de cette période, le renne était encore bien plus nombreux que tout autre animal ; nous pouvons donc conclure sans risque qu’il était le principal objet de chasse et de nourriture ; en fait, il semblerait que les rennes étaient des formes résidentes dans la vallée de la Vézère, chassées et consommées tout au long de l’année40. On y trouve également occasionnellement le lemming des steppes du nord ou Obi, un animal qui s’étend à la même époque le long des rives de la Volga vers le sud de la Russie. Il semblerait qu’à l’époque solutréenne, dans le sud-ouest de la France, régnait un climat subarctique continental sec et froid, semblable à celui des steppes caspiennes, volgatiques et ouraliennes actuelles. Aux côtés du mammouth et du renne cohabitent une grande variété d’espèces forestières d’Europe du Nord : le renard, le lièvre, le cerf, l’ours brun, le loup, le bison et l’ours. L’identification du chacal comme appartenant à l’espèce ancienne C. neschersensis est particulièrement intéressante. Dans la localité industrielle type de Solutré, le renne est très abondant dans les foyers associés à l’industrie du Solutréen inférieur, mais moins abondant dans les niveaux supérieurs ; une antilope, peut-être l’antilope saïga, aurait été découverte parmi les gravures osseuses grossières.
¶ Races solutréennes
Il existait certainement deux races distinctes d’hommes en Europe à l’époque solutréenne : à l’est, la race de Brünn et à l’ouest, la race de Crô-Magnon. Des restes attribués aux Crô-Magnon ont été découverts dans les départements de la Charente, de la Gironde, du Lot, de la Haute-Garonne, du Tarn et de la Dordogne. Cependant, la plupart de ces vestiges sont très fragmentaires et leur origine raciale est difficile à déterminer. Les fragments de dix crânes et de quelques autres ossements découverts dans la grotte du Placard, en Charente, sont attribués au Solutréen récent et au Magdalénien ancien et constituent l’une des découvertes les plus exceptionnelles réalisées à ce jour en France ; les sépultures datent probablement du Magdalénien ancien (p. 380), mais appartiennent probablement à une race survivante du Solutréen. La section du dépôt de la grotte, d’une épaisseur de 7 à 8 mètres, est très instructive ; elle présente huit couches culturelles, séparées par des couches de débris et se succédant dans l’ordre suivant :
[ p. 334 ]
8. Couche néolithique.
7-4. Couches magdaléniennes ; dans la couche la plus basse se trouve l’enterrement cérémoniel de quatre crânes.
3. Couche solutréenne à pointes à cran et quelques pointes de laurier.
2. Couche solutréenne à pointes en feuille de laurier mais sans pointes épaulées ; couteaux, grattoirs, grattoirs, perceurs, en grand nombre, ainsi que des pointes de javelot et des poinçons en os et ornés d’encoches, et des fragments de craie rouge et de plomb noir trouvés incrustés avec les pointes solutréennes.
1. Couche moustérienne.
¶ Course de Brünn, Brüx, Predmost et (?) Galley Hill
En 1871, une calotte crânienne, aujourd’hui conservée au Musée royal de Vienne, fut découverte lors d’une exploitation minière à Brüx, en Bohême. En 189141, un squelette, apparemment de la même race, fut découvert à Brünn, en Moravie, profondément enchâssé dans le loess, avec des os de mammouth laineux et d’autres grands mammifères du Pléistocène. En 1892, il fut décrit par Makowsky42, qui, quelques années auparavant, avait exhumé du sable loessique des environs de Brünn le crâne fragmentaire aujourd’hui connu sous le nom de Brünn II. Ces deux crânes sont d’un type racial plutôt inférieur et ont longtemps été considérés comme des formes de transition entre les Néandertaliens et l’Homo sapiens. Mais en 1906, Schwalbe43 a démontré l’affinité entre les crânes de Brüx et de Brünn et, en même temps, leur complète distinction avec le crâne néandertalien et leur rapprochement avec les formes inférieures de l’Homo sapiens. La principale distinction de ces crânes est leur allongement extrême ou dolichocéphalie, le rapport largeur/longueur étant de 69 % pour le crâne de Brüx et de 68,2 % pour celui de Brünn. Ce dernier se classe plus bas en type racial que les négroïdes australiens. La principale distinction avec le crâne néandertalien réside dans l’indice de hauteur du crâne. (51,22 pour cent) et en l’absence des crêtes proéminentes s’étendant à travers la région des sourcils au-dessus du nez ;[9] le front, en bref, est plus moderne, l’angle frontal [ p. 335 ] étant de 74,7 - 75 pour cent. La capacité cérébrale de cette race est estimée, selon Makowsky,44 à 1 350 cxm. Les crânes de Brüx et de Brünn sont tous deux harmoniques ; ils ne présentent pas les pommettes très larges et hautes caractéristiques de la race Crô-Magnon, le visage étant d’un type étroit et moderne, mais pas très long. Il existe des preuves que le cou et les épaules [ p. 336 ] étaient puissants et musclés ; la proéminence du menton est prononcée ; la dentition est macrodonte, c’est-à-dire que la dernière molaire inférieure est de taille exceptionnellement grande ; il n’y avait pas de prognathisme ni de protrusion des mâchoires. Le deuxième crâne de Brünn (Brünn II) pourrait représenter un type féminin de la race Brünn, l’indice céphalique étant estimé à 72 %.
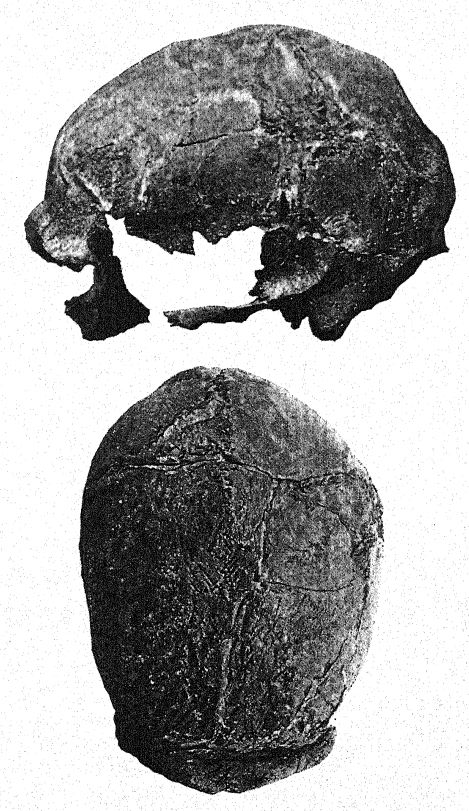
DÉCOUVERTES PRINCIPALEMENT DES RACES CRO-MAGNON ET BRUNN*
Référé à Solutrean Times
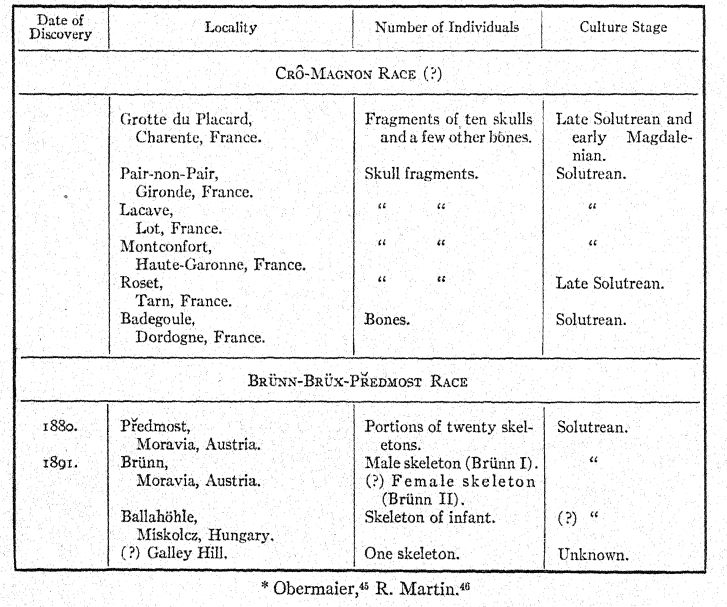
Il est possible47 que la race Brünn soit l’ancêtre de plusieurs groupes dolichocéphales ultérieurs que l’on trouve dans la région du Danube et en Allemagne centrale et méridionale. Schliz caractérise le crâne de Brünn comme se distinguant par un front fuyant, des éminences massives au-dessus des orbites séparées par une fente dans la ligne médiane, des orbites larges et basses, et un menton proéminent. Ces caractères se retrouvent dans l’un des crânes dolichocéphales découverts dans l’enterrement d’Ofnet, [ p. 337 ] à la toute fin du Paléolithique supérieur. Il semblerait donc que la race Brünn soit distincte de la race Crô-Magnon, qu’elle représente un type à tête longue qui s’est établi le long du Danube dès l’époque solutréenne, et qu’elle puisse être liée à l’introduction de certaines caractéristiques particulières de la culture solutréenne.
L’un des squelettes de Brünn, découvert à une profondeur de 3,6 mètres sous la surface du lœss, était richement orné de coquilles de dents, de disques de pierre perforés et d’ornements en os fabriqués à partir de côtes et de dents de mammouth. À ces objets était associée une idole en ivoire, apparemment masculine, dont seuls subsistent la tête, le torse et le bras gauche. Le squelette et de nombreux objets trouvés avec la sépulture étaient partiellement teintés de rouge. Une figurine en ivoire appartient à l’étage ébouméen de Piette et semble indiquer que la sépulture était d’âge aurignacien plutôt que solutréen.
Les « chasseurs de mammouths » de Predmost appartenaient probablement aussi à cette race. Ils sont représentés par les restes de six individus mis au jour depuis 1880 à Predmost, en Moravie, par Wankel, Kriz et Maska. Les os ont été retrouvés très brisés. Maska a depuis découvert une sépulture collective de quatorze squelettes humains, ainsi que les restes de six autres ; les corps étaient recouverts de pierres, mais aucun silex ni objet d’art n’était enterré avec eux. Les dimensions des membres indiquent une race de grande taille. Les squelettes étaient profondément enfouis dans le lœss, et au-dessus et en dessous de la riche couche archéologique se trouvaient d’abondants débris de mammouths, représentant entre huit et neuf cents spécimens. Outre les nombreux silex, dont des pointes de lance en feuille de laurier de type Solutréen moyen, d’autres objets et même des œuvres d’art primitives en os et en ivoire ont été découverts. Il ne fait aucun doute que les restes humains appartiennent au Solutréen moyen48
Français Avec cette race est également associé par de nombreux auteurs (Schwalbe, Schliz, Edaatsch, Keith) le crâne de Galley Hill, qui a été trouvé en 1888, enterré à une profondeur de 8 pieds dans les graviers de la « haute terrasse » [ p. 338 ] 90 pieds au-dessus de la Tamise.49 Sollas pense qu’il est hautement probable que les restes étaient dans une position naturelle et du même âge que les graviers de haut niveau et les silex paléolithiques et les restes d’animaux éteints qu’ils contenaient, mais Evans et Dawkins considèrent l’homme de Galley Hill comme appartenant à une race néolithique à tête longue enterrée dans une strate paléolithique. Les graviers de la « haute terrasse » dans laquelle le crâne de Galley Hill a été enterré ne sont en aucun cas de l’antiquité géologique de 200 000 ans qui leur est attribuée par Keith ; ils sont probablement de l’âge du quatrième glaciaire ou de l’âge postglaciaire, et se situent dans les estimations de l’époque postglaciaire, à savoir de 20 000 à 40 000 ans.
Keith a confirmé avec brio l’ancienneté du type crânien de Galley Hill. Le crâne est extrêmement long, ou hépadolichocéphale, l’indice céphalique étant estimé par Keith à 69 %51 ; la capacité cérébrale est estimée entre 1 350 et 1 400 cm³ ; les pommettes ne sont pas préservées, de sorte qu’aucun jugement ne peut être porté sur ce caractère si distinctif de la race de Crô-Magnon. Keith compare également à cette race de Galley Hill l’homme de Combe-Capelle, ou Aurignacien de Klaatsch52, bien qu’il considère à tort l’homme de Combe-Capelle comme beaucoup moins ancien géologiquement. Il poursuit : « Ainsi, bien que l’auteur soit enclin à attribuer provisoirement l’homme de Gombe-CapeUe à la race Galley Hill, il croit que de nouvelles découvertes montreront que l’homme de Combe-CapeUe appartient à une branche marquée par certaines caractéristiques négroïdes. »
¶ Industrie du silex solutéen
La « retouche solutréenne » marque l’une des avancées les plus notables dans la technique du travail du silex ; elle est totalement distincte de la « retouche aurignacienne », héritée du Moustérien.53 Le silex est extrait par pression en éclats fins et minces sur toute la surface de l’outil, auxquels l’artisan peut, dans sa forme perfectionnée, donner un tranchant fin et une symétrie parfaite. Il s’agit d’un progrès considérable par rapport à la retouche aurignacienne abrupte [ p. 339 ], dans laquelle le silex est taillé en arrière selon un angle plutôt émoussé pour obtenir un tranchant vif. Selon de Mortillet, la méthode de pression solutréenne a permis l’exécution d’un travail beaucoup plus délicat.
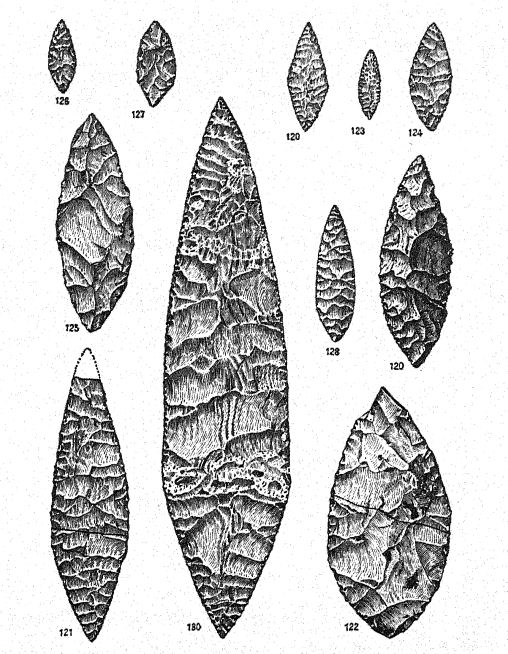
La question se pose immédiatement : ce progrès industriel a-t-il eu lieu en France ou s’agit-il d’une invention venue d’Orient ? Sur ce point, Breuil observe54 que dans les niveaux aurignaciens les plus élevés [ p. 340 ] en Belgique, en Dordogne et à Solutré, la technique solutréenne apparaît faiblement, soit dans les pointes à soie de Font Robert, de La Ferrassie et de Spy, soit dans les pointes à double tranchant tendant vers le type à feuille de laurier du Solutréen, mais que tous les autres outils restent purement aurignaciens.
Relations et subdivisions de la culture solutréenne
Magdalénien inférieur (début).
- Prototypes de harpons en os.
- Débuts de la sculpture animalière.
- Absence de toute trace des pointes de lance en feuilles de laurier de l’époque solutréenne.
Solutréen supérieur (Lak). - Pointes à cran typiques : éclats allongés travaillés sur une ou deux faces et entaillés. Petites pointes de lance en feuille de laurier.
- Pointes de javelot, poinçons et aiguilles en os, très finement travaillés. Placard. Lacave.
Solutréen moyen (supérieur). - Grandes pointes de lance en « feuille de laurier » travaillées sur les deux faces. Apogée de l’industrie du silex solutréen. Placard.
Solutréen inférieur (proto-). - Pointes de lance primitives en « feuille de laurier » et en « feuille de saule », la plupart travaillées sur une seule face. Grotte du Trilobite.
Transition de l’Aurignacien. - Pointes à soie pédonculées de type primitif Font Robert.
- Point culminant de la sculpture humaine.
Quant à la principale source de l’influence solutréenne, le même auteur remarque que, puisque cette culture est totalement absente du centre et du sud de l’Espagne, d’Italie, de Sicile, d’Algérie et de Phénicie, il ne faut certainement pas en chercher l’origine en Méditerranée, mais plutôt en Europe orientale ; car dans les grottes de Hongrie, on trouve un grand développement du véritable Solutréen, tandis que jusqu’à présent l’Aurignacien n’y a pas été trouvé, bien que l’on trouve des traces des premiers stades de transition sous les niveaux des véritables pointes de laurier. Nous devons donc admettre que, selon toute probabilité, la culture solutréenne a atteint l’Europe par l’est et que sa source est aussi mystérieuse que celle de l’Aurignacien, qui, comme nous l’avons vu, était d’origine méridionale et probablement méditerranéenne. Il n’est pas impossible que le [ p. 341 ] L’évolution de la pointe de la feuille de laurier a eu lieu en Hongrie, car elle n’a certainement pas évolué en Europe centrale ou occidentale.
À Predmost, en Moravie, on observe une industrie aurignacienne avancée qui avait adopté un style solutréen pour ses fers de lance. Ici, les outils en feuille de laurier sont rares, tandis que les outils en os sont abondants ; mais dans les stations solutréennes de Hongrie, on ne trouve aucun outil en os. À mesure que la technique solutréenne se perfectionne, la pointe de lance en feuille de laurier, si caractéristique de l’industrie solutréenne dans son ensemble, est créée et se rencontre en Pologne, en Hongrie, en Bavière, puis en France, où l’industrie s’étend vers le sud, à l’ouest et à l’est du plateau central. En France, elle apparaît assez soudainement dans la grotte du Trilobite (Yonne), ainsi qu’en Dordogne et en Ardèche, où les types proto-solutréens présentent un appauvrissement marqué, tant dans la variété que dans l’exécution de la plupart des outils en silex, la seule exception étant les pointes à face plane, qui présentent une retouche solutréenne régulière, belle mais monotone. Les pointes en feuille de laurier découvertes à Crouzade, Gourdan et Montfort témoignent de la présence de la véritable culture solutréenne, mais cette culture est loin d’approcher les stations voisines de Brassempouy. Plus au nord, la grotte de Spy, en Belgique, offre des exemples de types proto-solutréens, également retrouvés dans plusieurs cavernes britanniques. Il n’est cependant pas certain que de véritables outils solutréens aient été découverts en Grande-Bretagne.
En Picard, une couche proto-solutréenne a été retrouvée, mais sans pointes en feuilles de laurier. Dans la station type de Solutré, dans le sud-est de la France, Breuil a découvert deux couches solutréennes, très différentes l’une de l’autre : l’une riche en outils en os et en outils de gravure, avec de petites feuilles de laurier en silex retouchées sur une seule face ; l’autre, pauvre en outils en os, mais avec de grandes pointes de lance en feuilles de laurier.
La culture solutréenne n’a jamais pénétré au sud de la grande barrière des Pyrénées, mais, passant par la vallée de la Vézère, en Dordogne, elle s’est étendue le long de la côte occidentale jusqu’aux pentes nord des monts Cantabriques, dans la province de Santander, en Espagne. On y trouve les pointes en feuille de laurier du Solutréen moyen à Castillo, tandis que les pointes à cran, typiques du Solutréen tardif, se trouvent à Altamira, ainsi que des outils en os. Il convient néanmoins de noter que dans le sud-ouest de l’Europe, les phases antérieures du Solutréen se caractérisent par une diminution de l’utilisation de l’os, qui, cependant, augmente à nouveau dans les niveaux supérieurs.
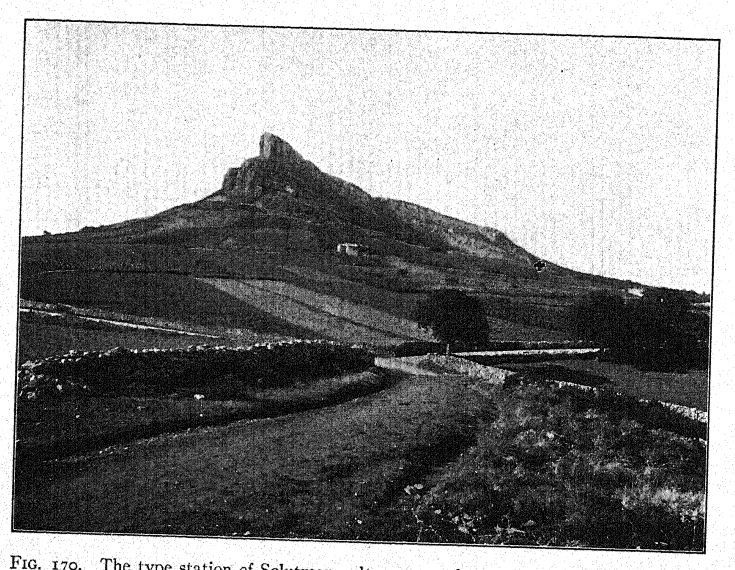
La station type de la culture solutréenne est le grand campement à ciel ouvert de Solutré, près de la rivière Sadne, abrité au nord par une crête suintante et bénéficiant d’une belle exposition ensoleillée au sud. Les vestiges de ce grand campement, le plus grand découvert à ce jour en Europe occidentale, couvrent une superficie de 91 mètres carrés et sont situés à proximité d’une bonne source d’eau. Explorée en 1866 par Arcelin, Ferry et Ducrost, cette station avait déjà été occupée à l’époque aurignacienne ; deux coupes, prises en deux points différents, ont montré que les dépôts de l’ancien camp avaient une épaisseur de 6,7 à 8 mètres, représentant des foyers aurignaciens et solutréens superposés avec d’épaisses couches de débris intermédiaires. Dans le niveau aurignacien se trouve l’importante accumulation d’ossements de chevaux déjà décrite.
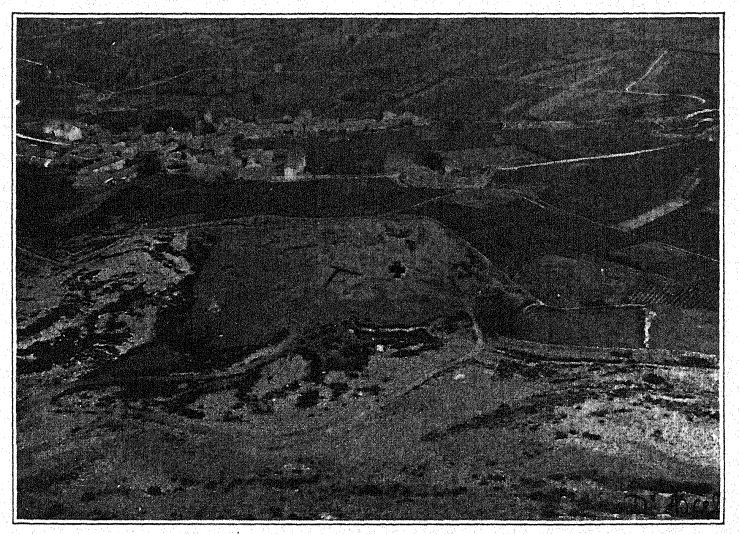
Dans les niveaux du Solutréen moyen, on trouve de grands foyers avec des ustensiles en silex et les vestiges de nombreux festins parmi les débris calcinés. La faima comprend le loup, le renard, la hyène, l’ours des cavernes et l’ours brun, le blaireau, le lapin, le cerf, le bétail sauvage et deux formes nordiques caractéristiques : le mammouth laineux et le renne ; les vestiges de ce dernier sont les plus abondants dans les foyers anciens.
Dans toutes les stations solutréennes, outre les outils en os55, on trouve deux classes distinctes de silex. La première appartient à toute l’« Époque du Renne » et se compose de grattoirs simples et doubles, de forets, de burins, d’éclats retouchés et d’éclats simples de petites dimensions.
Le second est composé des types « en feuilles », qui sont uniquement caractéristiques du Solutréen et qui dégénèrent et disparaissent entièrement à sa fin ; ces dernières sont les formes de pointes de flèches et de lances, dont beaucoup sont façonnées avec un rare degré de perfection et présentent la belle et large retouche solutréenne sur toute la surface des deux côtés de l’éclat, ainsi qu’une symétrie parfaite, tant latérale que bilatérale ; elles sont communément appelées formes en feuille de saule (étroite) et en feuille de laurier (large). Les explorateurs de la station type de Solutré ont découvert cinq formes principales, comme suit : (i) losange irrégulier ; (2) ovale, pointu aux deux extrémités ; (3) ovale, pointu à une extrémité ; (4) losange régulier ; (5) forme en pointe de flèche avec pédoncule, sans doute pour fixation à une hampe. Les pointes de lance en laurier solutréennes perfectionnées ne réapparaissent dans aucune autre période du Paléolithique supérieur, mais leur ressemblance avec les silex néolithiques est très marquée.
Les pointes de saule, taillées sur une seule face, caractéristiques du Solutréen ancien, pourraient être contemporaines de la fin de la culture aurignacienne de Font Robert. À Solutré, on a également découvert des couches riches en outils en os et en outils de gravure, ainsi que de petites pointes en feuille de laurier travaillées sur une seule face. En ce qui concerne les tendances générales de la culture du Solutréen ancien en Dordogne, à la grotte du Trilobite (Yonne) et en Ardèche, on observe un déclin marqué du travail de l’os et de la variété et de la facture de tous les outils, à l’exception des pointes de saule primitives aplaties, faites d’éclats, retouchées à la manière solutréenne, mais sur une seule face. Des gisements typiques de la culture du Solutréen ancien se trouvent à Trou Magrite, en Belgique, à Font Robert, en Corrèze, et dans le troisième niveau de la grotte du Trilobite, dans l’Yonne ; au deuxième niveau on trouve des silex à retouche solutréenne naissante.
Français L’instrument distinctif du Solutréen « haut » ou moyen est la grande pointe en « feuille de laurier », ébréchée et taillée des deux côtés, atteignant une perfection merveilleuse de technique et de symétrie. [ p. 345 ] Les plus beaux exemples de ces pointes de lance sont les fameuses pointes de laurier, au nombre de quatorze, découvertes à Volgu, en Saône-et-Loire, en 1873 : elles ont été trouvées ensemble dans une sorte de cache et, semble-t-il, étaient destinées à une offrande votive, car l’une au moins était colorée en rouge, et toutes étaient trop fragiles et délicates pour être d’une quelconque utilité dans la chasse. Elles sont d’une taille inhabituelle, la plus petite mesurant 9 pouces et la plus grande plus de 13 ½. En termes de fabrication, elles ne sont égalées que par les merveilleux spécimens néolithiques d’Égypte et de Scandinavie.
À Solutré et dans d’autres stations, on trouve également des outils en os, bien que moins fréquents que dans les divisions solutréennes plus tardives. Si les stations solutréennes les plus orientales de Hongrie ne présentent aucun outil en os, celles-ci sont abondantes à Predmost, en Moravie, où la culture est globalement de type aurignacien avancé, avec la retouche solutréenne utilisée pour le façonnage de ses pointes de lance en silex. L’industrie osseuse comprend un certain nombre d’alènes et de lissoirs, ainsi que de nombreux bâtons de commandement. À ce niveau, à Predmost, on trouve quelques œuvres d’art comprenant des représentations de quatre animaux sculptés sur des nodules de calcaire, les sujets étant apparemment des rennes, ainsi qu’une seule gravure sur os.
La principale invention du Solutréen tardif est la pointe à cran, une fléchette unique, entaillée et très fine. Ces entailles sont la première indication de l’utilité de la pointe pour maintenir une arme dans la chair. On y trouve également une tige pour fixer le manche de la fléchette. Aux premiers stades du Solutréen, on trouve des silex dont la base asymétrique de la pointe présente une petite languette ou tige obtuse. Le pédoncule allongé à la base de ces pointes à soie se développe en pointe à cran, ou pointe à cran, constituée de longs éclats fins, avec une courte retouche sur une ou les deux faces, et retrouvée au Solutréen tardif à la grotte de Lacave, à Placard et dans de nombreuses stations de Dordogne. Aucun exemplaire de la pointe à cran n’a jamais été trouvé à la station type de Solutré, mais on la trouve fréquemment dans les stations situées entre la Loire et les Pyrénées cantabriques, à Altamira, à Laugerie Haute, à Monthaud (Indre), en Chalosse et en Charente, tandis que la grande grotte du Placard n’a livré pas moins de 5 000 spécimens, entiers et brisés.
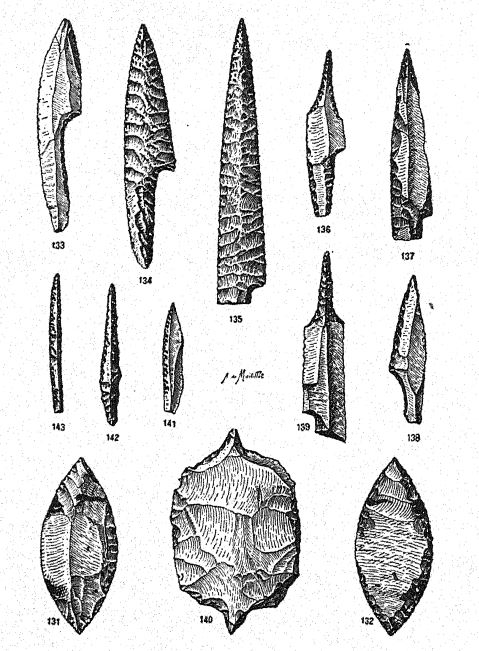
À Monthaud, on a également découvert des outils en os, dont plusieurs poinçons et une série de sagaies. Les sagaies solutréennes sont cependant très rares et très primitives par rapport au Magdalénien.
[ p. 347 ]
Les phases successives de l’industrie solutréenne sont toutes représentées dans le sud de la France. Quant à ses relations stratigraphiques, la station type de Solutré présente du Solutréen inférieur et moyen au-dessus de foyers et de dépôts aurignaciens ; celle de Placard, en Charente, montre le Solutréen moyen et supérieur recouvert d’une couche magdalénienne. Dans la grotte du Trilobite, la couche solutréenne se situe entre une couche aurignacienne et une couche magdalénienne primitive ; c’est ici que l’on observe la transition la plus nette avec la culture aurignacienne, avec l’apparition de prototypes de pointes en feuille de laurier et en feuille de saule, réalisées à partir d’éclats, retouchées d’un seul côté. À Brassempouy, le Solutréen se situe immédiatement sous une couche magdalénienne, avec des os gravés et des silex magdaléniens. Les aiguilles, particulièrement abondantes à l’époque magdalénienne, sont également présentes dans plusieurs stations solutréennes. Dans la grotte de Lacave, dans le Lot, dans une couche du Solutréen supérieur, Vire a découvert de belles aiguilles en os, percées à une extrémité et d’une belle facture, ainsi que des ustensiles gravés en corne de renne ; on y a également trouvé une tête d’antilope gravée sur un fragment de corne de renne. La faune locale de cette période comprenait le cheval, le bouquetin et le renne.
¶ Gravure et sculpture animalière solutréennes
L’œuvre artistique du Solutréen n’est pas aussi riche que celle de l’Aurignacien. Cela, comme nous l’avons suggéré, peut être en partie dû à la diffusion moins étendue de la culture solutréenne, ainsi qu’à la grande importance accordée au façonnage soigné des armes en pierre. Néanmoins, nous pouvons retrouver des indices du développement des deux phases artistiques, linéaire et plastique, et notamment des débuts de la sculpture animalière. À la sculpture ronde et pleine de l’Aurignacien succède, au Solutréen, un développement de la sculpture sur os des Rundstabfiguren (bâtons cérémoniels) et du haut-relief. Le lion et la tête de cheval d’Isturitz, dans les Pyrénées, que Breuil attribue à la fin de la période solutréenne, en sont des exemples typiques.
[ p. 348 ]
Les gravures pariétales et mobiles, ainsi que les représentations schématiques, telles que celles de Placard et de Champs Blancs, sont relativement rares. Selon Alcalde del Rio, on a découvert à Altamira, dans le nord de l’Espagne, des figures de biche très simples et finement gravées sur l’os de l’omoplate ; la tête et le cou sont couverts de lignes, et l’œil, le naseau et la forme de l’oreille sont très caractéristiques de l’animal. BreuLl, cependant, les considère comme appartenant plutôt à l’époque magdalénienne antérieure.
L’art décoratif fait certainement quelques progrès sur l’œuvre aurignacienne, car la disposition des figures géométriques est assez claire, et l’exécution montre un progrès marqué dans la technique de la gravure.
À Predmost, près du site de la sépulture humaine décrite ci-dessus, on a découvert une statuette de mammouth sculptée en ronde-bosse, en ivoire, ce qui prouve que la sculpture animalière était très avancée à l’époque solutréenne. La statuette a été trouvée entre deux et trois mètres sous la surface du loess, dans une couche solutréenne incontestable. La faune qui l’accompagne est de nature véritablement arctique : le mammouth y est extraordinairement abondant ; les formes de la toundra, notamment le mammouth, le rhinocéros laineux, le bœuf musqué, le renne, le renard arctique, le lièvre arctique, le glouton et le lemming rayé ; les formes asiatiques, notamment le lion et le léopard ; la faune des forêts et des prairies, comprenant le loup, le renard, le castor, l’ours brun, le bison, le bétail sauvage, l’élan, le cheval et le bouquetin. Parmi les restes de 30 000 silex, on trouve une douzaine de pointes (feuilles de laurier) et d’autres pièces avec la « retouche » solutréenne. L’industrie de l’ivoire, de l’os et de la corne de renne est également variée, comprenant de nombreux poignards, polissoirs, perceurs, lanceurs de fléchettes et bâtons de commandement.
Cette sculpture en ivoire du mammouth indique très précisément les contours caractéristiques du sommet de la tête et du dos ; les stries sur le côté représentent les masses de cheveux retombantes. D’autres figures sculptées représentant le mammouth sont considérées comme d’âge magdalénien, les plus connues étant celles trouvées dans les grottes de Bruniquel et de Laugerie Basse, [ p. 349 ] un fragment de Raymonden, Dordogne, et un bas-relief de la grotte de Figuier, Card. Toutes ces sculptures du mammouth ont en commun l’indication d’une très petite oreille — semblable à celle du modèle de Predmost — des pieds en forme de champignons inversés, bordés de poils courts et grossiers, la queue se terminant par une longue touffe de poils. Si la figure de Predmost est d’âge solutréen, elle est de loin la plus ancienne de toutes les représentations animales sculptées ou gravées de l’art mobilier, et aussi la plus complète des figurines animales de ce groupe. Elle est certainement plus récente que les motifs gravés d’âge aurignacien des grottes de Gargas et de Chabot, ou que les tracés rouges ou noirs du mammouth, également d’âge aurignacien, de Castillo, Pindal et Font-de-Gaume. Il est probable que les figures de mammouth de Combarelles sont plus récentes que la sculpture de Predmost et appartiennent au début du Magdalénien, tandis que celles de Font-de-Gaume appartiennent à la fin du Magdalénien [ p. 350 ] et sont les plus récentes de toutes les décorations pariétales. Malgré les différences d’âge et de technique, tous les dessins du mammouth sont sans aucun doute l’œuvre d’artistes d’une seule race ; ils s’accordent à représenter fidèlement la forme extérieure de ce grand proboscidien qui a erré dans les steppes et les prairies de l’Europe occidentale depuis le début de la quatrième glaciation jusqu’à la fin de l’ère postglaciaire.
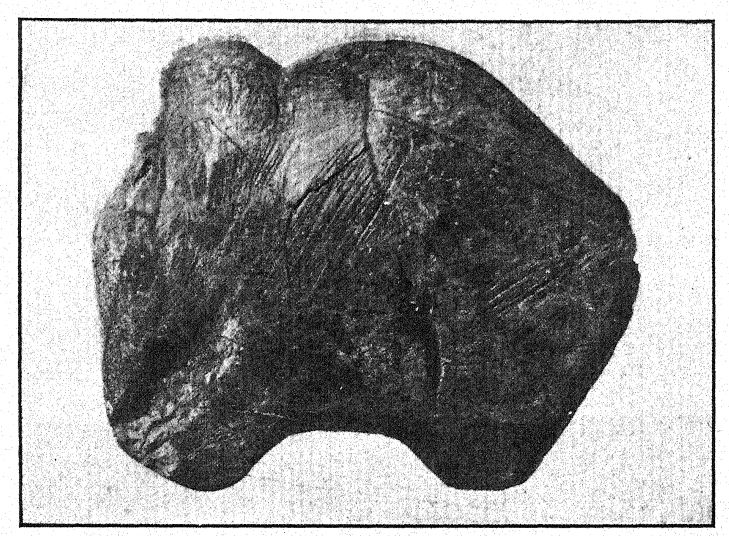
¶ Bibliographie
(1) Breuil, 1912. 7.
(2) Verneau, 1906.1, pp. 202-207.
(3) Op. cit., p. 204.
(4) Keith, 1911.1, p. 60.
(5) Obermaier, 1912.1, p. 178.
(6) Breuil, 1912.7, p. 174.
(7) op. cit., pp. 165-168.
(8) Obermaier, 1 91 2.1, pp. 177, 178.
(9) Wiegers, 1913.1.
(10) Schmidt, 1912.1, p. 266.
(11) Geikie, 1914.1, p. 278.
(12) Dawkins, 1880.1, pp. 148, 149.
(13) Ewart, 1904.1.
(14) Obermaier, 1909.2, p. 145.
(15) Solias, 1913.1, p. 325.
(16) Broca, 1868.1.
(17) Lartet, 1875.1.
(18) Verneau, 1886.1; 1906.1, pp. 68, 69.
(19) Obermaier, 1912.2.
(20) Martin, R., 1914.1, pp. 15, 16.
(21) Keith, 1911.1, p. 71.
(22) Klaatsch, 1909.1.
(23) Keith, op. cit., p. 56.
(24) Hauser, 1909.1.
(25) Fischer, 1913.1.
(26) Schliz, 1912.1, p. 554.
(27) Breuil, 1912.7, p. 175.
(28) Op. cit., p. 183.
(29) Op. cit., pp. 177-180.
(30) Schmidt, 1912.1, p. 266.
(31) Breuil, op. cit., p. 178.
(32) Obermaier, 1912.1, p. 181.
(33) Breuil, 1912.7, p. 169.
(34) Breuil, 1912.1, p. 194-200.
(35) Schmidt, 1912.1.
(36) Breuil, op. cit.
(37) Schmidt, 1912.1, p. 142.
(38) Breuil, 1912.1, p. 202.
(39) Breuil, 1912,6.
(40) Hilzheimer, 1913.1, p. 151.
(41) Fischer, 1913.1.
(42) Makowsky, 1902.1.
(43) Schwalbe, 1906.1.
(44) Makowsky, op. cit.
(45) Obermaier, 1912.1, pp. 342-355.
(46) Martin, R., 1914-1, pp. iS, 16.
(47) Schliz, 1912.1.
(48) Dechelette, 1908.1, vol. I, p. 28.
(49) Keane, 1901. i, p. 147.
(50) Keith, 1911.X, p. 30.
(51) Op. cit., pp. 28-45.
(52) Op. cit., pp. 51-56,
(53) Obermaier, 1912. i, p. 93.
(54) Breuil, 1912.7, p. 188.
(55) Arcelin, 1869.1,
(56) Dechelette, 1908.1, vol. I, pp. 137-141
(57) Schmidt, 1912. i, p. 144, Tafel B.
¶ Notes de bas de page
Voir Annexe, Note VL. ↩︎
Nommé en l’honneur du prince régnant de Monaco, dont les dons généreux et l’intérêt personnel ont rendu possible l’exploration adéquate de ces grottes. ↩︎
Cette corrélation s’accorde dans l’ensemble avec celle de Schmidt dans son Diluviale Vorzeit Deutschlands. ↩︎
Indique une occurrence très fréquente d’une forme typique. ↩︎ ↩︎
Indique une occurrence très fréquente d’une forme typique. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Indique une occurrence très fréquente d’une forme typique. ↩︎
Breuil,34 Schmidt.35 ↩︎
L’écrivain a eu le privilège de visiter toutes ces cavernes en compagnie soit du professeur Emile Cartailhac, soit de l’abbé Breuil. ↩︎
Malgré les déclarations de Schwalbe, les crêtes supraorbitaires de ce crâne semblent former un pont complet. Le docteur Hrdlicka considère que le crâne de Predmost, qui lui est apparenté, présente clairement une affinité néandertalienne. ↩︎