[ p. 351 ]
TEMPS MAGDALÉNIEN — CLIMAT ET VIE DES MAMMIFÈRES DE L’EUROPE — COUTUMES ET VIE DES CRO-MAGNONS ; LEUR INDUSTRIE DU SILEX ET DE L’OS ; LEUR RÉPARTITION — DÉVELOPPEMENT DE LEUR ART, GRAVURE, PEINTURE, SCULPTURE — ART DANS LES CAVERNES — APOLOGUE DE L’ART ET DE L’INDUSTRIE MAGDALÉNIEN DES CRO-MAGNONS — DÉCLIN APPARENT DE LA RACE.
L’époque artistique et industrielle du Magdalénien est de loin la plus connue et la plus fascinante de l’Âge de la Pierre. Cette période marque l’apogée de la civilisation paléolithique ; elle marque le plus haut développement de la race Crô-Magnon, précédant son déclin soudain et sa disparition en tant que type dominant en Europe occidentale. Les hommes de cette époque sont communément appelés les Magdaléniens, d’après la station type de La Madeleine, tout comme les Grecs à leur apogée tiraient leur nom d’Athènes et étaient connus sous le nom d’Athéniens.
Nous attribuerions la date préhistorique minimale de 16 000 av. J.-C. au début de la culture magdalénienne, et puisque nous avons attribué au début de la culture aurignacienne la date de 25 000 av. J.-C., nous devrions accorder 9 000 ans au développement des industries aurignaciennes et solutréennes en Europe occidentale.
¶ Introduction. Développement industriel et artistique
Français Bien que cette culture soit bien connue, son origine est obscurcie par le fait qu’elle ne montre que peu ou pas de lien avec l’industrie solutréenne précédente, ce qui, comme nous l’avons noté (p. 331), semble être une invasion technique dans l’histoire de l’Europe occidentale et non une partie inhérente de la ligne principale de développement culturel. Ainsi Breuil1 observe qu’il semble que les éléments fondamentaux de la culture aurignacienne supérieure aient contribué par une voie inconnue à constituer le noyau de la civilisation magdalénienne pendant que l’épisode solutréen se déroulait ailleurs. De nouveau, l’art magdalénien ancien présente des ressemblances frappantes avec l’art aurignacien supérieur des Pyrénées, en particulier l’art pariétal, comme le montre la comparaison des gravures aurignaciennes de Gargas avec le Magdalénien ancien de Gombarelles. Français De plus, le même auteur observe que, s’il y a un fait préhistorique certain, c’est que la première culture magdalénienne ne s’est pas développée à partir du Solutréen - que ces Magdaléniens étaient des nouveaux venus dans l’ouest de la France, aussi peu habiles dans l’art de tailler et de retoucher les silex que leurs prédécesseurs l’étaient. On trouve d’anciens foyers magdaléniens dans de nombreuses localités proches des niveaux des industries du Solutréen supérieur avec leurs pointes à cran et leur travail du silex très perfectionné. Pourtant, les Magdaléniens montrent un écart radical par rapport au type de travail du silex solutréen ; tant en Dordogne (Laugerie Haute et Laussel) qu’en Charente (Placard), les éclats de silex sont massifs, lourds, mal sélectionnés, souvent de mauvaise qualité et mal retouchés, parfois presque à la manière éolithique ; en même temps, les silex de hasard, c’est-à-dire les perceurs et les outils de gravure fabriqués à partir d’éclats de forme accidentelle, sont abondants. Pour ces populations, les outils en silex semblent d’une importance secondaire ; bien que très nombreux, ils ne présentent aucune des perfections de la technique solutréenne ; la pointe de lance en feuille de laurier et la pointe de dard à épaulement ont entièrement disparu, mais une grande variété de formes plus petites de gravure et de ciselure sont employées pour façonner les outils en os et en corne. Quel contraste avec les magnifiques silex, si finement retouchés et fabriqués dans des matériaux si soigneusement sélectionnés, découverts dans les mêmes stations, dans les couches du Solutréen moyen et supérieur !
Ainsi, Breuil, toujours prédisposé à croire à une invasion culturelle plutôt qu’à un développement autochtone, privilégie la théorie de l’origine orientale de l’industrie magdalénienne, car elle ne manque ni en Autriche ni en Pologne ; deux sites d’industrie magdalénienne ancienne ont été découverts par Obermaier dans les stations de « loess » d’Autriche, tandis qu’en Pologne russe, la grotte de Maszycka, près d’Ojcow, présente des ouvraisons osseuses semblables à celles trouvées à la grotte de Placard, en Charente, dans les couches succédant directement à la base du Magdalonien. Le fait qu’à proximité des monts Oural on ait également découvert une culture magdalénienne particulière, dont l’origine n’est pas occidentale, nous incite à croire que la culture magdalénienne s’est étendue de l’est vers l’ouest, puis, plus tard, vers la Baltique.
Cette théorie de l’origine orientale de l’industrie magdalénienne doit cependant faire face, premièrement, à la contre-évidence très forte de l’étroite affinité entre l’art aurignacien et l’art magdalénien, que Breuil lui-même a le plus contribué à démontrer ; deuxièmement, à l’identité physique, mentale et surtout artistique de la race Crô-Magnon aux époques aurignacienne et magdalénienne. La récente découverte de deux squelettes de Crô-Magnon ainsi que de deux outils en os sculptés de type magdalénien, à Obercassel, sur le Rhin, relie cet art à cette race et à aucune autre, car, comme nous l’avons remarqué plus haut, un instinct et un talent artistiques ne peuvent se transmettre d’une race à une autre comme la technique d’un artisanat. Breuil2 lui-même a affirmé positivement que tout le développement artistique du Paléolithique supérieur en Europe était l’œuvre d’une seule race : si tel est le cas, cette race ne peut être autre que celle de Crô-Magnon.
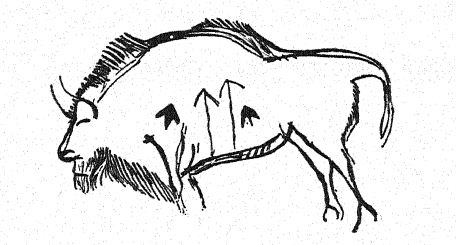
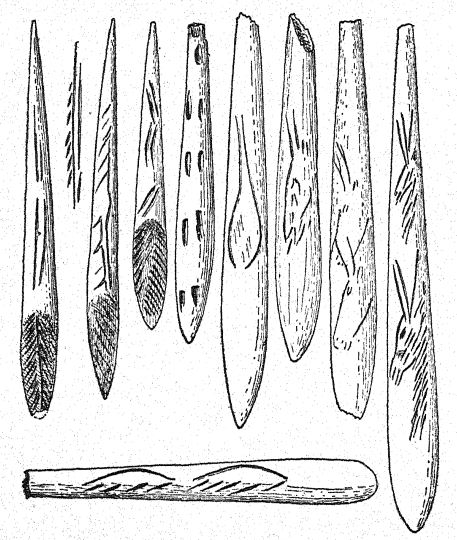
Nous devons donc revenir à l’explication proposée dans un chapitre précédent, selon laquelle la technique solutréenne était une intrusion [ p. 354 ] ou une invasion soit apportée par une autre race, soit acquise auprès des artisans d’une race orientale, peut-être celle de Brünn, Brüx et Predmost. La raison pour laquelle l’art de façonner ces pointes de lance, de dard et de flèche solutréennes parfaites a été perdu est très difficile à expliquer, car elles semblent être les instruments de guerre et de chasse les plus efficaces jamais développés par les ouvriers paléolithiques.
Il est possible, bien que peu probable, que l’arc ait été introduit à cette époque et qu’une pointe de silex moins parfaite, fixée à un fût comme une pointe de flèche et projetée avec une grande vélocité et précision, se soit révélée bien plus efficace que la lance. Les bisons de la grotte de Niaux présentent plusieurs pointes barbelées adhérant aux flancs, et le symbole de la flèche apparaît sur les flancs de nombreux bisons, bovins et autres animaux de chasse dans les dessins magdaléniens. D’après ces dessins et symboles, il semblerait que des armes barbelées aient été utilisées à la chasse, mais aucun silex barbelé n’a été trouvé au Paléolithique, et aucune trace de pointes de flèches barbelées en os n’a été trouvée, ni aucune preuve directe de l’existence de l’arc.
Le déclin du silex est compensé par le développement rapide des outils en os, trait le plus distinctif de l’industrie magdalénienne. À la fin du Solutréen, nous avons noté l’apparition occasionnelle de pointes de javelot en os (sagaies) avec leurs motifs décoratifs ; ceux-ci deviennent beaucoup plus fréquents à l’époque magdalénienne. On les trouve dans les niveaux magdaléniens les plus anciens de la grotte de Placard, en Charente, antérieurs même à l’apparition des prototypes du harpon, dont l’évolution marque clairement les périodes magdaléniennes ancienne, moyenne et tardive. Ces javelots primitifs, décorés de façon caractéristique, se trouvent en Pologne, à la grotte de Kesslerloch et ailleurs en Suisse, dans de nombreuses stations de Dordogne et des Pyrénées du sud de la France, ainsi que dans les monts Cantabriques du nord de l’Espagne.
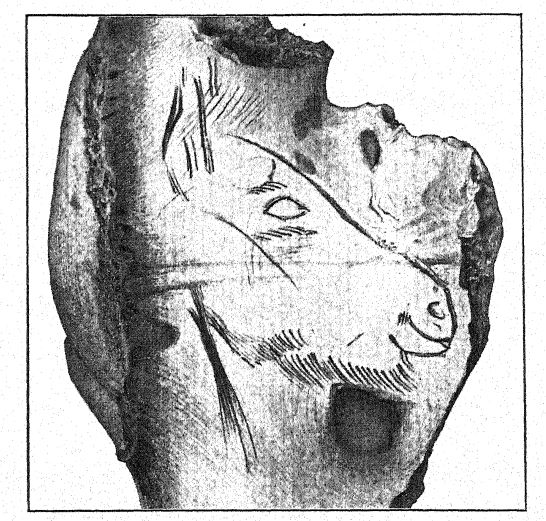
C’est seulement au-dessus des niveaux où se trouvent les premiers types de pointes de javelot que l’on trouve les harpons rudimentaires typiques du Magdalénien ancien. La découverte du harpon en os comme moyen de pêche marque un ajout important à l’approvisionnement alimentaire, qui fut apparemment suivi d’un déclin de la chasse. Plus tard, au javelot, à la lance et au harpon s’ajoute le propulseur, qui se répand progressivement dans toute l’Europe occidentale, où l’évolution de ces outils en os et de la décoration dont ils sont richement ornés permet également à l’archéologue expérimenté d’établir des subdivisions correspondantes de l’époque magdalénienne.
Du caractère uniforme de l’art paléolithique dans ses formes les plus élevées de gravure, de peinture et de sculpture animalière, nous pouvons déduire l’unité probable de la race de Crô-Magnon, en particulier dans toute l’Europe occidentale. Au Magdalénien, diverses branches de l’art ont atteint leur apogée et ont été l’aboutissement d’un mouvement commencé au début de l’Aurignacien. L’artiste, dont la vie l’a mis en contact étroit avec la nature et qui a manifestement suivi les mouvements des animaux individuels et des troupeaux pendant des heures, a rendu ses observations de la manière la plus réaliste. Parmi les animaux représentés figurent le bison, le mammouth, le cheval sauvage, le renne, le bœuf sauvage, le cerf et le rhinocéros ; les représentations du bouquetin, du loup et du sanglier sont moins fréquentes, et il y a relativement peu de représentations de poissons ou de toute forme de vie végétale ; Les bêtes de proie les plus nobles, comme le lion et l’ours, sont souvent représentées, mais il n’existe aucune figure de la hyène furtive, qui était à cette époque un animal rare, voire presque éteint. Si de nombreuses figures présentent une réelle valeur artistique et atteignent un haut niveau, d’autres sont des tentatives plus ou moins grossières ; la composition de figures ou de groupes d’animaux est rarement entreprise.
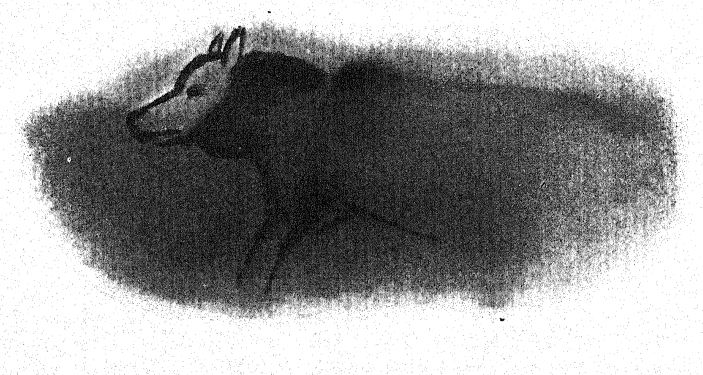
Le sens artistique de ces peuples se manifeste également dans la décoration de leurs ustensiles domestiques et de leurs armes de chasse. Ici, les petits animaux de chasse, le saïga, le bouquetin et le chamois, sont exécutés avec une main sûre. La sculpture animalière de grande taille, qui débute au Solutréen, se poursuit et atteint son apogée au début du Magdalénien. C’est à cette époque que la sculpture décorative apparaît et s’étend jusqu’au Magdalénien moyen et récent. Ces dernières divisions se distinguent également par la réapparition de figurines humaines, nues, comme à l’Aurignacien, et parfois plus graciles. Il semble ainsi que l’esprit artistique, plus ou moins endormi au Solutréen, ait retrouvé un second souffle.
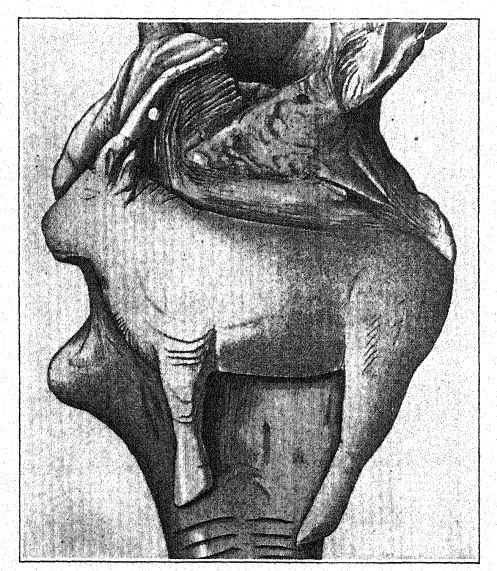
[ p. 358 ]
La diversité des industries témoigne de l’existence d’une race dotée d’esprits observateurs et créatifs, dont les deux principaux moteurs semblent avoir été la chasse et la poursuite de l’art. Les silex magdaléniens sont façonnés d’une manière quelque peu différente de ceux du Solutréen : de longs éclats fins, ou « lames », peu ou pas retouchés, sont fréquents, et pour d’autres instruments, le travail semble être poussé jusqu’au point où le silex remplit sa fonction. Aucune tentative n’est faite pour atteindre une symétrie parfaite. Ainsi, l’ancienne impulsion technique de l’industrie du silex semble bien moindre que celle des fabricants de silex du Solutréen, tandis qu’une nouvelle impulsion technique se manifeste dans plusieurs branches de l’art : armes et ustensiles sont sculptés en ivoire, en corne de renne et en os, et la sculpture et la gravure sur os et ivoire sont largement développées. Nous constatons que ces gens commencent à utiliser les murs de cavernes sombres et mystérieuses pour leurs dessins et peintures, qui témoignent d’une profonde appréciation pour la perfection de la forme animale, représentée par eux dans des attitudes très réalistes.
On peut en déduire qu’il existait une organisation tribale, et il a été suggéré que certains instruments inexpliqués en corne de renne, souvent magnifiquement sculptés et connus sous le nom de « bâtons de commandement », étaient des insignes d’autorité portés par les chefs.
Il ne fait guère de doute que les diversités de tempéraments, de talents et de prédispositions actuelles prévalaient alors, et qu’elles tendaient à différencier la société en chefs, prêtres et guérisseurs, chasseurs de gros gibier et pêcheurs, façonneurs de silex et de peaux, fabricants de vêtements et de chaussures, fabricants d’ornements, graveurs, sculpteurs sur bois, os, ivoire et pierre, et artistes de la couleur et du pinceau. Dans leur travail artistique, du moins, ces gens étaient animés d’un sens irrésistible de la vérité, et on ne peut leur nier un profond sens de la beauté.
Il est probable qu’un sentiment d’émerveillement face aux forces de la nature était lié au développement d’un sentiment religieux. Dans quelle mesure leur travail artistique dans les cavernes exprimait-il un tel sentiment et dans quelle mesure il était le fruit d’une impulsion purement artistique ? Ces questions méritent une étude approfondie. Il ne fait aucun doute que la curiosité qui les conduisit dans les profondeurs et les recoins dangereux des cavernes s’accompagnait d’un sentiment accru de crainte respectueuse et peut-être d’un sentiment que nous pouvons considérer comme plus ou moins religieux. Nous pouvons nous attarder un instant sur ce problème très intéressant de l’origine de la religion à l’âge de pierre, afin que le lecteur puisse en juger par lui-même à la lecture des récits ultérieurs sur l’art magdalénien.
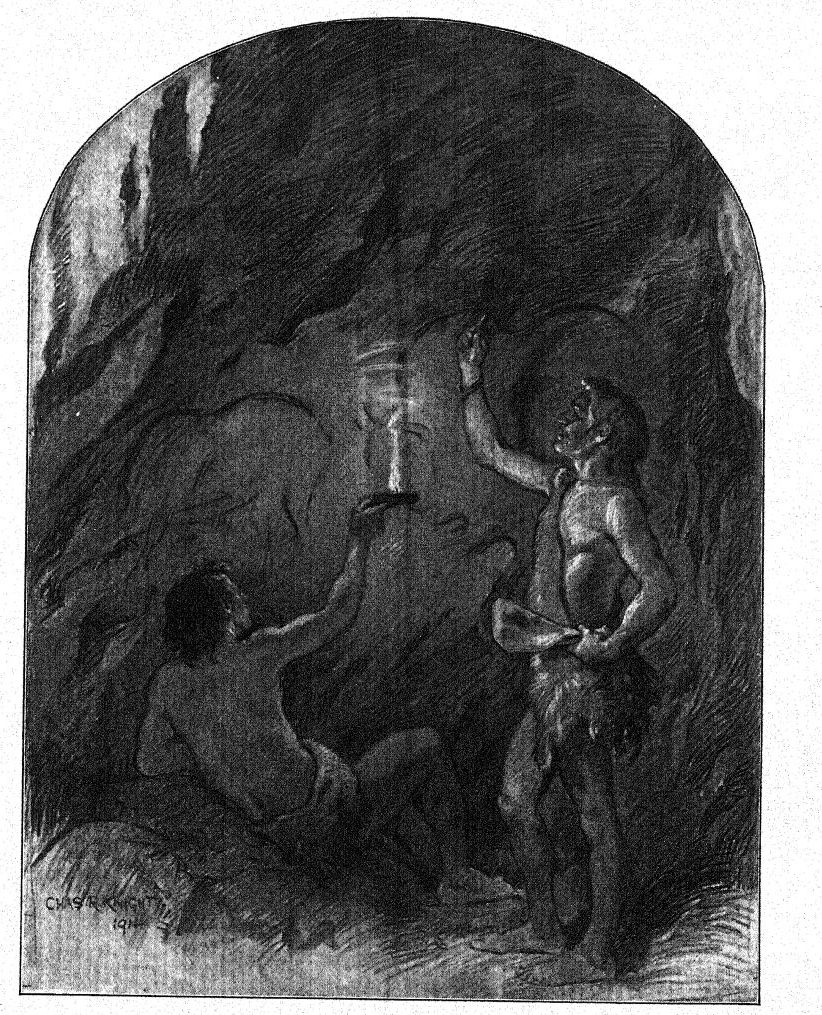
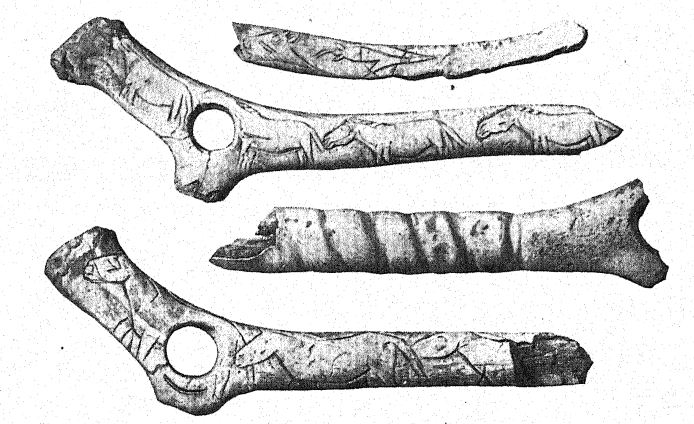
« Le phénomène religieux », observe James3, « s’est révélé consister partout, et à tous ses stades, dans la conscience qu’ont les individus d’une relation entre eux et des puissances supérieures auxquelles ils se sentent liés. Cette relation est perçue sur le moment comme étant à la fois active et mutuelle. […] Les dieux auxquels nous croyons – qu’ils soient le fait de simples sauvages ou d’hommes intellectuellement disciplinés – s’accordent pour reconnaître les appels personnels. […] Contraindre les puissances spirituelles, ou les rallier à notre cause, a été, pendant d’immenses périodes, le seul objectif majeur de nos relations avec le monde naturel. »
[ p. 360 ]
L’étude de cette race, à notre avis, suggère une phase encore plus ancienne du développement de la pensée religieuse que celle envisagée par James, à savoir une phase où les merveilles de la nature, dans leurs diverses manifestations, commencent à éveiller dans l’esprit primitif le désir d’une explication de ces phénomènes, et où l’on tente de rechercher cette cause dans une vague puissance surnaturelle sous-jacente à ces événements autrement inexplicables, cause à laquelle l’esprit humain primitif commence à faire appel. Selon certains anthropologues[1], cette force prodigieuse peut être personnelle, comme les dieux d’Homère, ou impersonnelle, comme le Mana des Mélanésiens ou le Manitou des Indiens d’Amérique du Nord. Elle peut impressionner un individu lorsqu’il est dans un état d’esprit approprié et, par la magie ou la propitiation, être mise en relation avec ses fins individuelles. La magie et la religion appartiennent conjointement au surnaturel, par opposition au monde quotidien du sauvage.
Nous avons déjà constaté, grâce aux sépultures, que ces peuples croyaient apparemment à la préparation des corps des morts pour une existence future. La mesure dans laquelle ces croyances et ce sentiment votif de propitiation, pour la protection et le succès de la chasse, sont révélés par l’art des cavernes, doit être évaluée en fonction de leur vie et de leurs efforts productifs, de leurs sépultures associées à des offrandes d’outils et de nourriture, et de leur art.
¶ Les trois cycles climatiques du Magdalénien
La culture des Crô-Magnons fut sans doute influencée par les conditions climatiques changeantes de l’époque magdalénienne, qui furent très variées, de sorte que l’on peut tracer trois lignes parallèles de développement : celle du milieu, comme l’indiquent le climat et les formes de vie animale, celle de l’industrie, et celle de l’art.
Français L’ensemble du cycle climatique, biologique et industriel dont le Magdalénien marque la conclusion a été présenté au chapitre IV (p. 281). Après une très longue période de climat froid et quelque peu aride suivant la quatrième glaciation, il semblerait que l’Europe occidentale du début du Magdalénien ait de nouveau connu une phase de froid et d’humidité croissants, accompagnée d’une nouvelle avancée des glaciers dans la région alpine, en Scandinavie et en Grande-Bretagne. C’est ce qu’on appelle la phase Bühl dans les Alpes, au cours de laquelle la limite des neiges est descendue de 2 700 pieds sous son niveau actuel et les grands glaciers ont poussé le long des rives sud du lac des Quatre-Cantons une série de nouvelles moraines recouvrant nettement celles de la quatrième glaciation. Une autre indication de la baisse de température et de l’augmentation de l’humidité dans la même région géographique se trouve dans le retour des lemmings arctiques des toundras du nord ; ces migrants ont laissé leurs restes dans plusieurs des grandes grottes au nord des Alpes, notamment à Schweizersbild et à Kesslerloch, composant ce que l’on appelle la couche supérieure des rongeurs, à laquelle sont associés les outils et objets d’art du stade culturel magdalénien ancien.
Nous avons adopté l’estimation minimale de 25 000 ans depuis la quatrième glaciation, mais Heim^ a estimé que l’événement préhistorique beaucoup plus récent de l’avancée de cette glaciation mineure de Bühl a commencé il y a au moins 24 000 ans, qu’il s’est étendu sur une très longue période de temps, et que les moraines de Bühl dans le lac des Quatre-Cantons ont au moins 16 000 ans.
Les trois changements climatiques de l’époque magdalénienne sont donc les suivants :
Premièrement, l’étape postglaciaire de Bühl dans les Alpes, qui correspond à ce que Geikie a appelé la cinquième époque glaciaire, ou Turbarien inférieur, en Écosse ; car il croit qu’une rechute vers des conditions froides dans le nord de la Grande-Bretagne s’est accompagnée d’un affaissement partiel des terres côtières, que des champs de neige sont réapparus, que des glaciers considérables ont descendu les vallées montagneuses et ont même atteint la mer. À cette époque, la flore alpine arctique d’Écosse est également descendue à moins de 150 pieds du niveau de la mer. Le résultat de cette nouvelle ou cinquième glaciation en [ p. 362 ] Europe occidentale a été l’avènement de la grande vague de vie de la toundra et la descente vers les plaines de toutes les formes de vie alpine.
Deuxièmement, il semblerait qu’au Magdalénien moyen, après l’avancée de Bühl, les glaciers se soient temporairement retirés et que, durant cette période, la vie des steppes d’Asie occidentale et d’Europe orientale se soit propagée pour la première fois sur l’Europe occidentale, notamment avec des animaux comme la gerboise et l’antilope saïga, le pika nain et le hamster des steppes. La corrélation est très hasardeuse, mais ce retrait glaciaire pourrait correspondre au Forestien supérieur, ou cinquième stade interglaciaire en Écosse, décrit par Geikie, stade qu’il mentionne comme marqué par l’élévation de la côte écossaise et le retrait de la mer au-delà des côtes actuelles ; des changements géographiques qui s’accompagnèrent de la disparition des neiges et des glaces pérennes, et du retour de conditions plus clémentes. La faune de la toundra prédominait encore ; un animal arctique typique, le bœuf musqué, errait aussi loin au sud que la Dordogne et les [ p. 363 ] Pyrénées, et devint l’un des objets de chasse. Durant ce que l’on appelle le Magdalénien moyen ou « complet », les faunes de la toundra, de la steppe, des Alpes, des forêts et des prairies se répandirent dans les plaines et les vallées de toute l’Europe occidentale.
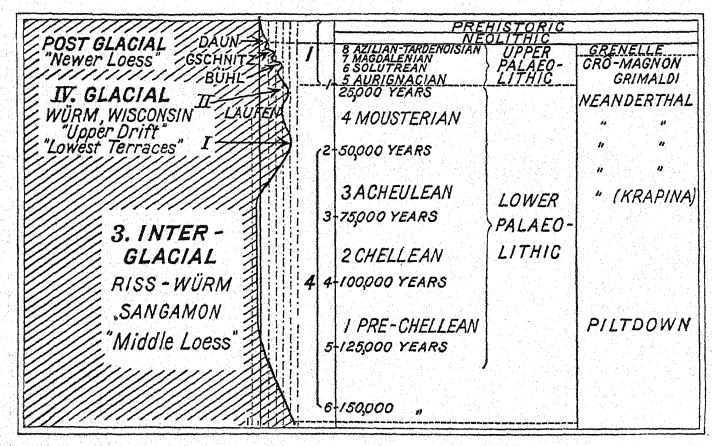
Troisièmement, la deuxième avancée postglaciaire, connue sous le nom d’étape de Gschnitz dans la région alpine, semble avoir été contemporaine de la fin de la culture magdalénienne. Ce fut le dernier grand effort des champs de glace pour conquérir l’Europe occidentale, et dans la région alpine, la limite des neiges s’abaissa de 350 mètres sous les niveaux actuels ; elle marqua la fin de la longue période climatique froide qui avait favorisé la présence du renne, du mammouth laineux et du rhinocéros laineux en Europe occidentale, ainsi que la fin de l’« Époque du Renne » de Lartet. De plus, dans le nord de la Grande-Bretagne, Geikie observe un Turbarien supérieur ou sixième époque glaciaire, accompagné d’un affaissement partiel de la côte écossaise et du retour d’un climat froid et humide ; l’existence de glaciers de neige n’est attestée que sur les hautes montagnes. L’étape Gschnitz marque la fin des conditions glaciaires en Europe, le retrait de la faune de la toundra et de la steppe et la prédominance de l’environnement et de la vie des forêts et des prairies.
Dans les Alpes, il y eut cependant encore un effort final des glaciers, connu sous le nom d’étape Daun, qui, croit-on, correspond largement à la période de l’industrie azilienne-tardenoisienne et à une condition climatique en Europe favorable à la propagation de la vie forestière et des prairies eurasiennes.
La clé de cette grande chronologie préhistorique se trouve dans la paléontologie. Les rongeurs de la toundra arctique, en particulier, sont les plus précieux chronométreurs ; selon Schmidt5, il ne fait aucun doute que la Couche Supérieure des Rongeurs, composée des animaux de la seconde invasion des toundras arctiques, correspond, d’une part, au début de l’industrie magdalénienne et, d’autre part, à la nouvelle avancée glaciaire dans la région alpine, connue sous le nom d’étage Bühl, et probablement aussi à celle du nord. La Couche Supérieure des Rongeurs de l’époque magdalénienne se trouve dans la succession remarquablement complète [ p. 364 ] des dépôts des stations de Schweizersbild et de Kesslerloch, qui sont plus récentes dans le temps que les « basse terrasse » bordant le Rhin voisin. Les animaux fossiles prouvent qu’après le froid extrême du Magdalénien ancien, la faune de la toundra a progressivement cédé la place à une faune steppique largement répandue. Le long du Rhin et du Danube, les lemmings rayés deviennent moins fréquents ; les gerboises, les hamsters et les sousliks des steppes deviennent plus abondants. Des changements exactement similaires sont observés en Dordogne. À Longueroche, sur la Vézère, on trouve pour la première fois en Europe occidentale de grands nombres de lapins (Lepus cuniculus) ; de nombreux baxts (Lepus timidus) sont également observés à la station type de La Madeleine, en particulier dans les couches culturelles les plus hautes et les plus basses. Ces petits lapins provenaient probablement de la région méditerranéenne et dénotent une légère élévation de température. Mais ce n’est que dans les couches magdaléniennes les plus élevées que la vie animale de l’Europe occidentale commence à se rapprocher de celle des temps récents, à savoir celle des faunes préhistoriques des forêts et des prairies.
¶ La vie des mammifères à l’époque magdalénienne
Il est donc très important de garder à l’esprit qu’au Magdalénien, il y avait à la fois des périodes froides et humides, propices à la vie dans la toundra, et des périodes froides et arides, propices à la vie dans la steppe. C’est dans ces dernières que se sont déposées les nappes de « loess supérieur ».
La vie des mammifères du Magdalénien présente un intérêt non seulement en lien avec le climat et l’environnement de la race de Crô-Magnon, mais aussi avec le développement de son industrie et surtout de son art. Il est remarquable que les formes imposantes de la vie animale, le mammouth parmi la faune de la toundra et le bison parmi la faune des prairies, aient fait forte impression et aient été les sujets favoris des dessinateurs et des coloristes ; mais l’œil était également sensible à la beauté du renne, du cerf et du cheval, ainsi qu’à la grâce du chamois. Les artistes et les sculpteurs ont conservé l’apparence extérieure de plus de trente formes de ce merveilleux assemblage de mammifères, qui concordent parfaitement avec les fossiles conservés dans les foyers des grottes et des abris, et avec les dépôts accumulés par les bêtes et les oiseaux de proie dans les cavernes inhabitées.
Aucun artiste n’a jamais eu sous les yeux, à la même époque et dans le même pays, un panorama aussi merveilleux de la vie animale que celui observé par les Crô-Magnon. Leurs représentations, en dessin, gravure, peinture et sculpture, nous offrent un aperçu d’une grande partie de la vie de cette époque, y compris son contingent de formes des toundras, des steppes, des sommets alpins, des forêts et prairies eurasiennes, ainsi que du seul représentant survivant de la faune asiatique, le lion.
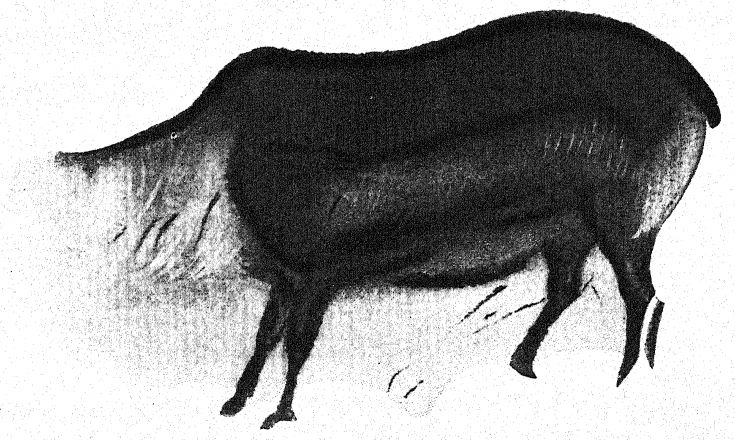
Les peintures et dessins de Dordogne représentent principalement le mammouth, le renne, le rhinocéros, le bison, le cheval, le bétail sauvage, le cerf, le bouquetin, le lion et l’ours. Les cavernes des Pyrénées, dans le sud de la France, présentent principalement des bisons, des chevaux, des cerfs, du bétail sauvage, du bouquetin et du chamois ; le renne et le mammouth sont relativement rares, et dans certains cas, totalement absents de l’art pariétal ; ceci est singulier car dans les Pyrénées, le renne constituait la principale nourriture des auteurs des dessins et des fresques. Dans les grottes des monts Cantabriques, les représentations du renne sont totalement absentes, tandis que la biche et le cerf du cerf sont fréquemment représentés ; on ne trouve que quelques représentations du phalène et une de l’ours des cavernes. Dans les dessins de l’est de l’Espagne, les cerfs et les bovins sauvages sont abondamment représentés, et il existe sans aucun doute une représentation de l’élan à Alpera.
En ce qui concerne les sources de cette grande faune, nous avons observé qu’à la fin de l’Aurignacien et au Solutréen, à Predmost, en Moravie et ailleurs, la faune des steppes n’était pas richement représentée en Europe occidentale, car elle ne comprenait que le cheval des steppes et l’âne sauvage d’Asie ou kiang ; que la toundra contemporaine manquait de deux des formes les plus petites mais les plus caractéristiques, les lemmings à bandes et les lemmings Obi, bien que toutes les grandes formes de la toundra soient encore répandues et librement mêlées à la vie des forêts et des prairies ; et que les prédateurs de ces mammifères herbivores étaient les lions et les hyènes d’Asie survivants.
Les phases fauniques successives du Magdalénien, commençant par la période froide et humide précoce ou toundra, ont été déterminées avec une précision remarquable par Schmidt à partir des restes animaux retrouvés associés aux cultures du Magdalénien inférieur, moyen et supérieur dans les dépôts de grottes et de cavernes du nord de la Suisse, du Rhin supérieur et du Danube supérieur. Cette région manquait de certains des animaux caractéristiques observés en Dordogne, mais ces précieux documents montrent que, tout au long de la période du Magdalénien, s’étendant probablement sur plusieurs milliers d’années, les forêts, les prairies et les bords des rivières d’Europe occidentale ont conservé l’intégralité de la faune forestière et de prairie existante, ou plutôt préhistorique. Le cerf royal, ou cerf élaphe (Cervus elaphus), n’était plus accompagné du cerf géant (Megaceros), qui aurait quitté cette région d’Europe à l’époque aurignacienne, mais le maral ou cerf de Perse (Cervus maral) apparaît occasionnellement ; le cerf et le chevreuil (Capreolus) étaient particulièrement abondants dans le sud-ouest de l’Europe et dans les monts Cantabriques du nord de l’Espagne, où le cerf devint le sujet favori des artistes magdaléniens en même temps que le renne l’était en Dordogne. Dans les forêts, on trouvait également l’ours brun, le lynx, le blaireau, la martre et dans les ruisseaux le castor ; les écureuils arboricoles (Sciurus [ p. 368 ] vulgaris) apparaissent pour la première fois ; et en Dordogne, les lapins et les lièvres deviennent nombreux. Parmi les oiseaux, nous observons le tétras et le corbeau. Le sanglier (Sus scrofa ferus) était occasionnellement trouvé dans la région du Danube et du Rhin, mais abondait dans le sud-ouest de l’Europe et les Pyrénées. Les deux formes dominantes de vie des prairies survivant depuis le début du Pléistocène et largement réparties dans tout le Magdalénien sont le bison (B. priscus) et le bétail sauvage (Bos primigenius) ; de ces animaux, le bison semble avoir été le plus rustique et recherchant une aire de répartition plus septentrionale, tandis que l’urus était extrêmement abondant dans le sud-ouest de la France et les Pyrénées.
Sujets d’art préférés
La vie dans la toundra.
- Mammouth.
- Rhinocéros laineux. Renne.
- Bœuf musqué.
La vie dans les steppes.
- Cheval des steppes.
- Antilope saïga.
- Âne sauvage, kiang.
La vie asiatique.
- Lion.
- Cheval du désert.
La vie alpine.
- Bouquetin.
- Chamois.
La vie dans les prés.
- Bison.
- Bovins sauvages.
La vie en forêt.
- Cerf élaphe, cerf.
- Cheval de forêt.
- Ours des cavernes.
- Loup.
- Renard.
- Sanglier.
- Élan.
- Daim.
La vie marine.
- Joint.
Reptiles, oiseaux, poissons.
- (Rarement représenté.)
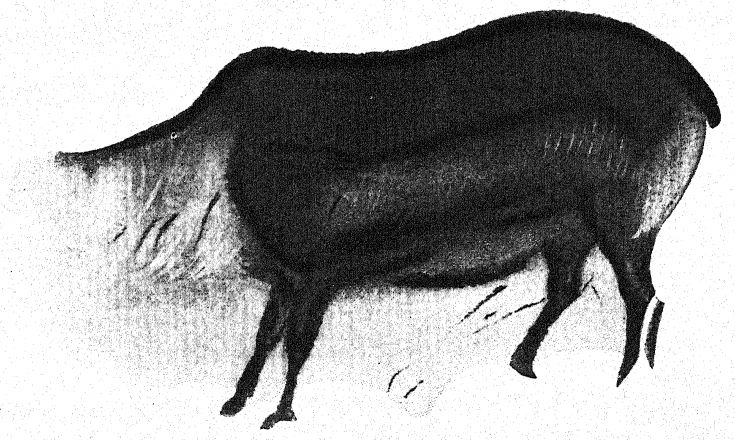
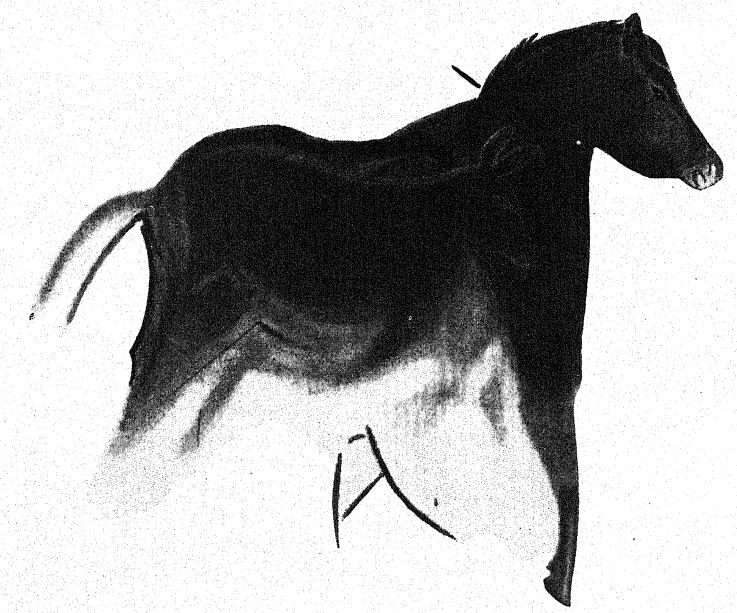
En ce qui concerne l’art, la forme majestueuse du bison semble [ p. 369 ] frapper l’imagination de l’artiste plus que les silhouettes moins imposantes du bétail sauvage ; il y a peut-être cinquante dessins du bison pour un seul des Bos. Parmi la vie des forêts et des prairies, non reconnue dans les restes fossiles, mais clairement distinguée dans l’œuvre des artistes, se trouvent deux types de chevaux : le cheval des forêts ou nordique, apparenté au cheval du nord ou de trait, et le petit cheval des plateaux ou du désert (E. caballus celticus), apparenté à l’Arabe. Avec la vie des forêts, il faut également compter l’ours des cavernes (Ursus spelaeus) du sud-ouest de l’Europe et l’élan (Alces), indiqué par les artistes de l’époque aurignacienne comme présent dans les Pyrénées cantabriques.
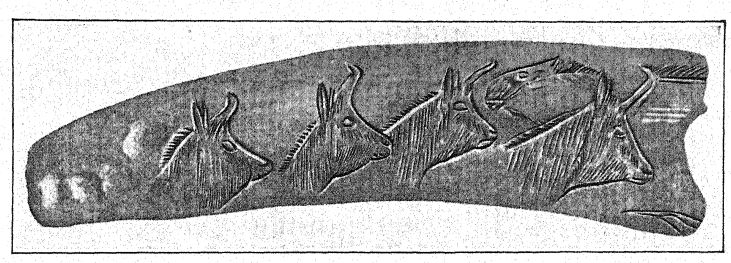
C’est toute la faune eurasienne des forêts et des prairies qui a survécu à toutes les vicissitudes climatiques du Pléistocène et qui est la seule à être restée en Europe occidentale jusqu’à la fin de la culture du Paléolithique supérieur et jusqu’à la période d’arrivée de la race néolithique.
La descente des mammifères alpins européens et asiatiques vers les basses collines et vallées est l’un des épisodes les plus marquants de l’époque magdalénienne. L’argali (Ovis argaloides) d’Asie occidentale était déjà apparu dans la région du Danube supérieur à l’Aurignacien ; il est remplacé à l’époque magdalénienne par le bouquetin (Ibex priscus) et par le chamois, qui descendent le long des versants septentrionaux des Alpes et des Pyrénées et comptent parmi les sujets les plus prisés des artistes magdaléniens, notamment dans l’art mobile en ivoire et en os, et dans la décoration de leurs propulseurs et bâtons de commandement. Des montagnes viennent également les pikas ou lièvres sans queue (Lagomys pusillus), la marmotte alpine (Arctomys marmotta), le campagnol alpin (Arvicola nivalis) et le lagopède alpin (Lagopus alpinus).
¶ Le climat de la toundra au début du Magdalénien
Au cours de la première période froide et humide, la pleine vague de vie de la toundra arctique est apparue dans toute la région située entre les glaciers alpins et scandinaves, lors de la nouvelle descente des champs de glace ; ce fut l’étape timdra du Magdalénien ancien, accompagnant l’avancée de Bühl. Aux stations de Thaingen, Schweizersbild, Kastlhang et Niedernau, apparaît le bœuf musqué, ainsi que le mammouth laineux, le rhinocéros laineux et le renne. La découverte de la grotte de Kastlhang, une station de chasse au renne dans l’Altmuhltale en Bavière®, comble ce qui a longtemps été une lacune dans la répartition géographique du Magdalénien ancien. Les principaux objets de chasse étaient ici le renne, le cheval sauvage, le lièvre arctique et le lagopède ; le cerf royal est très rare et le bison est totalement absent ; La faune présente un caractère arctique marqué par la présence du lemming rayé, du carcajou arctique et du renard arctique. De cette région, le bœuf musqué a migré loin vers le sud-ouest, atteignant les pentes nord des Pyrénées. À la même époque, le tétras arctique, le cygne siffleur et d’autres oiseaux nordiques ont pénétré dans la région du Rhin et du Danube. Mais les indicateurs les plus sûrs d’un climat de toundra froide prévalant pendant la période de l’avancée de Bühl sont le lemming rayé (Myodes torquatus) et le lemming d’Obi (Myodes obensis), que l’on trouve dans les mêmes gisements que le lièvre arctique, le renne et le mammouth laineux, mêlés aux outils de l’industrie du Magdalénien ancien, aux stations de Sirgenstein, Wildscheuer et Ofnet, le long du Danube supérieur et moyen. On y trouve également l’hermine et le carcajou arctique ; en fait, presque toutes les formes caractéristiques de la vie dans la toundra [ p. 371 ] [ p. 372 ] sauf l’ours polaire, qui ne pénètre dans les toundras du nord qu’en été.
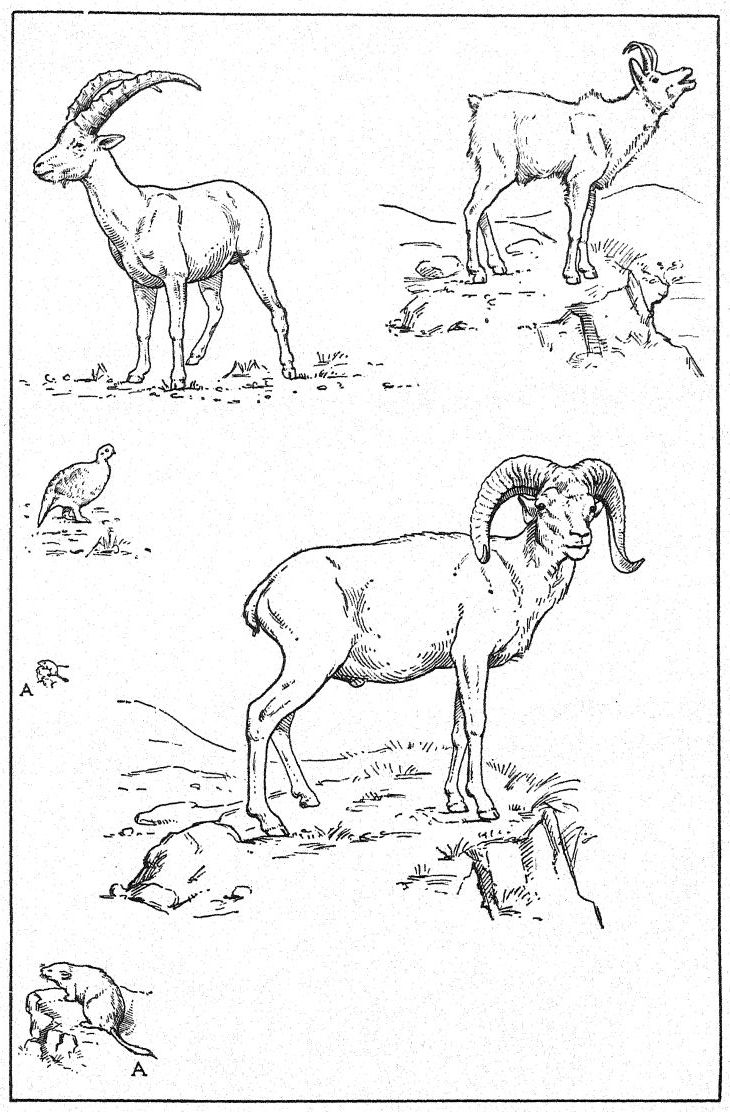
Les régions des Alpes du Nord bordant les grands glaciers des avancées de Bühl et de Gschnitz étaient des étendues rocheuses arides, et les vallées et plateaux désormais libres de glace devinrent des toundras, où les marais alternaient avec des parcelles de saules polaires et de sapins à feuilles étroites, tandis que d’autres zones étaient couvertes de bouleaux bas et broussailleux, de lichens et de mousses de renne. Le retour de ces rudes conditions de vie exerça sans aucun doute une grande influence sur le développement physique et mental de la race de Crô-Magnon ; c’est à l’époque même où les conditions de vie en Europe occidentale étaient les plus difficiles que le développement artistique de ce peuple commença à renaître. Contraints de retourner aux abris et aux grottes, certes moins fréquentés à l’époque solutréenne, ils eurent le temps de développer leur imagination et de s’exprimer dans les arts mobiles et pariétaux. L’industrie du silex connut un développement moins vigoureux, et une dégénérescence apparente de leur physique et de leur stature.
En Allemagne et dans le nord de la Suisse, aux sources du Rhin et du Danube, l’entrée et la sortie des vagues de vie nordiques sont enregistrées, notamment dans les grottes de Sirgenstein, Schussenquelle, Andernach, Schmiechenfels et Propstfels. Il semblerait que le mammouth laineux et le rhinocéros laineux n’aient pas été chassés dans cette région, car leurs restes ne sont conservés dans aucune des grottes ou stations mêlées aux cultures du Magdalénien moyen ou récent. En revanche, on trouve le cheval des steppes, le kiang, le cerf et le renne très abondants. Le bison est absent et le bétail sauvage est très rare ; de sorte que cette région n’est pas représentative de la vie mammalienne du Magdalénien telle qu’on la trouve en Dordogne et dans les Pyrénées.
La migration du manamoth laineux et du rhinocéros laineux le long des Pyrénées et vers l’ouest dans les monts Cantabriques, ainsi que la traversée des Pyrénées par le renne, ont déjà été décrites. Dans les fresques murales de Font-de-Gaume, en Dordogne, il est remarquable que les gravures les plus récentes soient celles du mammouth superposées sur de belles polychromies qui appartiennent à la période de l’art magdalénien moyen.
¶ Le climat des steppes sèches au Magdalénien moyen
La période froide et sèche, durant laquelle la pleine vie des steppes a atteint l’Europe occidentale, est de date assez incertaine ; elle a probablement débuté au Magdalénien moyen et s’est poursuivie jusqu’au Magdalénien supérieur ou supérieur. Il existait certainement un environnement attrayant pour ces mammifères particuliers et hautement spécialisés, qui sont aujourd’hui de couleur neutre, rapides, habitués à une végétation très clairsemée et adaptés aux extrêmes de chaleur et de froid. Parmi les formes plus petites des steppes figuraient la marmotte à poche (Spermophilus rufescens) et le hamster des steppes (Cricetus phaeus), ainsi que le campagnol de Sibérie (Arvicola gregalis). Plus caractéristiques encore étaient la grande gerboise (Alaciaga jaculus), aux longues pattes postérieures élastiques, et l’antilope saïga (Antilope saiga). Avec ces mammifères est apparu le tétras des steppes (Perdix cinerea), que l’on trouve le long du Danube dans les strates du Magdalénien supérieur ; un autre oiseau caractéristique des steppes et des toundras du nord est la « bécasse des bois » (Brachyotus palustris). Parmi ces mammifères figurait sans doute le cheval des steppes (Equus przewalski), aujourd’hui confiné au désert de Gobi ; on dit qu’il fréquente les grottes du nord de la Suisse.
Français Il semblerait que l’antilope saïga ait atteint l’Europe de l’Est à la fin du Solutréen, car son contour aurait été trouvé dans une gravure à Solutréen. Le géant Élasme y était largement répandu en Europe ; il semble très improbable que cet animal ait été présent au Magdalénien, car il aurait certainement attiré l’attention des artistes. Nous n’avons pas non plus de traces artistiques positives de l’âne sauvage, ou kiang, bien que certains dessins des grottes de Niaux et de Marsoulas, du Magdalénien moyen, ainsi que d’Albarracin, en Espagne, puissent être interprétés comme représentant cet animal. Ainsi, la faune des steppes et des déserts asiatiques, qui, dans la région du Rhin supérieur et [ p. 374 ] [ p. 375 ] Le Danube était limité à deux espèces de mammifères à l’Aurignacien et au Solutréen, et atteint neuf ou dix espèces au Magdalénien moyen, de sorte que, pour la première fois pendant toute l’« Époque du Renne », les faunes de la steppe et de la toundra sont équilibrées. On trouve également six ou sept espèces d’oiseaux des landes et des hautes terres d’Asie centrale. L’avifaune représentée dans l’art du Magdalénien moyen comprend le lagopède alpin ou tétras, le cygne sauvage, les oies et les canards.
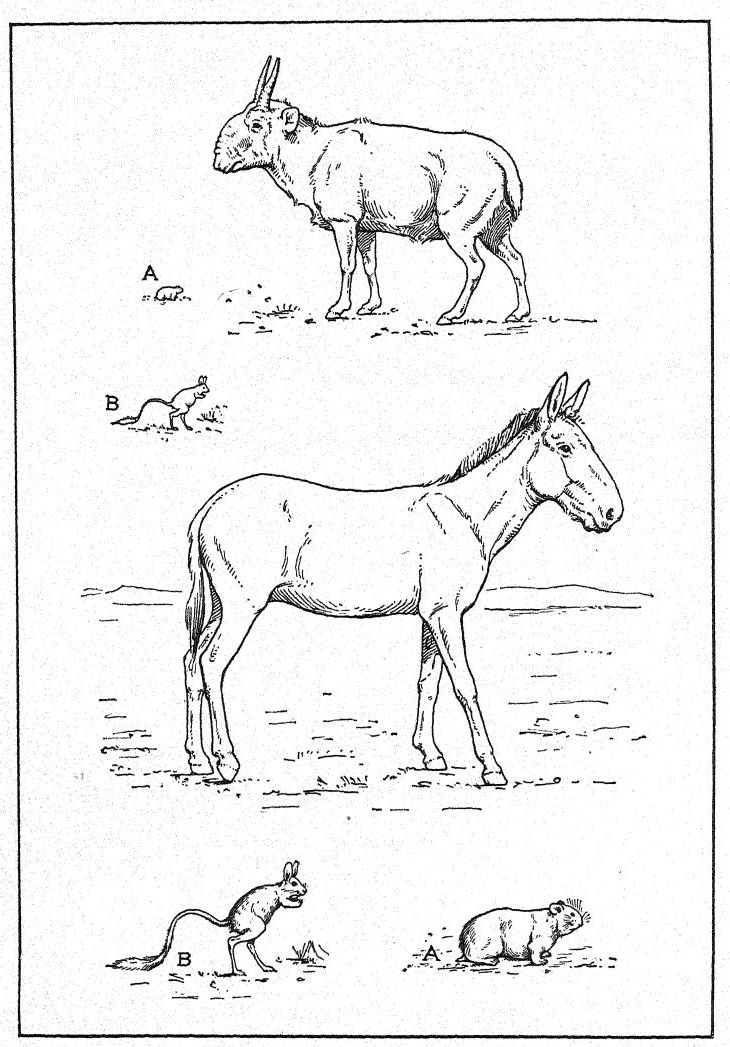
La flore actuelle des steppes subarctiques du sud-est de la Russie et du sud-ouest de la Sibérie comprend des forêts de pins, de mélèzes, de bouleaux, de chênes, d’aulnes et de saules, s’étendant le long des rives des rivières et des ruisseaux, entrecoupées de vastes plaines basses et herbeuses. Il existe de nombreuses gradations entre les steppes basses et hautes ; le climat est relativement chaud en été, la température atteignant 70 °C, tandis que la température moyenne au milieu de l’hiver ne dépasse guère 30 °C ; en général, il existe un fort contraste entre les saisons estivale et hivernale ; les steppes sont pratiquement sans pluie en été, de sorte que le sable et la poussière s’élèvent au moindre vent. Ainsi, été comme hiver, les tempêtes de sable et de poussière jouent un rôle important. Les grandes tempêtes de neige des steppes subarctiques sont aussi destructrices que celles des toundras plus septentrionales et entraînent souvent de lourdes pertes humaines. De nombreuses découvertes tendent à prouver que des conditions similaires prévalaient en Europe occidentale à l’époque magdalénienne. Ainsi, à Châteauneuf-sur-Charente, on trouve une faune mêlée de toundra et de steppe, contenant les ossements de nombreux jeunes animaux qui ont dû périr lors d’un blizzard. On rappelle que dans cette région se trouve la station du Placard, d’âge Solutréen supérieur et Magdalénien. Près de Wurtzbourg, en Bavière, [ p. 376 ], on trouve une faune enfouie dans le lœss, contenant vingt espèces de mammifères des steppes et des montagnes, ainsi que des bisons et des urus.
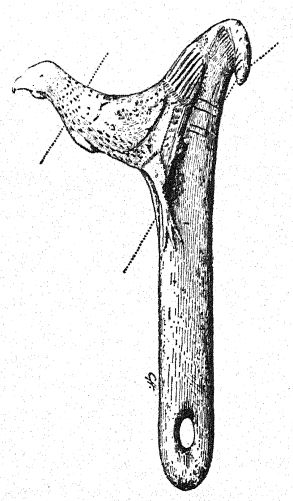
La preuve la plus convaincante de l’extension du climat des steppes froides et sèches est peut-être la migration de l’antilope saïga (Saiga tartarica) vers la Dordogne, où elle est représentée sur des gravures et des sculptures, et vers d’autres régions du sud-ouest de la France, où ses restes fossiles ont été découverts dans treize localités, en association avec une faune de steppe froide. Dans la même région, on a découvert des restes de bœuf musqué (Ovibos), l’un des représentants les plus caractéristiques de la faune arctique.
¶ Races humaines de l’époque magdalénienne
Il semble que la race Crô-Magnon ait continué à prévaloir, mais les anthropologues ont longtemps été divisés quant à l’affinité raciale des hommes découverts à l’époque industrielle du Magdalénien. Les sépultures les plus célèbres sont celles de Laugerie Basse et de Chancelade, en Dordogne, constituées chacune de squelettes de stature inférieure, appartenant probablement à des femmes. Elles représentent certainement une race quelque peu différente des Crô-Magnon typiques de l’Aurignacien, tels que découverts à Crô-Magnon et à Grimaldi. L’archéologue de Mortillet a attribué ces deux squelettes à une nouvelle race, la race de Laugerie. Schliz, qui a récemment étudié ce sujet, a cependant, à juste titre, traité tous ces individus comme des Crô-Magnon d’un type modifié.
Le squelette magdalénien de Laugerie Basse, découvert par Massenat en 1872, reposait sur le dos, les membres fléchis, accompagné d’un collier de coquillages percés de Méditerranée : le corps avait apparemment été recouvert d’une couche d’outils magdaléniens. D’après la longueur du fémur, l’individu mesurait 1,65 m ; les os étaient solides et compacts ; le crâne était bien cambré, avec un front droit et un indice céphalique de 73,2 %.
Le squelette dit de Chancelade a été trouvé dans l’abri de Raymonden en 1888, à une profondeur de 1,50 mètre, et était également dans une position pliée, reposant directement sur le rocher et recouvert de plusieurs couches d’artefacts de la culture magdalénienne tardive ; les membres étaient si étroitement fléchis qu’ils prouvaient qu’ils avaient été enveloppés dans des bandages. Ce squelette présente un crâne bien arqué, un front haut et large et une forme de tête dolichocéphale, mais les membres sont relativement petits, la hauteur ne dépassant pas 1,50 m, soit environ 4 pieds 7 pouces ; le bras et la cuisse sont courts, compacts et maladroits, et le fémur est tordu avec des extrémités relativement épaisses ; ce squelette est généralement classé avec la race Crô-Magnon, mais Klaatsch considère qu’il pourrait appartenir à un type distinct. Français On ne peut négliger, dit Breuil,9 les caractères anatomiques attribués par Testut à l’homme de Chancelade et ses ressemblances avec le type esquimau actuel ; cet indice est en faveur d’un élément nouveau, venu peut-être de la Sibérie asiatique, mais acquérant en Europe occidentale la culture artistique [ p. 378 ] réalisée et conservée dans certaines régions par les tribus aurignaciennes et leurs dérivées. Toutes les races aurignaciennes, solutréennes et magdaléniennes rappellent cependant très fortement la race de Crô-Magnon, ce qui tend à prouver que ces transformations de culture ne se sont pas faites sans un élément notable de continuité humaine.
DÉCOUVERTES D’ÂGE MAGDALÉNIEN PRINCIPALEMENT ATTRIBUÉES À LA RACE CRÔ-MAGN0N[2]
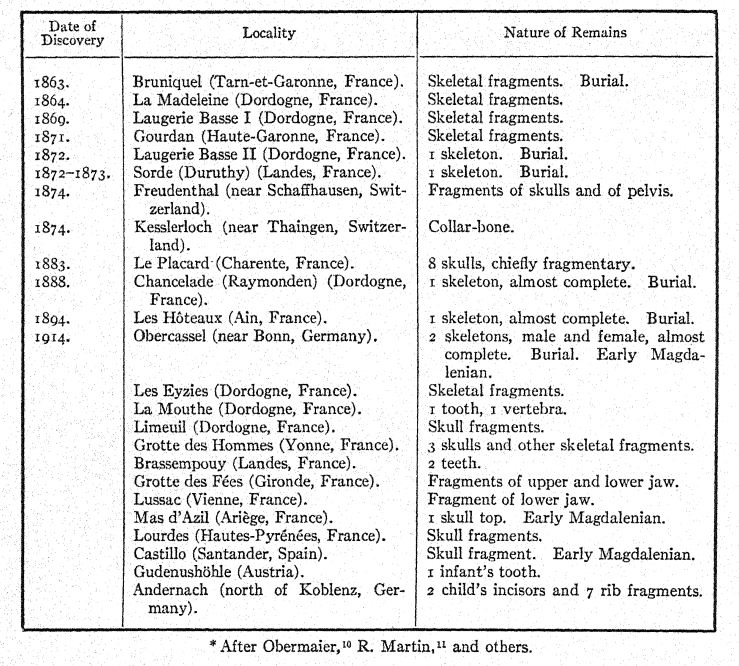
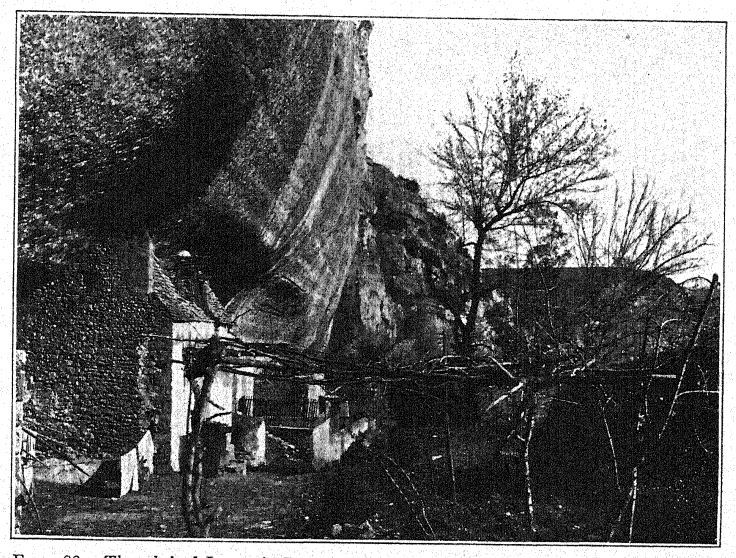
Une autre sépulture magdalénienne est celle de Sorde, dans les Landes, dans la grotte de Duruthy ; ce squelette fut découvert en 1872, enfoui à 2,10 m de profondeur, le corps étant orné d’un collier et d’une ceinture de dents de lion et d’ours, percées et gravées. Sept crânes trouvés en 1883 dans la grotte de Placard, en Charente, appartiennent également au Magdalénien. Le squelette [ p. 379 ] découvert en 1894 dans la grotte des Hoteaux, dans l’Ain, fut enfoui à 1,80 m de profondeur sous des outils magdaléniens ; le corps, reposant sur le dos, était recouvert d’ocre rouge ; les fémurs étaient inversés, indiquant que les membres avaient été démembrés avant l’enterrement, coutume observée chez certains sauvages.
Il s’agit des vestiges magdaïeniens les mieux conservés découverts en France à ce jour. Le point le plus important est la survivance des modes d’inhumation caractéristiques des Crô-Magnon à l’époque aurignacienne, avec l’utilisation de couleurs et d’ornements, et parfois le corps plié et bandé.
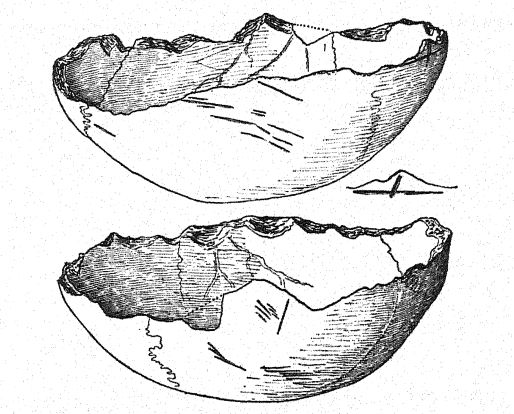
Français Dans la grande grotte de Placard, près de Rochebertier, en Charente, une nouvelle caractéristique dans le mode d’inhumation a été découverte : la séparation de la tête du corps.[3] Les sépultures cérémonielles précédentes, qui ont certainement commencé chez les Néandertaliens à l’époque moustérienne, montrent toujours la coutume d’enterrer le corps entier ; au Paléolithique supérieur commence la nouvelle coutume d’enrober le corps de matière colorante ocre ou rouge, et cela [ p. 380 ] s’applique des sépultures ayrignadiennes de Grimaldi à la sépulture azilienne du Mas d’Azil. La flexion des membres est fréquente au Paléolithique supérieur. Il semblerait que le nouveau cérémonial de Placard ait été introduit au Magdalénien ancien, car dans les couches magdaléniennes les plus basses, quatre crânes ont été découverts serrés les uns contre les autres, le sommet du crâne tourné vers le bas ; des autres parties du squelette, seuls un humérus et un fémur ont été retrouvés. Dans une couche supérieure du même stade industriel, un crâne et une mâchoire de femme ont été découverts, entourés de coquilles d’escargots, dont beaucoup étaient perforées. Plus singulière encore est la présence, dans les couches magdaléniennes de cette grotte, de deux sommets de crânes distincts, façonnés en bols à l’aide d’un outil pointu en silex (fig. 189).
À Arcy-sur-Cure, trois crânes ont été découverts, rapprochés les uns des autres, ainsi qu’un couteau en silex, dans une couche superposée à une industrie aurigée. Le type Placard, avec la tête seule, est de nouveau présent dans l’étage azilien d’Ofnet, en Bavière.
L’incertitude concernant l’affinité raciale des hommes de culture magdalénienne a été entièrement dissipée par la découverte, en février 1914, de deux squelettes à Obercassel, près de Bonn, premier exemple de squelettes humains complets d’âge quaternaire découvert en Allemagne. Comme le rapporte Verworn, les squelettes gisaient à un peu plus d’un mètre l’un de l’autre ; ils étaient recouverts de grandes dalles de basalte et reposaient dans un dépôt de terreau profondément teinté de rouge. Cette matière colorante rouge, qui s’étendait entièrement sur les squelettes et les pierres environnantes, indique qu’il s’agissait d’une sépulture cérémonielle similaire à celle pratiquée par les Cro-Magnons aurinésiens. Avec les squelettes ont été trouvés des ossements d’animaux et plusieurs spécimens d’os finement sculptés, mais aucun outil en silex, d’aucune sorte. Les outils en os comprennent un « Tissoir » finement poli, d’une belle facture, placé sous la tête de l’un des squelettes ; le manche est sculpté dans une petite tête d’animal ressemblant à une martre ; les côtés présentent la décoration entaillée si typique du Magdalénien français. Le deuxième spécimen d’os sculpté est l’une de ces petites têtes de cheval plates et étroites, gravées des deux côtés, telles qu’on en trouve à Laugerie Basse et dans les Pyrénées. L’un des squelettes est celui d’une femme d’une vingtaine d’années et, comme c’est souvent le cas chez les jeunes squelettes féminins, il présente les caractères raciaux à un degré beaucoup moins marqué que le squelette masculin, qui appartient à un homme de quarante à cinquante ans ; l’indice céphalique est de 70 % ; les crêtes supra-orbitaires sont bien développées et les orbites sont nettement rectangulaires ; les os des membres indiquent un corps d’environ 155 cm, ou 5 pieds 1 pouce, de hauteur.
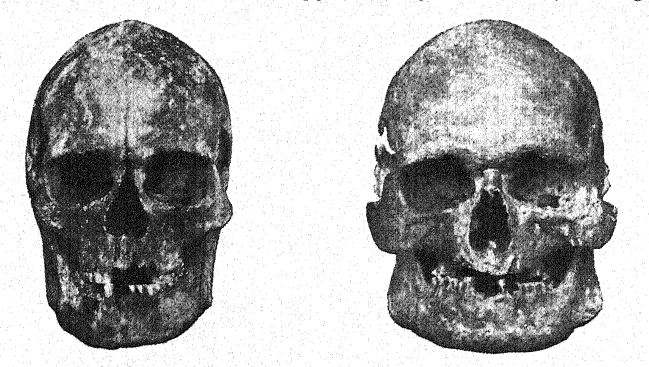
Français Contrairement à ce crâne plus raffiné, le visage extrêmement large et bas de l’homme est entièrement disproportionné par rapport au front modérément large et à la calotte crânienne bien arrondie ; la largeur du visage est de 153 mm et dépasse la plus grande largeur du crâne, qui n’est que de 144 mm. Il s’agit d’un type nettement disharmonique, la largeur du visage étant due non seulement à la large mâchoire supérieure mais à la taille et à la largeur exceptionnelles des pommettes. Le crâne est nettement dolichocéphale, l’indice céphalique étant de 74 % ; la capacité cérébrale est d’environ 1 500 cm³ ; les orbites sont rectangulaires, et au-dessus d’elles s’étend une crête supraorbitaire ininterrompue, avec une légère éminence frontale médiane ; l’ouverture nasale est relativement petite ; la mâchoire inférieure a un cbin fortement marqué ; les couronnes des dents sont usées jusqu’à ce que le [ p. 382 ] l’émail a presque disparu. Alors que les attaches musculaires indiquent une grande force corporelle, la taille ne dépasse pas 1,60 m. Comme des traits prononcés de Crô-Magnon, les deux crânes d’Obercassel présentent un visage inhabituellement large ; dans les deux cas, les profils sont droits et la racine du nez est enfoncée, le nez est étroit et les orbites sont rectangulaires. Mais, observe Bonnet, la plus grande largeur de ces crânes ne se trouve pas au niveau des pariétaux, comme chez les Crô-Magnon typiques, mais juste au-dessus de la région des oreilles, une position beaucoup plus basse ; à cet égard, les crânes d’Obercassel ressemblent au crâne du squelette de Chancelade.
Cette découverte très importante de deux descendants indiscutables de la race Crô-Magnon, associés à des outils en os de facture magdalénienne inférieure, semble prouver de manière concluante que les Crô-Magnon étaient une race passionnée d’art. Les squelettes d’Obercassel confirment les preuves fournies par les sépultures en France selon lesquelles ces personnes étaient de petite taille ; peut-être en raison des conditions climatiques rigoureuses de l’époque magdalénienne, elles avaient perdu les splendides proportions physiques des Crô-Magnon vivant le long de la Riviera à l’époque aurignacienne. Le crâne, tout en conservant tous les caractères prononcés des Crô-Magnon, avait subi une modification au niveau de sa plus grande largeur.
Dans la réduction de la taille de la femme à 5 pieds x pouce et de l’homme à 5 pieds 3 pouces, et dans la réduction de la capacité cérébrale à 1 500 cm³, nous pouvons être témoins du résultat de l’exposition à des conditions climatiques très sévères dans une race qui n’a conservé ses belles caractéristiques physiques et mentales que dans les conditions climatiques plus clémentes du sud.
¶ Les quatre phases industrielles de la culture magdalénienne
Le développement industriel se concentre sur l’Europe centrale et occidentale plutôt que sur le bassin méditerranéen. Il est remarquable qu’il ne s’étende pas le long des côtes africaines, ni même en Italie ou dans le sud de l’Espagne. Il présente quatre grandes étapes ou phases :
Les types les plus anciens14 de la culture magdalénienne naissante ou [ p. 383 ] PROTO-MAGDALÉNIEN, ne sont nulle part mieux représentés que sous le grand abri de Placard, en Charente, où les dépôts successifs profonds obligent à prendre conscience de la longue période de temps nécessaire à l’évolution du Magdalénien et à son merveilleux aboutissement artistique. Avant même la découverte du harpon ou de tout exemple d’art de la gravure comparable à la série classique des niveaux supérieurs, nous trouvons trois niveaux d’industrie magdalénienne naissante à Placard. Des horizons locaux similaires, reconnaissables au type de leurs pointes de javelot (sagaies) et à leurs motifs décoratifs, se trouvent également à Kesslerloch, en Suisse, et jusqu’en Pologne à l’est. De la Dordogne, ils s’étendent jusqu’aux Pyrénées et aux monts Cantabriques du nord de l’Espagne, mais pas plus au sud. Il existe donc une industrie magdalénienne très primitive, largement répandue en Europe centrale et occidentale, autochtone ou influencée par l’Est, mais certainement pas par la Méditerranée. Ce n’est qu’au-dessus de ces horizons primitifs que l’on découvre des couches comportant des harpons rudimentaires, puis des harpons perfectionnés à simple et double rangée de barbelures. Il semblerait que les bassins drainés par la Dordogne et la Garouine aient été à la fois les plus densément peuplés et les centres d’où l’industrie, la culture et l’art se sont répandus vers l’est et vers l’ouest.
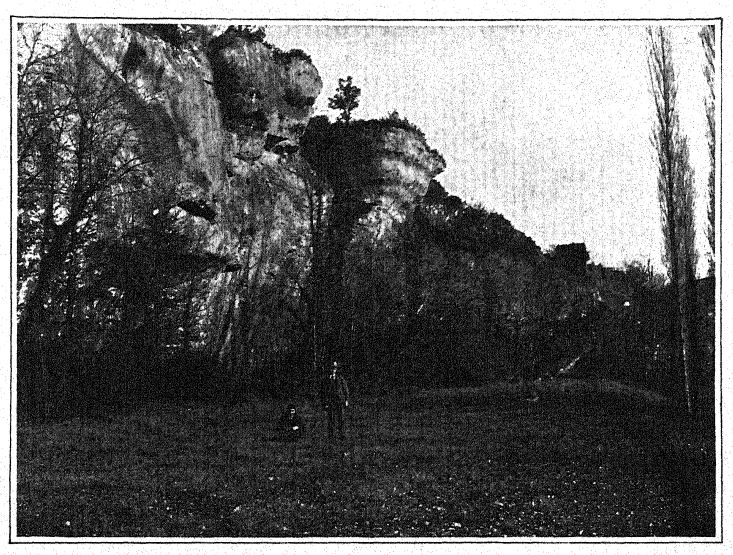
Au cœur de la Dordogne se trouve le grand abri sous roche de La Madeleine, station type de la culture magdalénienne, et autour d’elle, pas moins de quinze stations. Cette station, dont le niveau industriel le plus bas (niveau inférieur) est postérieur à la phase proto-magdalénienne et appartient au Magdalénien ancien, a été largement fouillée par Lartet et Christy durant la décennie qui a suivi sa découverte, en 1865, et plus récemment par Peyrony et d’autres. Le gisement industriel est situé à la base d’un escarpement calcaire surplombant la rive droite de la Vézère ; il s’étend sur une distance de 15 mètres avec une épaisseur moyenne de 2,7 mètres, les niveaux les plus bas ou magdaléniens anciens descendant sous le niveau actuel de la Vézère. Il est significatif que les crues fluviales qui surviennent ici de temps à autre aient également occasionnellement chassé les tailleurs de silex à l’époque magdalénienne. Cela témoigne d’une topographie intacte et de conditions pluviométriques similaires. Il faut imaginer cette falaise bordée d’une flore nordique, ces rives de rivière comme le repaire des bisons et des rennes, et le site d’un camp long et étroit d’abris recouverts de peaux.
Parmi les nombreux spécimens d’industrie et d’art magdaléniens typiques qui ont été découverts ici, on peut citer une géode de quartzite, apparemment utilisée pour contenir de l’eau, et des creusets en pierre, généralement de forme arrondie, adaptés au broyage de couleurs minérales pour le tatouage ou à des fins artistiques ; l’un de ces creusets, présentant des traces de couleur, subsiste encore. Le plus beau des objets d’art est la gravure vive, sur une section de défense en ivoire, du mammouth laineux en train de charger ; c’est l’une des gravures paléolithiques les plus réalistes jamais découvertes ; il existe des indications que l’artiste a utilisé ce morceau d’ivoire relativement petit pour la représentation de trois mammouths ; [ p. 385 ] mais dans la reproduction (fig. 199), toutes les lignes sont éliminées, sauf celles appartenant au mammouth en train de charger ; on observe surtout l’élévation de la tête et de la queue, ainsi que l’action remarquablement vivante des membres et du corps.
De très nombreux niveaux industriels sont découverts dans huit ou dix foyers sus-jacents, qui sont cependant divisés en trois niveaux principaux, comme suit :
Niveau supérieur (culture magdalénienne tardive).
Harpons à double rangée de barbes. Indications d’un climat plus froid et plus sec, rappelant celui des steppes. Bisons, chevaux et rennes abondaient.
Niveau moyen (culture du Magdalénien moyen).
Harpons à barbelures d’un seul côté ; également bâtons de commandement. Indications d’un climat plus humide, avec de fréquentes inondations dues au fleuve. Bisons, rennes et chevaux moins abondants.
Niveau inférieur (culture magdalénienne ancienne).
Harpons à une seule rangée de barbes. Indications de sculpture animalière. Harpons de bison et de renne, mais ceux de cheval sont particulièrement nombreux.
Au Magdalénien ancien, on note l’invention du harpon ; sa première forme rudimentaire est celle d’une courte pointe d’os droite, profondément rainurée sur une face, les crêtes et les encoches le long d’un bord étant les seules indications de ce qui deviendra plus tard les pointes barbelées recourbées du harpon typique. Comme indiqué précédemment, cette invention était destinée à exercer une influence considérable sur les habitudes de ces peuples. Les gros poissons étaient sans aucun doute très abondants dans toutes les rivières à cette époque, et ce nouveau moyen d’obtenir une nourriture abondante a probablement détourné les Crô-Magnon en partie de la chasse, plus ardente et plus dangereuse, aux plus gros gibiers. La découverte s’est rapidement répandue, et parmi les nombreuses localités où l’on a retrouvé des prototypes du harpon, on peut citer Placard, en Charente ; Laugerie Basse, en Dordogne ; Mas d’Azil, sur l’Arize ; et Altamira, dans le nord de l’Espagne. Au Magdalénien ancien, une grande variété de forets ou perceurs en silex est également développée en lien avec le façonnage de l’os, y compris le type « bec de perroquet », ou silex recourbé. Les silex microlithiques, exclusivement destinés aux œuvres artistiques fines et délicates, sont plus abondants qu’à n’importe quelle étape précédente et servaient à façonner et à finir les outils en os qui caractérisent principalement la culture magdalénienne. D’autres outils qui nous permettent de reconnaître les couches culturelles du Magdalénien ancien sont des pointes de javelot en os ou en corne de renne à base oblique, de petites tiges en corne de renne ou en ivoire, des plaques ovales en os fréquemment décorées de motifs gravés et des aiguilles fines et finement finies.
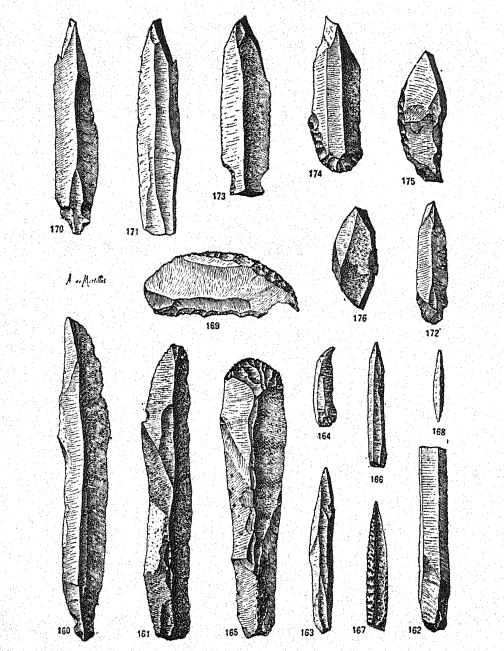
Français Les outils du Magdalénien moyen étaient plus largement répandus que les types anciens, l’arme la plus caractéristique étant le harpon à une seule rangée de barbelures bien définie (Breuil,16 Schmidt17). Selon Breuil, ce harpon à une seule rangée est rare dans les couches inférieures, mais abondant dans les couches supérieures du Magdalénien moyen ; on y trouve également des exemples de harpons à une seule rangée à base en queue d’aronde. D’autres outils de cette époque sont les pointes de javelot en os à base fendue, de petites douelles en os richement décorées, ainsi que de nombreuses aiguilles, plus fines et plus fines que celles du Magdalénien ancien. Il est très intéressant de noter qu’il n’y a pas d’inventions distinctives dans l’industrie du silex, qui ne montre pas de progrès importants, bien que les silex microlithiques soient encore plus abondants qu’auparavant. À des fins industrielles, les grattoirs continuent d’être très abondants, ainsi que les perforateurs pour la perforation des outils en os. Le [ p. 388 ] L’industrie du Magdalénien moyen est mieux représentée dans les gisements du centre et du sud de la France, à Raymonden, Bruniquel, Laugerie Basse, Gourdan, Mas d’Azil et Teyjat.
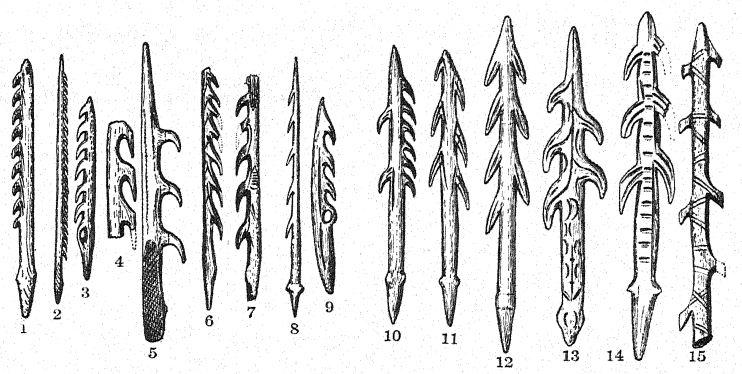
L’arme principale du Magdalénien récent est le harpon à double rangée de barbelures, que l’on retrouve sur tous les principaux sites de découverte, depuis les stations du sud-ouest et du sud de la France jusqu’à l’extrême est. Outre le harpon à double rangée, on retrouve fréquemment le ciseau cylindrique en bois de renne, souvent pointu à l’extrémité et légèrement incurvé sur le côté ; celui-ci, comme d’autres outils en os, était richement décoré de gravures. Ce niveau du Magdalénien récent se distingue partout par la richesse décorative de tous les outils et armes en os, ainsi que des bâtons de commandement. La quantité d’aiguilles en os, plus nombreuses à cette époque que jamais auparavant, témoigne d’un plus grand raffinement dans la confection des vêtements.
Ce fut le point culminant de l’industrie et de l’art magdaléniens, et probablement aussi de la morale et des modes de vie. Des types caractéristiques de cette culture magdalénienne tardive se trouvent à La Madeleine, aux Eyzies et à Teyjat, et s’étendent jusqu’aux Pyrénées septentrionales, à Lourdes, Gourdan et au Mas d’Azil. Leur répartition géographique vers l’est sera décrite ultérieurement. Les silex microlithiques atteignent alors leur apogée ; aux petits éclats laminés au dos émoussé s’ajoutent de petites lames de silex en forme de plumes, et d’autres encore à extrémités obliques, qui commencent à suggérer les formes géométriques de l’industrie tardenoisienne qui lui succéda. Parmi les perceurs de silex, on remarque un type prédominant à pointe centrale robuste, également appelé perceur « à bec de perroquet » ; pour la préparation des peaux, les grattoirs sont fabriqués, comme auparavant, à partir de fins éclats, légèrement retouchés aux deux extrémités pour leur donner une forme arrondie ou rectangulaire.
Après l’étage Magdalénien supérieur ou supérieur, vient une période de déclin de l’industrie. Dans le sud de la France18, les outils en silex et en os présentent des indications indéniables de l’approche de l’étage tardénoisien ou azilien qui lui succède. Dans les Pyrénées, les silex et les grands polisseurs en bois de cerf commencent à ressembler à ceux que l’on trouve dans les niveaux post-magdaléniens. [ p. 389 ] Cette étape industrielle correspond globalement à la période de déclin de l’art et au changement des habitudes industrielles et de l’esprit artistique des Crô-Magnon.
Les divisions du Magdalénien sont donc les suivantes :
5. Déclin de l’art et de l’industrie magdaléniens.
4. Magdalénien tardif typifié à La Madeleine, Dordogne.
3. Magdalénien moyen typifié à La Madeleine, Dordogne.
2. Magdalénien ancien typifié à La Madeleine, Dordogne.
1. Proto-Magdalénien typifié à Placard, Charente.
¶ Industrie du silex et de l’os
A travers les quatre stades successifs de développement que nous avons déjà retracés (p. 382), on perçoit certaines tendances et caractéristiques générales qui séparent nettement la culture magdalénienne de la culture solutréenne précédente.
Comparés à l’époque solutréenne, époque à laquelle l’art du silex atteignit son apogée, les palséolithes magdaléniens présentent une dégénérescence technique marquée, n’ayant ni la symétrie de forme ni les surfaces finement taillées qui distinguent les types solutréens ; en effet, ils n’égalent même pas la retouche marginale rainurée des meilleures œuvres aurignaciennes. La retouche magdalénienne ne présente aucune influence du Solutréen ; elle est même plus émoussée et marginale que celle de l’Aurignacien récent. En compensation de cette décadence dans l’art de la retouche, les Crô-Magnon font aujourd’hui preuve d’une habileté extraordinaire dans la production de longs éclats de silex étroits et minces, détachés du nucléus d’un seul coup ; ces « lames », très nombreuses, ne sont souvent pas retouchées du tout ; il arrive que quelques touches hâtives permettent d’obtenir une extrémité arrondie ou oblique ; dans d’autres cas, un écaillage marginal très limité le long des côtés ou le développement d’un pédicule allongé (soie) produit des instruments très efficaces pour la gravure et le travail sculptural.
Pour l’art de la gravure, des burins, burins-grattoirs et burins doubles parfaits furent rapidement fabriqués à partir de ces minces éclats ; on fabriqua également des burins à bord oblique et à extrémité en « bec de perroquet ». À des fins industrielles, certains silex étaient denticulés sur le pourtour, sans doute pour la préparation de fibres [ p. 390 ] et de fines lanières de cuir destinées à fixer les vêtements au corps et à fixer les pointes de lance en silex et en os aux hampes en bois. On a découvert des pergoirs extrêmement fins, adaptés à la perforation des aiguilles en os ; le grattoir, simple ou double, était également fabriqué à partir de ces éclats, et le noyau du silex servait de marteau. On a également trouvé des marteaux en pierres simples et arrondies.
Mais la caractéristique notable de l’industrie magdalénienne réside dans l’utilisation massive et sans précédent de l’os, de la corne et de l’ivoire. À partir des bois de renne, les sagaies, ou pointes de javelot de tailles variées, sont très tôt développées. Elles sont généralement ornées sur les côtés et présentent diverses formes d’attache au manche en bois, fourchues, biseautées ou arrondies. L’ornementation consiste en des lignes gravées allongées ou perlées, et en de profondes rainures, peut-être destinées à l’insertion de fluides toxiques ou à l’évacuation du sang.
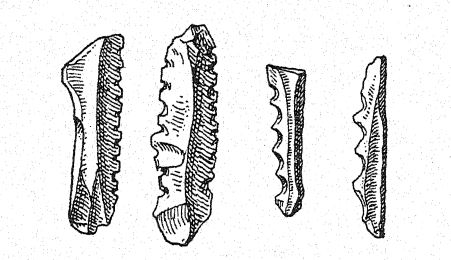
De toutes les armes magdaléniennes, la plus caractéristique est le harpon, principal instrument de pêche, qui apparaît pour la première fois marqué par l’invention du dard ou pointe rétroversée de manière à se maintenir en place dans la chair. Le dard n’apparaît pas soudainement comme une mutation inventive, mais il évolue très lentement à mesure que son utilité se démontre dans la pratique. Le manche est très rarement perforé à la base pour y attacher une ligne ; il est de forme cylindrique, adapté à la capture des gros poissons des ruisseaux. L’utilisation d’une arme barbelée pour la chasse semble être attestée par des dessins de la grotte de Niaux et des lignes gravées sur les dents de l’ours, mais ces dessins indiquent la forme d’une flèche plutôt que d’un harpon. Sa longueur varie de deux à quinze pouces. Les harpons étaient peut-être lancés au moyen de propulseurs, qui ressemblent aux instruments utilisés aujourd’hui par les Esquimaux et les Australiens. Ces lanceurs sont souvent magnifiquement sculptés, comme celui retrouvé au Mas d’Azil, orné d’un magnifique relief représentant un bouquetin.
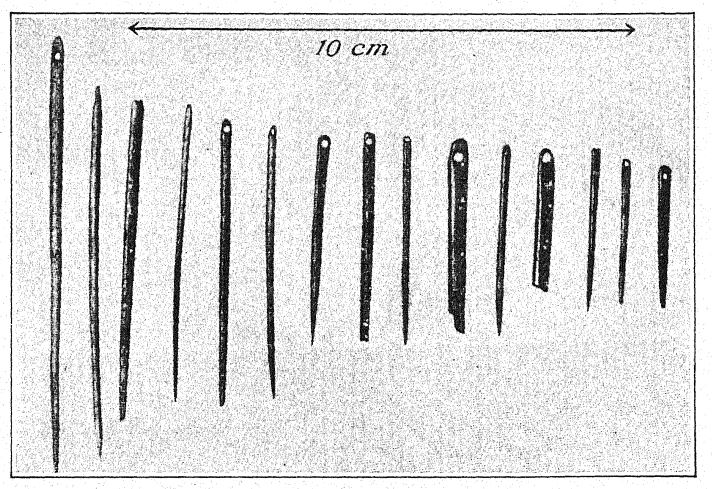
Il y avait ensuite des bâtons de commandement, sculptés de scènes de chasse et de têtes de chevaux et d’autres animaux, qui étaient très probablement des insignes d’officiers. Reinach a suggéré que les bâtons étaient des trophées de chasse et, selon Schoetensack, ils auraient pu servir d’ornements pour attacher les vêtements. La découverte de peintures murales et de gravures suggère que l’on croyait que ces bâtons avaient une influence magique et étaient liés à des rites mystérieux dans les cavernes, car on trouve une grande variété de ces bâtons cérémoniels chez les peuples primitifs. Géographiquement, les bâtons se sont répandus des Pyrénées jusqu’en Belgique et vers l’est jusqu’en Moravie et en Russie.
De fines aiguilles en os, finement pointues sur des polissoirs en pierre, témoignent d’un grand soin apporté à la préparation des vêtements. De nombreux autres instruments en os sont associés aux perceurs : poinçons, marteaux, ciseaux, stylets, épingles avec ou sans tête, spatules et polissoirs ; ces derniers pourraient avoir été utilisés pour la préparation du cuir. Les perceurs, épingles et polissoirs apparaissent dès le début de la sculpture. Le nom de poignard est donné à de longues pointes en bois de renne ; l’une d’elles a été retrouvée à Laugerie Basse.
¶ Histoire ou art du Paléolithique supérieur
Après les études pionnières de Lartet, l’histoire de l’art de la période du renne, tel qu’il se manifeste dans l’os, l’ivoire et les cornes de cerf gravées et sculptées, occupa les trente-cinq dernières années de la vie d’Édouard Piette, un magistrat de Graonne qui se consacra à ce sujet passionnant par passion. Il fut un pionnier dans l’interprétation de l’art mohilier. Il faut se rappeler qu’à l’époque de Piette, les quatre divisions de la culture du Paléolithique supérieur, si familières à nous, n’étaient que partiellement perçues ; ses études, en fait, portaient principalement sur l’art mobile de l’époque magdalénienne, et il entreprit d’en suivre les modifications dans chaque grotte successive, en commençant par sa brochure La Grotte de Gourdan, en 1873, dans laquelle il annonça pour la première fois l’idée qui sous-tendait toutes ses conclusions ultérieures, à savoir que la sculpture précédait la gravure au trait et l’eau-forte. Il divisa l’art en une série de phases ; Il nomma celle du cerf élaphique (Cervus elaphus), celle du renne Tarandienne, celle du cheval Hippiquienne et celle du bétail sauvage Bovidienne. En concluant ce premier ouvrage de 1873, il remarquait : « Écrire l’histoire de l’art magdalénien, c’est donner l’histoire de l’art primitif lui-même. » Il observait qu’en sculptant la corne du renne, l’artiste était obligé de travailler l’extérieur dur, l’os, et d’éviter l’intérieur spongieux ; ce défaut de matériau suggérait l’invention du bas-relief. Il considérait la statuette comme l’assemblage de deux bas-reliefs, un de chaque côté de l’os. Ainsi, il décrivit la tête en ivoire de la femme de Brassempouy, seul visage humain du Paléolithique supérieur qui soit même assez bien représenté ; ainsi que les deux torses féminins imparfaits en ivoire. En 1897, à l’âge de soixante-dix ans, Piette entreprit ses dernières fouilles, et la somme de ses travaux nous est conservée dans le magnifique ouvrage intitulé l’Art pendant l’âge du Renne, publié en 1907.
Français L’élève et biographe de Piette, l’abbé Henri Breuil, observe que son schéma de l’évolution de l’art est exact dans ses grandes lignes20. Il est vrai que la sculpture humaine apparaît pour la première fois dans l’Aurignacien inférieur, qu’elle survit au Solutréen et s’étend même jusqu’au Magdalénien moyen, mais cette énorme période ne peut être placée dans une seule division archéologique comme le supposait Piette ; en vérité, il ne soupçonnait pas la gestation prolongée de l’art quaternaire, mais il contractait en une petite division les documents de nombreuses phases. En même temps, Piette avait raison d’attribuer la fleur de l’art de la gravure accompagnée de contours de formes animales en relief aux deuxième et troisième niveaux de l’industrie magdalénienne, mais il ignorait que ce développement avait été précédé d’une longue période au cours de laquelle la gravure avait été pratiquée de manière timide et plus ou moins sporadique comme art pariétal sur les parois des cavernes aussi bien que sur l’os et la pierre. Il est vrai aussi qu’une grande aisance en sculpture a précédé l’art de la gravure, mais elle a été arrêtée dans ses progrès tandis que la gravure se développait lentement ; dans le choix initial des sujets, les sculpteurs de l’Aurignacien moyen et récent ont montré une préférence pour la forme humaine, tandis que plus tard, au Solutréen et au début du Magdalénien, ils se sont principalement tournés vers les figures animales, de sorte que la sculpture n’a pas été soudainement éclipsée. Les premières gravures faites à la fine pointe de silex sur pierre ne sont guère moins anciennes que les premières sculptures, et coexistent modestement à leurs côtés jusqu’au moment où la gravure, grandement multipliée, supplante largement la sculpture. Enfin, observe Breuil, c’est une des gloires d’Édouard Piette [ p. 394 ] d’avoir compris que les galets peints du Mas d’Azil représentaient le dernier prolongement de l’art quaternaire agonisant.
Il est heureux que le flambeau de Piette soit tombé sur un homme doté du génie artistique et de l’appréciation de Breuil, à qui nous devons principalement notre compréhension claire de l’évolution chronologique de l’art du Paléolithique supérieur. Le tableau ci-joint (p. 395) rassemble les résultats des observations de Piette, Sautuola, Rivière, Cartailhac, Capitan, Breuil et de bien d’autres, en grande partie selon l’ordre chronologique déterminé par les travaux de Breuil.
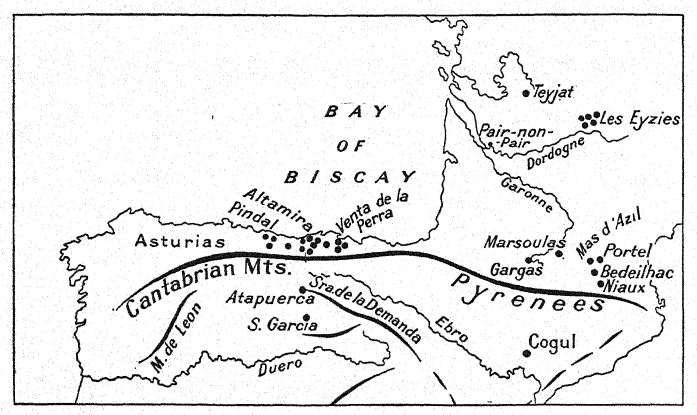
Nous sommes loin de 1880, observe Cartailhac21, lorsque la découverte par Sautuola des peintures du plafond de la caverne d’Altamira fut accueillie avec tant de scepticisme et d’indifférence. Connaissant l’instinct artistique des peuples du Paléolithique supérieur grâce à leurs gravures sur os et sur ivoire, nous aurions dû nous attendre à la découverte d’un art pariétal. La publication des gravures de la grotte de La Mouthe par Rivière^^ en avril 1895 fut le premier avertissement de notre oubli, et immédiatement Édouard Piette rappela Altamira à la mémoire des chercheurs en art préhistorique. La découverte de Sautuola cessa d’être isolée. Guidés par les gravures trouvées à La Mouthe, [ p. 395 ] [ p. 396 ] Daleau découvrit les gravures de la grotte de Pair-non-Pair, en Gironde. En 1902, il y eut la double découverte des gravures de la grotte de Combarelles et des peintures de la grotte de Font-de-Gaume, communiquées par Gapitan et Breuil. Des découvertes à Marsoulas, au Mas d’Azil, à La Grèze, à Bernifal et à Teyjat suivirent bientôt.[4]
| Sculpture | Figures gravées | Figures peintes | |
|---|---|---|---|
| Azilien. | VI. Absence de dessins animaliers. | VI. Décoration azilienne conventionnelle. Galets plats colorés en rouge et noir. Mas d’Azil, Marsoulas, Pindal, | |
| Magdalénien récent. | V. Absence totale. | V. Pas d’art animalier. Diverses figures et signes schématiques et conventionnels (bandes, branches, lignes, surfaces ponctuées évoquant les galets aziliens). | |
| Magdalénien moyen. | Figurines humaines élancées en ivoire et en os. Formes animales en corne de renne et de cerf sur des instruments de chasse et des insignes cérémoniels. |
IV. Gravures faiblement tracées ; de fines lignes indiquant des poils prédominent dans les dessins, comme à Font-de-Gaume et à Marsoulas. Contours et détails animaliers perfectionnés. Beaux contours animaliers, Grotte de la Mairie, Marsoulas. Gravure perfectionnée sur os et ivoire. |
IV. Figures animales polychromes au contour noir et modelé intérieur obtenu par un mélange de jaune, de rouge et de noir. Association constante du r adage et des incisions avec la peinture. siy Usees. Grandes et brillantes fresques polychromes de Marsoulas, Font-de-Gaume, Altamira. Contours animaliers en noir, Niaux. |
| Magdalénien ancien. | Sculpture animalière. Bisons de F. d’Audoubert ; hauts-reliefs de chevaux, Cap-Blanc. | III. Lignes profondément incisées suivies de légers contours en graffiti. Contours et poils incisés, par exemple, mammouths de Combarelles. Dessins striés, Castillo, Altamira, Pasiega. | III. Figures en aplat et ombrage chinois sans modelé, ainsi que figures animales pointillées comme à Font-de-Gaume, Marsoulas, Altamira, Pasiega. |
| Solutréen. | Sculpture osseuse en haut-relief ; 1er siècle av. J.-C., Pyrénées. Sculpture animalière en ronde-bosse, Préd. ost. | Gravures. | |
| Aurignacien récent. | Lourdes statuettes humaines (id jls) de Menton, Brassempouy, Wiliendarf, Brünn. Bas-reliefs humains de Laussel. Lourdes figures humaines de Sireuil, Paire-non-Paire. | II. Figures animales et humaines, d’abord très profondément incisées, puis moins ; quatre membres généralement figurés. Dessins vigoureux, un peu maladroits, comme à La Mouthe, puis plus caractéristiques comme à Combarelles. | II. Lignes de remplissage d’abord faibles, puis de plus en plus fortes, finalement associées à un modelé de contour qui finit par recouvrir toute la silhouette. ^ Lignes incisées associées à la peinture comme à Combarelles, Fontde-Gaume, La Mouthe, Marsoulas, Altamira. |
| Aurignacien ancien. | Animaux en bas-relief. | I. Figures profondément incisées, lourdes, de profil absolu ; de forme rigide comme à Pair-non-Pair, La Grèze, La Mouthe, Gargas, Bernifal, Hornos de la Peña, Marsoulas, Altamira. Contours animaliers archaïques de Castille. |
I. Tracés linéaires en monochrome, simples lignes noires ou rouges, indiquant seulement une silhouette. Deux membres sur quatre sont ordinairement figurés. Les plus anciennes peintures de Castillo, Altamira, Pindal, Font-de-Gaume, Marsoiilas, La Mouthe, Combarelles, Bernifal. |
| Statuaire et bas-relief. | Art mobile et pariétal au trait. | Art pariétal et mobile en couleur. |
ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DE L’ART DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
En 1908, Dechelette a répertorié huit grottes en Dordogne, six dans les Pyrénées et sept le long des Pyrénées cantabriques du nord de l’Espagne, mais il existe maintenant plus de trente grottes dans lesquelles des traces d’art pariétal ont été trouvées, et sans doute le nombre sera considérablement augmenté par les explorations futures, car les entrées de nombreuses grottes ont été fermées et les recoins éloignés dans lesquels sont placés des dessins, comme dans la récente découverte du Tuc d’Audoubert, sont très difficiles à explorer.
Les principales divisions de l’art palgéolithique supérieur sont les suivantes :
- Dessin, gravure et eau-forte avec de fines pointes de silex sur des surfaces de pierre, d’os, d’ivoire et sur les parois calcaires des cavernes.
- Sculpture en bas ou haut-relief. Principalement en pierre, en os et en argile.
- Sculpture en ronde-bosse en pierre, ivoire, bois de renne et de cerf.
- Peinture au trait, en tons monochromes et en polychromies de trois ou quatre couleurs, généralement accompagnée ou précédée de gravure au trait, avec des pointes de silex ou des bas-reliefs.
- Ornements conventionnels tirés de la répétition de formes animales ou végétales ou de la répétition de lignes géométriques.
¶ Dessins et gravures du Magdalénien ancien
Nous avons déjà retracé l’art de la gravure, tel qu’il apparaît pour la première fois à la fin de l’Aurignacien, jusqu’au Solutréen ; dans ce dernier, il n’est que faiblement représenté. Son développement ultérieur au début du Magdalénien se retrouve dans les gravures réalisées avec des instruments en silex plus délicats ou plus pointus, capables de tracer une ligne excessivement fine ; il s’agissait sans doute des premiers microlithes magdaléniens. Les contours des animaux, avec une indication [ p. 397 ] de poils, sont fréquemment esquissés avec des lignes si extrêmement fines qu’elles ressemblent à des eaux-fortes ; les figures sont souvent de très petites dimensions et marquées par une attention beaucoup plus particulière aux détails, tels que les yeux, les oreilles, les cheveux de la tête et de la crinière, et les sabots ; les proportions sont également beaucoup plus exactes, de sorte que ces gravures deviennent très réalistes. Breuil attribue au Magdalénien ancien les traces gravées de mammouths de Combarelles. On trouve également des gravures de cette période dans les grottes d’Altamira en Espagne et de Font-de-Gaume en Dordogne, [ p. 398 ] et à cette époque appartient le groupe de biches d’Altamira, qui se distingue par les lignes particulières de leurs poils recouvrant leur visage. Les sujets choisis sont principalement le cerf rouge, le renne, le mammouth, le cheval, le chamois et le bison. Les dessins striés de Castillo et d’Altamira, qui représentent en partie des poils et en partie des indications d’ombrage, appartiennent à cette période.
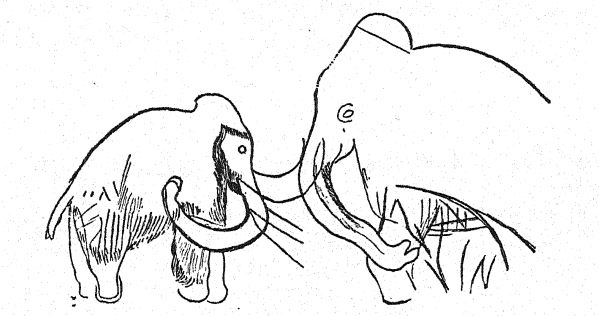
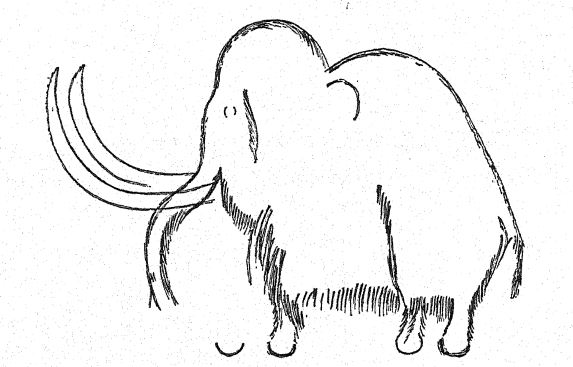
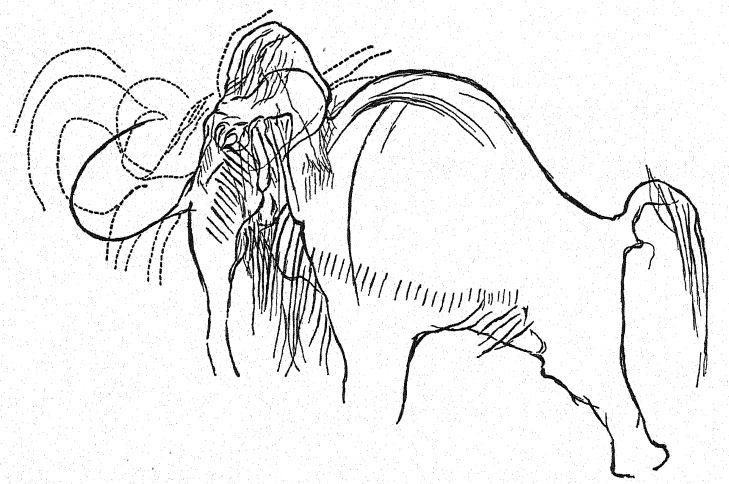
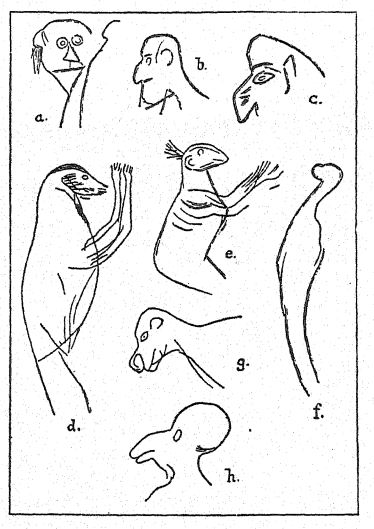
Français Les gravures de la grotte de La Mouthe ont été découvertes par Rivière en 1895 et ont permis de redonner de l’attention à l’art pariétal depuis longtemps oublié découvert à Altamira par Sautuola en 1880. Les dessins de La Mouthe commencent à environ 270 pieds de l’entrée et peuvent être suivis sur une distance de 100 pieds, dispersés en divers groupes ; ils appartiennent manifestement à une étape très primitive, probablement du Magdalénien ancien, le point d’intérêt principal étant que, tandis que la plus grande partie des gravures sont en simples lignes incisées, ici et là le contour est renforcé par une ligne de peinture rouge ou noire ; c’est le début d’une méthode suivie dans tout l’art pariétal magdalénien, dans laquelle l’artiste esquisse soigneusement ses contours avec des silex pointus avant d’appliquer la couleur. Ce traitement, d’abord limité aux simples contours, a conduit à tracer de nombreux détails au trait gravé, les yeux, les oreilles, les cheveux ; Breuil a ainsi montré qu’à son développement final, une gravure soigneusement élaborée sous-tend le tableau. Dans les dessins de La Mouthe, les proportions sont très mauvaises ; ils représentent le renne, le bison, le mammouth, le cheval, le bouquetin et l’urus ; des taches rouges sont parfois éclaboussées sur les flancs des animaux ; çà et là, on trouve un travail de qualité supérieure, comme le renne en mouvement.
Français La grotte des Combarelles, découverte en 1901, en Dordogne, près des Eyzies, contient de loin le témoignage le plus remarquable de l’art magdalénien ancien ; on y trouve plus de quatre cents dessins et gravures représentant presque tous les animaux du Magdalénien ancien, parmi lesquels le cheval, le rhinocéros, le mammouth, le renne, le bison, le cerf, le bouquetin, le lion et le loup ; il y a aussi entre cinq et six représentations des hommes de l’époque, masqués et démasqués ; le style est plus récent que celui des plus anciens dessins de Font-de-Gaume, mais beaucoup plus ancien que la période de l’art polychrome.[5] La galerie mesure 720 pieds de long et à peine 6 pieds de large ; les dessins commencent à environ 350 pieds de l’entrée et sont dispersés à intervalles irréguliers jusqu’à la toute fin. En général, l’art est très raffiné et manifestement en grande partie l’œuvre d’un seul artiste ; les représentations du rhinocéros laineux et du mammouth sont très fidèles à la réalité ; on y trouve deux magnifiques chevaux, un mâle et une femelle ; les dessins du cheval sont abondants, et nous avons côte à côte une représentation de plusieurs types de chevaux : le pur type forestier au front arqué, le petit type celtique à la tête fine, et un type plus grand rappelant le kiang, ou âne sauvage. Ici, la majeure partie de l’œuvre est de la gravure, contrastant avec les contours peints de la caverne de Niaux et avec les contours gravés à l’eau-forte de la grotte de la Mairie.
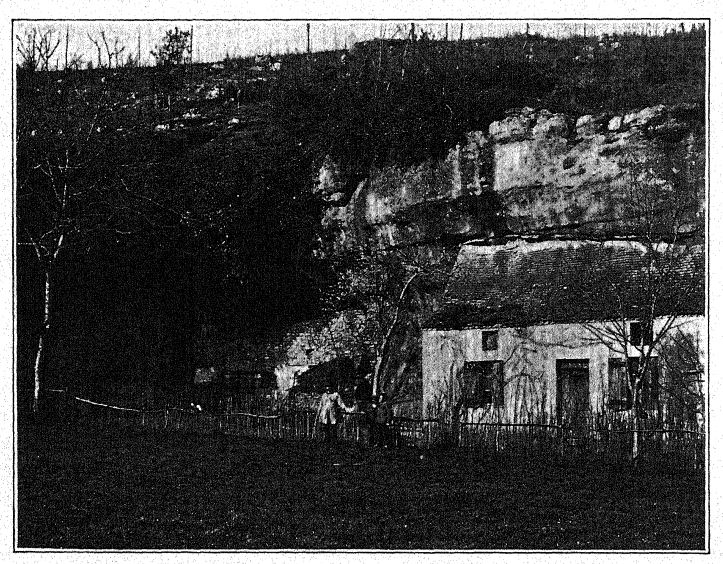
Même une grande caverne comme Combarelles offre relativement peu de surfaces propices à ces lignes gravées ; mais, petites ou grandes, de telles surfaces étaient avidement recherchées, tantôt près du sol, tantôt sur les murs, tantôt sur les plafonds ; même avec la lumière éclatante d’une lampe à acétylène, il est aujourd’hui difficile de découvrir tous ces contours, dont certains sont dessinés aux endroits les plus inattendus. Si les incisions extrêmement fines, telles que celles représentant les poils du mammouth, sont si difficiles à déceler avec un puissant éclairage, on peut imaginer la tâche des artistes de Crô-Magnon avec leurs petites lampes de pierre et leur mèche alimentée par la graisse en fusion. Une telle lampe a été trouvée dans la grotte de La Mouthe, à environ 15 mètres de l’entrée ; la pioche de l’ouvrier la brisa en quatre morceaux, dont trois seulement furent récupérés. Le bol peu profond contenait une matière carbonisée, dont l’analyse a conduit le chimiste Berthelot à conclure à l’utilisation d’une graisse animale pour l’éclairage. Comme la plupart des autres ustensiles, cette lampe est décorée, en l’occurrence d’une gravure [ p. 402 ] représentant la tête et les cornes du bouquetin. Trois de ces lampes ont été retrouvées en Charente et dans le Lot, et il est intéressant de noter que des lampes similaires à celles de l’époque magdalénienne sont encore utilisées en Dordogne.
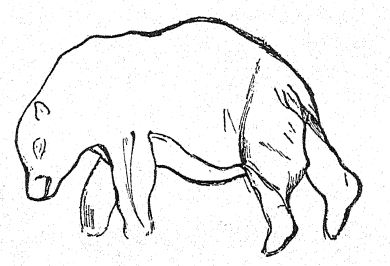
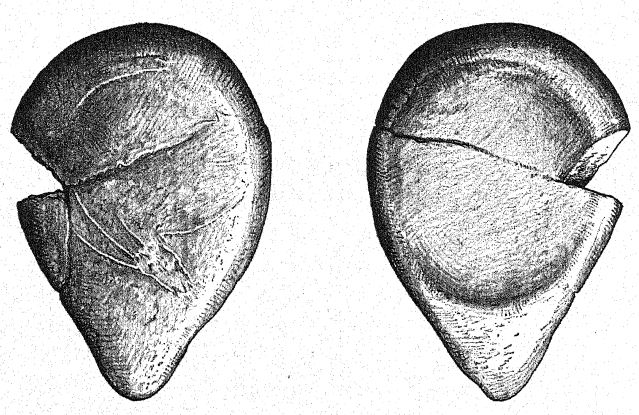
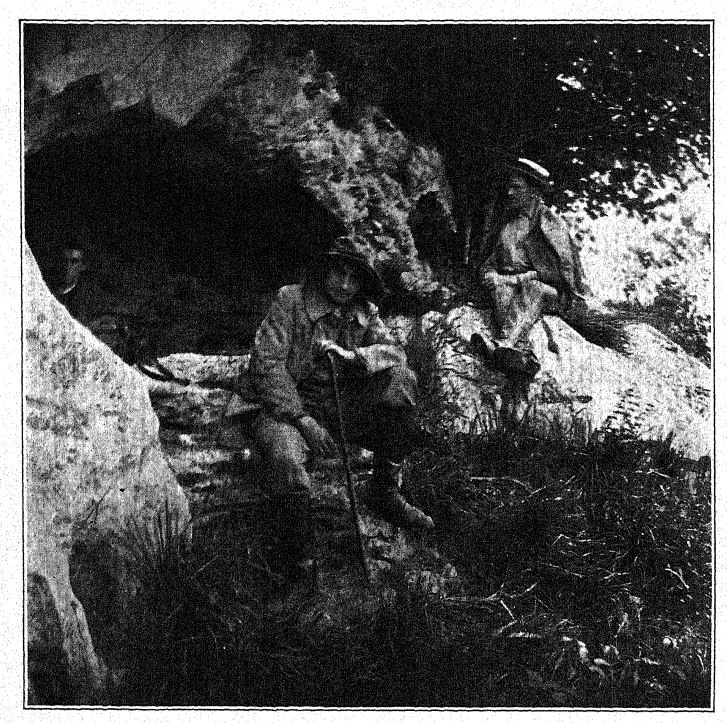
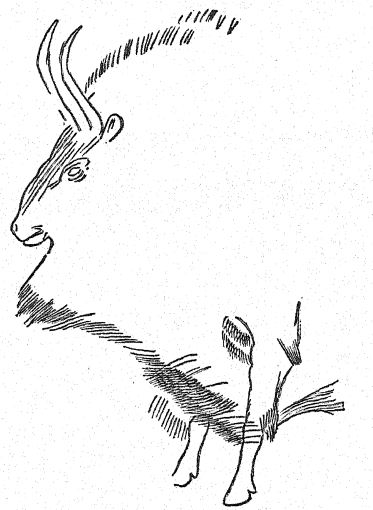
Français Dans la grande caverne du Castillo,[6] à Puente-Viesgo, découverte en 1903 par Alcalde del Rio, et à laquelle on accède par la majestueuse grotte déjà décrite p. 162, les dessins animaliers sont pour la plupart d’un caractère archaïque, appartenant aux tout débuts [ p. 403 ] de l’art pariétal aurignacien ancien. Les sujets les plus abondants sont les chevaux et les cerfs, qui remplacent entièrement les dessins de rennes si abondants dans le centre de la France, les contours du cerf et de la biche étant très nombreux ; en revanche, le bison et le bœuf sont rarement dessinés. Appartenant à la catégorie de la peinture la plus primitive, on trouve les simples contours en noir d’un cheval et d’un mammouth, les deux membres d’un côté étant représentés par des triangles inversés, terminés par une pointe acérée, comme les dessins d’enfants. De style plus récent, on trouve les bisons polychromes plutôt grossiers, les nombreuses mains soulignées de rouge et un grand nombre de signes et symboles tectiformes qui représentent des œuvres inférieures de la période magdalénienne moyenne.
De l’autre côté de la même montagne se trouve la grotte de Pasiega, découverte en 1912 par le docteur Hugo Obermaier. Cette petite grotte, située à environ 150 mètres au-dessus de la rivière, doit son nom à la retraite des bergers. Le sol est percé d’une ouverture très étroite par laquelle on descend rapidement au moyen d’un tube de pierre à peine assez large pour permettre le passage du corps. L’intérieur est très labyrinthique. Après avoir traversé la Galerie des Animaux et la Galerie des Inscriptions, on atteint, après un détour des plus difficiles, la salle terminale, qu’Obermaier a appelée la Salle du Trône ; on y trouve un siège naturel en calcaire, avec des supports latéraux pour les bras, et l’on peut encore voir la décoloration de la roche due aux mains sales des magiciens ou des artistes. Dans cette salle se trouvent quelques dessins et gravures [ p. 404 ] sur les parois, et quelques morceaux de silex ont été découverts. Dans aucune autre caverne, peut-être, il n’y a un plus grand mystère quant à l’influence, religieuse, magique ou artistique, qui a poussé les hommes à rechercher et à pénétrer dans ces passages dangereux, les roches glissantes éclairées au mieux par une lumière très imparfaite, menant aux recoins profonds et dangereux en contrebas, où un faux pas serait fatal. L’impulsion, quelle qu’elle ait pu être, était sans aucun doute très forte, et dans cette caverne, comme dans d’autres, presque toutes les surfaces favorablement préparées par les processus de la nature ont reçu un dessin. Aucun silex industriel n’a été trouvé à l’entrée de cette caverne, mais quelques-uns ont été retracés à l’intérieur. L’art est considéré en partie de l’Aurignacien tardif, peut-être du Solutréen, et certainement en partie du Magdalénien ancien ; en général, il est beaucoup plus récent que celui de Castillo. Elle se compose à la fois de gravures et de contours peints, avec des proportions généralement excellentes et parfois admirables. Les peintures de cerfs sont en ocre jaune, celles de chamois en rouge. Il y a au total 226 peintures et 36 gravures, dans lesquelles sont représentés 50 chevreuils, 51 chevaux, 47 tectiformes, 16 [ p. 405 ] Bos, 15 bisons, 12 cerfs, 9 bouquetins, 1 chamois et 16 autres formes, réparties dans toutes les parties de la grotte. Les contours sont de couleur rouge unie ou en bandes rouges ou noires, ou il y a une série de taches ; les sujets sont principalement le cerf, la biche, le bétail sauvage (qui sont assez communs), le bison (qui sont moins communs), le bouquetin et le chamois. Parmi les nombreuses représentations du cheval, on trouve deux petites gravures d’un type à crinière dressée, les pieds et la crinière étant soigneusement dessinés, les membres bien dessinés et d’excellentes proportions, manifestement dans le style magdalénien ancien. La découverte de deux chevaux au front arrondi et à la crinière tombante est particulièrement intéressante.le seul cas dans lequel la crinière tombante du type moderne de cheval (Equus cahallus) a été observée dans les dessins de la caverne.
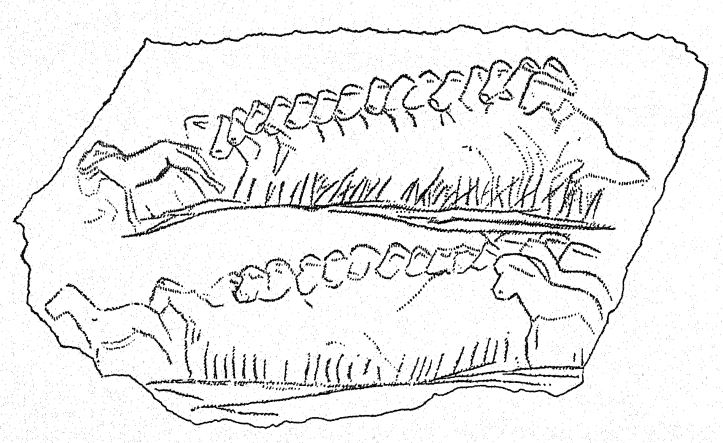
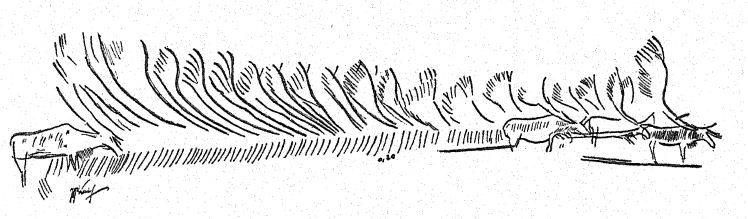
Dans le développement avancé de l’art magdalénien moyen ou supérieur, la gravure pariétale avec des instruments en silex finement pointus se rapproche davantage de la vérité, tant au niveau des proportions que des détails, que dans les stades antérieurs. À ce stade, les gravures semblent principalement constituées de figures animales indépendantes et servir de prélude à l’application de la couleur. Un exemple simple mais frappant d’une technique proche de la perfection est observé dans le bison (fig. 205) gravé dans la caverne de Marsoulas, où le profil est souligné et les grandes masses de poils hirsutes sous le cou sont admirablement indiquées. Dans ces dessins, les détails complexes des pieds, avec leurs touffes de poils caractéristiques, et de la tête témoignent d’une observation beaucoup plus minutieuse. Dans la grande série de bisons de Font-de-Gaume, l’animal tout entier est esquissé par ces lignes finement gravées, comme le mettent en évidence l’observation et les études remarquablement minutieuses de Breuil. Cela ressemble beaucoup à la pratique de l’artiste moderne qui esquisse sa figure au crayon ou au fusain avant d’appliquer la couleur.
Cette gravure présente deux styles très différents : l’un se manifeste par les profondes incisions de la tête de renne de la grotte du Tuc d’Audoubert (fig. 232), un dessin complet en soi ; l’autre se manifeste par les profondes incisions dans le calcaire qui dessinent les chevaux et les bisons observés dans la grotte de Niaux (fig. 174). Ici, le trait gravé est suivi d’une ligne peinte en noir, ce qui a pour effet de faire ressortir le corps dans la roche environnante et de donner à la silhouette un relief prononcé.
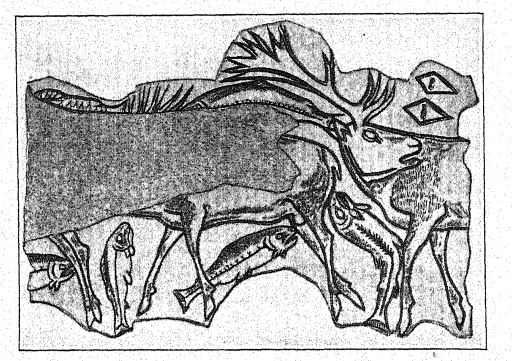
Dans les grands dessins sur ces surfaces murales courbes, dont seule une partie était visible à l’œil nu, les difficultés à maintenir les proportions étaient extrêmes, et l’audace et la confiance avec lesquelles les longs traits de silex étaient exécutés impressionnent toujours, car on ne voit que rarement, voire jamais, de traces de contours corrigés. Seul un observateur de longue date des subtilités qui distinguent les différentes races préhistoriques de chevaux pouvait apprécier l’extraordinaire habileté avec laquelle les lignes aristocratiques et fougueuses du cheval celtique sont exécutées, d’une part, et, d’autre part, les silhouettes plébéiennes et lourdes du cheval des steppes. Dans les meilleurs exemples de gravure magdalénienne, tant pariétale que sur os ou ivoire, on peut presque immédiatement détecter le type spécifique de cheval que l’artiste avait devant lui ou à l’esprit, ainsi que la saison de l’année, comme l’indique la représentation d’un pelage d’été ou d’hiver.
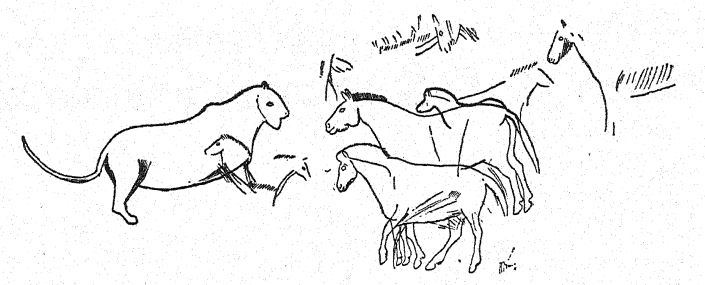
Le réalisme de la plupart des œuvres d’art pariétal se mue en impressionnisme, avec ses gravures sur os ou sur corne de renne, d’une finesse extrême, exécutées en quelques traits, représentant un troupeau de chevaux ou de rennes (fig. 207), ou encore un troupeau de cerfs (fig. 208) traversant un ruisseau poissonneux, comme dans les célèbres gravures sur corne de renne trouvées dans la grotte de Lorthet, dans les Pyrénées. C’est l’un des rares exemples, dans l’art paléolithique, gravure ou peinture, de montrer un sens de la composition ou le traitement d’un sujet ou d’un incident impliquant plusieurs figures. Citons également le troupeau de rennes passant gravé sur un morceau de schiste dans la grotte de Laugerie Basse, le lion faisant face à un groupe de chevaux gravé sur une stalagmite à Font-de-Gaume, et la procession de mammouths gravée sur une procession de bisons dans la même caverne.
[ p. 408 ]
¶ Débuts de la peinture
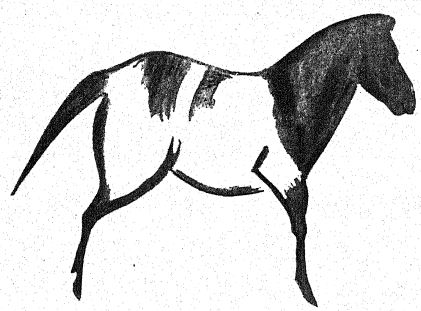
Les débuts de la peinture à l’époque aurignacienne, composée de contours simples et de contours bruts en rouge ou en noir, avec peu ou pas de tentative d’ombrage, passent au début de l’époque magdalénienne24 à une longue phase de monochromes, en noir ou en rouge, dans laquelle la technique poursuit un certain nombre de variations, du simple traitement linéaire, continu ou pointillé, aux demi-teintes ou aux teintes pleines, empiétant progressivement sur les côtés du corps à partir du contour linéaire. De cet ordre se trouvent les figures en aplats et en ombrage, ressemblant à celles des Chinois, sans modelé ; ainsi que les figures entièrement couvertes de points, comme on en voit à Marsoulas, Font-de-Gaume et Altamira. Les teintes, comme dans le dessin du cheval des steppes au galop, passent vers l’intérieur à partir du contour noir [ p. 409 ] pour renforcer l’effet de rondeur ou de relief. Dans la splendide série de peintures de la grotte de Niaux, on ne trouve guère plus que le contour noir du corps, mais le recouvrement des flancs par des lignes, indiquant la chevelure, se prête à la présentation arrondie de la forme. Un effet similaire est recherché dans les lignes du rhinocéros laineux peint en rouge dans la grotte de Font-de-Gaume, que Breuil attribue à l’Aurignacien, mais qui évoque également le Magdalénien ancien.
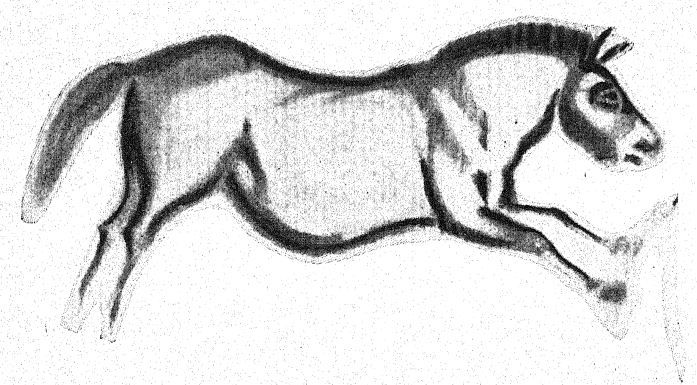
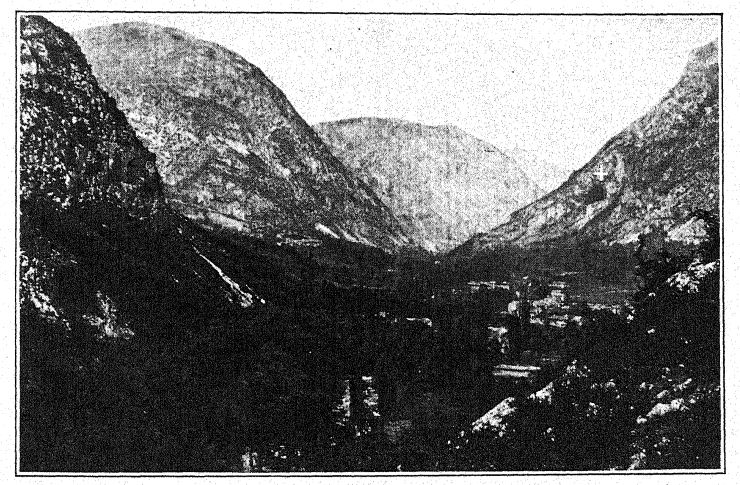
¶ Dessins dans diverses cavernes du Magdalénien ancien et moyen
La plus grande caverne découverte jusqu’à présent en France est celle de Niaux (1906), qui, à partir d’une petite ouverture sur le flanc d’une montagne calcaire et à 90 mètres au-dessus du Vic de Sos, s’étend presque horizontalement sur 1 380 mètres au cœur de la montagne25. Non loin de Tarascon, sur l’Ariège, elle se trouvait près de l’une des routes les plus accessibles entre la France et l’Espagne. En traversant la longue galerie au-delà des bords du lac souterrain qui en barre l’entrée, on atteint, à 800 mètres de distance, une grande salle où les parois en surplomb de calcaire ont été finement polies par les sables et graviers transportés par les cours d’eau sous-glaciaires ; sur ces larges panneaux légèrement concaves, d’une couleur ocre très foncée, se trouvent des dessins d’un grand nombre de bisons et de chevaux, aussi frais et brillants que s’ils étaient l’œuvre d’hier ; Les contours dessinés à l’oxyde de manganèse noir et à la graisse sur la pierre lisse ressemblent à de la lithographie grossière. Les animaux sont dessinés avec des contours splendides et audacieux, sans hachures, mais avec des masses solides de couleurs vives çà et là ; le bison, animal le plus admiré de la chasse, est dessiné majestueusement avec une superbe crête, le museau parfaitement dessiné, les cornes indiquées par de simples fines, et les yeux avec l’expression de défi si caractéristique de l’animal blessé ou enragé. Ici, pour la première fois, sont révélées les premières méthodes magdaléniennes de chasse au bison, car sur leurs flancs sont clairement tracées une ou plusieurs pointes de flèche ou de lance, dont les hampes sont encore attachées ; la preuve la plus certaine de l’utilisation de la flèche est l’extrémité apparente de la hampe en bois dans les plumes, représentées grossièrement dans trois des dessins. On y trouve également de nombreuses silhouettes de chevaux qui ressemblent fortement au pur type des steppes asiatiques vivant aujourd’hui dans le désert de Gobi, le cheval de Przewalski, avec sa crinière dressée et son toupet non tombant ; Contrairement au bison, les yeux sont plutôt ternes et stupides dans leur expression. On trouve également des dessins [ p. 411 ] d’autres types de chevaux, un très beau bouquetin, un chamois, quelques silhouettes de bovins sauvages et une très belle silhouette du cerf royal ; nous ne trouvons ni renne ni mammouth représentés. Dans certains des passages les plus étroits, la roche a été magnifiquement sculptée par l’eau, et les artistes ont été prompts à tirer parti des lignes naturelles pour ajouter un peu de couleur ici ou là et ainsi faire ressortir la silhouette d’un bison.
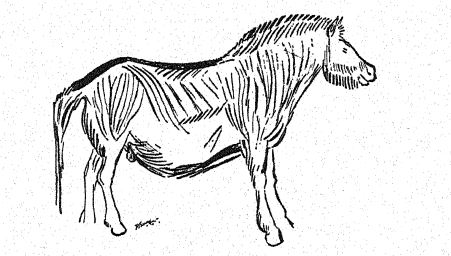
La grotte du Portel, à l’ouest de Tarascon, offre le contraste le plus frappant avec Niaux. Son entrée est resserrée et son passage en descente rapide, à peine assez large pour laisser passer le corps. Cette grotte étroite et tortueuse se termine par un passage extrêmement étroit, si étroit qu’il laisse à peine passer l’artiste-explorateur, l’abbé Breuil, à la fois athlétique et déterminé. Ici, comme à Font-de-Gaume et dans d’autres grottes, se trouve l’un des plus grands mystères de l’art rupestre : ces diverticules terminaux et dangereux ont été façonnés selon des motifs parmi les plus soignés et les plus artistiques. Le Portel, comme Niaux, révèle un style unique, mais totalement différent. De très nombreux bisons sont dessinés en contours, en rouge et en noir ; les flancs du corps sont souvent pointillés de rouge ou hachurés en lignes parallèles serrées. Sur un long panneau horizontal, on peut voir de nombreux bisons en rouge, et l’on remarque ici une paire de pieds de bison finement dessinés dans le meilleur style magdalénien. Le cheval représenté ici est d’un type tout à fait différent, avec une queue supérieure fine et une touffe caudale ressemblant à celle de l’âne sauvage, de sorte qu’on est presque tenté de croire que le kiang est voulu, mais les oreilles sont trop courtes ; il a une croupe haute et un cou haut et magnifiquement arqué, comme celui de l’étalon, et l’œil est mieux dessiné ; le corps est couvert de longues lignes verticales ou obliques qui pourraient être confondues avec des rayures, mais ces hachures ne sont qu’une question de technique. De plus, la crinière est dressée et il n’y a pas de toupet ; en fait, aucun de ces artistes magdaléniens n’a représenté le cheval avec le toupet, ce qui indique que ce personnage [ p. 413 ] du cheval moderne était inconnu en Europe occidentale et est probablement apparu à l’époque néolithique.
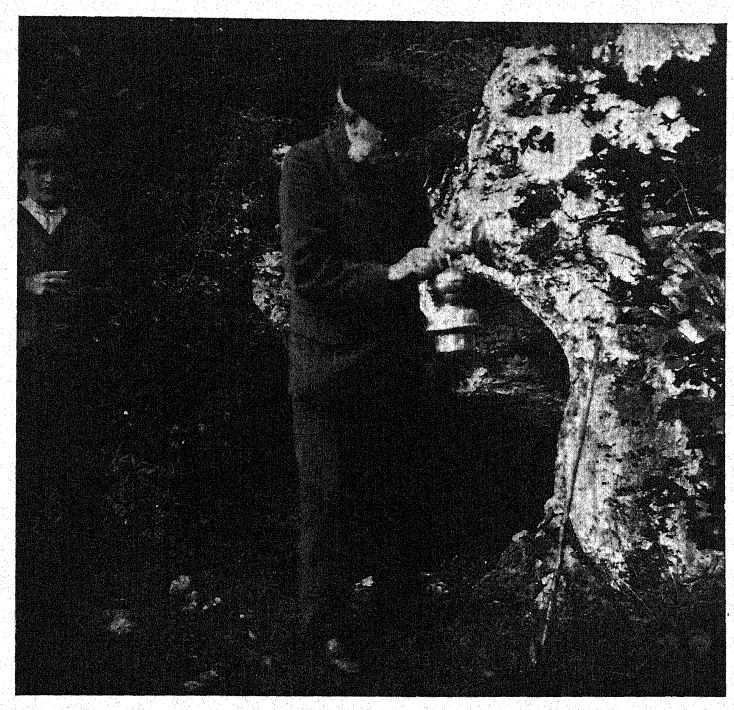
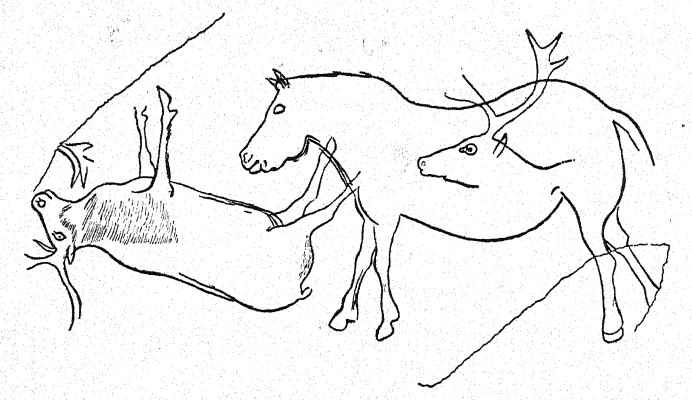
D’un type entièrement différent sont les figures miniatures magnifiquement gravées d’animaux découvertes en 1903 dans la grotte de la Mairie.26 Les contours, de 18 à 20 pouces de longueur, sont nettement gravés sur les stalagmites calcaires ; ils sont tous dans le style magdalénien moyen et comprennent le cerf, le renne, le bison, l’ours des cavernes, le lion, le bétail sauvage et deux types très distincts de chevaux : l’un de ces types est à grosse tête avec un front arqué ; c’est probablement le type forestier et représente peut-être [ p. 414 ] le cheval le plus abondant au campement de Solutré (voir p. 288) ; l’autre cheval est à petite tête, avec un front parfaitement plat et droit, correspondant au type de poney arabe ou celtique.
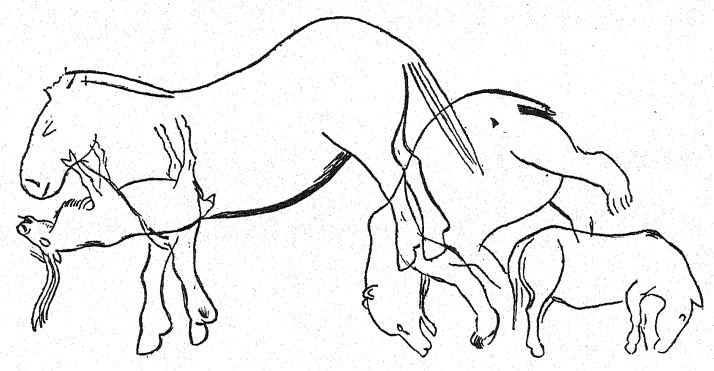
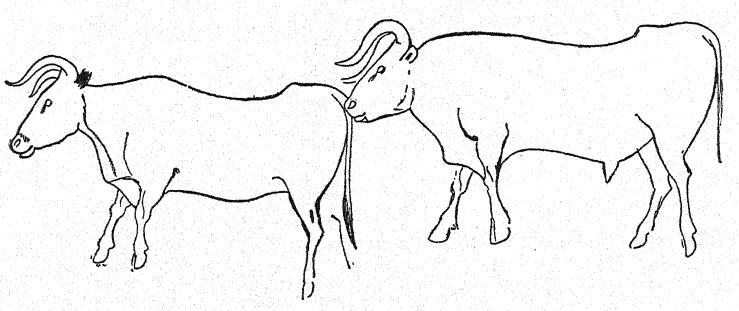
¶ Dessins et peintures de la fin du Magdalénien moyen
La quatrième et dernière phase de développement de la peinture s’épanouit vers la fin du Magdalénien moyen, durant la grande période des polychromies. Celles-ci sont d’abord gravées à l’eau-forte avec des lignes sous-jacentes gravées au silex, la surface du calcaire ayant été préalablement préparée par raclage des bords afin d’accentuer le relief du dessin ; un contour très marqué est ensuite tracé en noir, éventuellement suivi d’un autre contour en rouge (l’usage du noir et du rouge est très ancien) ; une couleur brun ocre est mélangée, s’harmonisant bien avec ce que nous connaissons comme les teintes des parties poilues du bison. Ainsi se développe progressivement une fresque polychrome complète. Vient ensuite l’étape finale de cet art, où le remplissage de diverses tonalités de couleur nécessite l’utilisation de noir, de brun, de rouge et de nuances jaunâtres. La gravure sous-jacente, ou préliminaire, commence alors à s’estomper, n’étant conservée que pour le traçage des derniers détails : les poils, les yeux, les cornes et les sabots. [ p. 415 ] Les premiers stades de cet art se voient dans la caverne de Marsoulas, et son apogée est atteinte dans les fresques murales de Font-de-Gaume et dans le plafond d’Altamira, ce dernier étant encore dans un état de conservation parfait et brillant.
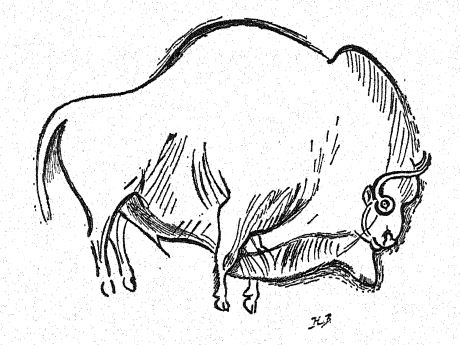
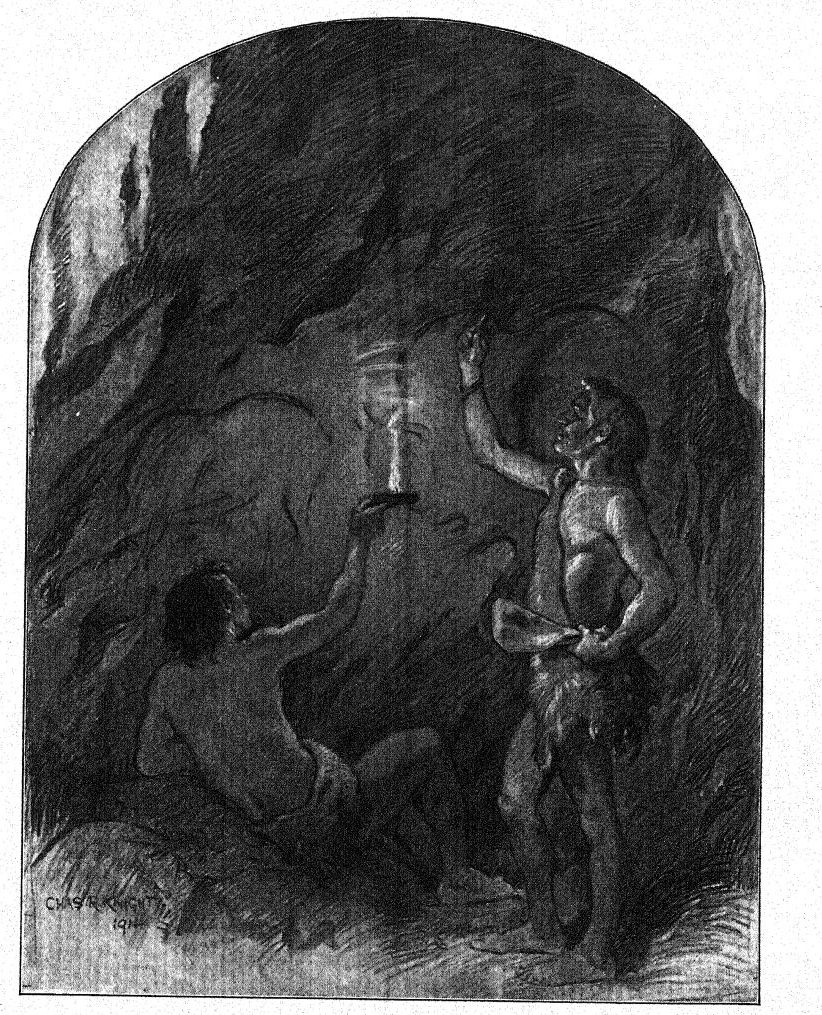
Pour préparer les couleurs, l’ocre et l’oxyde de manganèse étaient réduits en fine poudre dans des mortiers de pierre ; le pigment brut était transporté dans des étuis ornés fabriqués à partir d’os de membres inférieurs de renne, et de tels tubes contenant encore l’ocre ont été retrouvés dans les foyers magdaléniens ; le mélange de la poudre finement broyée avec les huiles ou graisses animales utilisées se faisait probablement sur le côté plat de l’omoplate du renne ou sur une autre palette. Le pigment était parfaitement permanent et, dans l’obscurité de la grotte d’Altamira, il a été si parfaitement préservé que les couleurs sont toujours aussi éclatantes que si elles avaient été appliquées la veille.
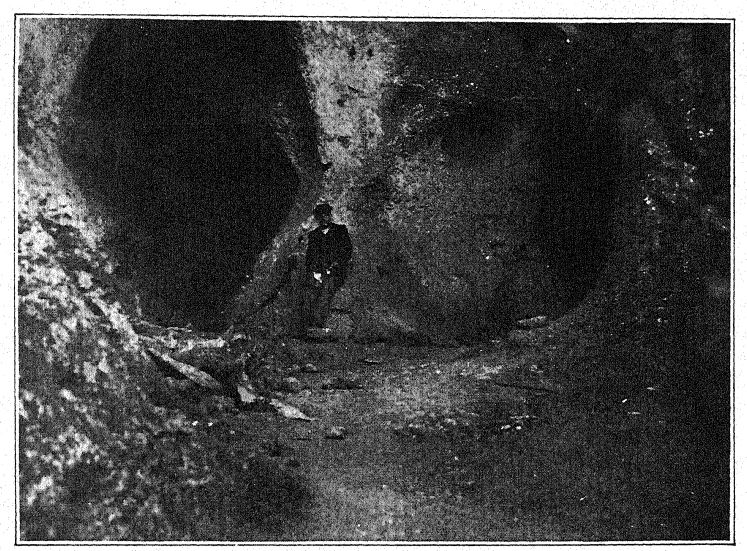
L’art de la grotte d’Idhrsoulas, dans les Pyrénées, est à la fois ancien et plus récent ; les lignes gravées, comme celles de la tête et du front d’un bison, sont magnifiquement exécutées dans un style magdalénien avancé, des incisions profondes représentant les contours les plus larges et des incisions plus fines représentant les cheveux ; ici, les contours sont également tracés en couleur, et il y a plusieurs masques ou grotesques du visage humain ; ces derniers sont traités avec un mépris total de la vérité qui caractérise l’œuvre animalière. Parmi les quelques bisons représentés ici, certains sont couverts de points ou d’éclaboussures de couleur, d’autres montrent le contour peint qui commence à s’étendre sur la surface avec des dégradés de teintes, anticipant les effets de couleur obtenus dans les peintures achevées d’Altamira et de Font-de-Gaume. On retrouve ici tous les détails de la technique primitive : l’artiste dessine la forme d’un trait gravé ; il trace en noir les contours de la tête et du corps ; il commence à appliquer des masses de rouge sur la figure. Ce début de l’art polychrome à Marsoulas marque une étape vers la coloration de toute la surface à l’ocre rouge et au noir, comme dans les peintures achevées d’une période ultérieure.
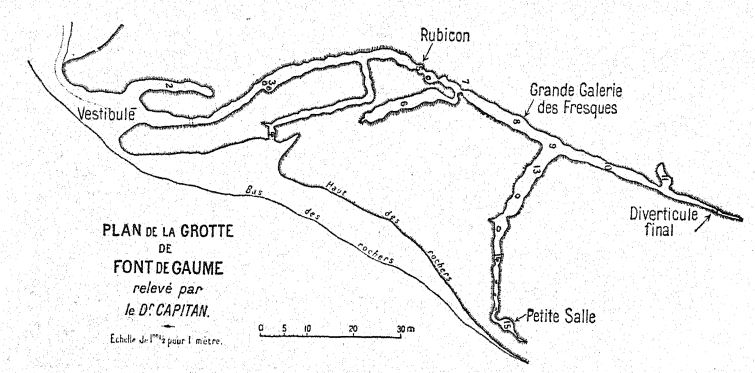
La grande caverne de Font-de-Gaume27, sur la Beune, non loin des Eyzies, contient le témoignage le plus complet de l’art du Paléolithique supérieur, notamment de la fin de l’Aurignacien à la fin du Magdalénien. On y trouve des dessins aurignaciens bruts, de simples contours peints en noir, des contours complétés par l’indication de poils (exemples des premiers stades de développement de la polychromie ainsi que des stades les plus avancés), des compositions comme le lion et le groupe de chevaux, et les peintures murales de la Galerie des Fresques, qui montrent une composition générale dans les processions d’animaux, ainsi que quelques compositions particulières comme les rennes et les bisons se faisant face. La vie représentée est principalement celle de la toundra, des mammouths, des rhinocéros et des rennes, mais elle comprend également le cheval de type steppique ou celtique, représenté au galop (fig. 211), et un petit groupe de chevaux de type arabe ou celtique. Parmi la faune des prairies, le bison est généralement représenté de préférence au bœuf sauvage ou urus.
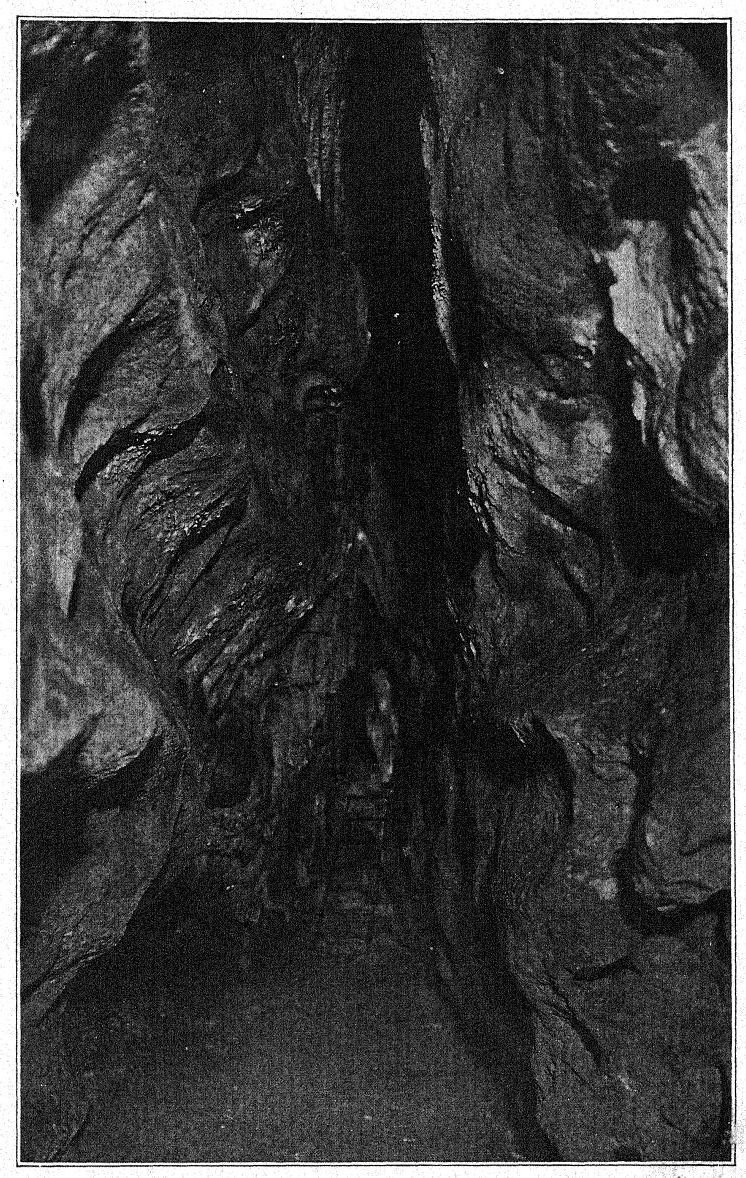
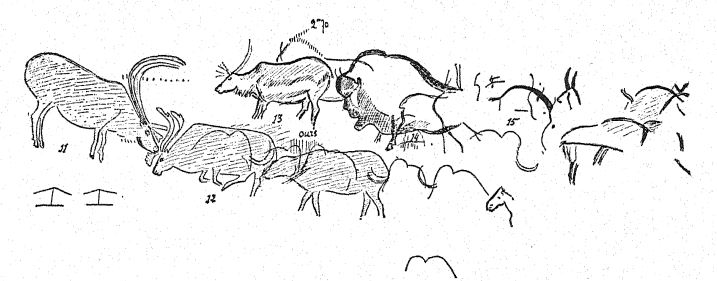
Dans toute la caverne, les surfaces favorables des murs sont ornées de gravures, et dans la Galerie des Fresques, au-delà de l’étroit passage connu sous le nom de « Rubicon » (fig. 221), nous voyons les plus beaux exemples d’art paléo-hétique supérieur. De chaque côté de cette galerie se trouve une surface murale particulièrement avantageuse, large, relativement lisse et légèrement concave (pl. VII), probablement la meilleure que puisse offrir une caverne. On y observe de grandes processions de mammifères superposées, telles les archives d’un palimpseste, comme si une telle surface était si rare qu’elle était visitée à maintes reprises. La série la plus imposante est celle des bisons, réalisée dans un style polychrome des plus raffinés, la plupart [ p. 420 ] se dirigeant dans une seule direction. Les rennes forment une autre série et, dans certains cas, se font face, bien que principalement disposés en une longue procession tournée vers la gauche. Cette superposition de dessins s’achève par la dernière superposition, en lignes finement incisées, d’une grande procession de mammouths sur celle des bisons polychromes. Il est difficile de concilier une interprétation religieuse ou votive avec la multiplication de ces dessins. De plus, cela semble incompatible avec l’esprit de révérence qui imprègne l’œuvre de cette caverne comme de toutes les autres, car ce qui frappe le plus est l’absence d’œuvres triviales ou de dessins dénués de sens.
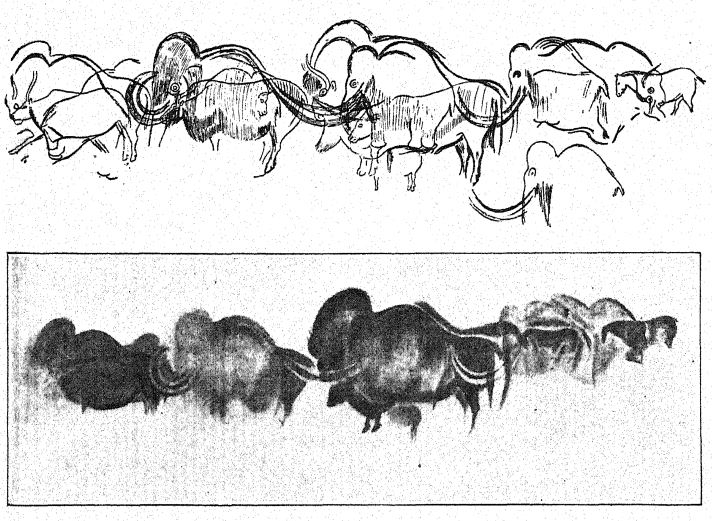
Il semble qu’à chaque étape de leur développement artistique, ces personnes étaient extrêmement sérieuses dans leur travail, chaque dessin étant exécuté avec le plus grand soin possible, en fonction du degré de développement artistique et d’appréciation.
Dans la grande galerie de fresques, on ne trouve pas moins de quatre-vingts [ p. 421 ] figures, parfois partiellement recouvertes d’un fin lustrage de calcaire stalagmitique ; on y trouve 49 bisons, 4 rennes, 4 chevaux et 15 mammouths. Les polychromies des bisons ont quelque peu souffert de leur couleur et sont beaucoup moins brillantes que celles d’Altamira. Dans les polychromies, la couleur est appliquée soit en longues lignes rouges ou noires entourant les contours de l’animal, soit en aplats juxtaposés, soit encore les deux couleurs se mélangent et donnent des teintes intermédiaires d’un effet saisissant. Sur l’un des plus beaux bisons, on trouve le dessin sous-jacent d’un renne, d’un sanglier et la superposition d’une excellente gravure d’un mammouth, représentée à une échelle totalement différente, de sorte qu’elle s’intègre parfaitement aux lignes du corps du bison (fig. 224). Chez chacun de ces mammouths, le contour grotesque mais fidèle est préservé dans la draperie de poils qui enveloppe presque entièrement les membres ; l’accentuation de la dépression soudaine de la ligne dorsale derrière la tête est partout la même et sans aucun doute très fidèle à la nature.
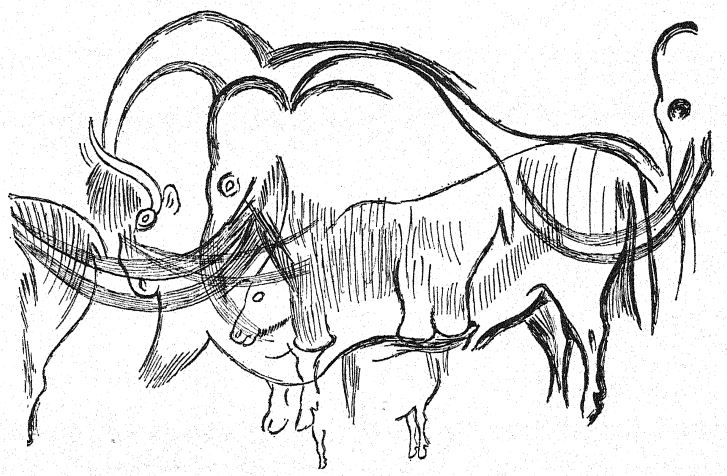
[ p. 422 ]
Après avoir dépassé la Galerie des Fresques, nous pénétrons dans le dernier renfoncement appelé le Diverticule final, par des ouvertures tubulaires excessivement étroites laissant à peine passer le corps, et nous sommes à nouveau saisis par le mystère de l’impulsion qui a porté cet art dans les parties sombres et profondes des cavernes. Si cela était dû à un sentiment en partie religieux qui regardait les cavernes avec une crainte particulière, pourquoi trouvons-nous un travail aussi habile et consciencieux sur tous les ustensiles mobiles de la vie quotidienne et de la chasse, en dehors des cavernes ? La superposition d’un dessin sur l’autre, particulièrement caractéristique de cette caverne, ne semble pas renforcer l’interprétation religieuse.
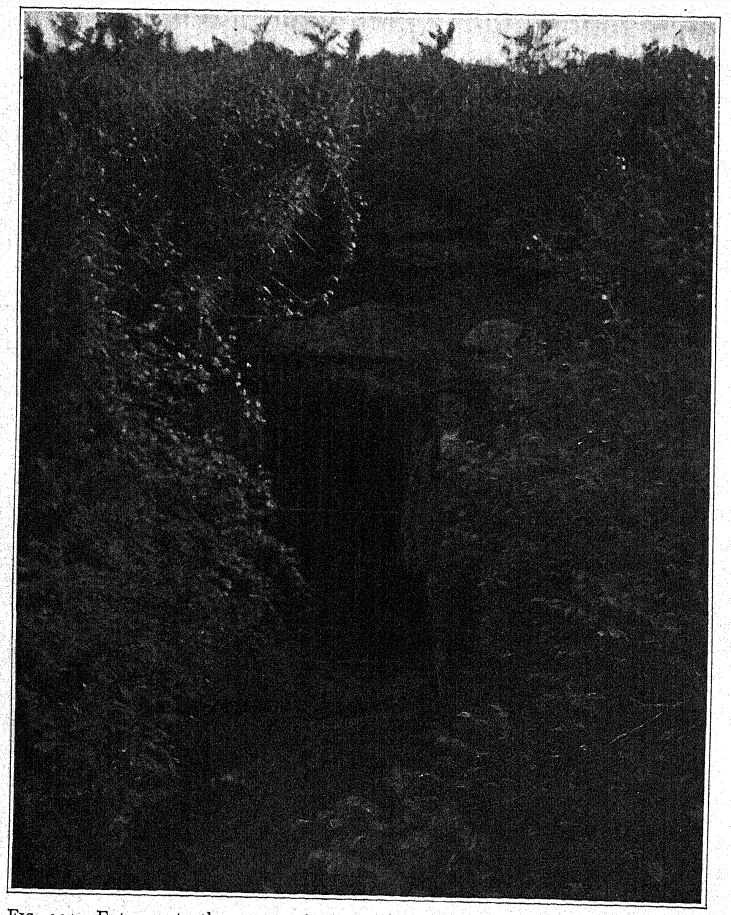
Il semblerait que l’amour de l’art pour l’art, apparenté sous une forme très rudimentaire à celui qui inspirait les premiers Grecs, ainsi que les beaux espaces que ces cavernes offraient à elles seules pour des représentations de plus grande envergure, puissent constituer une autre explication. Rien ne prouve que ces cavernes aient été fréquentées en grand nombre. Si tel avait été le cas, les exemples d’œuvres non artistiques sur les parois seraient bien plus nombreux. Il est possible que les artistes de Crô-Magnon aient constitué une classe reconnue, particulièrement douée par la nature, distincte de la classe des magiciens ou de celle des artisans. Les recoins sombres des cavernes donnant sur les grottes étaient peut-être considérés comme des demeures mystérieuses. Cette théorie s’accorde avec l’hypothèse selon laquelle les artistes auraient été invités à y pénétrer par les prêtres ou les guérisseurs pour décorer les parois de tous les animaux de la chasse.
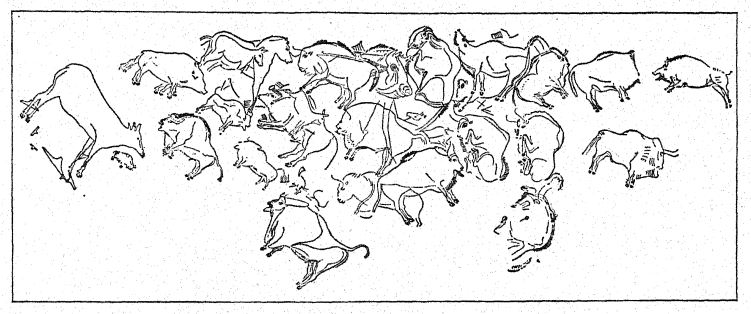
Français Les polychromies du plafond d’Altamira, dans le nord de l’Espagne, qui comptent parmi les œuvres d’art brutes du Paléolithique, tout comme le plafond de la chapelle Sixtine dans l’art moderne, sont d’une technique un peu plus conventionnelle que celles de Font-de-Gaume, mais elles sont manifestement l’œuvre de la même école et prouvent que la technique artistique s’est répandue, comme celle de la gravure, de la sculpture et de la préparation des instruments en silex et en os, dans tout le sud-ouest de l’Europe. On ne saurait trouver de preuve plus frappante de l’unité de race, de la communauté de vie et des échanges d’idées entre ces peuples nomades que l’étroite ressemblance observée entre l’art d’Altamira, en Espagne, et celui de Font-de-Gaume, à 465 kilomètres de distance, en Dordogne.
Le récit de la découverte de ce magnifique plafond est très pittoresque. Il a été fait non par l’archéologue espagnol Sautuola lui-même, mais par sa petite fille qui, alors qu’il cherchait des silex sur le sol de la caverne, fut la première à apercevoir les peintures du plafond et à insister pour qu’il lève sa lampe. C’était en 1879, bien avant la découverte de l’art pariétal en France. Le plafond est large et bas, à portée de main, et les bossages ovales en calcaire (Fig. 227), de 1,20 à 1,50 mètre de long et de 90 à 100 centimètres de large, ont conduit au développement de l’une des caractéristiques les plus frappantes de tout l’art paléolithique, à savoir l’adaptation du sujet par l’artiste à son médium et au caractère de la surface sur laquelle il travaillait. Il semble témoigner d’un génie créatif exceptionnel que chacune de ces protubérances ait été choisie pour représenter un bison couché, les membres repliés sous le corps dans différentes positions (fig. 228) et soigneusement dessinés. La queue ou les cornes seules dépassent de la surface convexe pour atteindre la surface plane environnante. C’est le seul exemple connu où le bison est représenté couché, dans des attitudes très réalistes, montrant la plante des sabots, observée avec le plus grand soin et représentée par quelques lignes fortes et significatives. Ainsi, si la coloration d’Altamira tend vers le conventionnel, la pose de ces animaux témoigne de la plus grande liberté de style et de la plus grande maîtrise de la perspective jamais observée. Dans ce magnifique groupe, on voit également un bison mugissant, le dos arqué et les membres repliés sous lui comme pour expulser l’air. Un élément frappant de toutes ces peintures est la représentation vivante [ p. 426 ] de l’œil, auquel on attribue dans chaque cas un caractère féroce et provocateur, si caractéristique du bison mâle enragé. Nous observons également un sanglier courant et plusieurs représentations fougueuses du cheval et de la biche. La caverne d’Altamira, outre ce chef-d’œuvre, contient des œuvres d’un caractère très avancé, comme l’indique l’imposante gravure du cerf royal (fig. 229), qui est de loin la plus belle représentation de cet animal découverte jusqu’à présent dans une caverne.
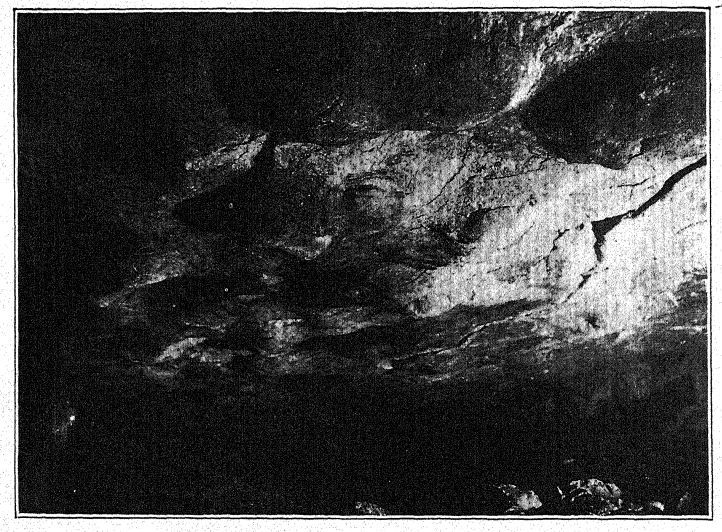
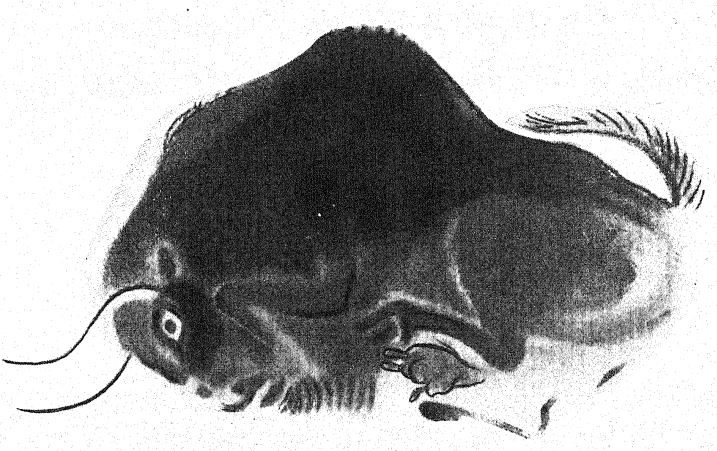
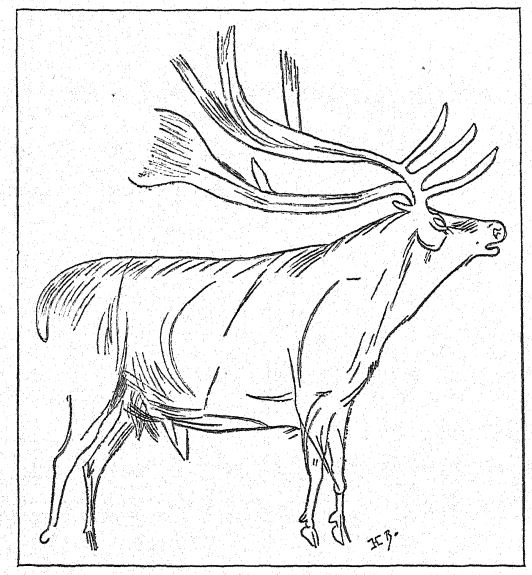
Altamira, comme Font-de-Gaume, présente de nombreuses phases du développement artistique du Magdalénien. On trouve une couche solutréenne dans le vestibule de cette grande caverne, mais Breuil n’est pas enclin à attribuer quoi que ce soit à cette période. La première entrée d’Altamira par les artistes de Crô-Magnon est datée par la découverte de gravures sur os de biche, identiques [ p. 427 ] à celles des parois et qui appartiennent à un Magdalénien très ancien, époque à laquelle on pénétrait également dans les cavernes de Castillo et de La Pasiega28
¶ Sculpture
La sculpture animalière en ronde-bosse, attestée par les quelques statuettes retrouvées près de la sépulture de Brünn, en Moravie, et par la statuette de mammouth en ivoire découverte à Predmost, s’est poursuivie jusqu’au Magdalénien ancien et constitue certainement l’un des traits les plus distinctifs de l’art de cette période, car au Magdalénien tardif, elle a pris une orientation différente vers la sculpture décorative. Seuls deux beaux exemples de sculpture animalière du Magdalénien ancien ont été découverts, mais leur caractère est si remarquable qu’il indique que le modelage en ronde-bosse était largement pratiqué à cette époque. Il s’agit des bisons découverts en 1912 dans la grotte du Tuc d’Audoubert près de Montesquieu, dans les Pyrénées, et des beaux bas-reliefs de chevaux à l’abri du Cap-Blanc, sur la Beune, en Dordogne.
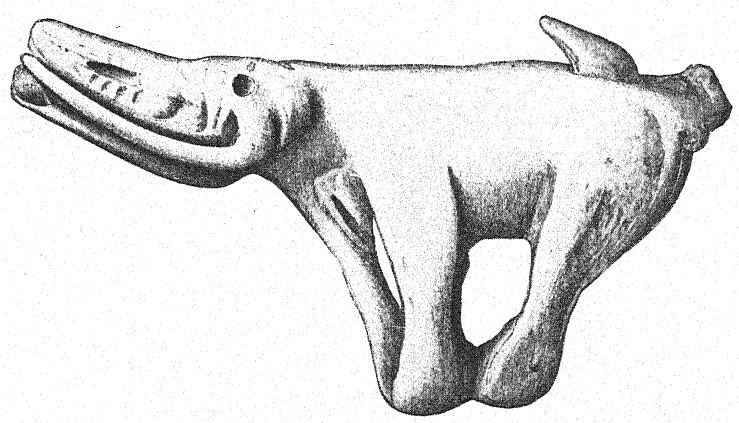
En compagnie du professeur Cartailhac, l’auteur a eu la chance de pénétrer dans la caverne du Tuc d’Audoubert quelques jours après sa découverte par le comte de Begouen et ses fils ; elle est encore en cours de construction, car de l’entrée coule un cours d’eau assez grand pour faire flotter une petite barque, par lequel on atteint la première d’une série de galeries superbement cristallisées. Après avoir traversé un labyrinthe de passages et de chambres, une surface favorable a été trouvée où le groupe de Begouen nous a montré un mur entier couvert de bas-reliefs gravés, très simplement exécutés, d’une belle exécution, avec des contours sûrs et fermes du bison, le sujet favori comme dans toutes les autres cavernes ; des chevaux assez bien exécutés et du même type steppique que ceux de la caverne voisine de Niaux ; un contour superbement gravé du renne, avec ses longues cornes recourbées ; la tête d’un cerf dont les cornes sont encore dans le velours ; et un mammouth. Tout ce travail est gravé ; il n’y a pas de contours dessinés, mais çà et là des taches de couleur rouge et noire. Peu de temps après, une grande découverte fut faite dans cette caverne ; elle est décrite comme suit par le comte de Begouen[7]: « Je suis heureux de vous donner aujourd’hui d’excellentes nouvelles de la caverne Tuc d’Audoubert. Comme vous avez été le premier à visiter [ p. 430 ] cette caverne, vous serez aussi le premier à apprendre que dans une galerie supérieure, très difficile d’accès, au bout d’un passage ascendant très étroit, et après avoir été obligés de briser un certain nombre de stalactites qui fermaient complètement l’entrée, mon fils et moi avons trouvé deux superbes statuettes en argile, d’environ 60 cm de long, absolument intactes, et représentant des bisons. Cartailhac et Breuil, qui sont venus les voir, ont été remplis d’enthousiasme. Le sol de ces chambres était couvert d’empreintes de griffes de l’ours, dont des squelettes étaient enterrés çà et là. Les Magdaléniens ont traversé cet ossuaire et en ont retiré tous les canines pour en faire des ornements. Leurs pas ont laissé de fines empreintes sur l’argile humide et molle, et nous voyons encore les contours de plusieurs pieds hruniens nus. Ils avaient également perdu plusieurs éclats de silex et une dent de bœuf percée au cou ; nous les avons recueillis. [ p. 431 ] et il semble qu’ils ne soient tombés que d’hier ; les Magdaléniens ont également laissé un modèle incomplet de bison et quelques morceaux d’argile pétrie qui portent encore l’empreinte de leurs doigts. Nous prouvons qu’à cette époque, toutes les branches de l’art étaient cultivées. » Ce modèle de bison mâle et femelle en argile a été décrit par Cartailhac comme d’une exécution parfaite et d’un art idéal.
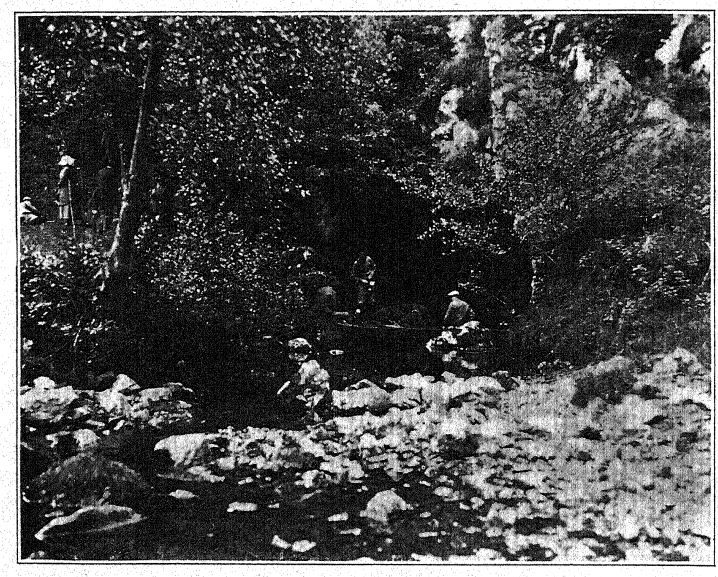
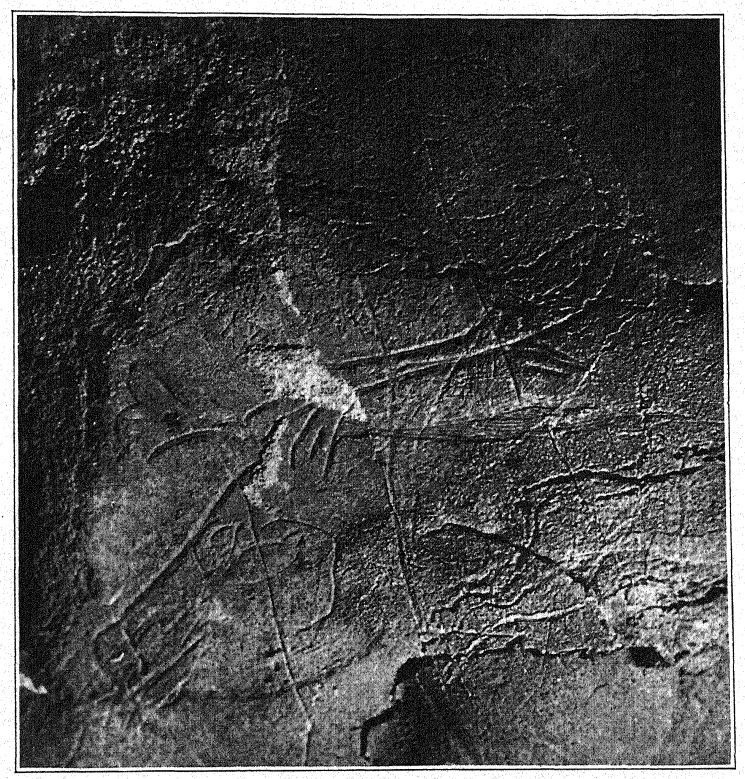
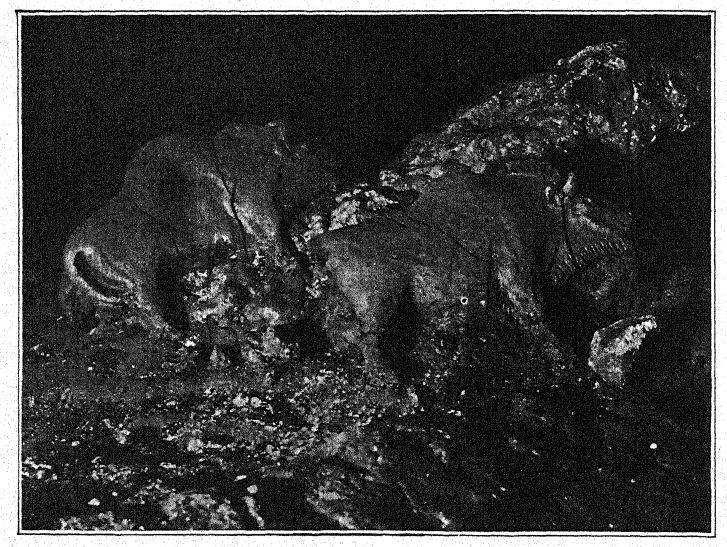
La procession de six chevaux taillés dans le calcaire sous la falaise abritée du Cap-Blanc est de loin l’œuvre d’art magdalénien la plus imposante jamais découverte. Les sculptures, en haut-relief et de grande taille, présentent d’excellentes proportions ; elles semblent représenter le type de cheval celtique ou du désert, apparenté à l’arabe, d’après le visage long et droit, le nez fin, les petites narines et l’angle prononcé de la mâchoire inférieure. Les oreilles sont plutôt longues et pointues, et la queue est représentée fine et dépourvue de poils. Elles ont été trouvées partiellement enfouies sous des couches contenant des outils de l’industrie magdalénienne moyenne, et sont donc attribuées à une époque magdalénienne ancienne, époque à laquelle la sculpture animalière en ronde-bosse a atteint son apogée.
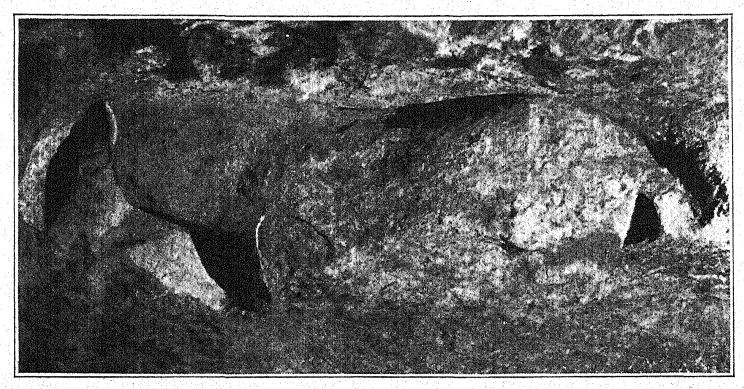
[ p. 432 ]
Du début au milieu du Magdalénien, la sculpture animalière en os, corne et ivoire fut pratiquée comme art décoratif d’une manière audacieuse et hautement naturaliste. L’adaptation de la figure animale à la surface et au matériau utilisé n’est nulle part plus remarquable que dans les bâtons, les lanceurs de fléchettes et les poignards. De toutes les œuvres du Paléolithique supérieur, ces têtes et corps décoratifs sont peut-être les créations les plus artistiques au sens moderne du terme. Le célèbre cheval trouvé dans les niveaux magdaléniens tardifs du Mas d’Azil (Fig. 235) et les petits chevaux de la grotte d’Espelugues, du Magdalénien moyen, sont pleins de mouvement et de vie et font preuve d’une telle certitude et d’une telle ampleur de traitement qu’ils doivent être considérés comme les chefs-d’œuvre de l’art grec du Paléolithique supérieur. Le bouquetin sculpté sur le lanceur de fléchettes de la grotte du Mas d’Azú (fig. 178) indique une observation et une puissance d’expression saisissantes ; si tous les détails sont notés, le traitement est très large.
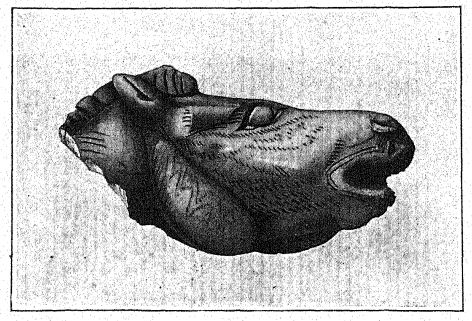
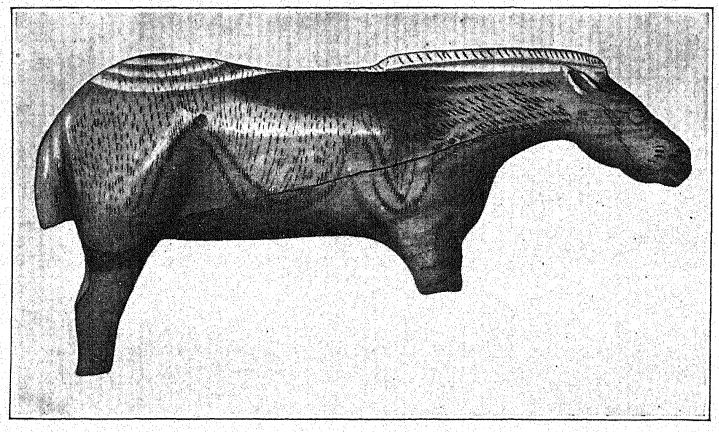
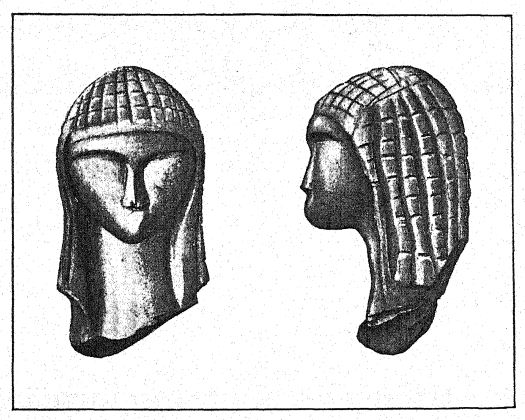
La poursuite de la sculpture animalière en ronde-bosse se retrouve dans la célèbre statuette de cheval de la grotte de Lourdes ; les rayures, partiellement décoratives, marquent un pas vers un traitement conventionnel. Le renne sculpté découvert par Begouen dans la grotte d’Enlène présente un style assez similaire.
De petites figurines humaines réapparaissent sous forme de statuettes en os ou en ivoire, symbolisant la renaissance de l’esprit de la sculpture humaine. Certaines de ces œuvres semblent rechercher la beauté et emprunter des motifs totalement différents des statuettes féminines repoussantes de l’Aurignacien moyen et récent, car [ p. 434 ] les sujets sont élancés et les membres sont modelés avec une relative habileté. Comme dans les œuvres antérieures, les traits sont partiellement absents, ce qui contraste fortement avec le traitement réaliste des têtes animales. Très peu d’exemplaires de ces œuvres ont été retrouvés, et la plupart ont été brisés. À cette période appartiennent la statuette de Vénus de Laugerie Basse et la tête de jeune fille sculptée en ivoire trouvée à Brassempouy (fig. 237), dont les traits sont assez bien suggérés et la coiffure élaborée.
¶ Répartition géographique de la culture magdalénienne
À l’époque magdalénienne, la race Crô-Magnon a sans doute atteint son plus haut développement et sa plus large distribution géographique, mais il serait erroné de déduire que les frontières de la culture magdalénienne marquent aussi les points extrêmes de migration de ce peuple nomade, car les industries et les inventions ont bien pu s’étendre bien au-delà des zones effectivement habitées par la race elle-même.
L’absence d’influence magdalénienne sur les côtes septentrionales de la Méditerranée est certainement l’un des faits les plus surprenants. Breuil a suggéré que l’Italie est restée à un stade de développement aurignacien tout au long de l’époque magdalénienne et indique qu’il existe de nombreuses preuves que la culture magdalénienne n’a jamais pénétré cette péninsule, car en Italie, l’étape industrielle aurignacienne est suivie de traces de l’Azilien. Cette lacune géographique, cependant, pourrait être comblée à tout moment par une nouvelle découverte. En Espagne également, la culture magdalénienne n’est connue que dans les monts Cantabriques, mais jamais plus au sud. L’un des plus anciens sites découverts dans cette région est la grotte de Peña la Miel, visitée par Lartet en 1865, et l’un des plus célèbres, la caverne d’Altamira, découverte par Sautuola en 1875 ; au nord-est se trouve la station de Banyolas. Jusqu’à présent, les provinces orientales de l’Espagne n’ont livré aucun outil en os gravé ou sculpté.
Contrairement à cette incapacité à s’étendre vers le sud, la culture magdalénienne est largement répandue à travers la France, la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche et jusqu’en Russie. Il semblerait que les hommes de l’époque magdalénienne aient erré au loin ou qu’il y ait eu un système de troc étendu, car la découverte de coquillages rapportés des rivages méditerranéens pour la parure personnelle vers divers sites magdaléniens en France et en Europe centrale semble indiquer une communication étendue entre ces chasseurs nomades et un système commercial s’étendant des côtes de la Méditerranée et de l’Atlantique à la vallée du Neckar en Allemagne et le long du Danube en Basse-Autriche. Une autre preuve de cette communication est la large diffusion non seulement de formes similaires d’outils mais aussi de décorations très similaires ; Français à titre d’exemple, Breuil note la ressemblance des gravures schématiques sur corne de renne dans [ p. 436 ] les deux couches magdaléniennes primitives de Placard, en Charente, avec celles trouvées dans la caverne polonaise de Maszycka, près d’Ojcow, et avec d’autres dans les couches correspondantes de Castillo, près de Santander, de Solutré sur la Sadne, et de divers sites en Dordogne. Une décoration géométrique très particulière sur os est celle de lignes brisées en zigzag avec de petites lignes transversales intercalées, que nous remarquons à Altamira, dans le nord de l’Espagne, et qui se rencontre également çà et là en Dordogne et en Charente et s’étend aux grottes d’Arlay dans le Jura. Un autre style d’ornement, avec des lignes pectinées et ponctuées profondes, trouvé dans le très ancien Magdalénien de Placard, se rencontre également dans les couches les plus anciennes de Kesslerloch, en Suisse. Des ornements en spirale, semblables à ceux des armes en os de Dordogne, d’Arudy et de Lourdes, se trouvent à Hornos de la Peña, dans les monts Cantabriques. La diffusion de décorations analogues est encore plus frappante lorsqu’on les retrouve dans les détails de la sculpture ou dans un certain type de propulseur, qui s’étendait des Pyrénées jusqu’au lac de Constance. Des inventions comme celle du harpon et des modes comme celles des motifs décoratifs se sont propagées de point en point.
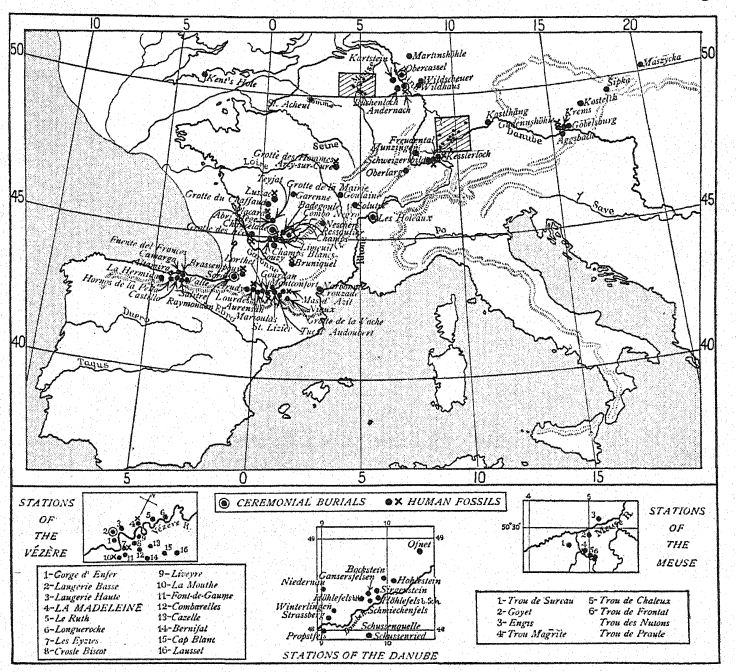
Cette influence ne conduit pas à une identité. Certaines phases de l’art et de la décoration sont confinées à certaines localités ; par exemple, les gravures de cerfs sur les omoplates osseuses des cavernes près de Santander, en Espagne, ne se retrouvent pas en France ; on observe également de nombreux styles locaux dans les formes et les décorations du javelot, de la lance et du harpon ; ces variations, cependant, ne masquent pas l’élément de communauté culturelle et les fluctuations similaires de l’industrie et de l’art entre des stations très éloignées.
De nombreuses stations magdaléniennes étaient regroupées autour des falaises abritées de Dordogne (Fig. 238). Outre celles-ci, on observe les sites magdaléniens de Champs, Ressaulier et la grotte de Combo-Nègre en Corrèze ; au sud de la Dordogne et de la Corrèze se trouvent d’autres stations le long de la Garonne et de l’Adour. Certains des plus beaux exemples d’art magdalénien proviennent de Bruniquel, dans l’Aveyron, près de la limite entre le Tarn-et-Garonne [ p. 437 ] et le Tarn, où pas moins de quatre sites importants ont été fouillés.
Français La carte culturelle de la France à l’époque magdalénienne est couverte du nord au sud de ces anciens campements, soit regroupés le long des rives des rivières, où l’érosion a créé des abris, soit dans les grands affleurements calcaires le long des pentes nord des Pyrénées, où l’exposition du calcaire a conduit à la formation de grottes et de cavernes, soit sur les plateaux où le gibier abondait ou où l’on pouvait trouver du silex pour l’industrie du silex en déclin rapide. Près du golfe du Lyon se trouvent les stations de Rise, Tournal, Narbonne et Crouzade ; s’étendant vers l’ouest en direction des sources de l’Ariège se trouvent La Vache, Massat et le grand tunnel du Mas d’Azil, formé par la rivière Arièze. Ici, les niveaux magdaléniens découverts par Piette ont livré quelques [ p. 438 ]des œuvres d’art magdaléniennes les plus remarquables, notamment des statuettes d’animaux, des bas-reliefs et des gravures aux contours incisés.
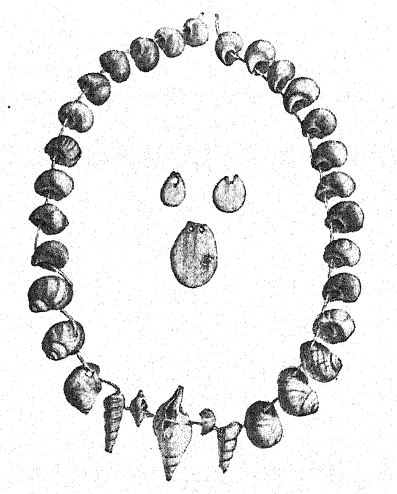
Plus à l’ouest, sur les sources de la Garonne, se trouve Gourdan, où Piette entreprit ses remarquables fouilles en 1871 et découvrit deux des phases antiques de la sculpture magdalénienne ; viennent ensuite les sites plus à l’ouest d’Aurensan, Lorthet et Lourdes, cette dernière ayant livré l’un des plus beaux exemples de cheval sculpté en ivoire, et devenue depuis célèbre comme lieu de miracle et de pèlerinage moderne. Entre la Garonne et le golfe de Gascogne se trouvent les stations de Duruthy et la grotte du Pape de Brassempouy, cette dernière occupée à l’époque magdalénienne, mais surtout connue comme un haut lieu de sculpture de statuettes de l’Aurignacien tardif.
Au nord-est, au cœur même de la région montagneuse d’Auvergne, se trouve la station de Neschers, où une coulée de lave du mont Tartaret est descendue sur les pentes du Mont-Dore et a recouvert un gisement industriel moustérien de sa faune de mammouths, puis, après un laps de temps, est devenue le site d’un camp industriel magdalénien, de sorte que Boule a pu déterminer l’âge géologique des éruptions volcaniques les plus récentes en France, celles des Monts d’Auvergne, comme s’étant produites entre les périodes d’industrie moustérienne et magdalénienne.
Français Compte tenu de la présence fréquente de camps aurignaciens et solutréens ainsi que de stations néolithiques dans le sud-est de la France, nous sommes surpris par l’extrême rareté des outils en silex magdaléniens. Cependant, Capitan a reconnu une station magdalénienne à Solutré, près des sources de la Saône, et non loin de ce site se trouve la station de Goulaine, qui a livré un énorme grattoir ou enclume en silex, le plus grand outil du Paléolithique supérieur jamais découvert ; il est soigneusement taillé sur toute la longueur du bord incurvé et pèse plus de 4 £ 14. Au nord de la Dordogne se trouve la célèbre grotte de Placard, en Charente, où l’on a découvert les prémices de l’industrie magdalénienne, et de nouveau directement au nord de celle-ci se trouve la grotte de Chaffaud, à Savigné, où le premier os gravé de « l’âge du renne » a été découvert en 1834 ; non loin de là se trouve l’abri [ p. 439 ] [ p. 440 ] de la Garenne, près de St. Mareel (Indre), qui a fourni une belle figure d’un renne au galop.
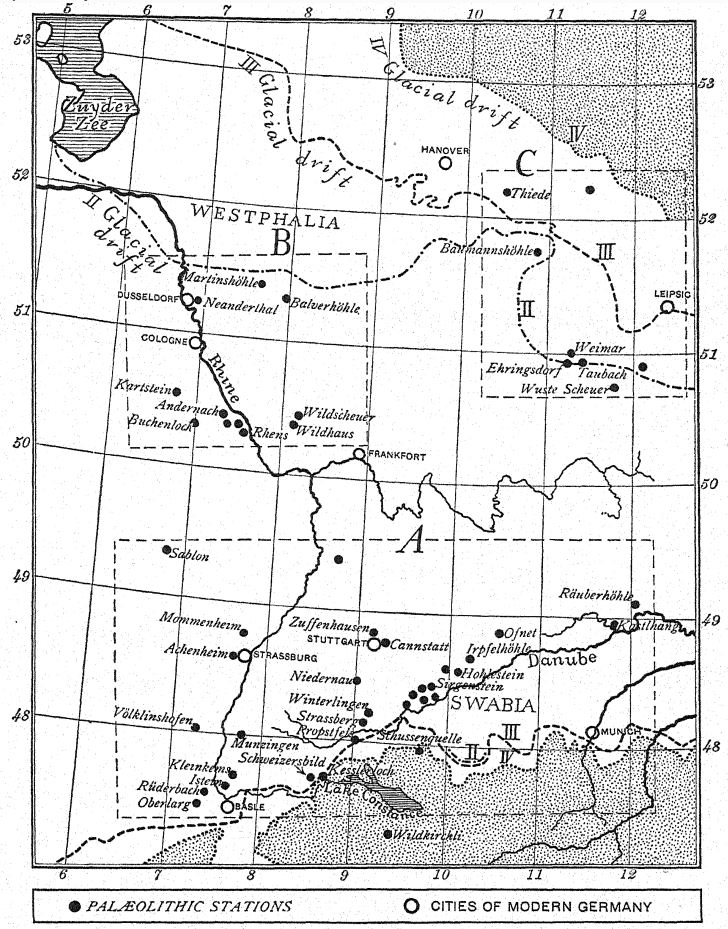
Ces documents géographiques et artistiques présentent un intérêt considérable, car ils transportent la culture périgourdine ou dordogne vers le nord. Un peu plus à l’est, à la source de la Cure, un affluent de l’Yonne, se trouve un important ensemble comprenant plus de soixante abris ouverts creusés dans le calcaire jurassique, où ont été découverts des outils en os magdaléniens caractéristiques. Parmi ces derniers, les plus célèbres sont la grotte des Fées et la grotte du Trilobite, toutes deux découvertes par les Néandertaliens au Moustérien et à nouveau recherchées par les Crô-Magnon au Magdalénien. Plus au nord encore, les Crô-Magnon ont visité les confins de la Somme et recherché la station de silex historique de Saint-Acheul, fréquentée par des races humaines depuis des millénaires, dès l’époque pré-chelléenne.
Au nord-est se trouvent les stations de Belgique, principalement révélées par les travaux de Dupont, réparties le long des vallées de la Lesse et de la Meuse et livrant des silex magdaléniens caractéristiques ainsi que de nombreuses gravures sur os. Nous pouvons être certains que cette région était sous domination des Cro-Magnons et que leur contrôle s’étendait jusqu’en Grande-Bretagne, où, rappelons-le, un squelette de Cro-Magnon a été découvert à Paviland, dans l’ouest du Pays de Galles. Là encore, à l’époque magdalénienne, la race Cro-Magnon était probablement répandue dans le sud de la Grande-Bretagne. À Bacon’s Hole, près de Swansea, au Pays de Galles, se trouve une décoration murale composée de dix bandes rouges qui, selon Breuil et Sollas, pourrait remonter au Paléolithique. L’industrie magdalénienne observée aux Cresswell Crags, dans le Derbyshire, est plus précise ; tandis que près de Torquay, dans le Devonshire, se trouve la célèbre station de Kent’s Hole, découverte en 1824, dans laquelle on a trouvé une aiguille en os et plusieurs harpons à double rangée de barbes appartenant à l’industrie magdalénienne tardive.
En Allemagne, alors que seulement trois stations solutréennes ont été découvertes29, on compte pas moins de quatorze stations magdaléniennes attestant de la large diffusion de cette culture. Ainsi, la grotte favorite de Sirgenstein, près du centre des stations magdaléniennes sur les eaux supérieures du Danube, bien qu’abandonnée à l’époque solutréenne, fut de nouveau visitée par l’homme au début de la culture magdalénienne. Coïncidant avec le retour de l’homme dans cette grande grotte, on assista à l’arrivée du lemming rayé (Myodes torquatus), annonciateur de la vague de vie de la toundra froide dans l’extrême nord. Au même moment, l’homme et le lemming rayé arrivèrent à Schweizersbild, près du lac de Constance ; à une époque légèrement antérieure, à l’aube de la culture magdalénienne, l’homme pénétra dans la station sœur de Kesslerloch. Il apparaît clairement qu’un climat froid et humide accompagnant l’avancée de Bühl a influencé tous les peuples Crô-Magnon de cette région, juste au nord des glaciers alpins, et les a contraints à rechercher les grottes et les abris. Il existe cependant quelques stations ouvertes dans cette région, par exemple à Schussenried, dans le Wurtemberg ; la couche culturelle magdalénienne ne se trouve pas dans une grotte, mais repose sous un dépôt de tourbe mêlé à des restes de renne, de cheval, d’ours brun et de loup. Parmi les sites les plus connus du Rhin moyen figure la station en plein air d’Andernach. La présence de gravures de ce type à Andernach et dans la grotte de Wildscheuer, près de Steeten, sur la Lahn, témoigne de la diffusion vers l’est de l’art de la gravure sur ivoire et sur os. Jusqu’à présent, ce sont les seules gares allemandes dans lesquelles de telles gravures ont été trouvées.
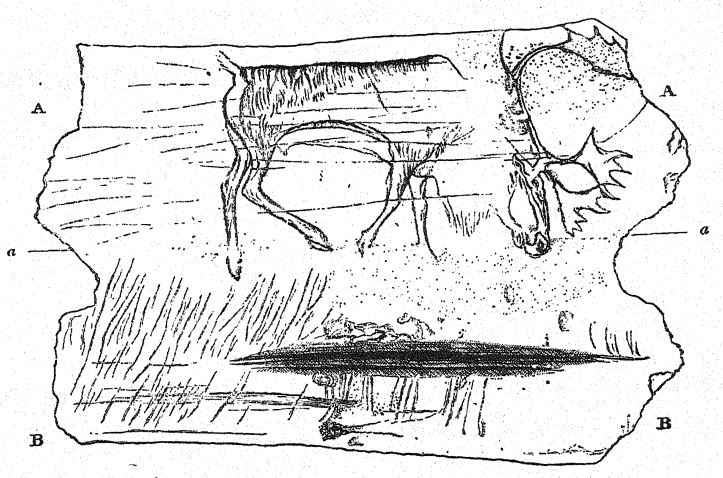
La station ouverte de lœss magdalénienne de Munzingen, sur le Rhin supérieur, présente également un intérêt particulier. Elle prouve que les couches les plus élevées du lœss supérieur, correspondant à la période climatique sèche ou steppique, étaient contemporaines de l’industrie magdalénienne avancée ou tardive. Ce stade final du lœss supérieur correspond également à la période où les derniers mammifères de la toundra arctique ont commencé à quitter l’Europe centrale. C’est à cette époque géologique critique que la culture magdalénienne tardive a commencé à s’éteindre. Kesslerloch, en Suisse, a livré un nombre considérable de gravures sur os, dont l’un des plus beaux exemples de renne broutant (fig. 241), et Schweizersbild a également livré un nombre considérable de gravures assez grossières.
A l’époque magdalénienne, la partie du Jura souabe comprise entre les sources du Neckar et du Danube était fréquentée ; le long du Danube, de Propstfels, près de Beuron, au sud-ouest, jusqu’à Ofnet, au nord-est, s’étendent les autres stations de Hohlefels bei Hiitten, Schmiechenfels et Bocksteinhohle.
Français À l’ouest du Danube, l’industrie s’est étendue jusqu’à la région actuelle de la Bavière, comme l’indique la récente découverte de Kastlhang.30 Ici, commençant par le Magdalénien ancien (Gourdanien inférieur de l’école française) et s’étendant jusqu’au Magdalénien moyen ou supérieur (Gourdanien supérieur), on trouve une série complète de stations magdaléniennes ; la couche magdalénienne moyenne est exactement du même type que celle trouvée dans l’abri Mege de Dordogne et dans les niveaux inférieurs de la grotte de la Mairie ; le même stade de culture est de nouveau observé dans le sud de l’Allemagne dans les stations de Schussenquelle et de Hohlefels, et il s’étend vers l’est en Autriche dans la station de Gudenushöhle ainsi que dans plusieurs stations moraves, par exemple, celle de Kostelik.
Ces faits sont d’un intérêt extraordinaire, car ils montrent que la civilisation, telle qu’elle était, du Paléolithique supérieur était très étendue. Cela marque une caractéristique sociale importante, à savoir la volonté de tirer parti de chaque étape du progrès humain, d’où qu’elle vienne. À ce stade, il est donc intéressant de comparer l’industrie magdalénienne de l’Allemagne avec celle de la France.31 L’Allemagne présente les mêmes tendances techniques et stylistiques et la même direction évolutive que la France. La vie des mammifères était, bien sûr, la même dans les deux pays, car dans chaque région, les types géants de mammifères survivaient encore, et le lemming rayé de l’Arctique apparaît dans les vallées abritées de la Dordogne aussi bien qu’en Belgique et en Allemagne. Les vicissitudes du climat étaient sans aucun doute les mêmes ; on observe l’alternance du climat froid et humide au Magdalénien inférieur le long du Danube supérieur ainsi qu’au Magdalénien inférieur de la station type de La Madeleine, en Dordogne. On observe encore la transition vers le climat froid et sec dans le caractère steppique de la faune à la fois le long du Rhin supérieur, à Munzingen, et aussi sous la station-abri de La Madeleine, comme l’a rapporté Peyrony.
Plus vitale encore pour cette communauté de culture industrielle était la communauté raciale, car à Obercassel nous trouvons le même type de Crô-Magnon que celui découvert sous les falaises abritées de la Dordogne. Il semble probable que les inventions de la région centrale de la Dordogne aient voyagé vers l’est si l’on note le fait qu’aucun des prototypes des premières formes de harpon, courants dans le sud de la France, ne se retrouve dans aucune des stations d’Europe centrale, mais le harpon à une seule rangée est caractéristique du Magdalénien moyen dans toute l’Allemagne. D’autres outils primitifs en os du Magdalénien, tels que la pointe de lance en os à base fendue, les bâtons et les aiguilles, sont également rares dans les stations allemandes. À la fin du Magdalénien, cependant, une communauté culturelle complète s’établit, car l’industrie des deux pays en silex et en os semble être très [ p. 444 ] similaire ; Les microlithes en silex apparaissent en nombre et en variété croissants ; à côté des petits éclats de silex à dos émoussé, on trouve de nombreux éclats en forme de plumes de type pré-tardenoisien, ainsi que des silex à graver. Certaines spécialités de la culture magdalénienne française n’ont pas pénétré en Allemagne ; par exemple, le burin de type « bec de perroquet » a été découvert en France, mais n’a pas été retrouvé loin vers l’est. Dans les deux pays, cependant, on trouve des ciseaux en corne de renne du Magdalénien supérieur et des aiguilles, bâtons et harpons en os perfectionnés à double rangée de barbes. En revanche, les œuvres d’art et les motifs décoratifs en corne et en os font presque totalement défaut dans les localités allemandes, à l’exception des stations d’Andernach et de Wildscheuer mentionnées précédemment. À la fin du Magdalénien, tant en Allemagne qu’en France, on constate une abondante faune forestière eurasienne.
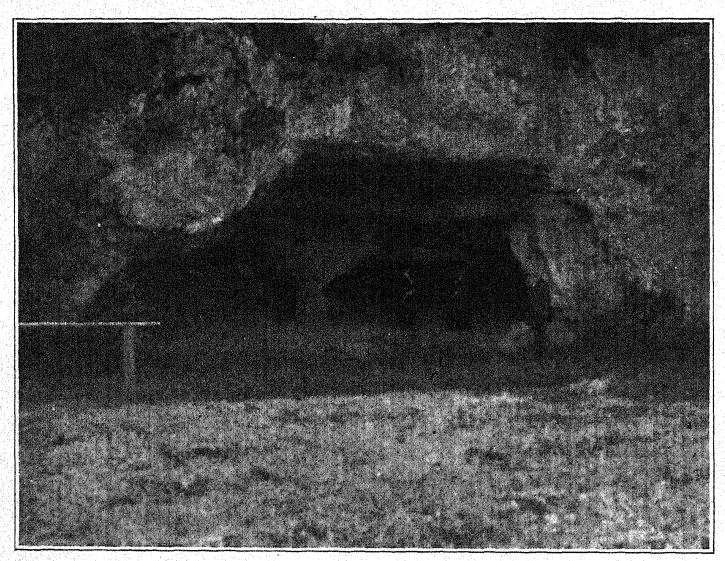
Français Les deux célèbres stations suisses de Kesslerloch et de Schweizers [ p. 445 ] bild, près du lac de Constance, semblent avoir été, tout au long de l’époque magdalénienne, en contact étroit avec les avancées culturelles de la Dordogne. Kesslerloch32 a livré 12 000 silex de petites dimensions, ressemblant dans leur succession à ceux de la station type de La Madeleine ; ainsi que des aiguilles, des harpons simples et doubles, des propulseurs de fléchettes, des bâtons, ainsi que les belles gravures mentionnées ci-dessus ; la sculpture osseuse est représentée ici dans la tête unique d’un bœuf musqué (Ovibos moschatus), dans des sculptures de rennes et d’autres animaux sur les bâtons et les armes de chasse. Kesslerloch se trouve au bord d’une vallée modérément large, traversée par un ruisseau ; Dans cette région abritée, bien arrosée et vallonnée, les arbres prospéraient et abritaient les animaux de la forêt, tandis que les glaciers, se retirant et laissant des zones humides et pierreuses, étaient suivis de près par la faune de la toundra ; le rhinocéros laineux et le mammouth y ont persisté plus longtemps que dans d’autres parties de l’Europe ; le cheval de Kesslerloch présenterait des ressemblances avec le cheval de Przewalski du désert de Gobi, en Asie centrale, et est par conséquent classé comme type steppique. Le développement des silex se fait étape par étape avec celui de la caverne sœur de Schweizersbild, et au début du Magdalénien, ces silex sont associés à l’arrivée de la grande migration des rongeurs de la toundra arctique, les lemmings à bandes (Myodes torquatus). Un foyer avec des cendres et des charbons et de nombreux os carbonisés de mammifères vieux et jeunes, y compris le rhinocéros laineux, a été trouvé ici ; la vie animale comprend au total vingt-cinq espèces de mammifères, parmi lesquelles le mammouth laineux, le rhinocéros laineux, le renne et le lion.
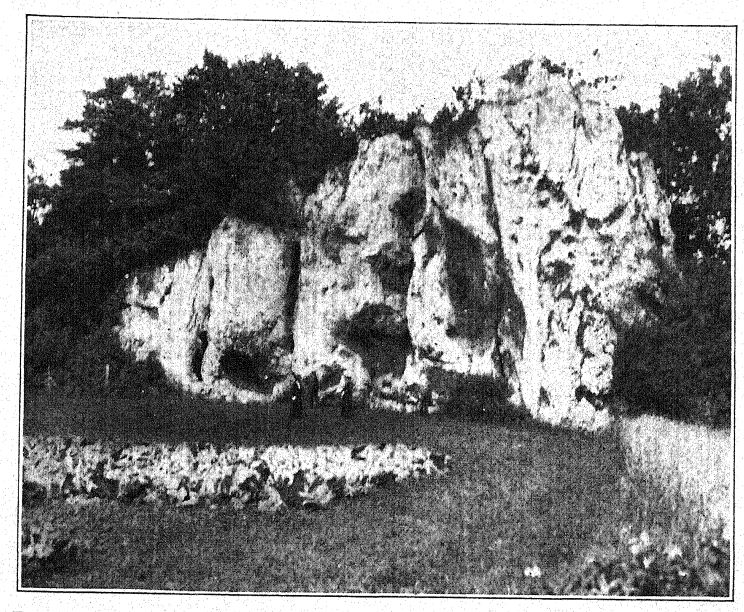
À moins de quatre miles de Kesslerloch, dans une petite vallée à environ deux miles au nord de Schaffhouse, se trouve l’autre célèbre station suisse de Schweizersbild. Les Crô-Magnon furent attirés par la falaise protectrice de calcaire isolé, s’élevant à pic sur la prairie. Au pied de cette falaise se trouve un abri orienté sud-ouest, dont l’entrée, haute d’environ 9 mètres, offre une vue imprenable sur la vallée lointaine. Les accumulations à la base de cet abri témoignent de l’évolution humaine, industrielle, faunique et climatique de cette région de Suisse, du Magdalénien ancien au Néolithique. Ce n’est qu’au Magdalénien ancien, après la fermeture des étages aurignacien et solutréen, que l’homme s’installa pour la première fois ici, lors de l’avancée de Bühl, période de dépôt de la couche supérieure des rongeurs, avec sa faune arctique froide et sa faune steppique. À partir de cette époque, la grotte fut occupée par intermittence jusqu’au Néolithique complet. Nüesch estime que le début de ces dépôts industriels remonte à 24 000 à 29 000 ans, mais nous avons adopté une estimation légèrement inférieure et plus prudente. Par ordre décroissant, les différentes couches de cet abri, telles qu’étudiées par Nüesch, sont les suivantes :
[ p. 447 ]
Section des dépôts Schweizersbild
Néolithique
6. Couche de terre humifère, d’une épaisseur comprise entre 15 et 19 pouces, contenant des outils néolithiques.
5. Couche de culture grise, d’environ 38 cm d’épaisseur, comprenant de nombreux foyers, des ornements en coquillage, des silex néolithiques polis et de la poterie non émaillée. La véritable faune forestière comprend l’ours brun, le blaireau, la martre, le loup, le renard, le castor, le lièvre, l’écureuil, le bœuf sauvage à cornes courtes (Bos taurus brachyceros) et le renne, ainsi que la chèvre et le mouton domestiques.
Paléolithique supérieur
4. Mince couche de rongeurs forestiers, principalement des écureuils. Os fendus et silex travaillés ; aucune sculpture sur os ou corne ; industrie du Magdalénien tardif ou proche du Magdalénien, Paléolithique supérieur ; preuves d’un changement climatique, de la disparition des conditions steppiques et de la prédominance des forêts ; seulement quelques espèces steppiques ; les espèces forestières comprennent le renne, le lièvre, le pika, l’écureuil, l’hermine et la martre.
3. Couche de culture jaune, période steppique, riche en foyers et ayant livré 14 000 silex du Magdalénien moyen [? et récent] ; gravures sur bois de renne, ornements en coquillages et en dents. Faune mixte, avec prédominance des types steppique et forestier ; parmi les quelques formes de la toundra, le renne est très abondant, ainsi que le renard arctique, mais le lemming rayé et les autres types de la toundra sont totalement absents ; la faune des steppes et du désert comprend le Kang, le cerf maral de Perse, le chat de Pallas (Felis manul), le cheval des steppes et le suslik des steppes ; de type alpin, le bouquetin ; de nombreuses espèces forestières, la martre des pins, le castor, l’écureuil, le cerf élaphe, le chevreuil et le sanglier.
2. Couche de rongeurs de la toundra arctique, 20 pouces d’épaisseur ; période de l’avancée postglaciaire de Bühl ; le lemming rayé (Myodes torquatus) le plus abondant, mêlé à des outils en silex et en os du début du Magdalénien ; un foyer ; une faune de toundra abondante, incluant tous les types de toundra sauf le lemming Obi et le bœuf musqué (Ovibos moschatus) que l’on trouve à Kesslerloch ; indications d’un climat très froid et humide ; le lemming rayé, le renard arctique, le lièvre arctique, le renne, le carcajou, l’hermine, ainsi que des formes forestières telles que le loup, le renard, l’ours, la belette et un certain nombre d’oiseaux du nord.
1. Lit de gravier et ancien dépôt fluvial, reconnus par Boule comme appartenant aux moraines de la quatrième glaciation.
Ce merveilleux dépôt d’artefacts humains et de restes animaux nous donne un enregistrement complet des changements climatiques dans cette région accompagnant les changements de culture et le développement de la race magdalénienne.
[ p. 448 ]
En tournant notre étude vers le cours du Danube, nous notons que plusieurs stations magdaléniennes s’étendent dans les provinces de Basse-Autriche, les principales étant la station ouverte de Toess d’Aggsbach et celle de Gobelsburg ; il y a aussi le Hundssteig près de Krems, mieux connu sous le nom de station de Krems, et la caverne connue sous le nom de Gudenushöhle ; dans cette dernière station, les bâtons, javelots et aiguilles en os caractéristiques ont été trouvés.[8]
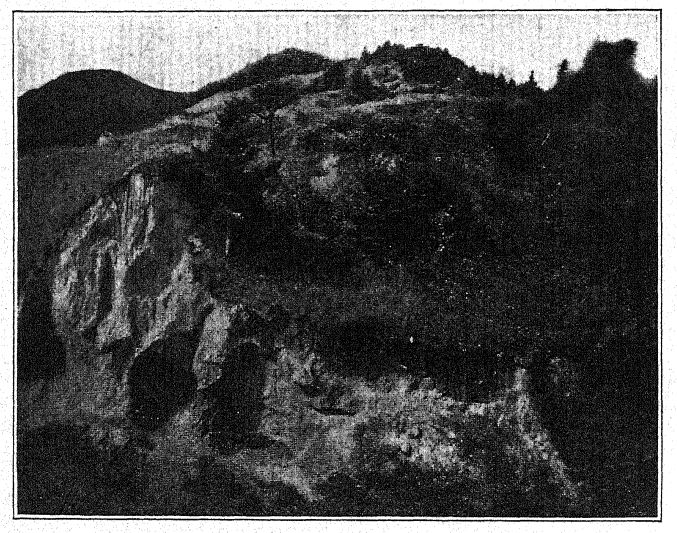
La région des grottes de Moravie attirait une population relativement importante, et parmi les nombreuses stations se trouvent les grottes de Kriz, Zitny, Kostelfk, Byciskala, Schoschuwka, Balcarovaskala, Kulna et Lautsch. Près de la frontière russe, des outils en os comme ceux de Gudenushöhle sur le Danube ont été découverts à la station de Kulna, et la stratification industrielle de [ p. 449 ] Sipka est très claire. Non loin de Cracovie, de l’autre côté de la frontière russe, les grottes de la région d’Ojcow ont été fréquentées par des hommes porteurs de la culture magdalénienne. Un autre site en Russie est la grotte de Maszycka, et des harpons, aiguilles et bâtons de commandement magdaléniens caractéristiques, ainsi que d’autres outils, ont également été découverts à l’est, dans les environs de Kiev, en Ukraine.
¶ Déclin de la culture magdalénienne
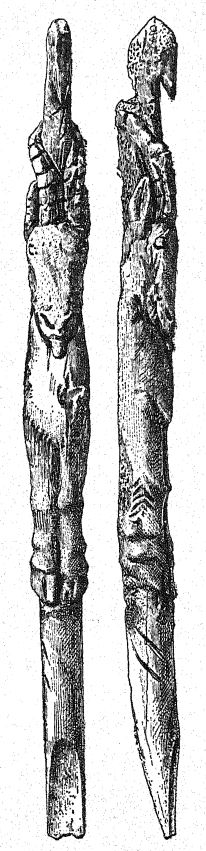
Le point le plus élevé touché par la race Crô-Magnon au Magdalénien moyen ou supérieur semble correspondre en gros à la période climatique froide et aride dans l’intervalle entre les avancées de Bühl et de Gschnitz dans la région alpine, au cours de laquelle les mammifères des steppes se sont largement répandus dans le sud-ouest de l’Europe.
L’antilope saïga, par exemple, un type steppique très caractéristique, est représentée dans l’une des gravures osseuses les plus raffinées découvertes dans les couches du Magdalénien tardif du Mas d’Azil ; le cheval steppique est également fréquemment représenté dans les gravures les plus avancées de la fin de l’époque magdalénienne. L’influence de ce climat froid et relativement sec sur l’énergie artistique et créatrice des Crô-Magnon est largement sujette à conjectures. Les archives, totalement indépendantes, de La Madeleine, de Schweizersbild et de Kesslerloch concordent pour associer le stade le plus élevé de l’histoire de l’art magdalénien à la prédominance de la faune steppique et aux preuves d’un climat froid et sec. L’abondance du mammouth est attestée par les gravures de mammouths superposées à celles du bison à Font-de-Gaume.
La période de vie suivante est celle du retrait des mammifères de la toundra [ p. 450 ] et des steppes, et de la raréfaction croissante du renne et du mammouth dans le sud-ouest de l’Europe ; elle correspond globalement au retour du climat froid et humide de la deuxième avancée postglaciaire connue dans les Alpes sous le nom d’étape de Gschnitz. Avec l’extension des forêts et le retrait vers le nord du renne, principale source d’approvisionnement en nourriture et en vêtements, ainsi qu’en tous les outils en os de l’industrie et de la chasse, un nouvel ensemble de conditions de vie a pu s’établir progressivement. S’il est vrai, comme le soutiennent la plupart des spécialistes des conditions géographiques et du climat, que l’Europe est devenue en même temps plus densément boisée, la chasse a pu devenir plus difficile, et les Crô-Magnon ont pu commencer à dépendre de plus en plus de la vie des cours d’eau et de l’art de la pêche. Il est généralement admis que les harpons étaient principalement utilisés pour la pêche et que nombre de silex microlithiques, de plus en plus abondants aujourd’hui, pourraient avoir été fixés à une hampe dans le même but. On sait que des microlithes similaires étaient utilisés comme pointes de flèches dans l’Égypte prédynastique.
Breuil35 observe des changements industriels très significatifs à la fin du Magdalénien : d’abord, l’apparition de petites formes géométriques de silex suggérant les types tardenoisiens ; ensuite, l’utilisation occasionnelle de corne de cerf à la place de la corne de renne ; troisièmement, une modification de la forme des outils en os vers les motifs de l’époque azilienne ; quatrièmement, le déclin rapide — on peut presque dire la disparition soudaine — de l’esprit artistique. Les dessins schématiques et conventionnels commencent à prendre la place de l’art réaliste libre du Magdalénien moyen.
Ainsi, le déclin des Crô-Magnons en tant que race puissante pourrait être dû en partie à des facteurs environnementaux et à l’abandon de leur mode de vie nomade et vigoureux, ou bien il se pourrait qu’ils aient atteint la fin d’un long cycle de développement psychique, que nous avons retracé depuis le début de l’Aurignacien. Nous savons, en parallèle, que dans l’histoire de nombreuses races civilisées, une période de grand développement artistique et industriel peut être suivie d’une période de stagnation et de déclin, sans cause environnementale apparente.
[ p. 451 ]
¶ Descendants de Gro-Magnon dans l’Europe moderne
On pourrait attribuer ce grand changement, qui a affecté toute l’Europe occidentale, à l’extinction de la race Crô-Magnon, si l’on ne disposait pas de preuves attestant de sa survie tout au long de l’Azihan-Tardenoisien ou de la fin du Paléolithique supérieur. À la fin du Paléolithique, la race s’est dispersée dans toute l’Europe occidentale en de nombreuses colonies, dont la présence remonte peut-être au Néolithique, voire à une époque récente. La preuve anatomique de cette théorie de la survie réside principalement dans la forme très caractéristique de la tête.
En Europe, un visage très large et un crâne long et étroit sont une combinaison si rare que les anthropologues soutiennent qu’elle permet d’identifier les descendants de la race préhistorique de Crô-Magnon, où qu’ils subsistent aujourd’hui. Puisque la Dordogne était le centre géographique de la race au Paléolithique supérieur, est-ce une simple coïncidence si la Dordogne est toujours le centre d’un type similaire ? Ripley® nous a fourni un précieux résumé de nos connaissances actuelles sur ce sujet. Le trait le plus significatif des habitants de Dordogne à tête longue est que, dans de nombreux cas, le visage est presque aussi large que chez le type alpin normal à tête ronde ; en d’autres termes, il est fortement dysharmonieux ; de profil, la partie arrière de la tête est relevée et vue de face, la tête est rétrécie au sommet ; le crâne est très bas ; les arcades sourcilières sont proéminentes ; le nez est bien formé ; les pommettes sont saillantes et les puissants muscles des joues donnent un aspect particulièrement rugueux au visage. L’apparence, cependant, n’est pas repoussante, mais plus souvent ouverte et bienveillante. Les hommes sont de taille moyenne, mais très sensibles à l’environnement en ce qui concerne la stature ; ils sont petits dans les endroits fertiles et rabougris dans les régions moins prospères. Ils ne sont pas du tout dégénérés, mais vifs et alertes d’esprit. Les habitants actuels de la Dordogne ne correspondent qu’à un autre type d’hommes connu des anthropologues, à savoir l’ancienne race Crô-Magnon. La preuve géographique qu’ici, en Dordogne, nous avons affaire aux survivants de la véritable race Crô-Magnon semble être confirmée par une comparaison des caractéristiques des crânes préhistoriques trouvés à Crô-Magnon, à Laugerie Basse et ailleurs en Dordogne, avec les têtes des types actuels. Les indices crâniens des crânes préhistoriques, variant de 70 à 73 %, correspondent à des indices de la tête vivante de 72 à 75 %. Aucun des habitants de la Dordogne n’a une tête aussi longue, l’indice moyen de la tête vivante dans une région extrême étant de 76 % ; mais dans l’ensemble de la population, les indices sont bien inférieurs.
La probabilité d’une filiation directe devient plus forte si l’on considère la forme disharmonieuse et basse du crâne de Crô-Magnon et l’allongement remarquable du crâne à l’arrière. Chez les Crô-Magnon préhistoriques, les sourcils étaient fortement développés, les orbites oculaires basses et le menton proéminent. Le type facial a été caractérisé par de Quatrefages37 comme suit : « L’œil enfoncé sous la voûte orbitaire ; le nez droit plutôt qu’arqué ; les lèvres un peu épaisses, la mâchoire et les pommettes fortement développées, le teint très brun, les cheveux très foncés et poussant bas sur le front — un ensemble qui, sans être attrayant, n’était en rien repoussant. »
Dans le sud de la France, on observe une continuité non seulement dans la forme de la tête, mais aussi dans la prédominance des cheveux et des yeux noirs. Pourquoi ce type Crô-Magnon aurait-il survécu ici et disparu ailleurs ? Pour étudier la cause particulière de la persistance d’une race paléolithique, il nous faut, avec Ripley, élargir notre horizon et considérer l’ensemble du sud-ouest, de la Méditerranée à la Bretagne, comme une unité.
La survie de cette race est en partie attribuée à un environnement géographique favorable, et en partie aux barrières géologiques et raciales. Au nord, l’intrusion de la race teutonique fut stoppée et la concurrence se limita aux types Crô-Magnon et Alpin.
Si les habitants de la Dordogne sont de véritables survivants des Crô-Magnons du Paléolithique supérieur, ils représentent certainement la plus ancienne race vivante d’Europe occidentale, et n’est-il pas extrêmement significatif que la langue la plus primitive d’Europe, celle des Basques des Pyrénées septentrionales, soit parlée à proximité, à seulement 320 kilomètres au sud-ouest ? Existe-t-il un lien possible entre la langue originelle des Crô-Magnons, une race qui peuplait autrefois la région des monts Cantabriques et des Pyrénées, et la langue agglutinante actuelle des Basques, qui est totalement différente de toutes les langues européennes ? Cette hypothèse, suggérée par Ripley,38 mérite d’être examinée, car il n’est pas inconcevable que les ancêtres des Basques aient conquis les Crô-Magnons et acquis par la suite leur langue.
Les hommes préhistoriques de Cro-Magnon semblent donc être restés sur leurs premiers sites ou à proximité, malgré les changements du temps et les vicissitudes de l’histoire. « C’est peut-être, observe Ripley, l’exemple le plus frappant connu de la persistance d’une population inchangée pendant des milliers d’années. »
L’extension géographique de cette race était autrefois bien plus vaste qu’elle ne l’est aujourd’hui. Le crâne classique d’Engis, en Belgique, appartient à ce type. On l’a suivi de l’Alsace à l’est jusqu’à l’Atlantique à l’ouest. Ranke affirme qu’on le trouve aujourd’hui dans les collines de Thuringe, et qu’il y était autrefois un type répandu. Verneau considère qu’il s’agissait du type prédominant chez les Guanches éteints des îles Canaries. Collignon39 l’a identifié en Afrique du Nord et considère les Crô-Magnons comme une sous-variété de la race méditerranéenne, une opinion qui concorde au moins avec les preuves archéologiques selon lesquelles cette race est arrivée en Europe avec la culture aurignacienne, dont la distribution était circum-méditerranéenne. On trouve des traces de la formation de la tête des Crô-Magnons chez les Berbères actuels.
À l’heure actuelle, cependant, on pense que cette race ne survit que dans quelques localités isolées, à savoir en Dordogne, dans une petite localité des Landes, près de la Garonne dans le sud de la France, et à Lannion en Bretagne, où près d’un tiers de la population est de type Crô-Magnon. On dit qu’elle survit sur l’île d’Oléron au large de la côte ouest de la France, et on trouve des preuves d’une descendance similaire parmi les habitants des îles [ p. 454 ] du nord de la Hollande. Les habitants de Trysil, sur la péninsule scandinave, sont caractérisés par des traits disharmonieux, représentant peut-être un affleurement du type Crô-Magnon.
Notre intérêt pour le sort des Crô-Magnon est si grand que la théorie guanche peut également être envisagée ; elle est reconnue par de nombreux anthropologues : von Behr, von Luschan, Mehlis, et surtout Verneau. Les Guanches étaient une race qui s’était autrefois répandue dans toutes les îles Canaries et qui a conservé ses caractéristiques primitives même après sa conquête par l’Espagne au XVe siècle. Les différences avec le type supposé moderne des Crô-Magnon doivent être mentionnées en premier lieu. La peau des Guanches est décrite par le poète Viana comme couleur de peau, et Verneau considère que leurs cheveux étaient blonds ou châtain clair et leurs yeux bleus ; cette couleur, cependant, est quelque peu conjecturale. Les traits de ressemblance avec les anciens Crô-Magnon sont nombreux. La taille minimale des hommes était de 1,70 m et la taille maximale de 1,90 m ; dans une localité, la taille moyenne des hommes dépassait 1,80 m. Les femmes étaient relativement petites. Les caractéristiques les plus frappantes de la tête étaient le front fin, le crâne extrêmement long et la forme pentagonale du crâne, vue d’en haut, due à la proéminence des pariétaux — une caractéristique de Crô-Magnon. Parmi les insignes des chefs figurait l’os du bras d’un ancêtre ; le crâne était également soigneusement conservé. Les armes offensives consistaient en trois pierres, une massue et plusieurs couteaux d’obsidienne ; l’arme défensive était une simple lance. Les Guanches utilisaient des épées de bois avec une grande habileté. L’habitation de tout le peuple se trouvait dans de vastes cavernes bien abritées, qui sillonnaient les flancs des montagnes ; toutes les parois de ces cavernes étaient décorées ; les plafonds étaient recouverts d’une couche uniforme d’ocre rouge, tandis que les murs étaient décorés de divers motifs géométriques rouges, noirs, gris et blancs. Des pierres creusées servaient de lampes. Nous pouvons conclure avec Verneau qu’il existe des preuves, quoique peu convaincantes, que les Guanches étaient apparentés aux [ p. 455 ] Crô-Magnon.40 Ses observations sur ces supposés Crô-Magnon des îles Canaries sont citées dans l’appendice, note V. Nous regrettons que Verneau, dans ses mémoires^*, ne présente pas ses vues les plus récentes sur la distribution préhistorique de cette grande race.
¶ Bibliographie
(1) Breuil, 1912.7, p. 203.
(2) Op. cit., p. 20$.
(3) Jacques, 1902.1.
(4) Heim, 1894.1, p. 184.
(5) Schmidt, 1912.1, p. 262.
(6) Fraunhoiz, 1911.1.
(7) Geikie, 1914.1, pp. 25, 26.
(8) Boule, 1899.1.
(9) Breuil, 1912.7, p. 203-205.
(10) Obermaier, 1912.1, pp. 341, 342.
(11) Martin, R., 1914.1, pp. 15, 16.
(12) Verworn, 1914.1.
(13) Op. cit., p. 646.
(14) Breuil, 1912.7, p. 201.
(est) Lartet, 1875.1.
(16) Breuil, 1912. 7, p. 213.
(17) Schmidt, 1912.1, 9. 136.
(18) Breuil, op. cit., p. 216, 217.
(19) Breuil, 1909.3.
(20) Op. cit., p. 410.
(21) Cartailhac, 1906.1, p. 227, 228.
(22) Rivière, 1897.1; 1897.2.
(23) Reinach, 1913.1.
(24) Breuil, 1912.1, p. 202.
(25) Cartailhac, 1908.1.
(26) Capitan, 1908.1, p. 501-514.
(27) Ibid. 1910.1, pp. 59-132.
(28) Breuil, 1912.1, p. 196, 197.
(29) Schmidt, 1912.1, p. 116.
(30) Fraunhoiz, 1911.1.
(31) Schmidt, 1912.1,9. 154.
(32) Dechelette, 1908.1, vol. I, pp. 191-194.
(33) Nehring, 1880.1: 1896.1.
(34) Bayer, 1912.1, p. 13-21.
(35) Breuil, 1912.7,99. 212, 216.
(36) Ripley, 1899.1, pp. 39, 165, 173, 174-179, 211, 406.
(37) Op. cit., p, 176.
(38) Op. cit., p. 1 81.
(39) Collignon, iSgo.1.
(40) Verneau, 1891.1.
(41) Ibid. 1906.1.
¶ Afrique du Nord et Espagne
Avant de poursuivre avec le chapitre VI, le lecteur devrait étudier attentivement la note sur l’industrie du silex capsien (voir annexe, note XI, p. 514) d’Espagne et du nord-ouest de l’Afrique, dont la station type est Gafsa, située à environ 290 kilomètres au sud-ouest de Tunis, dans la région comprise entre Tripoli et Alger, aujourd’hui connue sous le nom de Tunis. Il semblerait que cette partie de l’Afrique ait probablement été le berceau de l’industrie tardenoisienne décrite p. 465.
Le lien entre la vie espagnole et nord-africaine à l’époque paléolithique a récemment été entièrement décrit par Hugo Obermaier dans son ouvrage très intéressant, El Hombre fosil, publié à Madrid en 1916.
¶ Notes de bas de page
D’après les notes du docteur Robert H. Lowie (16 novembre 1914) du Musée américain d’histoire naturelle sur les opinions de Marett (Anthropologie) et de James. ↩︎
D’après Obermaier,10 R. MArtin,11 et autres. ↩︎
Cette coutume est observée à nouveau à l’époque azilienne dans les sépultures d’Ofnet sur le Danube (voir page 475). ↩︎
Toute l’histoire de ces découvertes successives, commençant par la découverte d’un os gravé, en 1834, dans la grotte de Chaffaud, et se terminant par les découvertes de Laianne et de Begouen, en 1912, est résumée dans l’admirable petit manuel de Salomon Reinach.22 Ce volume commode comprend également les tracés schématiques des dessins et des sculptures les plus importants trouvés en Europe occidentale jusqu’à nos jours. ↩︎
Seuls quelques dessins de cette caverne ont été publiés jusqu’à présent, comme le célèbre mammouth de Combarelles ; l’œuvre entière est entre les mains de Breuil. ↩︎
Les stations de Castillo, de Pasiega et d’Altamira ont été visitées par l’écrivain, sous la direction du docteur Hugo Obermaier, en août 1912. ↩︎
Lettre du 25 octobre 1912. ↩︎
J. Bayer34 a récemment exprimé l’opinion que l’industrie des stations de « loess » ouvertes de Munzingen, Aggsbach et Gobelsburg n’est pas réellement d’âge magdalénien, mais représente un Aurignacien atypique. ↩︎