[ p. 25 ]
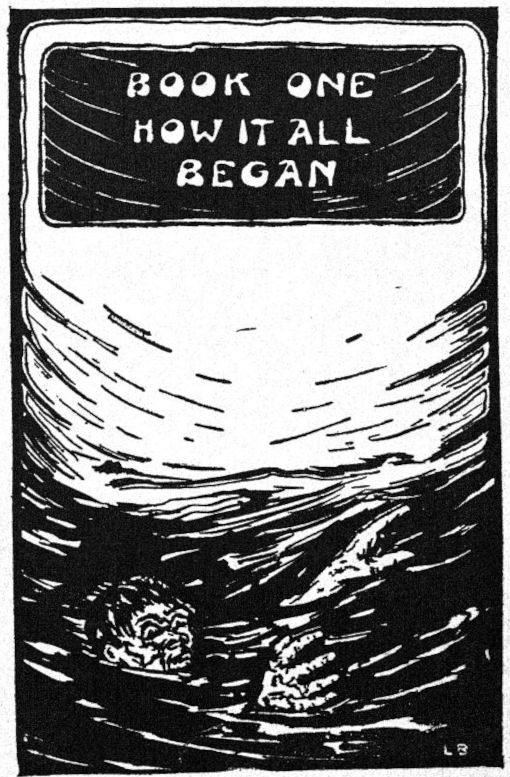
[ p. 26 ]
¶ LIVRE UN — COMMENT TOUT A COMMENCÉ
I. Magie
1 : Comment le sauvage tenta d’expliquer les maux qui lui arrivaient — il imaginait que tous les objets étaient animés — l’instinct de conservation et la magie. 2 : Définition de la religion et de la foi — la technique de la magie — l’aube de l’idée de « l’esprit » — l’animisme. 3 : L’homme commence à croire qu’il peut exploiter les esprits — le chamanisme — le charlatan aux débuts de la religion. 4 : Le fétichisme. 5 : L’idolâtrie — le début du sacrifice — de la prière — de l’église. 6 : Tabou.
II. Religion
1 : La tentative de contraindre les esprits cède la place à la tentative de les cajoler — mais la magie ne disparaît pas — les sacrifices. 2 : Les fêtes saisonnières — les rites sexuels — les sacrements. 3 : Comment les grands dieux ont été créés. 4 : Comment les idées de péché, de conscience et de rétribution future sont apparues — la religion sauve la moralité à un prix élevé — prophète contre prêtre. 5 : Comment la religion a rendu la société possible — et désirable — comment elle a donné naissance à l’art — l’importance de la religion primitive.
[ p. 27 ]
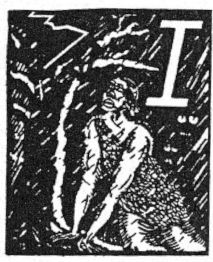
Au commencement résidait la peur ; et la peur était au cœur de l’homme ; et la peur contrôlait l’homme. À chaque instant, elle l’envahissait, ne lui laissant aucun moment de répit. Avec le souffle sauvage du vent, elle le balayait, avec le grondement du tonnerre et le grondement des bêtes aux aguets. Tous les jours de l’homme furent gris ; tout son univers semblait chargé de la terre, de la mer et du ciel qui s’opposaient à lui ; une inimitié implacable, une haine inexplicable, visaient sa destruction. Du moins, c’est ce que concluait l’homme primitif… C’était une conclusion inévitable dans ces circonstances, car tout semblait se retourner contre lui. Des rochers s’écroulaient et lui brisaient les os ; les maladies rongeaient sa chair ; la mort semblait toujours prête à le terrasser. Et lui, pauvre demi-singe bafouillant, soignant sa blessure dans une grotte aux courants d’air, ne pouvait que trembler de peur. Il ne pouvait se donner un courage stoïque à l’idée qu’une grande partie du mal qui s’était produit puisse [ p. 28 ] être accidentel. Il ne pouvait même pas concevoir l’accidentel. Non, pour autant que son pauvre crâne terne puisse déchiffrer l’énigme, tout ce qui se produisait était chargé de sens, intentionnel. Le rocher qui était tombé et avait écrasé son épaule avait voulu tomber et l’écraser. Bien sûr !… La lance de feu céleste qui avait réduit sa squaw en cendres avait consciemment tenté de faire exactement cela. Évidemment !…
Pour le sauvage, l’idée que tout ce qui l’entourait lui vouait de la malice n’avait rien d’absurde, car il n’avait pas encore découvert que certaines choses étaient inanimées. Dans le monde qui l’entourait, tous les objets étaient animés : bâtons, pierres, tempêtes, et tout le reste. Il s’effrayait devant chacun d’eux avec suspicion, comme un cheval s’effraye devant des morceaux de papier blanc au bord de la route. Et non seulement toutes choses étaient animées pour le sauvage, mais elles bouillonnaient aussi d’émotions. Les choses pouvaient être en colère, et elles pouvaient être contentes : elles pouvaient le détruire si elles le voulaient, ou le laisser tranquille.
Peut-être, comme le professeur George Foot Moore nous le rappelle avec finesse, même les gens civilisés s’accrochent instinctivement à cette idée primitive. Les enfants donnent des coups de pied furieux aux tables contre lesquelles ils se cognent la tête, comme si ces tables étaient humaines. Les hommes adultes murmurent des jurons aux tapis sur lesquels ils trébuchent, comme si ces tapis avaient intentionnellement tenté de les faire trébucher. Et il se peut que jeunes et vieux commettent encore des actes aussi irrationnels uniquement parce qu’aujourd’hui encore subsiste dans l’esprit humain l’idée farouche que tous les objets sont animés. Pris au dépourvu, l’homme se laisse encore tromper et tente de punir, soit par un coup, soit par l’envoi en enfer, les objets inanimés qui lui causent de la douleur.
[ p. 29 ]
Après tout, les gens civilisés, au fond, sont dangereusement proches du sauvage. Instinctivement, lui aussi voulait s’attaquer à tout ce qui semblait lui porter malheur. Seulement, il avait peur. D’expérience, il savait que le combat était inutile, que les objets ennemis, les rochers qui le mutilaient et les torrents qui dévastaient sa hutte, étaient, d’une manière étrangement invulnérable, à l’abri de ses lances et de ses flèches. C’est pourquoi il fut finalement contraint de recourir à des méthodes d’attaque plus subtiles. Puisque les coups ne pouvaient dompter les rochers ou les ruisseaux hostiles, notre ancêtre tenta de les maîtriser par la magie. Il pensait que les mots pourraient lui être utiles : d’étranges syllabes prononcées en gémissements, des cris insensés accompagnés de tam-tams. Ou il essayait des danses endiablées. Ou des porte-bonheur. Si ces sorts échouaient, il en inventait d’autres ; si ceux-ci échouaient à leur tour, il en inventait d’autres encore. Il semblait obstinément convaincu d’une chose : qu’un sort fonctionnerait. Il croyait que, d’une manière ou d’une autre, les choses hostiles qui l’entouraient pouvaient être apaisées ou contrôlées ; que, d’une manière ou d’une autre, la mort pouvait être évitée. Pourquoi en était-il si certain ? Personne ne le sait. C’était sans doute son adaptation instinctive aux conditions d’un monde qui le dépassait. L’instinct de survie l’avait forcé à cette certitude, car sans elle, la survie aurait été impossible. L’homme devait avoir foi en lui-même, ou mourir – et il ne mourrait pas.
Il avait donc la foi et développa la religion.
¶ 2
La RELIGION n’est pas toute la foi, mais seulement une partie de celle-ci. Par le mot foi, nous entendons cette illusion indispensable — et donc impérissable — au cœur de l’homme [ p. 30 ] selon laquelle, bien qu’il puisse paraître un simple ver sur terre, il peut néanmoins se faire le maître de l’univers. Par le mot religion, cependant, nous entendons une technique spécialisée par laquelle l’homme cherche à réaliser cette illusion. Ce n’était en aucun cas la première technique de ce genre inventée par l’homme ; et ce ne sera peut-être pas non plus la dernière. Bien avant que l’homme ne pense à la religion, il a tenté de contrôler les « pouvoirs » de l’univers par la magie. Lorsque « l’homme de l’aube » devint suffisamment éveillé pour prendre conscience de sa vie et des innombrables dangers qui la menaçaient, il ne s’arrêta pas d’abord pour examiner ces dangers ; non, il entreprit d’abord de les conjurer. Il voyait de tous côtés les « pouvoirs » sinistres et déroutants, et, illogiquement (mais naturellement), sa première préoccupation n’était pas de savoir comment ils fonctionnaient, mais comment les éviter. S’il spéculait à leur sujet, il concluait probablement que les objets mêmes qu’il voyait lui inspiraient une animosité : les tempêtes, les ruisseaux et les bêtes sauvages. Ce n’est que bien plus tard, bien plus tard, qu’il progressa suffisamment pour pouvoir considérer ces « pouvoirs » non pas comme les objets eux-mêmes, mais comme des esprits invisibles qui les habitaient. L’homme primitif était totalement incapable d’établir des distinctions subtiles entre l’âme et le corps, entre l’esprit et la matière. Il ne connaissait que les arbres qui l’écrasaient, les grottes qui l’étouffaient, les montagnes qui rugissaient et crachaient de la lave qui le détruisait. Son esprit chétif ne pouvait pas le porter plus loin.
Mais enfin, le jour arriva où, telle la montée furtive d’une lente aube, cette idée de l’esprit s’insinua dans l’esprit de l’homme. Elle lui vint presque inévitablement. Un matin, il se réveilla, leva les yeux, perplexe, vers les rochers familiers de sa grotte et s’exclama : « Bonjour, [ p. 31 ] c’est étrange ! » — ou quelque chose du genre. Car il était là, exactement là où il s’était allongé et endormi la nuit précédente — et pourtant il savait qu’il s’était éloigné de cet endroit pendant l’intervalle. Il en était certain ! Il se souvenait très précisément d’avoir combattu d’énormes bêtes pendant la nuit, ou d’avoir dévalé des ravins, ou d’avoir dévoré des mastodontes entiers, ou d’avoir volé… Et pourtant, il était là, toujours allongé dans sa grotte odorante, comme s’il ne l’avait jamais quittée un seul instant !…

Bien sûr, nous, civilisés, expliquerions le mystère en disant simplement que cet homme avait fait un rêve. (Ce qui n’est peut-être pas une explication aussi convaincante, d’ailleurs.) Mais lui, le pauvre sauvage, ne pouvait même pas imaginer une telle explication. L’idée d’un rêve lui était aussi étrangère que celle d’un monocle ou d’une malle-penderie. Non, la seule explication acceptable qu’il pouvait s’offrir était celle, évidente, de sa dualité : il possédait non seulement un corps, mais aussi un esprit, et si son corps était resté décemment [ p. 32 ] à la maison cette nuit-là, son esprit s’était égaré… Pourquoi pas ?
Il y avait d’autres expériences que cette réponse semblait expliquer. Il y avait, par exemple, la mort. Un corps était là, dressé et vibrant, un instant, puis prostré, inerte, l’instant d’après. Que lui était-il arrivé ?… De toute évidence, la même réponse s’imposait : son âme avait fui.
Le sauvage ne pouvait en être certain. Il pensait plutôt que l’âme pouvait être le souffle, car celui-ci s’enfuyait toujours à la mort. (C’est pourquoi le mot japonais pour âme était autrefois « boule de vent » et celui pour mort « départ du souffle ». De même, c’est pourquoi le mot hindou pour âme est toujours atman, ancêtre du mot allemand Ahtem, signifiant « souffle », et du mot anglais atmosphère.) Mais le sauvage devait imaginer que l’âme pouvait aussi être autre chose que le souffle, car il voyait des âmes dans les choses sans souffle. De fait, il voyait des âmes dans tout ce qu’il rencontrait. Son monde entier regorgeait d’âmes.
Les historiens appellent aujourd’hui ce stade du développement de la religion « animiste », du latin anima, qui signifie « esprit ». Des millions de sauvages dans le monde, aujourd’hui encore, restent englués dans ce stade animiste de la religion. Ils vivent en Inde, en Afrique et ailleurs, attachés à une foi primitive qui a dû être celle de tous les êtres humains.
¶ 3
Même à l’aube de l’animisme, il ne pouvait y avoir grand-chose au cœur de l’homme, si ce n’est la peur – et la haine née de la peur. Les sauvages ne semblaient alors connaître que deux sortes d’esprits : ceux qui étaient neutres, [ p. 33 ] et donc ne réclamant aucune attention, et ceux qui étaient hostiles, et donc à chasser ou à circonvenir. Par exemple, presque partout, les fantômes des morts étaient considérés comme hostiles. Parce qu’on pensait que ces fantômes planaient tels des spectres au-dessus des corps qu’ils avaient autrefois occupés, les corps étaient toujours rangés avec la plus grande prudence et la plus grande minutie. Après l’enterrement, les survivants essayaient généralement de se déguiser ou de se cacher pour échapper aux fantômes. Ils se peignaient en blanc (s’ils étaient noirs) ou en noir (s’ils étaient blancs) ; et ils barraient les portes de leurs huttes ou se cachaient dans des grottes. (C’est pourquoi nous continuons à « prendre le deuil » lorsqu’un proche décède, en revêtant des vêtements noirs et en baissant les stores des fenêtres.) …
Il ne fallut pas longtemps, semble-t-il, pour que l’homme cesse de supposer que les « puissances » actives étaient toutes irrémédiablement hostiles, et donc à chasser. Ce n’est que bien des siècles plus tard qu’il lui vint à l’esprit que certains esprits pouvaient être réellement amicaux, ou que même des esprits hostiles pouvaient, d’une certaine manière, être conquis et rendus amicaux. Mais une fois ce changement survenu, une révolution complète s’ensuivit dans la pratique religieuse. Au lieu de passer son temps à inventer des moyens de chasser les esprits, l’homme commença à tenter d’en rapprocher certains. Ainsi s’ouvrit une nouvelle ère dans l’histoire de l’espèce. Les premiers frémissements de confiance commencèrent à réchauffer le sang de l’homme, et peu à peu son dos se redressa. La peur subit son premier revers décisif, et la promesse de la civilisation fit son premier souffle. Car alors enfin l’homme osa penser pouvoir réellement exploiter les esprits !…
Il y avait maintenant deux façons [ p. 34 ] principales par lesquelles l’homme essayait d’exploiter le pouvoir d’un esprit. L’une consistait à l’invoquer dans un individu, un homme-médecine, ou comme on l’appelait dans la Sibérie primitive, un chaman. À l’origine, le chaman était probablement un épileptique, une personne sujette à des crises qui ne pouvaient s’expliquer que par la « possession ». Le chaman était considéré comme « possédé » par un esprit étrange, un esprit redoutable et peut-être violent, capable de faire des choses à la fois mauvaises et bonnes. Ainsi, si un homme avait de la fièvre, il allait voir son chaman tribal, et ce dernier essayait de la chasser en opposant son propre « esprit familier » à l’esprit de la fièvre du patient. S’il échouait à la première tentative, il recommençait, en utilisant un rituel plus élaboré la deuxième fois. Peut-être obligeait-il le patient à se barbouiller d’excréments, ou faisait-il autre chose d’aussi extraordinaire. Alors, lui, le chaman, s’emportait dans une crise où il dansait comme un forcené, poussait des cris horribles, frappait violemment sur un tam-tam ou agitait un hochet au son horrible. Il pouvait continuer ainsi toute la nuit, délirant, dansant et grimaçant, tout cela pour chasser le mauvais esprit du patient. Et plus sa performance était élaborée, plus il apparaissait merveilleux et puissant aux yeux du patient. L’échec semblait tout à fait impossible après de tels efforts – et c’était souvent le cas.
Mais le chaman n’était pas seulement employé pour chasser les mauvais esprits. Plus souvent peut-être, il était employé pour les insuffler aux gens. Grâce à l’esprit censé être à sa disposition, on pensait que le chaman était capable de faire le mal aussi bien que le bien, d’envoyer la maladie, la défaite et la mort à ses ennemis, ainsi que d’apporter le soulagement et la vie à ses amis. C’est pourquoi le chaman devenait généralement le chef de la tribu. Les braves [ p. 35 ] avaient constamment besoin de lui, car sans sa « médecine », sans ses sorts et ses malédictions, ils se croyaient perdus en guerre comme en paix. Il semblait le seul instrument efficace pour matraquer les « puissances » déployées contre eux, le seul moyen valable de maîtriser l’univers. Ils s’accrochaient donc à lui de toutes leurs forces, lui rendant un hommage craintif en raison du pouvoir magique qu’il était censé posséder.
Bien sûr, dès que la fausseté des prétentions d’un chaman était définitivement établie, le pauvre homme ne lui était jamais pardonné. Les sauvages se retournèrent contre lui sans pitié et le mirent à mort, peut-être au moyen de tortures des plus atroces. Ils n’avaient que faire des sorciers dont les remèdes étaient inefficaces… C’est pourquoi, parmi les chamans, seuls les charlatans conscients réussissaient le mieux et survivaient le plus longtemps. Les autres, les innocents, assez fous pour croire pouvoir commander aux esprits, étaient facilement démasqués et rapidement anéantis. Ils n’étaient pas assez perspicaces pour percevoir la fausseté fondamentale de leurs propres prétentions et, par conséquent, totalement incapables de la dissimuler aux autres. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, cette situation s’avéra d’un immense bénéfice pour l’humanité. Comme le remarque Sir James G. Frazer dans son grand ouvrage, Le Rameau d’Or, les fous honnêtes ont dû faire bien plus de mal dans la société primitive que les rusés coquins. Seul l’individu suffisamment supérieur à ses semblables pour songer à les tromper [ p. 36 ] était en mesure de les aider. Sans aucun désir conscient de sa part, le bien résultant de sa sagacité surpassait presque inévitablement le mal accompli par sa ruse. L’émergence d’une classe de chamans rusés, issue de la bêtise primitive, constituait donc un véritable avantage pour la civilisation. Elle retirait la direction des affaires tribales des mains des vieux (dont la seule distinction résidait dans leur âge) et des forts (dont la seule distinction résidait dans leur force physique) pour la confier à des personnes perspicaces et clairvoyantes. De fait, l’essor du chamanisme fut peut-être le facteur le plus fondamental du développement des premiers gouvernements.
¶ 4
Mais le chamanisme n’était que le moins courant des deux moyens par lesquels les hommes primitifs tentaient d’exploiter les esprits. L’autre, le fétichisme, était bien plus répandu car bien plus facile à manier. Le mot « fétichisme » vient du portugais feitico, qui signifie médaillon ou relique d’un saint porté comme porte-bonheur. C’est aujourd’hui le terme technique désignant la croyance qu’un esprit actif réside dans un objet particulier, et que la simple possession de cet objet confère le pouvoir de contrôler son esprit. Les premiers fétiches étaient probablement des galets marqués qui, par hasard, attiraient le regard des sauvages par leur couleur ou leur forme extraordinaire. (Des millions de personnes, dans les pays les plus civilisés, croient encore à ces « pierres porte-bonheur ».) Plus tard, cependant, des fétiches furent fabriqués. Il s’agissait souvent de petites bourses contenant des objets aux propriétés réputées magiques. On y mettait un poil de lion pour donner du courage, un morceau de cerveau humain pour la ruse, un globe oculaire pour la vue perçante, une griffe de tigre pour la férocité, etc. Le sauvage rassembla toute une collection de fétiches sur une ficelle et les accrocha [ p. 37 ] à son cou ou à la porte de sa hutte. (Certains érudits affirment que le port de croix autour du cou, ou la fixation de fers à cheval et de mezouzoth à la porte, n’est qu’une survivance de ce fétichisme sauvage.) Avec ces amulettes sur lui, le sauvage n’avait plus autant peur. Il se sentait plus à même de résister aux aléas de la vie et s’imaginait plus à la hauteur de l’univers. En cas de besoin, il appelait simplement l’un de ses fétiches à l’aide ; et si l’aide tardait à venir, il reprochait avec colère à l’objet sa paresse. S’il persistait, il le jetait et s’en procurait un autre.
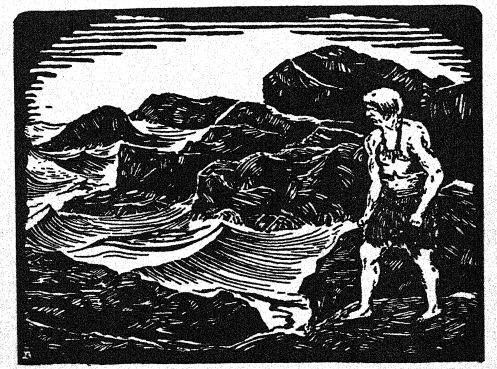
Il n’a fallu que peu de temps, bien sûr, pour que la fabrication de fétiches devienne une profession sacrée. Pour [ p. 38 ] une raison ou une autre, certains individus en sont venus à être considérés comme les fabricants des fétiches les plus puissants. Ils les fabriquaient non seulement pour leurs membres individuels, mais aussi pour la tribu dans son ensemble. Et c’est ainsi que même dans les pays où le chamanisme était inconnu, le saint homme professionnel, le prêtre, a fait son apparition. Il était incontournable. . » .
¶ 5
Les fétiches tribaux, comme les fétiches privés, étaient à l’origine des objets naturels : par exemple, des rochers d’une couleur particulière ou des arbres d’une forme étrange. La pierre de la Kaaba, encore vénérée par les musulmans de La Mecque, était à l’origine un fétiche tribal de ce type. Plus tard, cependant, ces fétiches tribaux furent également fabriqués. Le rocher ou le tronc d’arbre était sculpté de manière significative par le fabricant du fétiche et devenait une idole. Il est impossible de dire précisément où s’arrête le fétichisme et où commence l’idolâtrie. L’un se transforme en l’autre à mesure que l’enfant grandit.
Au début, l’idole servait probablement uniquement d’épouvantail pour chasser les mauvais esprits. Plus tard, cependant, elle fut sculptée de manière à avoir une apparence moins effrayante et fut utilisée à d’autres fins. Plus encore que pour effrayer les mauvais esprits, elle servait désormais à attirer les bons esprits. L’idole était enduite de sang ou d’huile, dans l’espoir qu’un bon esprit vienne lécher l’appât odorant – et peut-être y demeure. Puis, périodiquement, les enduits étaient renouvelés afin de retenir le bon esprit. Ils furent renouvelés à maintes reprises, jusqu’à ce que la pratique devienne un rite permanent. Après cela, au lieu de simples enduits de sang, [ p. 39 ] des carcasses entières étaient offertes au bon esprit logé dans l’idole. Et ainsi commença le sacrifice…
On apporta la nourriture, la plus rare et la plus riche possible, et le prêtre l’offrit cérémonieusement à l’esprit résidant dans l’idole. Comme pour un chef redoutable, on l’offrit avec de nombreuses révérences, des grattages et des chants cérémoniels. Et aussi avec de nombreuses louanges, car l’esprit était considéré comme vaniteux autant qu’affamé. Ainsi naquit la prière…
Avec le temps, un abri fut jugé nécessaire pour l’idole : d’abord une fente dans un rocher ou un arbre ombragé, puis une hutte rudimentaire. C’est ainsi que la première église fut construite.

Tout cela s’inscrivait dans un processus de développement des plus naturels. Une fois que l’homme s’était mis en tête que pour vivre, il devait maîtriser son univers, alors l’animisme, le fétichisme, l’idolâtrie, les intrigues sacerdotales, le sacrifice, la prière et l’Église – tout [ p. 40 ] cela était presque inévitable. L’homme primitif, noyé par la peur, s’accrochait désespérément aux esprits, comme un homme se noyant dans un ruisseau s’agrippe aux roseaux de la berge. Bien sûr, les esprits l’abandonnèrent l’un après l’autre – comme les roseaux se brisent entre les mains d’un homme qui se noie. Mais le sauvage continuait de s’accrocher aux esprits. C’était presque instinctif chez lui. Il ne pouvait s’en empêcher…
¶ 6
Mais le sauvage n’imaginait nullement qu’il fût prudent de s’agripper à chaque roseau qui bordait son lac de peur. Au contraire, il considérait la plupart d’entre eux comme extrêmement dangereux, et il s’efforçait, avec une prudence presque panique, de les éviter. Ces esprits maléfiques étaient ce que les sauvages de l’archipel malais appellent encore tabous, « marqués ». Une sorte d’électricité diabolique était censée régner en eux, de sorte que, si on les touchait, ils mutilaient, voire tuaient.
Toutes sortes d’objets et d’actions étaient considérés comme tabous : certains parce qu’ils étaient très saints, d’autres parce qu’ils étaient très démoniaques. Habituellement, le nom du dieu était tabou, et par conséquent, il n’osait être prononcé qu’à certains moments sacrés par des hommes officiellement saints. (Cette superstition primitive est toujours présente sur les lèvres de l’homme, l’empêchant de prononcer le nom de Dieu dans la conversation ordinaire.) La chair de certains animaux sacrés ou particulièrement impurs était considérée comme taboue, et ne pouvait donc pas être consommée. (Cette superstition primitive est responsable de l’aversion pour le porc qui caractérisait les anciens Égyptiens, et qui caractérise encore les Juifs et les Musulmans.) Se marier avec un proche parent, toucher un cadavre, tuer un membre de sa tribu, porter des vêtements de laine et de coton mélangés, voler la femme [ p. 41 ] d’un membre de sa tribu, allumer un feu un jour saint, maudire quelqu’un… Se découvrir le visage de son propre père, se découvrir la tête devant une idole – tous ces actes et des myriades d’autres, certains socialement criminels, la plupart socialement dénués de sens – étaient considérés comme tabous dans une religion ou une autre. Leurs contraires étaient parfois même tabous.
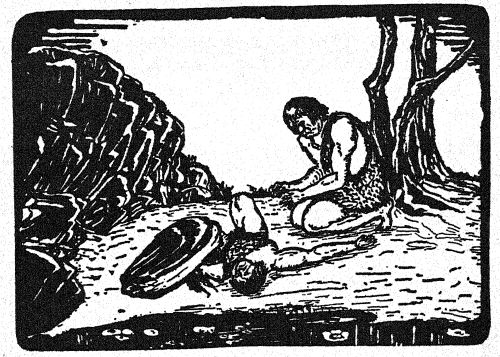
Certains tabous étaient temporaires, comme celui qui stigmatisait une femme comme contaminée pendant la durée de ses règles. D’autres étaient permanents, comme celui qui interdisait à un homme coupable d’avoir accidentellement tué un membre de sa tribu. Dans certains cas, les tribus elles-mêmes étaient tenues de punir le transgresseur ; dans d’autres, le châtiment était censé être infligé de manière magique par les esprits violés directement. La transgression de certains tabous entraînait [ p. 42 ] un désastre pour tous les membres de la tribu à laquelle appartenait le transgresseur ; dans d’autres cas, le châtiment était limité au transgresseur seul. Dans certains cas, le châtiment pouvait être évité par une pénitence et une purification élaborées de la part du transgresseur ; dans d’autres cas, la mort immédiate était inévitable. Les variantes étaient innombrables…
Aujourd’hui encore, la plupart des gens sont inhibés par les tabous. Superstitieusement, ils redoutent toutes sortes de petites choses futiles. Ils refusent de s’asseoir à treize à une table, de passer sous une échelle ou d’allumer trois cigarettes avec une seule allumette. Ils paniquent si un miroir se brise chez eux ou si un chat noir croise leur chemin ; et ils redoutent de parler de leur bonne santé sans « toucher du bois » ou marmonner « Unbeschrieen ». Il arrive que des personnes par ailleurs très intelligentes soient terrifiées par l’un ou l’autre de ces tabous stupides. Il n’est donc pas étonnant que le sauvage se soit laissé envahir par les tabous. Pauvre enfant qu’il était, toute sa vie s’est transformée en une lutte incessante et frénétique pour se tenir à l’écart de tout ce qui était « marqué ».