Des années, des siècles, des millénaires passèrent, et l’homme et sa pensée progressèrent, hésitants. Le sauvage changea de mode de vie, passant de celui d’un chasseur solitaire errant dans la jungle à celui d’un berger appartenant à une tribu. Et ses risques évoluèrent en conséquence. Il ne devait plus seulement se soucier de lui-même : il devait aussi penser à ses compatriotes et aux troupeaux dont lui et ses compatriotes vivaient. Cela impliquait un intérêt croissant pour les puits [ p. 43 ] où les troupeaux pouvaient être abreuvés, et pour le soleil, la lune et le ciel qui semblaient contrôler la pluie. Ainsi, un processus de sélection et d’élimination s’opéra parmi les esprits qu’il vénérait. Certains d’entre eux (par exemple, les esprits du soleil, du ciel et des sources du désert) ont atteint une place d’importance suprême, tandis que d’autres (comme les esprits de la flèche et du tigre de la jungle) sont tombés dans l’oubli et ont même été oubliés avec le temps.
Ce processus s’est bien sûr considérablement accéléré lorsque l’homme a opéré sa prochaine grande transformation : de berger à cultivateur. Sa dépendance aux éléments s’est alors complètement raffermie, et les esprits qui y résidaient sont devenus ses divinités suprêmes. En tant que berger, il était encore un peu indépendant, car il pouvait déplacer ses troupeaux pour capter la pluie. Mais cela lui était difficilement possible désormais, car il avait des champs et plus de troupeaux. Il devait donc attendre patiemment que la pluie le rattrape. Ou alors, il devait tenter de la forcer à le faire.
Au début, il essaya littéralement de forcer la pluie à venir sur lui et ses champs. Avec l’aide de son chaman ou de ses fétiches, il recourut à toutes sortes de pratiques magiques. Mais plus tard, lorsqu’il comprit que même avec son chaman ou ses fétiches il ne pourrait pas forcer la pluie à tomber, il tenta plutôt de la cajoler. Et ce n’est que lorsque cela se produisit que la religion commença véritablement. Tant que l’homme était encore assez naïf pour croire que, par la possession d’un fétiche ou l’énonciation d’un sort, il pouvait contraindre les esprits à obéir à sa volonté, il n’avait pas encore dépassé la foi absolue en la magie. Ce n’est que lorsque les coups durs d’échecs répétés [ p. 44 ] le rendirent plus humble et plus sage qu’il commença à croire en ce que l’on peut appeler strictement la religion. Ce n’est que lorsqu’il fut suffisamment grand pour soupçonner que certaines tentatives de contraindre les esprits étaient vouées à l’échec qu’il commença à essayer de les persuader.
Bien sûr, la religion n’a jamais complètement supplanté la magie. L’homme n’a jamais pu se résoudre à abandonner toute sa foi en l’ancienne technique, et à ce jour, aucune religion historique sur terre n’est exempte de ses altérations magiques. Dans toutes subsistent au moins les vestiges d’anciens rites coercitifs ; et dans toutes existent des prières initialement persuasives qui ont depuis pris le caractère de formules coercitives. La croyance, par exemple, que la substance entière d’un morceau de pain et d’une coupe de vin doit se transformer en corps et sang du Christ – cette croyance est manifestement la survivance d’un ancien rite magique. Ou encore la croyance qu’une prière n’est efficace que si elle est prononcée en un certain lieu, à un certain moment, dans une certaine langue et par une certaine personne, ou est particulièrement efficace si elle se termine par les mots « Nous le demandons au nom de Jésus » ou une formule similaire – une telle croyance révèle de toute évidence la dégénérescence d’une simple requête religieuse en simple formule magique.
Mais si la technique religieuse n’a jamais réussi à supplanter entièrement la technique magique, elle a réussi à la rendre secondaire. À mesure que la sagesse de l’homme s’accroissait, son assurance excessive le quittait, et il recourait de plus en plus à la persuasion pour obtenir des esprits qu’ils obéissent à ses désirs. En période de sécheresse, il offrait des sacrifices de nourriture et des psaumes de louange au soleil, à la lune et au ciel, ou à tout autre esprit qui, selon lui, pouvait exercer un contrôle sur l’eau dont il avait besoin. (En Égypte, par exemple, les sacrifices étaient offerts [ p. 45 ] à l’esprit du Nil, car c’était entièrement de la crue annuelle de ce fleuve que le peuple dépendait pour l’arrosage de ses terres.) Mais l’homme les offrait humblement. Le ton naïf et impératif avait disparu. L’homme avait grandi et avait appris qu’il ne pouvait aller bien loin avec la magie…
Dans l’ensemble, l’homme semblait s’accommoder assez bien de l’aide supposée provenir du sacrifice. Bien sûr, sous les climats défavorables, même les sacrifices se révélaient inutiles, et l’homme était alors contraint de rester nomade. Mais partout où le climat n’était pas trop rigoureux et d’une certaine régularité, les sacrifices semblaient admirablement efficaces. Nulle part, cependant, le climat n’était si doux et le sol si généreux que l’homme se sentît capable de se passer entièrement de sacrifices. Des sécheresses survenaient occasionnellement et les récoltes étaient mauvaises, même dans les régions les plus favorables. De ce fait, l’homme ne perdait jamais tout à fait sa crainte des esprits tyranniques, ni sa conviction qu’il fallait les courtiser sans cesse. Sa confiance en leur amitié se doublait toujours d’une vive crainte de leur inconstance. En effet, sa confiance en eux n’était pas plus solide que celle du pickpocket envers le policier qu’il venait de corrompre. Le cultivateur primitif ne faisait aucun geste sans avoir d’abord jeté un regard furtif pour vérifier si les « pouvoirs » étaient toujours bien disposés à son égard. Il n’avait jamais vraiment compris que son dur labeur suffisait à lui seul à faire prospérer la terre. Non, il imaginait que les esprits intervenaient invariablement, et il ne se lançait jamais dans la culture du sol sans s’y être d’abord arrêté. Pour lui, l’agriculture relevait davantage de la religion que de la science…
[ p. 46 ]
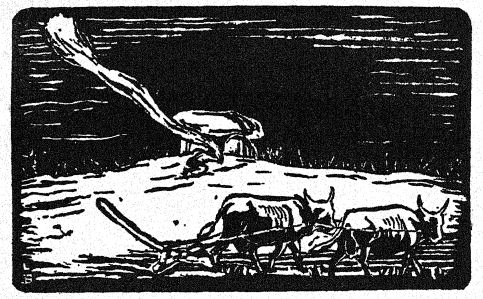
¶ 2
Il était tout naturel pour l’homme, le fermier, de se soucier particulièrement des esprits à certaines saisons de l’année. Le printemps, lors des semailles ; l’été, lors de la cueillette des premiers fruits ; et l’automne, lors de la récolte des récoltes ; ces périodes étaient d’une importance religieuse extraordinaire. C’est alors que le fermier primitif sentit qu’il devait déployer tous ses efforts pour persuader les « puissances » de lui être favorables. Ainsi naquirent les fêtes saisonnières…
Le rituel de ces fêtes était d’abord d’une obscénité presque impossible à décrire. Le sauvage imaginait que les esprits faisaient pousser les récoltes comme lui-même faisait naître les enfants. Et, de peur que les esprits n’oublient le processus de reproduction ou ne soient trop timides pour l’initier, il allait lui-même dans les champs et montrait la voie. La licence sexuelle était donc une vertu [ p. 47 ] religieuse lors de la plupart des fêtes saisonnières. Soit tous les hommes et toutes les femmes sortaient dehors et se couchaient ensemble sous les cieux, soit, dans les communautés plus avancées, le prêtre et une ou plusieurs vierges entraient au temple et se couchaient ensemble devant les idoles…
Mais le rituel de ces fêtes ne se résumait pas à des orgies sexuelles. Il incluait généralement des offrandes sacrificielles, humaines, animales ou céréalières. Au début, ces offrandes étaient assez rudimentaires et directes. Les sacrifices au dieu de l’eau étaient simplement jetés dans les ruisseaux, ceux au dieu de la terre étaient enterrés dans le sol, tandis que ceux au dieu du ciel étaient brûlés sur des autels afin que la fumée s’élève et chatouille les narines du divin. Mais au fil du temps, ces pratiques simples se sont avérées parfois inefficaces, et pour y remédier, des complications ont été inventées. Tel tendon, par exemple, était retiré de la carcasse sacrificielle, ou tel organe était exposé ; le sang était drainé et aspergé de tel côté de l’autel ; des prières étaient récitées à tel moment de la cérémonie. … L’étiquette à respecter pour approcher les dieux devint si complexe, en effet, qu’avec le temps, il devint impossible à l’homme ordinaire de la maîtriser. Il dut faire appel à un spécialiste du code rituel, un sacrificateur professionnel, pour lui offrir ses offrandes. De même que les hommes étaient autrefois contraints de faire appel à un chaman ou à un féticheur pour accomplir leurs rites magiques, ils devaient désormais faire appel à un prêtre pour accomplir leurs devoirs religieux. C’est ainsi que la prêtrise atteignit son apogée.

La même logique qui a conduit aux festivals saisonniers tout au long de l’année a également conduit à des cérémonies périodiques au cours de la vie de l’individu. On estimait qu’à la naissance, [ p. 48 ] quelque chose était nécessaire pour gagner la faveur du nouveau venu et, à cette fin, un sacrifice d’une sorte ou d’une autre était généralement offert. (Il est possible que la communauté en Afrique, en Australie, en Polynésie, ainsi que dans d’autres pays, ait été à l’origine un tel sacrifice.) Cependant, lorsque les penchants sexuels se sont manifestés pour la première fois, on a estimé qu’il fallait faire quelque chose de plus pour s’assurer la faveur des esprits. Des cérémonies d’initiation élaborées étaient organisées, et les jeunes étaient généralement soumis à d’horribles épreuves pour prouver qu’ils méritaient à la fois d’appartenir à la tribu et d’être protégés des dieux tribaux. (La confirmation chez les chrétiens et la Bar Mitzvah chez les juifs sont en réalité des survivances de ces anciennes initiations.) Ensuite, au mariage, on estimait bon d’invoquer la bénédiction des esprits. Après tout, le mariage avait pour but premier la procréation, et l’on croyait que, si les esprits n’étaient pas convenablement apaisés au préalable, ce but premier pourrait être contrecarré. (C’est pourquoi certaines personnes considèrent encore la vie conjugale comme inconvenante, sauf si elle était rituellement [ p. 49 ] consacrée par un ministre ou un prêtre.) . . . Et enfin, au moment de la mort, on considérait comme terriblement dangereux de porter ombrage aux esprits. Dans de nombreux endroits, les rites funéraires sont devenus incroyablement élaborés, donnant naissance – par exemple, en Égypte et en Chine – à des systèmes religieux entiers. . . .
Et ainsi naquirent les sacrements. . . .
¶ 3
Nous arrivons enfin à la création des grands dieux. De même que le chef de tribu devint roi, le fétiche tribal devint dieu. Ce fut une évolution naturelle. L’esprit sauvage, autrefois considéré comme résidant dans un arbre ou une colline, fut d’abord conjuré en un fétiche portatif, afin que les tribus nomades puissent bénéficier de sa protection où qu’elles se déplacent. (Les lecteurs de la Bible se souviendront comment l’esprit de Jéhovah – ou plus exactement, Yahvé – résidant au mont Sinaï fut transféré dans une « arche » portative que les Hébreux primitifs emportaient avec eux lors de leurs pérégrinations.) Plus tard, lorsque ces bergers nomades s’installèrent et devinrent agriculteurs, leur esprit nomade s’installa parfois avec eux. (L’ancienne « arche » des Hébreux bédouins trouva finalement refuge dans le temple de Jérusalem.) Cependant, cela ne se produisit pas toujours, car le taux de mortalité des divinités était extrêmement élevé pendant la période de transition entre la vie pastorale et la vie agricole. Et même les esprits qui parvinrent à survivre en sortirent complètement transformés. Leurs fonctions étaient désormais nouvelles, et souvent leurs noms aussi. Seuls quelques atavismes révélateurs subsistaient dans le rituel, trahissant leur origine nomade.
[ p. 50 ]
Mais même la vie des divinités survivant à cette grande transition demeurait précaire. En effet, leur taux de mortalité augmenta alors. Car des changements plus importants que jamais auparavant se produisirent parmi les hommes, et par conséquent, des changements plus importants encore durent s’opérer parmi les dieux. Les tribus fusionnèrent. La résistance aux invasions, ou la construction de barrages d’irrigation, contraignit de nombreux clans à fusionner, et leurs coutumes, mythes et dieux durent également fusionner. Des dieux apparurent, manifestement composites, aux noms et rituels composites. Et à mesure que la population augmentait, et que certains villages devenaient des villes, des cités-États, des nations, puis des empires, la juridiction de ces dieux composites s’étendit également. Ils commencèrent à absorber les petits dieux des terres tributaires, devenant ainsi, avec le temps, les seigneurs quasi incontestés de millions de fidèles.
Il fallut encore de nombreux siècles avant que quiconque puisse imaginer une divinité qui fût le Dieu Unique de l’Univers. Les hommes continuèrent d’être polythéistes, croyant en de multiples dieux. Ils pouvaient ne rendre hommage qu’à un seul, celui de leur tribu. Ils pouvaient le considérer comme le dieu le plus puissant de tous et se le représenter, à l’image des hindous dans leurs idoles grotesques, avec des bras qui s’étendaient partout et des yeux qui voyaient tout. Mais ils ne nièrent jamais l’existence d’autres dieux entretenant des relations similaires avec d’autres tribus.
Il est significatif, cependant, que même le dieu le plus puissant ne puisse semer autant de terreur dans le cœur de l’homme civilisé que l’idole la plus grossière dans celui du sauvage. Le temps avait mis à rude épreuve la peur. L’homme était encore loin de maîtriser son univers, mais au moins il montrait des signes d’une aptitude à le maîtriser. En conséquence, les « puissances » [ p. 51 ] de l’univers devinrent moins terrifiantes. L’homme commença à les considérer comme ses alliés et ses partenaires, et s’il les exaltait extravagamment, c’était surtout pour se glorifier lui-même. Les dieux des nations devinrent simplement les chefs divins des nations, les rois célestes…
¶ 4
L’idée que les dieux étaient des rois célestes avait au moins une implication d’une importance capitale. Les rois terrestres étaient naturellement censés veiller à l’application des lois de la nation. Leur tâche consistait à détecter les crimes et à punir les criminels. Mais il arrivait toujours que des crimes passent inaperçus, et que des criminels échappent à la justice. C’était particulièrement vrai dans les villes nouvellement peuplées, où la surveillance policière par le voisinage était devenue impossible. Dans ces nouvelles capitales, avec leurs populations grouillantes, denses et turbulentes, la moralité semblait n’avoir aucune chance. Les tabous, jusque-là strictement respectés au sein du petit clan compact, furent transgressés dans les villes presque impunément. Pendant un temps, l’effondrement de la société sembla inévitable.
[ p. 52 ]
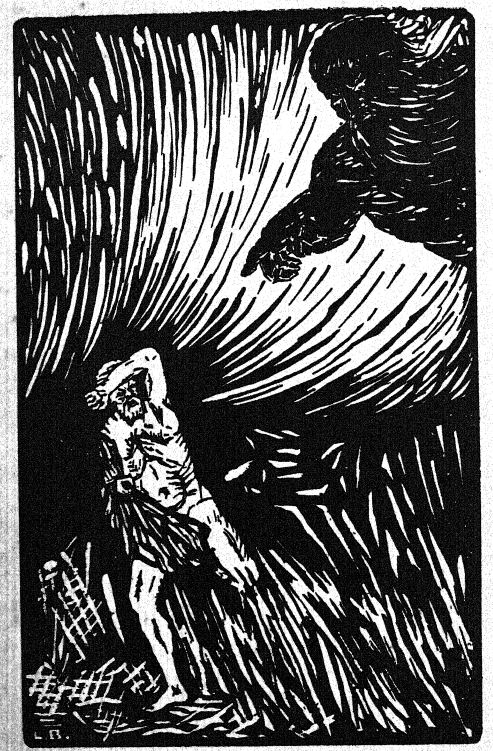
Mais l’idée que les dieux étaient des rois célestes sauva la situation. Par analogie, on en déduisit que, de même que les rois terrestres punissaient les crimes détectables, les rois célestes punissaient ceux qui étaient indétectables. Il n’y avait donc aucune chance d’échapper à la justice en fin de compte. Ni la force ni la ruse ne servaient à rien, car même si l’on échappait au jugement du roi terrestre, il en restait un autre, l’inévitable et inexorable jugement du dieu, qui restait à affronter. Le dieu du ciel [ p. 53 ] voyait tout et savait tout. Il n’existait ni tabou ni loi, mais il se préoccupait de leur application. (En effet, il était l’auteur même de tous les tabous et de toutes les lois – du moins, c’est ce qu’on a vite dit.) Le transgresseur n’avait donc aucune chance – il ne pouvait jamais échapper.
Ainsi naquit l’idée du péché. Le crime, qui était en réalité une offense à la société, fut considéré principalement comme un péché contre Dieu. Et comme souvent personne ne pouvait identifier le châtiment infligé par Dieu au coupable, l’idée de la conscience apparut. Dieu, croyait-on, punissait les méchants en secret, envoyant en eux des esprits maléfiques pour ronger leurs âmes et les empêcher de trouver le repos. Et lorsqu’on constata que nombre de ces méchants semblaient parfaitement insensibles à leur mauvaise conscience, parfaitement insensibles aux châtiments secrets, l’idée de souffrances futures fut avancée. On prétendait que, même si certains s’en sortaient indemnes en ce monde, ils seraient loin d’avoir autant de chance dans l’autre. Non, vraiment ! Après la mort, ils recevraient même plus que leur juste dû, rôtis dans les flammes – selon les habitants des terres torrides – ou gelés sur la banquise – selon les habitants des régions arctiques.
Le processus évolutif qui a donné naissance à ces idées de péché, de conscience et de châtiment post-mortem était, certes, loin d’être aussi simple qu’on le décrit ici. Pendant des siècles, l’homme a tâtonné pour s’emparer de ces idées, s’égarant dans les erreurs les plus pathétiques et ne s’en remettant qu’au prix d’une douleur atroce. Mais finalement, la grande tâche fut accomplie et la moralité, au prix d’une religiosité, fut préservée.
[ p. 54 ]
Le prix à payer était considérable. La religion s’est révélée, avec le temps, un conservateur bien trop efficace. Elle a abrité trop largement et sans discernement, alimentant non seulement la morale nécessaire à la vie en société, mais aussi chaque parcelle de rituel ancien et de tabou sauvage. La religion a développé une tendance à s’accrocher à tout avec la même ténacité, ne laissant aucune différence entre le moindre rite et la loi la plus grave. Ou, si elle admettait une différence, son verdict était généralement en faveur du rite. Les prêtres enseignants avaient tendance à dire au peuple que le rituel, le traitement juste réservé aux dieux, était nettement plus important que l’éthique, le traitement juste réservé aux simples hommes. Plus préjudiciable encore, ils enseignaient souvent que toutes les offenses, tant au rite qu’au droit, ne pouvaient être expiées que d’une seule manière : par le sacrifice. La justice, déclaraient-ils, pouvait toujours être tempérée, et le coupable pourrait peut-être même s’en tirer à bon compte, si seulement suffisamment de béliers et de bêtes grasses étaient offerts au juge céleste…
Cet enseignement, bien sûr, s’est révélé avec le temps un obstacle majeur sur le chemin de la civilisation. En effet, toute l’histoire de la religion parmi les peuples civilisés est, dans une certaine mesure, l’histoire de la lutte pour surmonter cet obstacle. C’est essentiellement l’histoire d’un prophète en guerre contre un prêtre ; de celui qui voulait moraliser la religion aux prises avec celui qui avait ritualisé la morale.
¶ 5
Mais si la religion a pu exiger un prix élevé pour sauver la moralité, elle l’a néanmoins sauvée. C’est une chose que beaucoup ont tendance à oublier. Ils ont l’habitude de ne s’attarder que sur les maux, [ p. 55 ] les contretemps et les frustrations que certaines formes de religion ont apportés à la civilisation par la suite. Mais il est bon de se rappeler que, sans la religion et sa foi sous-jacente dans la maîtrise de l’univers et de ses « puissances » déchues, il n’y aurait pas eu de civilisation à contrecarrer. La civilisation n’est qu’un autre nom pour la victoire croissante de l’homme sur la peur – et les premières phases de cette victoire ont été obtenues presque exclusivement par la religion. La religion a été le levier par lequel l’homme s’est extirpé de la sauvagerie. Ou, pour reprendre une métaphore déjà utilisée, elle a été le banc de roseaux auquel l’homme s’est accroché aussi souvent que les eaux sombres de la peur menaçaient de le submerger. Dans un sens très réel, c’était son salut.
C’était aussi le salut de la société. Non seulement la religion permettait à un homme de vivre seul, mais plus encore à deux hommes de vivre ensemble. Même les débuts de la société auraient été rendus impossibles par la simple peur innée des morts – et encore moins des vivants – si la religion n’avait pas acquis une grande importance dans le monde. À la vue de la mort, la réaction naturelle du sauvage était la fuite. Instinctivement, il voulait brûler tout le village où gisait le cadavre, et s’enfuir ! Et au début, il suivit probablement cet instinct, et pendant des siècles, aucun campement ne dura plus de quelques semaines ou quelques mois… Mais alors naquit l’idée des rites funéraires pour apaiser les esprits des morts, des rites religieux qui enracinaient fermement les survivants au lieu où les morts étaient enterrés. La religion trouva le moyen de dépouiller la mort d’un peu de son effroyable horreur. Des villages furent désormais créés autour des tombes, au lieu d’être incendiés [ p. 56 ] sur elles. L’homme, autrefois si terrifié par les fantômes qu’il fuyait au moindre soupçon de leur présence, osait désormais s’approcher d’eux et implorer leur aide. Le culte des ancêtres naquit. La solidarité des tribus reposait souvent sur le seul lien d’une prétendue descendance d’un ancêtre commun. À défaut, le lien qui les unissait était un rituel commun. Les cérémonies de naissance, de puberté, de mariage et de décès unissaient les membres de ces clans en un groupe compact. Il en était de même pour les fêtes annuelles. Et ainsi, par et avec la religion, la cohabitation des hommes fut rendue possible.
Plus encore : grâce à la religion, la cohabitation des hommes est devenue non seulement possible, mais aussi désirable. La religion a habillé et orné la froide nudité de l’existence primitive de lambeaux et de parcelles de beauté. Toute cette grâce et cette couleur qui transmuent la simple existence en Vie – en un mot, tout l’Art – peuvent véritablement être considérées comme issues de la religion. La sculpture trouve son origine dans la fabrication d’idoles, l’architecture dans la construction de temples, la poésie dans l’écriture de prières, la musique dans le chant des psaumes, le théâtre dans le récit de légendes et la danse dans le culte saisonnier des dieux…
Il peut nous paraître incroyablement grossier, cet amas de terreurs et d’espoirs, d’emprises et de tâtonnements, de stupidités et d’aspirations, que, faute d’un meilleur nom, nous appelons Religion Primitive. Mais malgré tout, elle était sacrée, car elle a sauvé l’humanité…