[ p. 57 ]
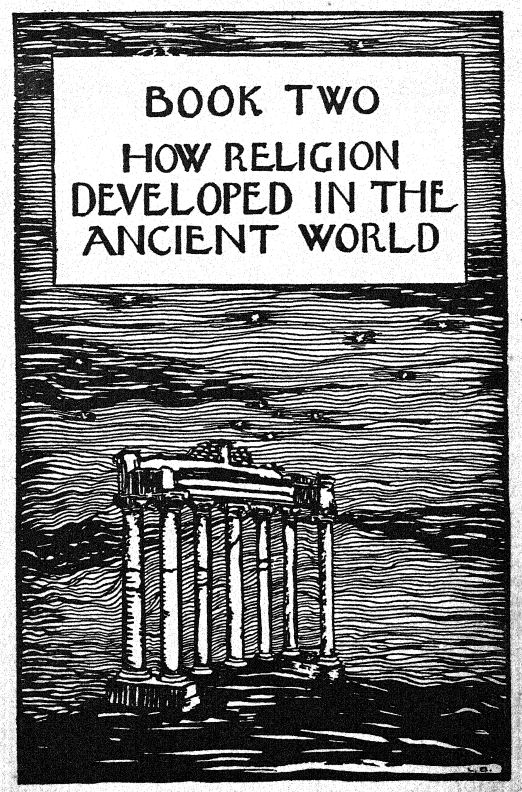
[ p. 58 ]
¶ LIVRE DEUX — COMMENT LA RELIGION S’EST DÉVELOPPÉE DANS LE MONDE ANTIQUE
I. Les Celtes
1 : Les dieux primitifs — Les druides — Le culte du gui. 2 : Les fêtes — Les grands holocaustes — Beltane — Lugnasad — Samhain — Le culte des fantômes.
II. Les Babyloniens
1 : Les déesses sémitiques — comment les dieux babyloniens sont apparus — les trinités. 2 : Ishtar et les rites sexuels — la prostitution sacrée — l’astrologie. 3 : Le sacerdoce — ses vices — et ses vertus. 4 : Les défauts de la religion — le polydémonisme — une morale ritualisée — le Shabatum et la mythologie — contrastent avec les versions hébraïques de celle-ci — la peur.
III. Les Égyptiens
1 : Le culte animal originel — la croissance des dieux — les prêtres, 2 : L’idée du monothéisme émerge. 3 : La réforme sous Ikhnaton — la réaction. 4 : La religion des masses — Osiris — la vie future — pourquoi les pyramides ont été construites. 5 : Les morts — le Jour du Jugement — le recours à la magie.
IV. Les Grecs
1 : La religion minoenne — comment les dieux grecs sont apparus — le culte olympien. 2 : L’échec du culte olympien — les érudits se tournent vers la philosophie. 3 : Les masses se tournent vers la magie — et les « mystères » — l’idée du dieu sauveur — comment les hommes ont essayé de devenir divins. 4 : Le désir d’une vie future — et comment les mystères l’ont satisfait.
V. Les Romains
1 : Le culte originel des esprits domestiques — la religion d’État naît — et s’intensifie. 2 : Pourquoi la religion d’État a échoué — l’avènement des mystères — Cybèle — Attis — les autres cultes étrangers. 3 : Auguste restaure la religion d’État — le Godemperor — la réaction — les Cyniques. 4 : Pourquoi la Rome décadente s’est tournée vers les mystères — Mithra — sa signification. 5 : Conclusion — Pourquoi ces cultes antiques ne peuvent pas être qualifiés de « morts » — la signification de leur attrait surnaturel.
[ p. 59 ]
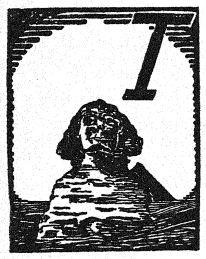
L’histoire des débuts de la religion a été rendue excessivement concise et simple dans le livre qui vient d’être fermé. Les éléments fondamentaux ont été traités de manière très succincte, et de nombreux aspects importants ont été à peine abordés. Mais dans un livre aussi concis, il était impossible de faire autrement. Entrer dans une religion primitive avec un minimum de détails, donner ne serait-ce que les grandes lignes des multiples variantes de chaque croyance et pratique selon les races, aurait nécessité non pas une vingtaine de pages, mais une étagère entière de lourds volumes. Tout ce qui était possible ici était d’esquisser l’intrigue principale, une esquisse rapide de la ligne directrice suivie par la religion au cours de son évolution à travers les siècles préhistoriques.
Malheureusement, ce résumé semble donné avec une assurance absolue. Malgré tous les « peut-être » et « probablement » disséminés dans le récit, on a l’impression que l’auteur savait avec certitude ce qui s’était passé. En réalité, il n’en sait rien. Tout ce qu’il sait, c’est ce que de nombreux anthropologues érudits, après de longues recherches minutieuses, ont supposé être la vérité. [ p. 60 ] Bien sûr, leurs suppositions ont peut-être été très mauvaises. Leur théorie sous-jacente est peut-être totalement erronée, et la religion, au lieu d’avoir été créée à l’origine pour échapper à la peur ou la vaincre, est peut-être apparue tout à fait indépendamment d’elle. La religion est peut-être un instinct primordial chez l’espèce humaine – quelque chose d’aussi ancien, fondamental et inné que la peur elle-même. Qui sait ?…
Cependant, aborder cette question ne ferait qu’ajouter à la confusion d’une histoire déjà bien trop confuse. De nombreuses hypothèses ont été émises quant à l’origine de la religion, mais ce petit livre ne laissait de place qu’à une seule d’entre elles : celle qui semble (à l’auteur) la plus plausible. Et cela étant dit, il faut se hâter…
Heureusement pour nous, le développement de la religion est loin d’être aussi entaché de doutes que ses débuts. Il existe des récits assez détaillés de nombreux cultes anciens, et à partir de ceux-ci, nous pouvons tracer une ligne de progression presque claire. De l’animisme des Celtes barbares jusqu’aux Mystères des derniers Romains, nous pouvons suivre presque pas à pas la lente progression de la religion primitive.
¶ I. LES CELTES
Il n’y a aucune raison particulière de commencer notre étude de la religion antique par les Celtes, si ce n’est que les archives de leurs rites et croyances nous sont parvenues avec une ampleur relative. Il y a deux mille ans, les Celtes n’étaient qu’un membre d’une horde de peuples aryens tout juste sortis de la nuit de la sauvagerie pour entrer dans cette aube agitée que nous appelons la barbarie. Leur religion, [ p. 61 ], n’était donc encore qu’un geste pathétique, oscillant entre les griffes courageuses mais insensées du sauvage et l’effort doux mais plein d’espoir de l’homme civilisé. Il ne s’agissait pas uniquement d’une dépendance aux rites magiques, car les Celtes avaient déjà découvert que la magie seule ne suffisait pas. Ils étaient déjà suffisamment avancés pour savoir que les « puissances » contrôlant l’univers, les esprits censés résider dans les arbres, les pierres et autres objets naturels, pouvaient souvent être influencés bien plus efficacement par la pétition que par la coercition. Pourtant, ils ne fondaient pas non plus toute leur foi sur la pétition. Leurs prêtres étaient encore des chamans clandestins, et leurs sacrifices étaient, au moins implicitement, des sorts semi-coercitifs. Le mot « cajolerie » décrit peut-être le mieux la technique par laquelle les Celtes cherchaient à conquérir leurs divinités.
Ils avaient de nombreuses divinités à conquérir, car tout objet naturel d’une quelconque beauté leur semblait contenir un esprit à invoquer. Certains de ces esprits étaient déjà suffisamment détachés de leurs corps physiques pour être considérés comme des dieux et des déesses lointains. Des noms leur avaient été donnés – Ogmius, Maponus, Brigitte, etc. – et des mythologies entières avaient été tissées autour d’eux. Un rituel sacrificiel s’était développé et une classe sacerdotale s’était établie. Il semble cependant qu’il n’y ait pas eu de temples, mais seulement des cercles de piliers de pierre sans toit – Stonehenge, en Angleterre, est les ruines de l’un de ces cercles – et des bosquets d’arbres sacrés. Dans ces cercles et bosquets, les prêtres (appelés druides, « Sages ») offraient des sacrifices et jetaient des sorts à intervalles réguliers, et les prêtresses – dont le nombre semble être assez élevé – accomplissaient des rites d’une respectabilité pour le moins douteuse.
[ p. 62 ]
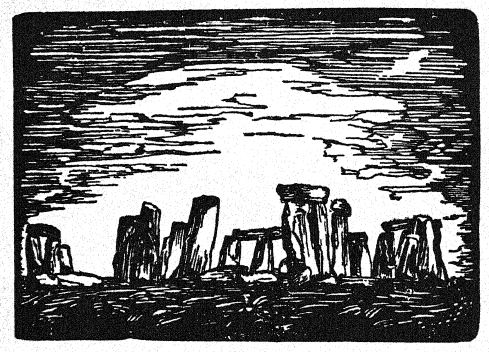
L’idolâtrie n’était pas très développée chez les Celtes, et leurs images des dieux étaient des rondins grossièrement sculptés ou simplement des armes. Leur principal objet cérémoniel était le gui, cette plante grimpante aux baies blanches qui a captivé l’imagination des peuples primitifs du monde entier. Sir James G. Frazer, dans l’ouvrage le plus fascinant de toute la littérature comparée des religions, Le Rameau d’Or, a tenté d’expliquer la vénération particulière attachée à cette plante. Il soutient que c’est parce que le gui n’a pas de racines dans la terre polluée, mais semble pousser comme par magie entre ciel et terre. Par cette pitoyable obsession pour les conclusions, qui est la seule logique de l’homme primitif, cette plante, suspendue au ciel, est donc considérée comme dotée de propriétés magiques. Partout où le [ p. 63 ] Les druides la découvrirent poussant sur un chêne. Ils s’en approchèrent avec une grande crainte et une pompe cérémonielle et la coupèrent avec une faucille d’or. Ils prenaient un soin extrême pour la récupérer avant qu’elle ne tombe à terre, puis l’utilisaient pour préparer une potion destinée à fertiliser les femmes et le bétail stériles, et pour guérir l’épilepsie, les ulcères, l’empoisonnement et presque toutes les autres maladies humaines.
¶ 2
Des fêtes régulières avaient lieu trois fois par an, et avec une splendeur particulière une fois tous les cinq ans. Il s’agissait principalement de fêtes du feu, destinées à inciter les esprits à fertiliser le sol. Jules César nous a légué la plus ancienne description de ces horribles fêtes quinquennales, où des dizaines de criminels – c’est-à-dire des personnes ayant transgressé des tabous –, des prisonniers de guerre et des animaux étaient parqués dans d’immenses statues en osier, puis brûlés vifs avec cérémonie. On imaginait que plus le nombre de victimes était élevé, plus la fertilité des terres serait grande, et autrefois, toute l’Europe du Nord empestait l’odeur de ces holocaustes. À l’origine, les fêtes annuelles ordinaires étaient aussi des scènes sanglantes de sacrifices humains ; mais à l’époque historique, elles avaient été débarrassées de ce facteur sauvage. Cependant, le feu jouait encore un rôle important dans le déroulement de ces fêtes, et leur but évident restait la fructification magique de la terre. La veille du 1er mai, lors de la fête de Beltane, les Celtes allumaient des feux de joie en bois de chêne sous des arbres ou des poteaux sacrés. Un « roi » et une « reine » étaient choisis pour conduire les processions dans [ p. 64 ] les champs. Pendant des heures, on entendit un flamboiement insensé de brandons tirés des feux, ainsi que des tourbillons et des danses sauvages, dans une orgie festive. Hommes et femmes se couchaient ensemble dans les champs et se comportaient comme tous les autres peuples primitifs lors de leurs fêtes religieuses. Simples barbares, ils agissaient de bonne foi, pensant que cela suggérerait au soleil et aux autres dieux ce qu’ils devaient faire à leur tour : faire pousser les choses. Ce n’est qu’avec l’introduction de la morale chrétienne que les Celtes prirent conscience de la malveillance de leurs anciens rites. Et même alors, ils n’y renoncèrent pas immédiatement. En effet, leurs descendants ne les ont pas encore complètement abandonnés. Ils les ont simplement élagués, raffinés et christianisés pour en faire les danses du mât de mai, éminemment respectables – mais qui rappellent leur côté très coquin – des temps modernes.
Les deux autres fêtes celtiques de l’année étaient Lugnasad, célébrée le 1er août, et Samhain, célébrée le dernier jour d’octobre. Toutes deux étaient marquées par des rites similaires à ceux de Beltane et ont perduré jusqu’à nos jours : l’une, la nuit de la Saint-Jean et la Saint-Jean, l’autre, Halloween et la Toussaint. Samhain était la plus importante des deux, car, comme dans le calendrier chrétien, elle était considérée comme le jour où les âmes des morts se réunissaient avec les vivants. De la nourriture était disposée dans les huttes des Celtes et de joyeux feux étaient allumés dans les foyers, afin que les ombres affamées et tremblantes des morts puissent se préparer aux mois d’hiver qui venaient de naître.
Les Celtes s’intéressaient démesurément aux morts. Ils savaient peu de choses de l’autre monde, si ce n’est qu’il existait quelque part dans la mer de l’Ouest une « île douce et [ p. 65 ] bénie » réservée aux héros et aux demi-dieux ; néanmoins, ils nourrissaient une foi inébranlable en une vie après la mort, même pour les plus humbles membres de leur tribu. Ils imaginaient nerveusement les morts comme des ombres planant dans la pénombre, des spectres intangibles, capables pourtant de faire grand mal ou de faire grand bien. Peut-être leurs grandes fêtes du feu, ces horribles holocaustes d’hommes et de bêtes, n’étaient-elles que des efforts désespérés pour chasser les ombres les plus malveillantes. Car ces pauvres Celtes, sans cesse harcelés par les tempêtes, la sécheresse et la peste, s’étaient convaincus que les morts étaient, du moins en partie, les auteurs de tous les maux. Les morts et les esprits de la nature semblaient être les maîtres absolus de l’univers, et toute la vie des vivants semblait dépendre de leur mystérieuse faveur. C’est pourquoi les rites religieux jouaient un rôle si important dans la pensée et la conduite celtiques. C’étaient des rites primitifs, grossiers, maladroits, d’une naïveté presque absurde – mais il fallait les entretenir. De même qu’un malade, bien qu’il puisse rejeter un médicament après l’autre, ne peut jamais se résoudre à rejeter complètement les médecins, les anciens Gaulois et Bretons délaissaient souvent un sort pour un autre, mais n’osaient jamais abandonner les druides. Ils avaient peur… peur…