[ p. 117 ]
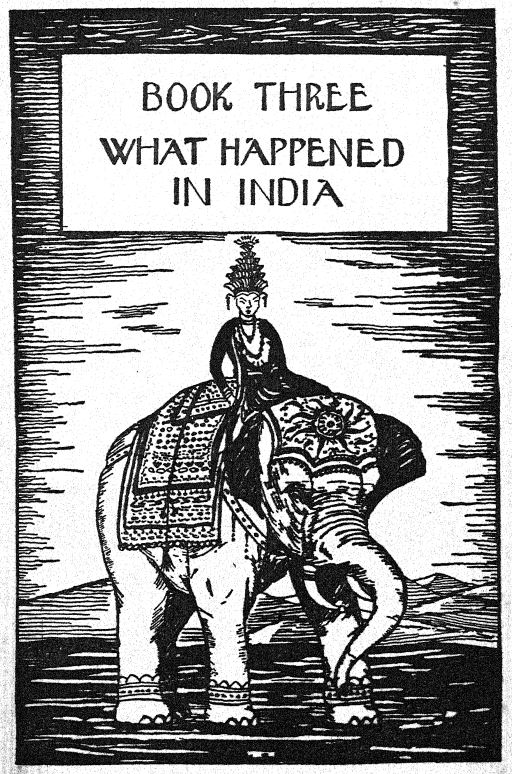
[ p. 118 ]
¶ LIVRE TROIS. — CE QUI S’EST PASSÉ EN INDE
I. Le brahmanisme
1 : Les dieux aryens primitifs — les Védas. 2 : Les Aryens migrent vers le Gange — la caste — les brahmanes. 3 : Les Upanishads — l’Âme Suprême — la transmigration — le Nirvana — l’essor de l’ascétisme*.
II. Le jaïnisme
1 : Mahavira — son évangile. 2 : Comment l’évangile de Mahavira a été corrompu — Le jaïnisme aujourd’hui.
III. Bouddhisme
1 : L’histoire de Gautama. 2 : Son évangile — ses implications — la loi du karma. 3 : Comment Gautama a répandu son évangile. 4 : Histoire ancienne du bouddhisme — déification de Bouddha — Asoka — le nouveau bouddhisme en Chine — Tibet — Japon — Inde — Ceylan.
IV. Hindouisme
1 : La religion dominante en Inde aujourd’hui — la caste — la trinité — la division dans l’hindouisme. 2 : Vishnu — les avatars — la Bhagavad-Gita — Krishna — la théologie dans le vishnouisme. 3 : Shiva — sa popularité — le Tantra — le sexe dans la religion. 4 : La philosophie hindoue — le yoga — l’extase mystique* 5 : La religion des classes inférieures.
[ p. 119 ]
¶ LIVRE TROIS — CE QUI S’EST PASSÉ EN INDE
I. LE BRAHMANISME
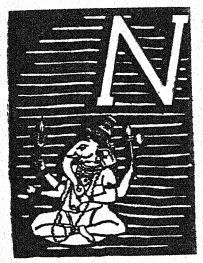
Personne ne peut l’affirmer avec certitude, mais il semble probable qu’avant l’arrivée du premier homme blanc en Inde, le pays était entièrement peuplé par un peuple au nez retroussé et à la peau noire. Par quels moyens ces sauvages noirs tentèrent-ils de composer avec l’univers, par quelles illusions cherchèrent-ils à rendre leur vie vivable ? Personne ne sait non plus, si ce n’est très vaguement, la nature de la religion indienne, même durant les premiers siècles suivant l’arrivée de l’homme blanc. Les premiers envahisseurs blancs de l’Inde appartenaient à ce que l’on appelle vaguement la race aryenne : la souche qui a également produit les Perses, les Grecs, les Romains, les Celtes et la plupart des autres peuples d’Europe. Il y a environ quatre ou cinq mille ans, ils franchirent les cols de l’Hindou Kouch et s’établirent dans la vallée fertile de l’Indus. C’étaient des guerriers et des bergers, un peuple simple et grossier qui semblait à peine moins sauvage que les hommes noirs qu’ils chassèrent avant eux. Leur religion reposait sur une crainte modérée de nombreux esprits, parmi lesquels se trouvaient « trente-trois [ p. 120 ] dieux » qu’on vénérait avec des offrandes de bière – on appelait soma – sur une étendue de paille. Il s’agissait donc d’une forme avancée d’animisme, un culte de la nature où les esprits les plus importants n’étaient plus considérés comme animant de simples bâtons ou pierres, mais plutôt de vastes phénomènes tels que le soleil et le ciel.
Le plus important de ces esprits était Indra, généralement représenté comme un vantard, glouton et ivrogne, combattant le vent et la pluie. Outre lui, plusieurs autres divinités étaient à prendre au sérieux : Dyaush Pitar (apparenté à Zeus Pater et à Jupiter), le dieu du ciel ; Asura, le « Sage Esprit du Ciel » ; Agni, le dieu du feu (son nom sanskrit est apparenté à notre mot anglais « Ignite ») ; Mithra, un dieu solaire (le lointain ancêtre, bien sûr, du dieu romain des mystères Mithra) ; Soma, le principe de l’ivresse devenu dieu ; et bien d’autres.
Certains de ces dieux, les envahisseurs aryens les ont dû apporter avec eux depuis leur berceau inconnu ; d’autres ont manifestement dû se développer dans leur nouveau foyer. La plupart, cependant, n’ont dû être vénérés que par des tribus isolées, car dès que ces tribus ont commencé à fusionner, nombre de ces dieux ont disparu. Dès les temps anciens, il semble y avoir eu dans l’Inde aryenne une tendance constante vers une synthèse, une fusion des dieux.
Au début, les moyens par lesquels les Aryens courtisaient la faveur de ces dieux étaient extrêmement simples. Le père de chaque famille était prêtre, et la mère prêtresse. Il n’y avait ni temples, ni lieux saints permanents d’aucune sorte… Mais ce qui se produisit dans le reste du monde se produisit bientôt aussi en Inde. Dans l’espoir de mieux cajoler les dieux, le rituel fut progressivement élaboré. Puis [ p. 121 ] apparurent les sacrifices professionnels – des prêtres dont les services à l’autel étaient supposés plus efficaces que ceux des hommes ordinaires. Et par ces prêtres, le rituel fut encore élaboré et compliqué. Ils créèrent une vaste littérature de psaumes et de formules magiques à réciter sur les autels afin de mieux s’emparer des dieux – une littérature encore préservée dans ce que l’on appelle les Védas. Le mot veda est apparenté à l’anglais « wit » et à l’allemand « wissen ». Interprété au sens large, il signifie « connaissance », mais désigne spécifiquement le type de savoir qui aide un homme à obtenir la protection des dieux. Il existe plus d’une centaine de livres appelés Védas, mais nombre d’entre eux sont méconnus, même des érudits les plus érudits d’aujourd’hui. Le plus ancien et le plus important d’entre eux est le Rig Veda, un recueil de plus d’un millier d’hymnes remontant peut-être à 2000 av. J.-C.
¶ 2
Cette littérature védique – ou du moins une grande partie d’entre elle – fut élaborée alors que la population aryenne était encore confinée à la vallée de l’Indus. De nombreuses années s’écoulèrent dans cette région fertile avant que la surpopulation ne force les Blancs à pénétrer plus profondément dans le pays ; mais une importante migration commença alors vers le sud, en direction de la vallée du Gange. Là, elle s’arrêta un temps, et une nouvelle civilisation s’y développa. La vie des Aryens prit un tout autre visage dans ce nouvel environnement. D’une part, les distinctions entre les différentes classes [ p. 122 ] d’êtres humains devaient être soulignées comme jamais auparavant. Les envahisseurs blancs étaient terrifiés à l’idée qu’avec le temps, l’identité de leur peuple ne se perde dans le tourbillon d’une population noire bien plus nombreuse. C’était l’antique soif d’instinct de survie qui se manifestait une fois de plus, la soif ancestrale de survie, tant pour l’espèce que pour l’individu. Et pour assouvir cette soif, les Aryens eurent recours au plus désespéré des expédients. Ils érigèrent une imposante barrière religieuse et sociale de caste pour se protéger des Noirs. (En sanskrit, le mot varnu signifie à la fois caste et couleur.) Et au-delà de cette barrière, ils interdisaient non seulement les mariages mixtes, mais aussi toute forme de relations sociales et religieuses. Le blanc était blanc et le noir était noir, et jamais les deux n’étaient censés se rencontrer…
Bien sûr, cet expédient échoua, comme le montre le fait que tous les hindous d’aujourd’hui, de haute comme de basse caste, sont noirs. Mais s’il échoua complètement sur ce point, il se révéla particulièrement efficace sur un autre. S’il ne parvint pas à séparer physiquement les Blancs des Noirs, il se révéla bientôt très efficace pour les maintenir socialement séparés. Car une fois que l’idée de caste s’enracina dans le pays, elle se répandit comme un véritable fléau. Bientôt, elle commença à établir une distinction non seulement entre Blancs et Noirs, mais aussi entre prêtres blancs et chefs blancs, puis entre chefs blancs et fermiers blancs, et enfin entre fermiers blancs et serfs blancs. Il était naturel, bien sûr, que les prêtres – les brahmanes qu’on appelait – émergent au sommet de ce monstrueux système social. Tant qu’eux seuls furent jugés capables d’apaiser et de cajoler les dieux, eux seuls furent capables [ p. 123 ] pour susciter le plus grand respect des hommes. Même les rajahs, les princes, devaient être d’un rang inférieur à eux. . . .
Un grand pouvoir s’accompagnait naturellement de l’opportunité d’acquérir de grandes richesses. Les richesses affluaient littéralement dans les coffres des brahmanes. De chaque sacrifice aux dieux, les prêtres étaient autorisés à prélever une part non négligeable ; et, de plus, ils n’hésitaient pas à accompagner leurs prières les plus poétiques et leurs adorations les plus sublimes de demandes ouvertes pour des « bakhchiesh » supplémentaires… Et une grande richesse offrait l’opportunité d’acquérir un pouvoir encore plus grand. Avec le temps, les prêtres, non satisfaits de leur suprématie sur les hommes, commencèrent à convoiter celle des dieux eux-mêmes. Et ils y parvinrent, eux aussi ! Ils commencèrent par exalter l’importance du rituel, en disant : « Le monde entier fut créé par le rite sacrificiel ; du rite sacrificiel sont issus les dieux… Assurément, le soleil ne se lèverait pas si le prêtre ne faisait pas de sacrifice. »* Et de là ils en vinrent à s’exalter eux-mêmes, en disant : « L’univers entier est soumis aux dieux, les dieux aux sorts, et les sorts aux brahmanes ; donc les brahmanes sont nos dieux ! » Ils en vinrent à considérer les dieux avec presque dédain, et les traitèrent comme autant de vagabonds affamés. « Comme le bœuf mugit pour la pluie », déclarèrent-ils présomptueux dans leurs écrits sacrés, « ainsi Indra aspire au soma. »… C’était une évolution qui avait atteint une hauteur si outrageante qu’elle avait basculé dans l’absurdité.
Bien sûr, une telle religion ne pouvait régner éternellement. Les masses, trouvant la protection offerte par les dieux brahmanes excessivement coûteuse, commencèrent à négocier la protection bien moins coûteuse de [ p. 124 ] démons non orthodoxes. Des profondeurs de leur ancien héritage sauvage, ou de la vase de l’animisme indigène noir qui les entourait, elles firent surgir des dizaines d’esprits maléfiques qu’elles redoutaient ou auxquels elles s’accrochaient… Et avec le temps, les prêtres commencèrent eux aussi à remettre en question la sincérité de leur religion surritualisée. Dans ces mêmes Brahmanes, les « Sacrificateurs », où les clercs osaient affirmer leur souveraineté religieuse, ils durent aussi trahir leurs doutes latents quant à la validité de la religion elle-même. Bien sûr, ils n’osaient pas confesser ouvertement ces doutes, car cela leur aurait coupé l’herbe sous le pied. Cela aurait mis fin à leur pouvoir démesuré en détruisant tout le système qui le leur avait donné. Ainsi, comme toujours lorsque des hommes ne croient plus mais ne peuvent se permettre de ne pas croire ouvertement, les brahmanes tentèrent de se donner bonne conscience en élaborant une théologie apologétique. Avec une anxiété soupçonneuse, ils tentèrent de dépouiller les cérémonies rituelles de leur absurdité évidente en les interprétant comme de beaux symboles et allégories. La théologie n’est bien souvent qu’une tentative de prolonger la vie d’idées moribondes en réinterprétant des mots qui ne signifient plus ce qu’ils disaient autrefois – et lorsque la théologie est cela, elle est invariablement une confession de méfiance et de scepticisme secrets. De toute évidence, des pans entiers des brahmanes étaient censés être les solides cordes d’un rationalisme ingénieux grâce auxquelles les prêtres pourraient se préserver de la noyade dans le doute.
Mais malgré la solidité de ces cordes et la manière dont elles étaient tressées, elles ne furent d’aucune utilité. Les prêtres coulèrent. Descendant, descendant, dans les eaux sombres et boueuses du doute et de la consternation. Les doigts gelés, ils s’accrochaient encore [ p. 125 ] aux cordes, tirant dessus encore et encore, dans un vain effort pour les empêcher de couler. Mais ils coulèrent néanmoins, descendant, descendant, jusqu’à ce qu’enfin leurs pieds touchent le fond, dans la vase du pessimisme le plus noir…
¶ 3
Peut-être les conditions de vie de l’époque ont-elles contribué à cet effondrement de l’espoir védique. Les choses avaient profondément changé depuis l’époque de la création des Védas dans la vallée de l’Indus. Les Aryens étaient désormais devenus hindous. Malgré l’épaisseur du mur des castes, le sang noir des aborigènes avait infiltré les veines des Blancs. Et, parallèlement à cette coloration de la peau, le climat malsain de la vallée du Gange avait obscurci l’âme. Un nouvel esprit, un esprit sépulcral de désespoir, s’empara des anciens Blancs. Il trouva son expression dans une nouvelle littérature : un vaste recueil de traités philosophiques appelés les Upanishads, les « Séances ». Il est difficile de préciser la date exacte de la rédaction des Upanishads, mais selon les autorités les plus compétentes, ce fut probablement durant les deux siècles allant de 600 av. J.-C. à environ 600 av. J.-C. Leur héritage était une compréhension entièrement nouvelle des chances de l’homme d’atteindre un jour le repos dans l’univers. Dans la première planche, ils rejetèrent tous les anciens dieux et les anciens rites, avouant franchement qu’ils étaient totalement dénués de réalité essentielle. Une seule chose, insistaient-ils, était réelle : Brahma, le « Soi », l’Unique, Absolu, Infini, Impersonnel, Indescriptible « Ça ». Et tous les actes et toutes les paroles, toutes les créatures, même tous les dieux, n’étaient que des manifestations fugaces de ce « Ça ». Par conséquent, [ p. 126 ] il n’existait qu’une seule voie par laquelle l’homme pouvait atteindre la paix ultime. De toute évidence, il devait se perdre dans le « Ça ». Il devait cesser d’être une simple manifestation et devenir enfin partie intégrante de Brahma.
Or, tout cela n’avait rien d’unique. Bien d’autres peuples que les Hindous se sont, à un moment ou à un autre, réfugiés dans l’idée que ce monde n’est qu’une illusion et que le salut ne peut être obtenu que sur un autre plan d’existence. Mais aucun autre peuple n’a jamais poussé cette pensée aussi loin que les Hindous. La plupart des autres peuples s’arrêtaient avec l’espoir que la mort leur ouvrirait immédiatement la porte du salut. Ils se disaient que, si la vie en ce monde était indiciblement vaine, la mort approchait, et avec elle l’assurance d’une vie réelle dans un autre monde plus glorieux. Mais les Hindous ne pouvaient nourrir un espoir aussi facile. La mort leur semblait tout sauf une issue. Dans la terrible vallée du Gange, où l’existence signifiait une lutte perpétuelle sous un soleil brûlant la chair et dans un air étouffant le courage, même la mort n’offrait aucune promesse immédiate de paix. L’idée funeste de la transmigration, d’un cycle épuisant d’une vie sans fin, s’était emparée des Hindous. La mort ne leur semblait que le début de ce même tourment qu’est la vie terrestre. Les âmes des morts pouvaient s’échapper un instant vers la lune ; mais dès que l’influence de leurs bonnes actions s’était épuisée, elles retombaient sur terre comme autant de ballons épuisés. Et alors, elles renaissaient sous forme de personnes, d’animaux, voire de plantes. Si leur vie précédente avait été extraordinairement bonne, à leur retour, elles devenaient peut-être des princes, voire des [ p. 127 ] brahmanes ; mais si elles avaient fait le mal, elles retournaient vivre comme des chiens, des cochons, ou même comme des herbes gluantes au bord des marais.
Il ne semblait y avoir qu’un seul moyen efficace d’échapper à ce terrible cycle de vie sans fin : l’absorption dans le « Cela ». Si seulement un homme pouvait anéantir son moi individuel, détruire complètement son petit « Cela », alors il pourrait enfin se libérer de la vie et atteindre la délivrance appelée Nirvana. Le Nirvana n’était pas un lieu, mais un état d’esprit, et ne pouvait donc être atteint que par l’esprit. De simples actes, bons ou mauvais, ne pouvaient rien y faire ; pas même les dieux eux-mêmes ne pouvaient y contribuer. Comme le déclarent explicitement les Upanishads : « Quiconque sait ainsi : “Je suis le Brahma !” devient le Brahma. Même les dieux n’ont aucun pouvoir d’empêcher un tel homme de devenir ainsi, car il devient leur âme même. » Par conséquent, le simple effort pour atteindre la perfection morale ou même la bienséance rituelle ne saurait jamais procurer à l’homme la béatitude du Nirvana ; non, seule l’abolition totale de l’effort lui-même le pouvait. Car l’effort, le désir, voilà la source même de toute vie illusoire. Désirer, vouloir, chérir la moindre lueur d’un désir mesquin, voilà la substance vicieuse dont était fait le soi en perpétuelle réincarnation. Sans désir, le « ça » individuel serait perdu, et seul subsisterait Brahma, l’Âme Suprême, l’Unique « ça » Universel. Ainsi, logiquement, il ne restait qu’un seul but sain à la vie : cesser de désirer !…
[ p. 128 ]
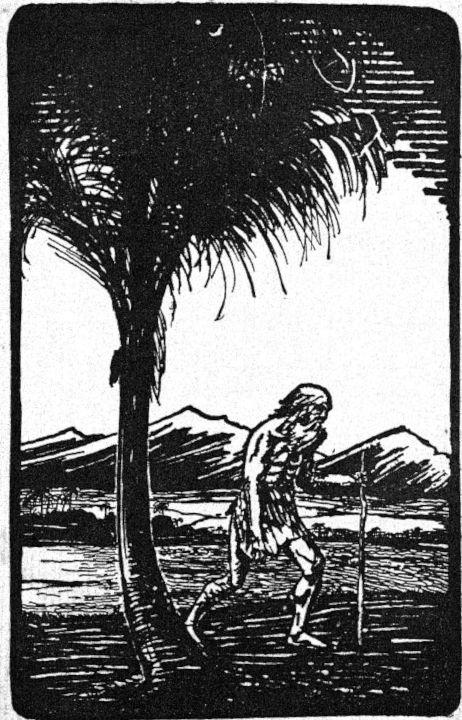
On se demande si cette philosophie nihiliste des Upanishads a grandement influencé la vie des masses en Inde il y a deux mille six cents ans. Probablement pas, car elle devait dépasser de loin la compréhension de [ p. 129 ] ces masses. Mais il ne fait aucun doute qu’elle a profondément affecté les érudits. Le désir de mettre fin au désir ravageait tout simplement les classes supérieures à cette époque. L’ascétisme, la suppression volontaire de l’appétit sous toutes ses formes, devint monnaie courante dans tous les temples et toutes les cours princières. Les hommes s’enfuirent dans les montagnes et loin dans les jungles, pour y vivre comme des anachorètes et étouffer jusqu’au dernier vestige de désir normal. Dans une misère incroyable, ils traînèrent leurs jours, affamés d’une seule chose : l’extinction de la faim.
Et puis vinrent les hérésies. . . .