[ p. 150 ]
Malgré l’essor du jaïnisme et du bouddhisme en Inde, la vieille religion sacerdotale, ancrée dans les Védas, ne fut jamais complètement supplantée. Même si elle perdit temporairement la faveur des dirigeants, elle ne perdit jamais un instant son attrait auprès des gouvernés. Bien sûr, intérieurement, elle changea de siècle en siècle, adoptant de nouveaux dieux et oubliant les anciens, adoptant des rites étranges et négligeant les traditions locales ; mais au moins, dans sa structure de castes et son caractère sacerdotal, la vieille religion hindoue ne vacilla jamais du début à la fin. Aujourd’hui, plus de deux cents millions d’âmes en Inde – soit [ p. 151 ] plus que le nombre de chrétiens protestants dans le monde – se disent encore hindouistes !
Définir l’hindouisme est quasiment impossible. En réalité, il s’agit moins d’une religion (au sens strict du terme) que d’un système religieux et social. Bien que l’hindouisme contienne un florilège de théologies, de philosophies et de systèmes sacrificiels, sa seule dominante reste celle des castes. Un tissu complexe de lois religieuses et sociales anciennes s’est consolidé au point de paraître aujourd’hui totalement indestructible. Ce tissu fut d’abord constitué par une série de codes de lois, dont le plus important est le Code de Manu, compilés à l’époque où l’hérésie bouddhiste était à son apogée. Ces codes visaient à accomplir pour l’hindouisme ce que le Talmud accomplit plus tard pour le judaïsme : ils cherchaient à ériger un mur de lois autour de la foi afin que nul ne puisse s’en écarter. Bien entendu, les plus solides piliers du mur hindou étaient naturellement les distinctions de castes, et celles-ci ont donc fait l’objet de la plus grande attention de la part des législateurs. La supériorité des brahmanes et l’infériorité des ouvriers étaient déclarées ordonnées au ciel selon un plan divin « pour la prospérité du monde ». La caste d’un homme, comme son souffle, l’accompagnait sans cesse de la naissance à la mort ; en effet, contrairement à son souffle, elle était même censée le suivre dans la tombe.
Mais hormis ces lois régissant les castes, l’hindouisme ne possède aucun autre élément unificateur. Il comprend deux sectes principales et au moins cinquante-sept sous-sectes, chacune cherchant le salut grâce à ses propres dieux et cérémonies. Le christianisme, encore plus profondément divisé, est au moins uni par sa [ p. 152 ] reconnaissance unanime du caractère unique de Jésus. L’hindouisme ne possède pas de doctrine commune de ce type. Il est vrai qu’aux alentours de 300 après J.-C., une tentative fut faite pour créer une telle doctrine en combinant les trois principaux dieux hindous en une trinité universellement acceptée ; mais cette tentative échoua lamentablement. Brahma, le dieu principal de cette trinité, ne devint populaire qu’auprès des prêtres et des philosophes. Il était loin d’être une divinité suffisamment concrète pour que le commun des mortels puisse la saisir et y croire, et il n’existe aujourd’hui que deux temples en Inde qui lui soient consacrés. Et Vishnu et Shiva, les deux autres dieux de la trinité, sont toujours restés distincts et séparés, continuant d’attirer des adeptes distincts et distincts. Mais si l’hindouisme n’a jamais été uni par une quelconque croyance ou un quelconque rite, ses divisions ont rarement, voire jamais, conduit à des effusions de sang. Contrairement aux chrétiens, qui ont eu recours à maintes reprises au massacre pour extirper toute hérésie, les hindous ont rarement persécuté les divergences de foi. Ils ont eu la sagesse de comprendre que chacun a le droit de pratiquer son culte comme il l’entend, et qu’aucun homme n’est justifié de chercher à imposer sa doctrine à son prochain. C’est pourquoi les adorateurs de Vishnu et ceux de Shiva ont vécu côte à côte pendant des siècles sans amertume, et d’innombrables sous-sectes ont émergé et disparu en Inde avec très peu de violence ou d’acrimonie. Quels que soient les nombreux maux imputés à l’hindouisme, il faut au moins mentionner cette vertu : sa tolérance.
¶ 2
L’un des deux dieux les plus populaires en Inde aujourd’hui est Vishnu. À l’origine un dieu solaire [ p. 153 ] védique mineur, il a depuis acquis une importance exceptionnelle, en grande partie parce qu’on lui attribue le pouvoir de s’incarner occasionnellement sous forme humaine. On comprend aisément pourquoi cette propension a rendu Vishnu attrayant aux yeux du peuple. Grâce à ces incarnations périodiques – ces « avatars » comme on les appelle –, Vishnu est devenu réel, tangible, presque humain pour toutes sortes d’hindous. Le problème avec un dieu comme Brahma, par exemple, était qu’il n’était rien de plus qu’une déduction froide, impersonnelle et philosophique – un néant. Mais Vishnu n’avait pas une telle impersonnalité froide. Au contraire, on croyait qu’il partageait toutes les joies et toutes les peines de ses disciples, et que leur détresse et leurs péchés étaient censés être ses préoccupations constantes. On disait en effet que chaque fois que le peuple s’égarait, Vishnu était si bienveillant qu’il descendait sur terre sous forme humaine et ouvrait la voie à la réforme. De nombreuses épopées furent écrites pour raconter comment le dieu s’était ainsi incarné en homme et avait accompli de grands prodiges. Deux de ces épopées, le Mahabharata et le Ramayana, constituent d’ailleurs le chapitre final et le plus populaire de toute la littérature sacrée hindoue.
Le Mahabharata raconte les aventures de Vishnu incarné dans le corps d’un grand héros nommé Krishna, et on y trouve ce célèbre traité appelé la Bhagavad-Gita, le « Chant de l’Adorable ». Ce petit traité, souvent appelé le Nouveau Testament de l’hindouisme, a été traduit et diffusé par des sociétés avec le même zèle missionnaire que les associations de diffusion de tracts pour la Bible. En réalité, la Bhagavad-Gita est un ouvrage extrêmement confus et répétitif, entaché d’incohérences [ p. 154 ] déconcertantes. C’est peut-être la raison de sa popularité, car ses fréquentes périodes de flou et de confusion confirment presque toutes les croyances du monde. On peut en dire ce que les rabbins ont dit de la Bible : « Retournez-la et retournez-la, car tout y est. » Mais, malgré tout cela, la Bhagavad-Gîtâ est une œuvre d’une rare grandeur. Par sa spiritualité et sa portée éthique élevée, elle n’est inférieure à aucune autre écriture au monde. Nulle part ailleurs on ne trouve note plus noble que celle qui résonne dans le « Chant de l’Adorable » : « Celui qui accomplit tout son travail pour mon amour (pour Vishnu), qui m’est entièrement dévoué, qui m’aime, qui est libre de tout attachement aux choses terrestres et sans haine envers aucun être, celui-là entre en moi. »
Krishna, l’homme-dieu, dont les aventures sont célébrées dans le Mahabharata et dont la sagesse est consignée dans la Bhagavad-Gita, est considéré comme le plus important des avatars de Vishnu. De fait, dans le cœur de millions d’hindous aujourd’hui, il a même pris la place de Vishnu lui-même. De même que de nombreux chrétiens se tournent bien plus souvent vers le Christ que vers Dieu, de même de nombreux hindous s’inclinent devant Krishna plutôt que Vishnu. Il a été suggéré que Krishna – dont le nom se prononce Krishto dans certains dialectes du nord – pourrait avoir un lien significatif avec le Christ. Cette théorie, cependant, ne peut être étayée par des faits. Selon toute probabilité, Krishna et le Christ ne se rapprochent que dans la mesure où ils sont tous deux nés d’une passion commune de l’espèce humaine : la passion qui sublime son héros jusqu’à le rendre plus que mortel et l’élever aux cieux. Il se peut qu’à l’origine, Krishna fût un chef de tribu apprécié et un réformateur religieux qui, pendant [ p. 155 ] de son vivant, il enseigna à son peuple à vénérer un dieu appelé Bhagavata, « Adorable ». Il était peut-être un personnage si merveilleux qu’après sa mort, ses disciples ne purent s’empêcher de penser qu’il avait été le dieu lui-même. C’est ainsi qu’apparut le culte de Krishna, l’homme-dieu ; et dès qu’il devint puissant, les prêtres de l’ancien ordre le recouvrirent astucieusement d’un voile d’orthodoxie brahmanique en affirmant que Krishna n’était autre qu’une incarnation de leur ancien dieu Vishnu.
Ceci, cependant, n’est que pure spéculation. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que, d’une manière ou d’une autre, les gens ont commencé à croire que le dieu Vishnu venait de temps à autre sur terre sous la forme d’avatars. Krishna n’était que l’un d’eux. Rama, dont les exploits sont détaillés dans l’épopée du Ramayana, était presque aussi grand ; et d’innombrables chefs, laitiers, et même des éléphants et des tigres, figurent dans la longue liste des avatars mineurs. Et parce que les gens humanisaient ainsi Vishnu, ils pouvaient croire en lui avec une grande intensité. Ils pouvaient le considérer comme un esprit enchâssé dans leurs propres cœurs humains, un esprit qui guidait leurs âmes et les a finalement arrachées au cycle de la vie pour les emmener au ciel. Du moins, c’est ainsi que les gens pouvaient et ont cru en Vishnu – avant l’apparition des théologiens. Cependant, dès l’apparition de ces derniers, l’innocence nue de la doctrine populaire fut immédiatement dissimulée sous d’épais plis de mots. Les termes furent définis et redéfinis, et des schismes en résultèrent aussitôt. De vives controverses ont éclaté sur des questions futiles. Aujourd’hui encore, les adeptes de Vishnu sont divisés en deux confessions, à cause d’un différend sur la question de savoir si l’homme est sauvé par Vishnu sous la forme d’un chaton [ p. 156 ] nouveau-né ou d’un singe nouveau-né par sa mère. Le chaton nouveau-né agit comme s’il était impuissant et sa mère doit l’attraper par la nuque pour le mettre en sécurité ; mais le singe nouveau-né participe à son propre sauvetage, s’accrochant à sa mère de toute la force de ses petits bras. (En substance, nous retrouvons ici ces vieux antagonistes : la prédestination et le libre arbitre.) Même aujourd’hui, ce conflit théologique fait rage, divisant les vishnouites en deux camps : ceux qui croient à la théorie de la « prise du chat », et ceux qui sont convaincus de la « prise du singe » !…
¶ 3
Mais Vishnu, malgré l’aide de tous ses avatars, ne parvint jamais à attirer une aussi large communauté que le troisième dieu de la trinité : Shiva. À l’origine, ce Shiva était peut-être l’un de ces démons macabres, évoqués dans les esprits terrifiés des aborigènes noirs, et qui étaient encore vénérés après l’arrivée des Aryens. Il était (et est parfois encore) perçu comme une divinité sauvage et morose, malveillante et destructrice, provoquant peste, tempêtes et toutes sortes d’autres horreurs ; il est communément représenté comme un monstre portant un trident et un rosaire. (Les chrétiens n’ont pas entendu parler du rosaire avant d’observer son utilisation pendant les croisades parmi les musulmans ; mais les musulmans eux-mêmes ne l’avaient adopté que peu de temps auparavant comme symbole sacré, à l’imitation des disciples de ce dieu Shiva.) Dans la trinité par laquelle les théologiens ont essayé d’unir les sectes hindoues, Brahma représentait le principe de la Création, Vishnu celui de la Préservation et Shiva celui de la Destruction. Des trois, Shiva est devenu et est resté le plus populaire. [ p. 157 ] Les masses l’aimaient parce qu’il était très semblable à leur espèce : passionné, violent et licencieux. Et avec lui, elles aimaient sa femme débauchée, Parvata la Terrible. À sa gloire, les Thugs, une secte secrète de pieux meurtriers, avaient l’habitude de commettre des outrages innommables ; et en son nom les tantristes, une secte secrète de pervers pieux, se livrent encore à des orgies sexuelles indescriptibles.
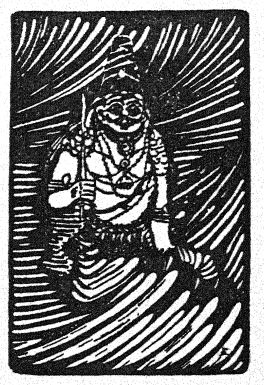
Il n’existe guère de village en Inde aujourd’hui qui ne possède au moins un sanctuaire abritant l’emblème de Shiva : un bloc cylindrique vertical reposant généralement sur une dalle circulaire percée d’un trou en son centre. Curieusement, les habitants ne semblent pas saisir le symbolisme grossier de cet emblème et ne l’associent même pas, même de loin, à la sexualité. Nombre d’entre eux le portent même autour du cou pour porter chance ou en signe de dévotion religieuse. Bien sûr, la sexualité joue un rôle très réel dans le culte de Shiva et de ses homologues féminins. Une confession, appelée Tantra, repose sur la théorie séduisante selon laquelle seul l’abandon débridé à la passion peut permettre à l’homme de traverser la région d’obscurité qui l’empêche de s’unir totalement à Shiva. La passion, on l’admet, [ p. 158 ] est un poison ; mais le seul antidote à ce poison est encore plus de poison. On en conclut donc que seule la complaisance dans les cinq vices qui empoisonnent l’âme de l’homme — le vin, la viande, le poisson, la gesticulation mystique avec les doigts et le relâchement sexuel — seules de véritables orgies de ces cinq vices peuvent chasser leur poison du système et purifier réellement l’âme ! . . .
Or, les érudits ne manquent pas pour soutenir que toute religion n’est qu’une forme d’expression sexuelle ; et ils disposent de nombreux arguments plausibles pour étayer leur théorie. Il serait étrange que la religion, qui atteint les profondeurs de la conscience humaine, ne soit pas fortement influencée par une pulsion aussi omniprésente que le sexe. En effet, il faut admettre que même les pratiques religieuses les plus avancées et les plus civilisées sont teintées de sexualité. (Mais d’ailleurs, il en va de même pour les formes d’art et les systèmes sociaux les plus avancés et les plus civilisés.)
Les pratiques religieuses de l’Inde, cependant, sont, pour la plupart, loin d’être avancées et civilisées, et il est donc d’autant plus naturel que le sexe s’y introduise. L’indulgence envers les pratiques érotiques fait partie du culte non seulement de Shiva, mais aussi de Vishnu. On dit que nombre des sectes mineures adorant Krishna adorent en réalité son épouse ou sa maîtresse, ou s’inspirent des récits insolites que le Mahabharata relate sur sa jeunesse dissipée. Il faut se rappeler que l’adorateur moyen de Vishnu, comme ses confrères de la secte shivaïte, est encore un homme relativement primitif. Il est encore avide de ces délices animaliers qui, seuls, semblent rendre sa misérable vie supportable.
[ p. 159 ]
¶ 4
Mais si l’hindouisme est resté d’une primitive révoltante parmi les basses castes, il a progressé parmi les philosophes de haute caste jusqu’à rendre certains de ses enseignements presque incompréhensibles. Les hindous, en tant que peuple, semblent dotés d’une profonde et nette tendance à penser plutôt qu’à agir. Peut-être en raison du climat énervant de leur pays, ils sont bien plus enclins au dur labeur de la contemplation et de la méditation qu’à celui de la conquête et de la création avec des outils et des machines. De ce fait, leurs plus grandes réalisations se situent dans le domaine des idées plutôt que dans celui des choses concrètes. Et le monde occidental, las des choses et de la lutte effrénée pour les obtenir, a, ces dernières décennies, manifesté un intérêt démesuré pour les réalisations intellectuelles des hindous. Nombre d’âmes occidentales, trop faibles ou trop fines pour supporter le poids de notre civilisation machiniste, se sont lancées avec un enthousiasme immense – et souvent sans esprit critique – dans la quête de divers systèmes de métaphysique indienne. Ils ont rejoint les églises de la Nouvelle Pensée, les Sociétés Théosophiques, les Ligues pour la Contemplation de l’Âme Suprême ; ou du moins ils se sont assis dans des salons à la mode et ont écouté, fascinés, les éloges de telle ou telle méthode de contemplation par des yogis en turban, des swami et d’autres conférenciers hindous.
Malgré tout cela, il est peu probable que la pensée indienne puisse un jour s’enraciner profondément dans le monde occidental. Au cœur de cette pensée se trouve une soif tout à fait incompréhensible pour l’esprit occidental, la soif de mort définitive, d’extinction, de libération totale du cycle redoutable de la vie transmigrante. Pour le penseur hindou, le plus grand malheur [ p. 160 ] de cette vie pleine de malheurs a toujours été la crainte de ne pouvoir s’en sortir. La quasi-totalité de la philosophie hindoue n’a été qu’une tentative interminable pour prouver qu’il existe bel et bien une issue. Selon Mahavira le Jina, l’issue passe par l’abnégation physique ; selon Gautama le Bouddha, par la tempérance spirituelle et la rectitude morale. Mais selon les philosophes hindous orthodoxes, l’issue passe plutôt par divers exercices physiques et psychiques.
La plupart de ces philosophes appartiennent à l’école dite du « Yoga ». Le mot sanskrit yoga serait apparenté au latin jugum et à l’anglais yoke ; il signifie « union ». Le yoga vise à unir l’âme individuelle à Brahma, l’Âme Suprême Universelle, par la suppression persistante de toute activité sensorielle perturbatrice. Les divers exercices qu’il propose permettent à l’homme de maîtriser la moindre action inutile de son corps, le laissant immobile, transpercé, presque essoufflé. Il est alors assis comme une statue de pierre, sans tremblement dans sa chair, sans éclat dans ses yeux, l’esprit rivé à la concentration sur l’Âme Suprême. Et soudain, le mariage mystique est consommé. La petite âme de l’individu s’unit soudain à la grande Âme Suprême de l’Univers. Une félicité ineffable envahit le dévot, une paix et un repos tels qu’il ne les connaissait que dans le ventre de sa mère. Il se sent d’une manière exquise exalté, délicieusement transporté hors de lui-même, divinement désincarné. Il devient l’espace d’un instant un esprit, une partie éthérée flottante du Tout, un yogi… Et puis la transe s’interrompt. Le cœur battant lentement, une horreur [ p. 161 ] écœurante envahit le cœur du dévot, qui redescend sur terre. Et là, il se réveille, se retrouvant à nouveau lié à la terre, mais avec un souvenir qu’il ne peut effacer. Dès lors, il est un homme transformé, car après avoir goûté au Nirvana, sa seule passion dévorante est d’y goûter à nouveau. Dès lors, il est complètement perdu dans le monde, ne se souciant ni de ses vertus ni de ses vices. Dès lors, il erre, solitaire comme un nuage, sans se soucier de faire le bien ou le mal, sans se demander s’il construit ou détruit. Car il n’est plus un homme ordinaire, il est un yogi !
Ce n’est pas le lieu d’une discussion détaillée du mysticisme. Personne ne peut affirmer avec une certitude absolue ce qu’il est ni d’où il vient. Les théologiens et la plupart des psychologues plus anciens insistent sur le fait que l’extase mystique éprouvée par le yogi ou le saint est un véritable aperçu de l’éternité et un don de Dieu ; les psychologues plus récents ont tendance à croire qu’il ne s’agit que d’une sublimation du désir sexuel. Mais même si nous ignorons ce qu’est l’extase mystique ni d’où elle vient, nul ne peut nier qu’il s’agit d’un phénomène réel et authentique. Le fait que quatre-vingt-dix-neuf personnes sur cent lisant ce paragraphe n’aient jamais connu une telle extase ne contredit en rien sa réalité. De toute évidence, il existe dans le monde, notamment en Inde, des personnes dont l’esprit est particulièrement sensible à ce que l’on appelle vaguement le spirituel. Et lorsque de telles personnes aiguisent leur sensibilité par des exercices comme le yoga, il n’y a pas lieu de s’étonner qu’elles éprouvent les extases transcendantes dont elles parlent. Nous, simples mortels, n’avons guère plus le droit de contester leur témoignage [ p. 162 ] que celui des astronomes qui, grâce à la vue accrue que leur offrent leurs télescopes, nous parlent d’étoiles que nos yeux nus n’ont jamais vues.
De plus, même si l’expérience mystique est bel et bien une illusion et un mensonge, l’important est qu’elle lui semble la seule vérité indubitable. Tous les phénomènes terrestres de la vie lui paraissent entièrement illusoires et irréels ; seuls ces instants fugaces d’extase surnaturelle lui semblent valables et authentiques. Et c’est dans cette foi qu’il vit. Fermement convaincu que tous les tourments et les dangers de la vie terrestre ne sont que mensonges et fantasmes, il peut parcourir le monde sans crainte. Il ne peut avoir aucune crainte de cet univers matériel, car il se dit qu’il n’existe tout simplement pas – et il le pense vraiment. La matière n’existe pas pour lui. Seul Brahma, l’Âme Suprême, le « Cela », l’Esprit Infini – seul existe. Son seul souci est de s’évader de ce monde illusoire, et toute sa religion est orientée vers cette libération. Par essence, la religion du mystique est la technique par laquelle il s’efforce de s’unir à Brahma. Bien sûr, cela ne ressemble en rien à la technique religieuse ordinaire. Elle ne met l’accent ni sur la prière ni sur le sacrifice, car l’Âme Suprême est purement impersonnelle et ne peut être influencée par la cajolerie ou la supplication. Elle ne met pas non plus l’accent sur la moralité, car, puisque l’Âme Suprême ne se préoccupe pas de ce monde matériel illusoire, elle ne peut nécessairement pas s’intéresser à la bonté ou à la méchanceté des actes illusoires qui y sont accomplis. Non, la religion, la technique du salut, pratiquée par le mystique hindou, met l’accent uniquement sur certains exercices psychiques. Elle exige seulement la concentration, la suppression de toute activité sensorielle, une méditation haletante [ p. 163 ] – et garantit ensuite le Nirvana. Elle exige que toute action soit mise à mort, puis promet l’inaction éternelle. Et des millions d’âmes en Inde ont été « sauvées » par cette croyance. …
¶ 5
Mais si de nombreux hindous ont pu trouver du réconfort dans le yoga et d’autres systèmes philosophiques, la grande majorité s’est toujours réfugiée dans des croyances moins absconses. Aujourd’hui encore, la religion des serfs et des paysans hindous, surtout dans le sud, est presque identique à l’animisme primitif des aborigènes noirs. On dit que les quatre cinquièmes de la population indienne vénèrent encore les esprits locaux, généralement des démons féminins, au moyen de sacrifices d’animaux des plus révoltants. L’hindouisme orthodoxe des brahmanes s’oppose à l’abattage des animaux et vénère particulièrement la vache. Mais les masses dénudées de la jungle prêtent peu d’attention à ce tabou et parviennent même parfois à engager des brahmanes tombés au combat pour officier lors de leurs sacrifices d’animaux. Ces misérables paysans, à moitié affamés, vénèrent des divinités, des démons et des fantômes, et continuent de vivre dans la jungle comme le faisaient leurs ancêtres noirs il y a des milliers d’années. Car ils ont encore peur. Ils ne sont pas las de la vie, comme le sont tant d’hindous de caste supérieure. En réalité, ces serfs n’ont jamais vraiment vécu assez pour connaître la vie, et encore moins s’en lasser. Ils ont simplement existé ; ils ont grandi, se sont reproduits et sont morts, génération après génération, comme autant de rongeurs de la jungle. Et par conséquent, ils n’ont jamais pu comprendre l’appétit d’anéantissement exsangue du philosophe. Ces masses ont toujours soif [ p. 164 ] de vie, mais d’une vie enrichie et rendue d’une luxuriance brahmimique.
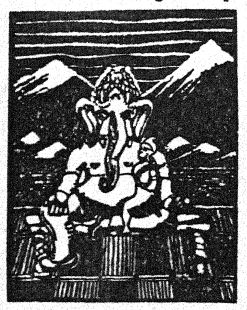
C’est pourquoi les paysans affluent aux temples pour offrir des offrandes de viande ou de fleurs, et prient avec crainte les idoles de bois et de pierre. Ils s’imaginent ainsi pouvoir accéder à une vie plus facile dans une caste supérieure après leur nouvelle naissance. Et s’ils rêvent d’échapper au cycle de la vie réincarnée, ce n’est jamais d’échapper à la passivité et au néant. Pour eux, le Nirvana n’est pas un état mental d’imperturbabilité absolue en ce monde, mais une explosion de joie physique dans un autre monde. Et l’atteinte de ce Nirvana luxurieux est bien sûr leur plus grand espoir. Pour l’atteindre, ils parcourront les rives du Gange, qui compte plus de deux mille temples et d’innombrables sanctuaires de moindre importance, tous soutenus par de tels pèlerins hindous crédules.
Bénarès, cependant, n’est pas la seule ville sainte du [ p. 165 ] pays, ni le Gange le seul fleuve sacré. Chaque recoin de l’Inde possède ses temples et ses sanctuaires. On y trouve partout des idoles grotesques au-delà de toute description : des corps à tête d’éléphant, des gargouilles à trois yeux, des monstres à plusieurs têtes et toutes sortes d’autres créations terrifiantes. Et des millions d’Indiens vénèrent ces idoles, dont le nombre et la monstruosité augmentent chaque année. Les prêtres, censés réveiller, laver et nourrir les idoles, sont toujours les aristocrates. Aujourd’hui, plus d’un serf en Inde refuse de rompre son jeûne le matin, sauf avec de l’eau dans laquelle a trempé l’orteil d’un brahmane. La caste exerce toujours une emprise de fer sur le peuple. Ses quatre divisions originelles se sont multipliées, et la population est désormais divisée en centaines de petites sous-castes. On dit qu’il y aurait cinquante millions d’hommes et de femmes dans le pays considérés comme trop inférieurs pour appartenir même à la plus basse des sous-castes. Ce sont les parias, les « Intouchables », dont le simple fait de croiser l’ombre d’un brahmane est censé le rendre rituellement impur !
On se demande ce qui adviendra de tout cela. La peur, organisée et amplifiée par les intrigues des prêtres, a conduit la pauvre Inde dans un bourbier d’où il semble impossible de sortir. Siècle après siècle, de courageuses tentatives ont été faites pour réformer la religion ; mais elles ont invariablement échoué. Peu importe le nombre de prophètes qui s’adressent aux masses pour leur dire de détruire leurs idoles et de chasser leurs prêtres, ces masses refusent d’obéir. Il leur faut simplement des roseaux auxquels s’accrocher, des esprits auxquels croire. Car elles ont toujours peur… peur…