[ p. 167 ]
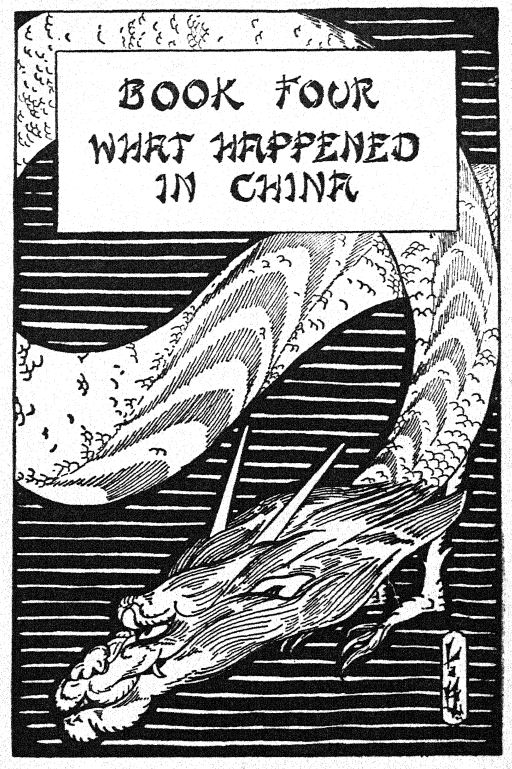
[ p. 168 ]
¶ LIVRE QUATRE — CE QUI S’EST PASSÉ EN CHINE
I. Le confucianisme
1 : La religion primitive de la Chine — le culte des ancêtres — le culte d’État — la religion populaire — les coutumes funéraires — les fêtes familiales — pourquoi la Chine a-t-elle progressé si tôt ? 2 : L’histoire de Confucius. 3 : L’œuvre de Confucius — son évangile — sa place dans l’histoire. 4 : La déification de Confucius.
II. Taoïsme
1 : La vie de Lao-Tseu — le roi Tao-Teb — l’évangile — Lao-Tseu était-il un maître religieux ? 2 : La dégénérescence du taoïsme — l’alchimie — les dieux et les prêtres — la déification de Lao-Tseu.
III. Bouddhisme
1 : Comment il est entré en Chine — pourquoi il y a réussi — son ascension et sa chute, 2 ; Le pays des « Trois Vérités » — le culte populaire.
[ p. 169 ]
¶ LIVRE QUATRE — CE QUI S’EST PASSÉ EN CHINE
I. CONFUCIANISME
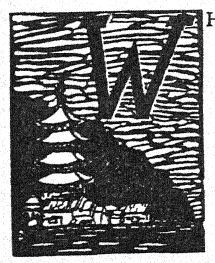
Personne ne semble savoir avec certitude quelle a pu être la plus ancienne religion de Chine. Certains érudits soutiennent qu’il s’agissait presque, voire tout à fait, d’un monothéisme, car, depuis les temps les plus reculés, les Chinois semblent avoir vénéré un Souverain suprême, généralement associé au Ciel. Cette théorie d’un monothéisme primitif est cependant difficilement acceptable, car, parallèlement au culte du Souverain suprême, l’Esprit du Ciel, se perpétuait celui de nombreux esprits de la terre. Aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps, les Chinois semblent avoir cherché l’aide des esprits qui, selon eux, animaient tous les phénomènes naturels, et en particulier les fantômes des morts. Il est donc plus sûr de décrire la plus ancienne religion de Chine comme un animisme avancé plutôt que comme un monothéisme – un animisme particulier ancré dans le culte des esprits de la nature et celui des esprits des morts. Peut-être qu’à l’origine, ces deux éléments, le culte de la nature et celui des ancêtres, étaient rivaux pour l’allégeance [ p. 170 ] du peuple ; mais plus tard, ils furent fusionnés par la croyance que le Ciel, le chef des esprits de la nature, était le premier ancêtre de l’empereur, et donc le chef aussi des esprits ancestraux.
La dévotion aux morts fut la caractéristique principale de la religion chinoise dès ses origines. Il incombait à tous les hommes, grands comme petits, de vénérer les esprits de leurs ancêtres. L’empereur vénérait l’esprit du Ciel comme son ancêtre, et les sacrifices réguliers qu’il lui offrait étaient l’occasion de grandioses rites. Dans une vaste étendue de sable déserte, juste au sud de Pékin, se dresse encore le magnifique autel de marbre blanc pur sur lequel l’empereur, vêtu d’une robe aussi azur que le ciel, se prosternait et faisait des offrandes une fois par an. On croyait que si l’empereur commettait la moindre erreur lors de ces rites annuels, le monde entier sombrerait aussitôt dans le chaos ! Et pour tout autre homme du pays, oser sacrifier à l’esprit associé au Ciel équivalait à une déclaration de rébellion. L’empereur était le chef religieux de la nation, et comme les esprits supérieurs étaient censés être ses ancêtres exclusifs, leur culte était considéré comme son privilège exclusif. Chaque année, il faisait des offrandes à l’esprit de la Terre, dont il prétendait également être le descendant. Il les faisait dans une seconde plaine sablonneuse et parsemée de pins, à l’extérieur de Pékin, avec la même pompe qu’il employait pour vénérer le Ciel. Il vénérait aussi les esprits de la terre, des récoltes et des rivières, et s’ils ne répondaient pas comme il le ferait pour un prince désobéissant, il les destituait comme il le ferait pour un prince désobéissant. Étant « Fils du Ciel [ p. 171 ] et de la Terre », il avait le droit de réduire ou d’augmenter le nombre des esprits à volonté !
Tout cela, cependant, n’était que la religion d’État. Les gens ordinaires ne pouvaient pas plus approcher le dieu appelé Ciel que l’empereur, et ils ne pouvaient pas plus participer au culte du Ciel que participer au gouvernement. Ils chérissaient donc nécessairement une religion distincte. Harcelés par les dangers et les frustrations de la vie, ils se tournaient vers les esprits de leurs ancêtres. Les funérailles étaient l’occasion de rites et d’offrandes des plus élaborés. Vêtements et nourriture étaient déposés dans les tombes. Même les serviteurs et les proches étaient parfois massacrés et enterrés avec le corps d’un homme de haut rang. La même chose se produisait, bien sûr, en Égypte à la mort d’un roi. Les pyramides regorgent de meubles et d’autres biens somptueux. Dans la Grèce antique également, cette pratique était observée, et elle y fut poussée à un tel excès que l’homme d’État Solon se sentit obligé de légiférer contre elle. Mais en Chine, où cette coutume devait aussi menacer sérieusement la stabilité économique, elle fut réprimée d’une autre manière. Là, la chose n’était pas supprimée, mais allégorisée. Ce qu’on appelait le « faire-voir » fut introduit, et désormais, les esclaves enterrés avec les corps n’étaient plus que des poupées de bois, et les vêtements étaient en papier ! De simples images de nourriture et de meubles étaient considérées comme suffisamment réelles pour être sacrifiées et enterrées avec les morts !
Ce subterfuge était peut-être possible en Chine, et non dans d’autres pays, car les Chinois adoptaient une attitude [ p. 172 ] particulière envers ceux qui avaient quitté cette vie. En Égypte, en Grèce et partout ailleurs où l’on enterrait des biens avec les morts, on admettait ouvertement que cette pratique était observée afin que les âmes des défunts soient bien soignées dans l’au-delà. Les Chinois, cependant, refusaient de l’admettre. Ils ne connaissaient rien d’autre que celui-ci et ne semblaient pas s’y être intéressés suffisamment pour spéculer à ce sujet. Il existait en Chine une croyance bien ancrée selon laquelle les morts survivaient quelque part – mais où exactement, personne ne se donnait la peine de le demander. Tout ce qui préoccupait les Chinois, c’était que les fantômes des morts reviennent aider les vivants. À cette fin, ils offraient régulièrement des sacrifices aux fantômes, les vénérant par l’intermédiaire de « persona tors » vivants qui restaient assis, immobiles, tout au long de la cérémonie, puis mangeaient une partie des offrandes. Plus tard, de simples tablettes commémoratives en pierre furent fabriquées pour remplacer ces « persona tors ». Les classes supérieures construisaient des temples pour conserver leurs tablettes ancestrales ; les classes inférieures les conservaient dans la pièce principale (généralement la seule) de leurs huttes.
Les sacrifices aux esprits des morts étaient de véritables festins familiaux. Tout l’art et le mystère de la cuisine chinoise étaient mis en œuvre pour la préparation des sauces, des condiments, des petits gâteaux et des condiments utilisés. Diverses boissons à base de millet étaient servies avec ces mets ; puis la cérémonie commençait. Avec le plus grand soin, chaque détail du rituel était exécuté, tandis que les tambours résonnaient, les flûtes grinçaient et d’énormes instruments à cordes émettaient un tintement persistant. Hommes et femmes chantaient des chansons et dansaient des pantomimes censées divertir [ p. 173 ] les fantômes présents dans la pièce. La cérémonie durait des heures durant, dépassant parfois la journée. Et puis, enfin, l’officier de prière déclarait que les fantômes étaient satisfaits. Gravement, il bénissait le célébrant en disant : « Ton sacrifice filial était parfumé, et les esprits se sont délectés des liqueurs et des mets. Ils te comblent de cent bénédictions, chacune selon tes désirs et aussi certaine que la loi. Tu as été exact et sincère, et tu seras assurément comblé de faveurs par myriades et dizaines de myriades. » Sur quoi, cloches et tambours faisaient retentir un puissant vacarme, et les esprits des morts s’en allaient poliment. Après être restés assis, invisibles comme des fantômes, tout au long de la cérémonie, après avoir écouté le bruit, humé le pudding, mangé et bu jusqu’à être présumés rassasiés, les esprits se retiraient tranquillement dans ce lieu inconnu où ils avaient leur résidence permanente. Et les célébrants, épuisés mais heureux, se levaient alors et se mettaient péniblement à débarrasser les plats…
Nulle part ailleurs au monde ne s’est développée une religion d’un caractère aussi fade. La peur y était soit inexistante, soit dissimulée sous une épaisse couche de courage et de confiance. Il n’existait pas de prière pour les morts, car aucun Chinois n’osait insulter ses ancêtres en imaginant qu’ils avaient besoin d’aide. On priait les morts, et seulement pour les rapprocher et obtenir leur aide. Bien sûr, il ne faut pas croire que les paysans chinois d’il y a trois mille ans ne connaissaient ni démons ni tabous à craindre. Mais on peut affirmer sans se tromper que, de tous les peuples anciens, les Chinois étaient les moins intimidés par de telles choses. C’est peut-être pourquoi, de tous les peuples [ p. 174 ] anciens, les Chinois furent les premiers à oser s’engager sur cette voie aventureuse que nous appelons la civilisation. Peut-être était-ce parce que les Chinois vivaient en grande partie sans terreur et complètement sans prêtres, et qu’à une époque où Athènes n’était encore qu’un village et Rome n’était pas encore construite, où la Bretagne était encore hors du monde et la Gaule n’était qu’un désert parcouru par des sauvages, la Chine était déjà une terre civilisée où les gens se promenaient en calèche, vivaient dans des maisons bien construites, s’habillaient de soie, portaient des chaussures en cuir, s’asseyaient sur des chaises, utilisaient des tables, mangeaient dans des assiettes, mesuraient le temps avec un cadran solaire et portaient des parapluies ! . . .
¶ 2
Mais si l’on ose prétendre que la religion intrépide et sans prêtres de la Chine fut responsable de son essor précoce dans la civilisation, force est de reconnaître qu’elle fut également responsable de son arrestation précoce. Aujourd’hui, la Chine est l’un des pays les plus arriérés de la planète, et il semble évident que son culte des ancêtres, tourné vers le passé, y est pour beaucoup. Car le culte des ancêtres est resté la religion orthodoxe de la Chine. Jusqu’à la révolution de 1912, on pouvait encore voir l’empereur, accompagné de sa vaste suite, se rendre aux grands autels au sud et au nord de Pékin, et y sacrifier au Ciel et à la Terre, presque exactement comme ses prédécesseurs trois mille ans plus tôt. Et bien que l’avènement d’une république en Chine ait mis fin à ce culte impérial du Ciel, le vieux culte familial des fantômes des ancêtres persiste. Il est peut-être bien moins naïf et grossier aujourd’hui qu’il ne l’était lorsque la nuit de la barbarie venait à peine de se lever en Chine ; mais de tous les [ p. 175 ]des religions du monde, celle qui a subi le moins d’altération au fil du temps.
En Occident, il est d’usage de qualifier le culte orthodoxe des ancêtres en Chine de confucianisme. Il ne faut cependant pas croire que la figure de Confucius soit liée à cette religion comme, par exemple, Bouddha est lié au bouddhisme, ou Mahomet à l’islam. Confucius n’en fut nullement le fondateur, ni même son réformateur. Il en fut plutôt le conservateur, s’en emparant il y a deux mille cinq cents ans, alors qu’elle commençait à peine à décliner, et la ravivant afin qu’elle demeure désormais la force dominante de la vie des Chinois. Il se disait lui-même « non pas un créateur, mais un transmetteur, croyant et aimant les anciens » – et il ne démentit guère cette description.
Confucius, dont le nom chinois était Kung-fu-tze, vécut au VIe siècle av. J.-C., qui vit naître Mahavira et Bouddha en Inde, Zoroastre (peut-être) en Perse, et Jérémie, Ézéchiel et le second Isaïe en Israël. Il naquit en 551 av. J.-C. et nous ne savons pratiquement rien de sa jeunesse. Tout ce que l’on nous dit de crédible, c’est qu’à vingt-deux ans, il était déjà un enseignant, et un enseignant extraordinairement populaire. Mais ses disciples semblent avoir été très différents de ceux de la plupart des autres jeunes enseignants qui ont marqué la civilisation. Ceux qui siégeaient aux pieds de Confucius n’étaient pas des rebelles zélés, mais des étudiants pieux. Car Confucius lui-même n’était en aucun cas un rebelle. C’était un antiquaire, un homme qui aimait les anciens et se consacrait de tout son cœur à l’étude de leur sagesse et de leurs voies. Très tôt, il acquit la réputation d’un [ p. 176 ] expert dans les anciennes coutumes rituelles, et il comptait parmi les grandes expériences de sa vie l’occasion qui lui était un jour venue de visiter Pékin et d’inspecter les lieux où les grands sacrifices au Ciel et à la Terre étaient offerts.
Confucius consacra de nombreuses années à rassembler et à éditer les écrits anciens de son peuple, et il ne fut appelé à se consacrer aux affaires pratiques qu’à l’âge de cinquante ans. En 501, il fut nommé magistrat en chef d’une ville nommée Chungtu ; la tradition rapporte qu’en l’espace d’un an, il avait débarrassé cette ville de toute trace de crime. Il accomplit ce miracle en soumettant toute vie à une étiquette complexe. Même la nourriture des différentes classes était réglementée. Tous les êtres vivants étaient enrégimentés, et même les corps étaient déposés dans des cercueils d’une épaisseur prescrite et enterrés dans des tombes de forme prescrite !
C’est alors que, selon l’histoire, le duc de la province éleva Confucius à des fonctions toujours plus élevées, le nommant finalement ministre de la Justice. En tant que ministre de la Justice, Confucius harcelait la population avec tant de règles et de règlements qu’en très peu de temps, toute la province devint un État modèle et que toutes les lois contre le crime tombèrent en désuétude. « La malhonnêteté et la débauche étaient honteuses. La loyauté et la bonne foi caractérisaient chaque homme, et la chasteté et la soumission honoraient chaque femme. Des étrangers accoururent en foule d’autres villes, et la renommée de Kungfu-tze, l’idole du peuple, jaillissait de toutes les bouches » — du moins, c’est ce que déclarent les biographes du sage, pourtant assez peu impartiaux.
[ p. 177 ]
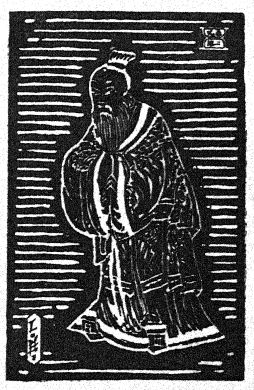
Mais les choses allèrent trop bien pour durer longtemps. Les princes voisins, jaloux de la prospérité et de la paix de la province réformée, séduisirent l’esprit du duc en lui offrant des chevaux rapides et des danseuses encore plus rapides. Le ministre thaumaturge, se retrouvant soudain en disgrâce, secoua tristement – et très lentement, car il espérait jusqu’au bout que le duc se repentirait – la poussière de la province ingrate. Il commença à parcourir la Chine, allant d’une cour à l’autre et offrant généreusement ses services à chaque prince et ministre qu’il rencontrait. Avec une assurance naïve, il leur dit : « En douze mois, je pourrais opérer de grands changements, et en trois ans, je pourrais tout perfectionner ! » Mais il n’y avait personne dans le pays pour profiter de son offre. Il erra pendant treize longues années sans trouver un seul dirigeant disposé à lui donner un emploi. De toute évidence, il était regardé avec suspicion par les princes et le peuple, et au moins une fois, il fut attaqué par une foule et faillit être assassiné. Bien des jours, il fut contraint de se passer de nourriture et bien des nuits, il resta sans abri. Pourtant, durant toutes ces années, son cœur ne l’abandonna [ p. 178 ] pas. Obstinément, il demeura confiant que le Ciel le protégerait dans sa mission de vérité et, malgré tous les découragements, il continua d’espérer une chance de sauver le monde.
Mais enfin, le jour arriva où il ne put plus errer. La vie commença à décliner, et, plein de chagrin, il retourna dans sa province natale pour passer ses derniers jours à étudier ses précieux manuscrits anciens. Son corps se ratatina, se transformant en un sac jaune et sec, et son courage s’étiola jusqu’à disparaître. Peut-être devint-il grincheux vers la fin ; il devint certainement plaintif et impuissant. « La grande montagne vacille », marmonna-t-il tandis que la mort l’envahissait ; « Oui, la poutre robuste se brise, et le sage se fane comme une plante ! Personne dans l’empire ne fera de moi son maître ! En vérité, mon heure est venue de mourir ! »
. . . Et ainsi finit la vie de Kung-furtze. . . .
¶ 3
Il est évident que cet homme, l’un des plus grands de l’histoire, mérite difficilement d’être qualifié de prophète religieux. Les prophètes sont presque invariablement des rebelles, de saints hérétiques en rupture permanente avec le passé. Mais cet homme, Confucius, ne cherchait pas à rompre avec le passé, mais plutôt à combler la brèche déjà ouverte. Et il y parvint. Par son travail assidu pour éditer les anciens écrits sacrés de la Chine et établir leur autorité suprême, il imposa à son peuple un joug qu’il n’a pu, à ce jour, secouer. […] Ce n’est pas le lieu ici d’aborder les livres, les cinq rois et les quatre shu, que lui ou ses disciples immédiats sont censés avoir écrits. [ p. 179 ] Il s’agit pour l’essentiel de recueils d’hymnes rituels anciens, de lois cérémonielles, de « permutations » magiques, de chroniques historiques et de proverbes. Leur importance pour nous ne repose pas sur leur propre mérite, mais uniquement sur le fait, bien que très réel et presque incroyable, qu’ils ont dominé, presque jusqu’à ce jour, la vie et la pensée de toute la Chine savante. C’est aussi sur ce fait que repose l’importance de Confucius. Il n’était en aucun cas un innovateur. Il n’a apporté aucune idée, pratique ou expérience nouvelle à la religion héritée de son pays. Mais il fut surtout un conservateur. Il s’est emparé d’une religion déjà ancienne et décadente et, à force d’organiser ses traditions dispersées, a réussi à lui insuffler une vie impérissable. On peut se demander si un autre homme dans toute l’histoire a eu une influence plus durable sur un peuple que ce vieux sage du Shandong qui, de son vivant, n’a même pas pu trouver un emploi !…
Mais bien que Confucius ait organisé et pratiquement établi une grande religion, lui-même, au sens strict, n’était pas un homme religieux. Il connaissait très peu les dieux et semble s’en être peu soucié. Lorsqu’un disciple l’interrogea sur le service des esprits, il aurait répondu : « Tant que tu ne peux pas servir les hommes, comment peux-tu servir les esprits ? » Il n’avait pas non plus un mot à dire sur l’autre monde. « Tant que tu ne connais pas la vie », déclara-t-il, « comment peux-tu connaître la mort ? » Il ne voyait aucune raison de prier et méprisait tout intérêt pour le surnaturel. « Se consacrer avec ferveur au service des hommes et, tout en respectant les esprits, ne pas en faire grand cas, voilà ce qui est sage », dit-il. . . . Il est donc clair que Confucius [ p. 180 ] n’avait guère de cette peur ni de cette humilité qui poussent les hommes à implorer l’aide des dieux. Il ne voyait guère la nécessité des dieux, car il croyait en lui-même, en sa propre puissance d’homme juste. « Ce qu’un homme supérieur recherche », déclarait-il, « c’est lui-même ! »… Confucius pensait que si un homme se conduisait avec bienséance, la frustration et le désespoir étaient impossibles. Il croyait au pouvoir moral des actes tout autant que son ancêtre sauvage aurait pu croire à l’efficacité des sortilèges. En effet, on rapporte qu’il déclara un jour que la course des étoiles était uniquement déterminée par la bienséance morale de l’homme. Ce n’est donc pas sans raison que Confucius peut être décrit comme un chaman qui s’appuyait sur des prescriptions morales plutôt que sur des rites magiques pour contrôler l’univers. Sa plus grande contribution se situe dans le domaine de l’éthique, et ses proverbes sont cités – et, du moins, observés en cas de manquement – encore aujourd’hui. On n’y trouve ni idéalisme extravagant, ni insolence exagérée. Des proverbes guident l’humanité trop humaine, et l’extravagance n’y a pas sa place. « C’est une folie de se retirer du monde », déclarait Confucius, « et de fréquenter des oiseaux et des bêtes qui ne sont pas nos semblables. Avec qui devrais-je fréquenter, sinon l’humanité souffrante ?… »
Mais il est important de résister à la tentation d’exagérer la majesté de Confucius, même en tant que maître d’éthique. La tendance courante à le classer parmi les grands sages qui se sont distingués en Grèce un siècle ou deux plus tard est peu justifiée. Il est vrai qu’ils étaient eux aussi tout à fait disposés à plier le genou devant n’importe quel dieu, [ p. 181 ] pourvu qu’on les laisse plier leurs pensées comme ils le voulaient. Mais ils différaient de Confucius en ce qu’ils orientaient leurs pensées vers le nouveau, et non vers l’ancien. Ils osaient s’aventurer dans des terres vierges de l’esprit, ouvrant des sentiers à travers des étendues sauvages qu’aucun esprit humain n’avait encore traversées. Mais Confucius ? Il n’a déployé les forces de sa raison que dans les landes délabrées et défoncées du passé. Il a peut-être douté de l’existence des dieux antiques, mais il n’a jamais douté de la validité des anciens rites qui leur étaient rendus. Il considérait qu’il incombait à tous les hommes d’adorer avec le plus grand soin, non pas tant pour le bienfait des esprits vénérés que pour la discipline des hommes qui accomplissaient ce culte. La bienséance, la régularité, l’observance exacte et méticuleuse des « trois cents points de cérémonie et des trois mille points de comportement » étaient les buts ultimes de la vie. Confucius lui-même, nous dit-on, a poussé ce rituel de régularité jusqu’à des extrêmes tout à fait fantastiques. Même sa posture, endormie, obéissait à une règle fixe ! […] Tout devait être ordonné, car « l’ordre est le Ciel », seule loi. Tout changement était néfaste, et le salut ne pouvait être obtenu que si personne ne cherchait à perturber l’ordre religieux, social et politique déjà établi. Bien sûr, il fallait remonter à l’autorité suprême pour les détails de cet ordre, jusqu’au passé glorieux. Tout ce qui appartenait aux pères semblait à Confucius être ennemi des fils. La piété filiale, le respect des ancêtres, était à ses yeux la plus haute des vertus.
Et, exaltant cette vertu, il mourut.
[ p. 182 ]
¶ 4
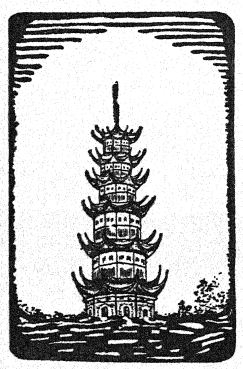
Mais alors, Confucius reprit une nouvelle vie. Des disciples dévoués consignèrent ses paroles dans d’immenses recueils appelés les « Entretiens ». La mémoire du grand sage commença à s’accroître, surtout au siècle suivant, lorsqu’un nouveau disciple, Mencius, apparut pour propager ses doctrines. Au IIIe siècle, un usurpateur du trône victorieux fit de son mieux pour éradiquer cette prolifération, car sa condamnation inflexible de toute non-conformité et de tout changement rendait sa vie rebelle indescriptiblement difficile. Cet empereur déploya des efforts systématiques pour détruire tous les confucéens et exterminer tous ceux qui les connaissaient par cœur. Mais il échoua, et lorsqu’un membre d’une dynastie ancienne regagna le trône impérial, Confucius connut un essor sans précédent. Confucius lui-même fut exalté jusqu’à devenir un véritable dieu. En l’an 1 de notre ère, le vieil antiquaire fut canonisé. Il fut officiellement nommé « Duc Ni, le Très-Complet et le Très-Illustre ». En 57 après J.-C., il fut ordonné que des sacrifices lui soient offerts dans tous les collèges. … En l’an 89, il fut élevé [ p. 183 ] au rang impérial supérieur de « comte », et en 267, il fut décrété que des sacrifices d’animaux plus élaborés lui seraient offerts quatre fois par an. … En 492, un plus grand honneur lui fut rendu et il fut officiellement canonisé « le Vénérable Ni, le Sage Accompli ». … En 555, des temples distincts pour le culte de Confucius furent ordonnés dans les capitales de toutes les préfectures de Chine, et en 740, son image fut déplacée du côté au centre du Collège impérial, pour se tenir aux côtés des rois historiques de Chine. . . . En 1068, il fut élevé au rang d’empereur., . . Et finalement en 1907 l’Impératrice Douairière l’éleva au premier degré de culte, le classant au même rang que les divinités du Ciel et de la Terre !
Et c’est ainsi que celui qui, de son vivant, fut battu et ligoté est désormais un dieu pour toute la Chine. Lui qui n’avait aucun refuge possède désormais plus de mille cinq cents temples pour abriter ses tablettes ; celui qui mourait de faim voit désormais plus de soixante-deux mille animaux offerts à son esprit chaque année. Pire encore, lui qui ne voyait aucune raison de prier est devenu lui-même l’objet de prières, et lui qui se moquait des dieux est devenu l’égal du Ciel… Ironie du sort !