[p. v]
La dernière partie de la préface des « Mémoires sur les choses anciennes » constitue la seule autorité documentaire sur l’origine de l’ouvrage. Elle en explique également la portée. Mais bien que l’auteur adopte ainsi un style plus concret que les phrases chinoises pompeuses et les allusions élaborées qu’il avait présentées, son propos peut néanmoins manquer de clarté, et il serait judicieux de présenter les faits dans un langage plus intelligible pour l’étudiant européen. M. Satow l’ayant déjà fait dans son article sur le « Renouveau du Shintō pur » [1], il est préférable de se contenter de citer ses propos. Elles sont les suivantes : « L’empereur Temmu, dont la période de son règne n’est pas mentionnée, déplorant que les archives détenues par les principales familles contiennent de nombreuses erreurs, résolut de prendre des mesures pour préserver les véritables traditions de l’oubli. Il fit donc examiner, comparer et épurer soigneusement les archives. Il se trouvait dans sa maisonnée une personne d’une mémoire merveilleuse nommée Hiyeda no Are, qui pouvait répéter sans erreur le contenu de tout document qu’il avait vu, et n’oubliait jamais rien de ce qu’il avait entendu. Temmu Tennō [2] prit la peine d’instruire cette personne dans les traditions authentiques et le « vieux langage des âges passés », et de les lui faire répéter jusqu’à ce qu’il les apprenne tout par cœur. « Avant que l’entreprise ne soit achevée », ce qui signifie probablement avant qu’elle ne puisse être mise par écrit, [p. vi] l’empereur mourut, et pendant vingt-cinq ans, la mémoire d’Are fut l’unique dépositaire de ce qui reçut plus tard ce titre. du Kojiki [3] ou Furu-koto-bumi, tel que le lit Motoori. À la fin de cet intervalle, l’impératrice Gemmiō ordonna à Yasumaro de le transcrire de la bouche d’Are, ce qui explique l’achèvement du manuscrit en seulement quatre mois et demi. L’âge d’Are à cette date n’est pas précisé, mais comme il avait vingt-huit ans sous le règne de Temmu Tennō, il ne pouvait pas dépasser soixante-huit ans. Compte tenu de la précédente commande de Temmu Tennō en 681 pour la compilation d’une histoire, et de l’affirmation selon laquelle il était occupé à la composition du Kojiki à sa mort en 686, il ne serait pas déraisonnable de conclure qu’il date de la dernière année de son règne, auquel cas Are n’avait que cinquante-trois ans en 711.
On suppose généralement que l’ordre précédent de l’empereur Temmu, mentionné dans l’extrait ci-dessus, a abouti à la compilation d’une histoire qui fut rapidement perdue. Mais Hirata avance des raisons de supposer que ce projet et celui des « Archives des Affaires Anciennes » étaient identiques. Si l’on accepte cette opinion, les « Archives », bien que le plus ancien livre japonais existant, sont, non pas le troisième, mais le deuxième ouvrage historique dont il soit fait mention, l’un d’eux ayant été compilé en 620, mais perdu dans un incendie en 645. On voit donc qu’il est assez difficile de déterminer qui désigner comme l’auteur de l’ouvrage. [p. vii] L’empereur Temmu, Hiyeda no Are et Yasumaro peuvent tous trois revendiquer ce titre. La question, cependant, n’a aucune importance pour nous, et la part prise par Are pourrait bien avoir été exagérée dans le récit. Ce qui semble rester comme résidu de fait est que le projet d’une histoire purement nationale est né avec l’empereur Temmu et a finalement été réalisé sous son successeur par Yasumaro, l’un des nobles de la cour.
Des preuves plus complètes et des preuves confirmatives provenant d’autres sources quant à l’origine de nos « Archives » seraient sans doute tout à fait acceptables. Mais le très petit nombre de lecteurs et d’écrivains à cette époque reculée, et la compilation quasi simultanée d’une histoire (les « Chroniques du Japon ») plus adaptée au goût de l’époque, rendent l’absence de telles preuves presque inévitable. Quoi qu’il en soit, et notons simplement en passant que le Japon n’a jamais été connu, jusqu’à ces dernières années, pour de telles contrefaçons littéraires massives (la condamnation par Motowori des « Chroniques des choses anciennes des âges passés » ayant été jugée téméraire par les érudits ultérieurs), on ne saurait trop insister sur le fait que, dans ce cas précis, l’authenticité est suffisamment prouvée par des preuves internes. Il est difficile de croire qu’un faussaire vivant après le VIIIe siècle de notre ère ait pu si bien se débarrasser du « rembourrage » chinois apporté aux anciennes traditions, qui, après l’acceptation des « Chroniques du Japon » par la Cour, en était généralement venue à être considérée comme partie intégrante de ces mêmes traditions ; Français et il est encore plus improbable qu’il ait inventé un style si peu propre à faire connaître son œuvre. Il aurait soit écrit dans un chinois correct, comme la plupart des premiers prosateurs japonais (et sa préface [p. viii] montre qu’il pouvait le faire s’il en avait eu envie) ; soit, si la tradition d’une histoire écrite dans la langue maternelle lui était parvenue, il aurait donné à sa composition une forme indubitablement japonaise en organisant un usage cohérent des caractères employés phonétiquement pour désigner les particules et les terminaisons, à la manière suivie dans les Rituels, et développé (apparemment avant la fin du IXe siècle) dans ce qui est techniquement connu sous le nom de « style phonétique mixte » (Kana-mazhiri), qui est resté depuis lors le véhicule le plus pratique pour écrire la langue. En l’état actuel des choses, sa construction quasi chinoise, qui s’effondre de temps à autre pour être relancée par quelques mots japonais écrits phonétiquement, constitue assurément la première tentative maladroite de combiner deux éléments divergents. Ce qui est tout simplement incroyable, en revanche, c’est que, si le prétendu faussaire a vécu ne serait-ce qu’un siècle après 712 après J.-C., il ait pu si bien imiter ou deviner les archaïsmes de cette époque reculée. Car le VIIIe siècle de notre ère marque un tournant majeur dans la langue japonaise, le dialecte archaïque étant alors remplacé par le dialecte classique ; et comme seules la langue et la littérature chinoises étaient désormais considérées comme dignes d’intérêt, il était impossible de conserver la connaissance de la diction des règnes antérieurs, et les poètes de l’époque n’ont jamais tenté d’agrémenter leurs vers d’une phraséologie désuète. C’était une affectation réservée à une époque ultérieure, lorsque la diffusion des livres le rendit possible.Français Les poètes des septième, huitième et neuvième siècles écrivaient apparemment comme ils parlaient ; et le seul critère de la langue nous permettrait presque d’arranger leurs compositions demi-siècle par demi-siècle, même sans les dates [p. ix] qui sont données à maintes reprises dans le « Recueil d’une myriade de feuilles » et dans le « Recueil de chansons [7] anciennes et modernes », les deux premiers recueils de poèmes publiés par décret impérial respectivement au milieu du huitième et au début du dixième siècle.
Les remarques ci-dessus s’appliquent plus particulièrement aux rares mots japonais, tous archaïques, qui, comme mentionné plus haut, sont utilisés de temps à autre dans le texte en prose des « Archives », pour éclairer le sens de l’auteur et préserver la prononciation exacte des noms qu’il souhaitait transmettre. Qu’il ait inventé les Chants serait une supposition trop monstrueuse pour être admise, même si nous n’en avions pas beaucoup, identiques ou similaires, conservés dans les pages des « Chroniques du Japon », un ouvrage sans doute achevé en 720 apr. J.-C. L’histoire de la langue japonaise nous est trop bien connue ; nous pouvons retracer son développement et son déclin dans trop de documents remontant du VIIIe siècle à nos jours, pour que l’on puisse envisager que le dernier de ces Chants, transmis avec un soin minutieux dans une transcription syllabique, soit postérieur à la première moitié du VIIIe siècle, tandis que la plupart doivent être attribués à une date antérieure, quoique incertaine. Si nous reportons la plupart d’entre eux, sous leur forme actuelle, au VIe siècle, et accordons une antiquité supplémentaire d’un ou deux siècles à d’autres plus anciens par leur sentiment et leur usage grammatical, nous ferons probablement une estimation modérée. Cette estimation est d’ailleurs confirmée par le fait que la première mention que nous ayons de l’usage de l’écriture au Japon date du [p. x] début du Ve siècle ; car il est naturel de supposer que les Chants que l’on croit avoir été composés par les dieux et les héros de l’Antiquité ont dû être parmi les premiers à être consignés par écrit, tandis que le respect qu’on leur portait les conduisait parfois à être transcrits exactement tels que la tradition les avait légués, même inintelligibles ou presque, tandis que dans d’autres cas, le même sentiment conduisait à corriger ce que l’on supposait être des erreurs ou des inélégances. Enfin, il convient de noter que l’authenticité des « Archives » n’a jamais été mise en doute, bien que, comme nous l’avons déjà mentionné, certains commentateurs autochtones n’aient pas hésité à accuser de fausseté une autre de leurs histoires anciennes les plus estimées. Or, il est peu probable que, dans la guerre qui a opposé les partisans des « Archives » à ceux des « Chroniques », une faille dans le droit des premières à l’authenticité et à la priorité n’ait pas été découverte et signalée, si elle existait.
Au Moyen Âge, alors qu’aucun ouvrage japonais n’était imprimé, et que peu d’autres, à l’exception des classiques chinois et des Écritures bouddhiques, étaient publiés, les « Mémoires des choses anciennes » restèrent manuscrits entre les mains du clergé shintō. Leur première impression date de 1644, époque à laquelle, la paix étant enfin rétablie dans le pays et le goût de la lecture se diffusant, la majeure partie de la littérature indigène commença à émerger de l’état manuscrit. Cette édition très rare (réimprimée en fac-similé en 1798) est indispensable à quiconque souhaite étudier les « Mémoires » en profondeur. L’édition suivante, due à un prêtre shintō, Deguchi Nobuyoshi, parut en 1687. Elle comporte des notes marginales [p. xi] sans grande valeur, et plusieurs corrections du texte. La première de ces deux éditions mentionnées est communément appelée « Ancienne Édition Imprimée » (  ), mais ne porte pas d’autre titre que celui de l’ouvrage original : « Récits d’Anciens Faits avec Lectures Marginales » (
), mais ne porte pas d’autre titre que celui de l’ouvrage original : « Récits d’Anciens Faits avec Lectures Marginales » (  ). Chacune est en trois volumes. Elles furent suivies entre 1789 et 1822 par la grande édition de Motowori, intitulée « Exposition des Récits d’Anciens Faits » (
). Chacune est en trois volumes. Elles furent suivies entre 1789 et 1822 par la grande édition de Motowori, intitulée « Exposition des Récits d’Anciens Faits » (  ). Cet ouvrage, peut-être le plus admirable dont puisse se vanter l’érudition japonaise, se compose de quarante-quatre gros volumes, dont quinze consacrés à l’élucidation du premier volume de l’original, dix-sept au deuxième, dix au troisième, et le reste aux prolégomènes, index, etc. Pour l’étudiant ordinaire, ce commentaire fournira tout ce dont il a besoin, et le charme du style de Motowori apportera un charme particulier aux passages les plus arides de l’ouvrage original. Le jugement de l’auteur ne semble le trahir qu’occasionnellement face aux passages les plus difficiles ou corrompus, ou susceptibles d’être interprétés d’une manière défavorable à ses prédilections de shintoïste fervent. Il cite fréquemment les opinions de son maître Mabuchi, dont le traité sur ce sujet est si rare que l’auteur n’en a jamais vu d’exemplaire, et que la bibliothèque publique de Tokyo n’en possède pas. Français Les éditions ultérieures et moins importantes sont les « Registres des choses anciennes avec la lecture ancienne » (
). Cet ouvrage, peut-être le plus admirable dont puisse se vanter l’érudition japonaise, se compose de quarante-quatre gros volumes, dont quinze consacrés à l’élucidation du premier volume de l’original, dix-sept au deuxième, dix au troisième, et le reste aux prolégomènes, index, etc. Pour l’étudiant ordinaire, ce commentaire fournira tout ce dont il a besoin, et le charme du style de Motowori apportera un charme particulier aux passages les plus arides de l’ouvrage original. Le jugement de l’auteur ne semble le trahir qu’occasionnellement face aux passages les plus difficiles ou corrompus, ou susceptibles d’être interprétés d’une manière défavorable à ses prédilections de shintoïste fervent. Il cite fréquemment les opinions de son maître Mabuchi, dont le traité sur ce sujet est si rare que l’auteur n’en a jamais vu d’exemplaire, et que la bibliothèque publique de Tokyo n’en possède pas. Français Les éditions ultérieures et moins importantes sont les « Registres des choses anciennes avec la lecture ancienne » (  ), une réimpression par l’un des élèves de Motowori du texte chinois et de la lecture Kana de son maître sans son commentaire, et utile comme référence, bien que le titre soit [9] un abus de langage, 1803 ; les « Registres des choses anciennes avec notes marginales » (
), une réimpression par l’un des élèves de Motowori du texte chinois et de la lecture Kana de son maître sans son commentaire, et utile comme référence, bien que le titre soit [9] un abus de langage, 1803 ; les « Registres des choses anciennes avec notes marginales » (  ), par Murakami Tadanori, 1874 ; les « Registres des choses anciennes dans le caractère syllabique [p. xii] » (
), par Murakami Tadanori, 1874 ; les « Registres des choses anciennes dans le caractère syllabique [p. xii] » (  ) de Sakata no Kaneyasu, 1874, un livre trompeur, car il donne la lecture moderne Kana avec ses honorifiques insérés arbitrairement et autres écarts par rapport au texte réel, comme ipissima verba de l’œuvre originale ; les « Registres des choses anciennes révisés » (
) de Sakata no Kaneyasu, 1874, un livre trompeur, car il donne la lecture moderne Kana avec ses honorifiques insérés arbitrairement et autres écarts par rapport au texte réel, comme ipissima verba de l’œuvre originale ; les « Registres des choses anciennes révisés » (  ), d’Uematsu Shigewoka, 1875. Toutes ces éditions sont en trois volumes, et les « Registres des choses anciennes avec la lecture ancienne » ont également été réimprimés en un seul volume sur un beau papier fin. Un autre en quatre volumes de Fujihara no Masaoki, 1871, intitulé les « Registres des choses anciennes dans le caractère divin » (
), d’Uematsu Shigewoka, 1875. Toutes ces éditions sont en trois volumes, et les « Registres des choses anciennes avec la lecture ancienne » ont également été réimprimés en un seul volume sur un beau papier fin. Un autre en quatre volumes de Fujihara no Masaoki, 1871, intitulé les « Registres des choses anciennes dans le caractère divin » (  ), est une véritable curiosité littéraire, bien qu’autrement sans valeur. L’éditeur a pris la peine de reproduire l’ouvrage entier, selon sa lecture moderne Kana, dans cette adaptation de l’écriture alphabétique coréenne que certains auteurs japonais modernes ont supposé être des caractères d’un âge et d’une sainteté particuliers, utilisés par les anciens dieux de leur pays et nommés en conséquence « Caractères Divins ».
), est une véritable curiosité littéraire, bien qu’autrement sans valeur. L’éditeur a pris la peine de reproduire l’ouvrage entier, selon sa lecture moderne Kana, dans cette adaptation de l’écriture alphabétique coréenne que certains auteurs japonais modernes ont supposé être des caractères d’un âge et d’une sainteté particuliers, utilisés par les anciens dieux de leur pays et nommés en conséquence « Caractères Divins ».
Outre ces éditions des « Mémoires des choses anciennes », il existe une masse considérable d’ouvrages portant moins directement sur le même ouvrage, et qu’il est impossible de recenser ici. Il suffit peut-être de mentionner le « Récit correct de l’âge divin » (  ) de Motowori, 3 vol. 1789, et un commentaire intitulé « Tokiha-Gusa » (
) de Motowori, 3 vol. 1789, et un commentaire intitulé « Tokiha-Gusa » ( 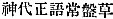 ) de Wosada Tominobu, dont le présent traducteur a emprunté quelques idées ; les « Sources des histoires anciennes » (
) de Wosada Tominobu, dont le présent traducteur a emprunté quelques idées ; les « Sources des histoires anciennes » (  ) et sa suite intitulée « Exposition des histoires anciennes » (
) et sa suite intitulée « Exposition des histoires anciennes » (  ), par Hirata Atsutane, dont l’impression a commencé en 1819, — des ouvrages particulièrement admirables d’un point de vue philologique, et dans lesquels l’étudiant trouvera [p. xiii] la solution de nombreuses difficultés qui, même pour Motowori, avaient été insurmontables ; [4] le « Idzu no Chi-Waki » (
), par Hirata Atsutane, dont l’impression a commencé en 1819, — des ouvrages particulièrement admirables d’un point de vue philologique, et dans lesquels l’étudiant trouvera [p. xiii] la solution de nombreuses difficultés qui, même pour Motowori, avaient été insurmontables ; [4] le « Idzu no Chi-Waki » (  ), de Tachibana no Moribe, dont l’impression a commencé en 1851, est un commentaire utile sur les « Chroniques du Japon » ; le [19] « Idzu no Koto-Waki » (
), de Tachibana no Moribe, dont l’impression a commencé en 1851, est un commentaire utile sur les « Chroniques du Japon » ; le [19] « Idzu no Koto-Waki » (  ), du même auteur, dont l’impression a commencé en 1847, une aide précieuse pour la compréhension des chansons contenues dans les « Records » et les « Chroniques l’examen des mots difficiles » (
), du même auteur, dont l’impression a commencé en 1847, une aide précieuse pour la compréhension des chansons contenues dans les « Records » et les « Chroniques l’examen des mots difficiles » (  , également intitulé
, également intitulé  ), en 3 vol., 1831, une sorte de dictionnaire de termes et d’expressions particulièrement déroutants, dans lequel la lumière est jetée sur de nombreux points cruciaux verbaux et une grande originalité de pensée est affichée ; Français et le « Commentaire perpétuel sur les Chroniques du Japon » (
), en 3 vol., 1831, une sorte de dictionnaire de termes et d’expressions particulièrement déroutants, dans lequel la lumière est jetée sur de nombreux points cruciaux verbaux et une grande originalité de pensée est affichée ; Français et le « Commentaire perpétuel sur les Chroniques du Japon » (  ), par Tanigaha Shisei, 1762, un ouvrage minutieux écrit en chinois, 23 vol. Il ne faut pas non plus oublier le « Kō Gan Shō », (
), par Tanigaha Shisei, 1762, un ouvrage minutieux écrit en chinois, 23 vol. Il ne faut pas non plus oublier le « Kō Gan Shō », (  ), un commentaire sur les Chants contenus dans les « Chroniques » et les « Archives » composé par le prêtre bouddhiste Keichiū, que l’on peut qualifier de père de l’école critique locale. Il est vrai que la plupart des jugements de Keichiū sur des points douteux ont été remplacés par l’érudition plus parfaite des temps ultérieurs ; mais quelques-unes de ses interprétations peuvent encore être suivies avec avantage. Le « Kō Gan Shō », achevé en 1691, n’a jamais été imprimé. Il est tiré de ces ouvrages et de quelques autres, ainsi que de dictionnaires et d’ouvrages de référence, tels que « Classification et explication des mots japonais » (
), un commentaire sur les Chants contenus dans les « Chroniques » et les « Archives » composé par le prêtre bouddhiste Keichiū, que l’on peut qualifier de père de l’école critique locale. Il est vrai que la plupart des jugements de Keichiū sur des points douteux ont été remplacés par l’érudition plus parfaite des temps ultérieurs ; mais quelques-unes de ses interprétations peuvent encore être suivies avec avantage. Le « Kō Gan Shō », achevé en 1691, n’a jamais été imprimé. Il est tiré de ces ouvrages et de quelques autres, ainsi que de dictionnaires et d’ouvrages de référence, tels que « Classification et explication des mots japonais » (  ), le « Catalogue des noms de famille » (
), le « Catalogue des noms de famille » (  ),Français et (en descendant vers des temps plus modernes) le « Tōga » d’Arawi Hakuseki (
),Français et (en descendant vers des temps plus modernes) le « Tōga » d’Arawi Hakuseki (  ), que le traducteur a tiré la plus grande aide. La majorité des citations utiles des dictionnaires, etc., ayant été incorporées par Motowori dans son « Commentaire », il n’a pas souvent été nécessaire de les mentionner nommément dans les notes de la traduction. En même temps, le traducteur doit exprimer sa conviction que, comme les autorités indigènes ne peuvent en aucun cas être supprimées, leurs affirmations doivent également être soigneusement pesées et acceptées seulement avec discernement par l’enquêteur européen critique. Français Il doit également remercier M. Tachibana no Chimori, petit-fils de l’éminent érudit Tachibana no Moribe, pour l’avoir aimablement autorisé à utiliser les parties inédites de l’« Idzu no Chi-Waki » et de l’« Idzu no Katō-Waki », ouvrages indispensables à la compréhension de la partie la plus difficile du texte des « Archives ». Il est redevable à M. Satow des équivalents anglais et latins des noms botaniques japonais, au capitaine Blakiston et à M. Namiye Motokichi pour une aide similaire en ce qui concerne les noms zoologiques.
), que le traducteur a tiré la plus grande aide. La majorité des citations utiles des dictionnaires, etc., ayant été incorporées par Motowori dans son « Commentaire », il n’a pas souvent été nécessaire de les mentionner nommément dans les notes de la traduction. En même temps, le traducteur doit exprimer sa conviction que, comme les autorités indigènes ne peuvent en aucun cas être supprimées, leurs affirmations doivent également être soigneusement pesées et acceptées seulement avec discernement par l’enquêteur européen critique. Français Il doit également remercier M. Tachibana no Chimori, petit-fils de l’éminent érudit Tachibana no Moribe, pour l’avoir aimablement autorisé à utiliser les parties inédites de l’« Idzu no Chi-Waki » et de l’« Idzu no Katō-Waki », ouvrages indispensables à la compréhension de la partie la plus difficile du texte des « Archives ». Il est redevable à M. Satow des équivalents anglais et latins des noms botaniques japonais, au capitaine Blakiston et à M. Namiye Motokichi pour une aide similaire en ce qui concerne les noms zoologiques.
[11] En comparant ce qui précède avec ce que l’auteur nous dit dans sa préface, la nature du texte, en ce qui concerne la langue, sera facilement comprise. Les Chants sont écrits phonétiquement, syllabe par syllabe, dans ce que l’on appelle techniquement Manyō-Gana, c’est-à-dire des caractères chinois entiers utilisés pour représenter le son et non le sens. Le reste du texte, en prose, est rédigé dans un chinois très pauvre, susceptible (en raison de la nature idéographique du caractère chinois écrit [5]), d’être lu en japonais. Il est non seulement rempli de « japonismes ». Mais [p. xv] irrégulièrement parsemé de caractères qui rendent le texte absurde pour un Chinois, car ils sont utilisés phonétiquement pour représenter certains mots japonais, pour lesquels l’auteur n’a pu trouver d’équivalents chinois appropriés. Ces mots écrits phonétiquement prouvent, même en dehors de la mention de la préface, que le texte n’a jamais été destiné à être lu en chinois pur. Il est probable que (le sens étant considéré comme plus important que le son) il a été lu en partie en chinois et en partie en japonais, selon un mode qui a depuis été systématisé et est devenu presque universel dans ce pays, même pour la lecture de textes chinois authentiques. L’école moderne des lettrés japonais, qui pousse sa haine de tout ce qui est étranger jusqu’aux limites du fanatisme, soutient cependant que ce livre, leur plus ancien et le plus vénéré, était dès l’origine destiné à être lu exclusivement en japonais. S’appuyant sur d’autres sources de notre connaissance du dialecte archaïque, Motowori a même risqué une restauration de la lecture japonaise de l’intégralité du texte en prose, dans lequel aucun mot chinois n’est utilisé, à l’exception des titres des deux livres chinois (les « Entretiens confucéens » et l’« Essai en mille caractères ») qui auraient été apportés au Japon sous le règne de l’empereur Ō-jin, et des noms d’un roi coréen et de trois ou quatre autres Coréens et Chinois. Quelle que soit leur opinion sur la question, la plupart des érudits européens, pour qui la sainteté supérieure de la langue japonaise n’est pas un article de foi, seront probablement d’accord avec M. Aston [6] pour refuser à cette restauration conjecturale le mérite de représenter les mots authentiques dans lesquels les étudiants en histoire japonais du VIIIe siècle lisaient le texte des « Archives ».
¶ Notes de bas de page
v:2 Publié dans le vol. iii, partie I, de ces « Transactions ». ↩︎
v:3 C’est-à-dire, l’empereur Tem-mu. ↩︎
vi:4 I.e., « Records of Ancient Matters ». La lecture alternative, qui n’est probablement qu’une invention de Motowori, donne le même sens en sons japonais purs (au lieu de sinico-japonais). ↩︎
xiii:5 Malheureusement, la partie déjà imprimée ne porte pas l’histoire jusqu’à la fin de l’« Âge Divin ». L’ouvrage est aussi colossal par son étendue que minutieux par ses recherches, quarante et un volumes (y compris les onze formant les « Sources ») ayant déjà paru. L’« Idzu no Chi-Waki » et l’« Idzu no Koto-Waki » sont également incomplets. ↩︎
xiv:6 p. xvLe traducteur adopte le terme « idéographique », parce que c’est celui communément utilisé et compris, et parce que ce n’est pas le lieu de démontrer son inadéquation. À proprement parler, « logographique » serait préférable à « idéographique », la différence entre les caractères chinois et l’écriture alphabétique étant que les premiers représentent dans leur intégralité les mots chinois désignant les choses et les idées, tandis que la seconde décortique en leurs sons composants les mots des langues qu’elle est employée à écrire. ↩︎
xvi:7 « Grammaire de la langue écrite japonaise », deuxième édition, annexe II, p. VI. ↩︎