[p. lix]
Les croyances religieuses des tenants modernes du shintoïsme [1] peuvent être établies sans grande difficulté en parcourant les œuvres des chefs de file du mouvement qui s’est efforcé, au cours du dernier siècle et demi, de détruire l’influence du bouddhisme et de la philosophie chinoise, et qui a récemment réussi dans une certaine mesure à supplanter ces deux systèmes étrangers. Mais au Japon, comme ailleurs, il a été impossible de revenir mille ans en arrière en matière de pensée et d’actes religieux ; et lorsque nous essayons de découvrir les opinions primitives du peuple japonais avant l’introduction de la culture chinoise, nous nous heurtons à des difficultés qui semblent à première vue insurmontables. Les documents sont rares et les commentaires modernes peu fiables, car ils sont tous rédigés sous l’influence d’opinions préconçues. De plus, le problème est apparemment compliqué par un mélange de races et de mythologies, et par un filtrage des idées chinoises avant la compilation de documents de toute sorte, bien que ce soient des considérations qui ont jusqu’ici été à peine prises en compte par les étrangers, et qui sont délibérément négligées et obscurcies par des écrivains autochtones étroitement patriotiques comme Motowori et Hirata.
[p. lx]
Dans le domaine politique, les difficultés ne sont pas moindres, mais bien plus grandes ; car, une fois la maison impériale et le système politique japonais centralisé, tels que nous les connaissons depuis le VIe ou le VIIe siècle de notre ère, pleinement établis, il était manifestement dans l’intérêt des pouvoirs en place d’effacer autant que possible toute trace des différents arrangements gouvernementaux qui les avaient précédés, et de faire croire que, telles qu’elles étaient alors, telles qu’elles avaient toujours été. L’empereur Tem-mu, soucieux de corriger « les déviations de la vérité et les faussetés creuses » des documents historiques conservés par les différentes familles, et l’auteur des « Chroniques du Japon » avec son système élaboré de dates fictives, nous reviennent à l’esprit, et nous nous demandons dans quelle mesure de telles altérations de l’histoire, parfois involontaires, ont pu se perpétuer à des époques antérieures, où les freins étaient encore moins nombreux qu’au VIIIe siècle. Si, par conséquent, le traducteur exprime ici quelques opinions fondées principalement sur une étude attentive du texte des « Archives des Affaires Anciennes », aidée par une étude des « Chroniques du Japon », on comprendra qu’il le fasse avec une grande méfiance, surtout en ce qui concerne ses rares remarques (pour ainsi dire) constructives. Quant au côté destructeur de la critique, il n’y a pas lieu d’hésiter davantage ; car les histoires anciennes sont trop irréfutables pour que leurs premières parties, du moins, puissent résister à l’épreuve d’une enquête sérieuse. Avant de tenter de reconstituer le peu que l’on trouve dans les « Archives » pour illustrer les croyances de l’époque japonaise archaïque, il sera nécessaire, au risque d’être ennuyeux, de résumer les anciennes traditions telles qu’elles nous sont présentées dans [p. lxi] leur intégralité, après quoi nous hasarderons quelques spéculations sur le sujet des tribus antérieures qui se sont combinées pour former le peuple japonais ; car les quatre questions de croyances religieuses, d’arrangements politiques, de race et de crédibilité des documents sont toutes étroitement liées et ne forment, à proprement parler, qu’un seul problème extrêmement complexe.
Très condensées, les traditions japonaises anciennes se résument ainsi : après une période indéfiniment longue, durant laquelle naquirent un certain nombre de divinités abstraites, énumérées différemment dans les « Archives » et dans les « Chroniques », deux de ces divinités, un frère et une sœur nommés Izanagi et Izanami (c’est-à-dire « l’Homme qui invite » et « la Femme qui invite »), s’unissent par le mariage et donnent naissance aux différentes îles de l’archipel japonais. Après avoir créé des îles, ils procèdent à la création d’un grand nombre de dieux et de déesses, dont beaucoup correspondent à ce que nous appellerions des personnifications des puissances de la nature, bien que le mot « personnification » soit, dans son acception légitime, étranger à l’esprit japonais. La naissance du Dieu du Feu entraîne la mort d’Izanami, et l’épisode le plus marquant de toute la mythologie survient alors : son mari, tel Orphée, lui rend visite aux Enfers pour la supplier de revenir à lui. Elle le ferait volontiers et lui ordonne d’attendre pendant qu’elle consulte les divinités du lieu. Mais, impatienté par son long retard, il casse une des dents du peigne coincé dans la mèche gauche de ses cheveux, l’allume et entre, pour ne trouver en elle qu’une hideuse masse corrompue, au milieu de laquelle sont assis les huit dieux du Tonnerre. Cet épisode se termine par la déification de [p. lxii] [58] trois pêches [2] qui l’avaient aidé dans sa retraite devant les armées des Enfers, et par un échange de paroles amères entre lui et sa femme, qui le poursuit elle-même jusqu’au « Passage Égal de l’Hadès ».
De retour à Himuka, dans le sud-ouest du Japon, Izanagi se purifie en se baignant dans un ruisseau. Ce faisant, de nouvelles divinités naissent de chaque vêtement qu’il jette sur la rive et de chaque partie de son corps. L’une de ces divinités est la Déesse-Soleil, née de son œil gauche, tandis que le Dieu-Lune jaillit de son œil droit. Le dernier né, Susa-no-Wo, dont le nom est traduit par « l’Homme Impétueux », naît de son nez. Leur père partage l’héritage de l’univers entre ces trois enfants.
À ce stade, l’histoire perd son unité. On n’entend plus parler du Dieu-Lune, et les traditions concernant la Déesse-Soleil et celles concernant le « Déité Mâle Impétueux » divergent d’une manière qui engendre des incohérences dans le reste de la mythologie. La Déesse-Soleil et le « Déité Mâle Impétueux » se disputent violemment, et finalement ce dernier perce un trou dans le toit de la salle céleste où sa sœur travaille avec les tisserandes célestes, et laisse tomber « un cheval pie céleste qu’il avait écorché à reculons ». Les conséquences de cet acte furent si désastreuses que la Déesse-Soleil se retira un temps dans une grotte, d’où le reste des huit cents myriades (selon les « Chroniques », quatre-vingts [p. lxiii] myriades) de divinités parvinrent difficilement à la séduire. La « Déité Mâle Impétueuse » fut alors bannie, et la Déesse-Soleil resta maîtresse du champ. Pourtant, chose étrange, elle se retire désormais à l’arrière-plan, et la partie la plus volumineuse de la mythologie consiste en des récits concernant la « Déité Mâle Impétueuse » et ses descendants, représentés comme les monarques du Japon, ou plutôt de la province d’Idzumo. Le « Déité Mâle Impétueux » lui-même, que son père avait chargé de la domination de la mer, n’assume jamais ce pouvoir. Il vit d’abord une aventure amoureuse curieusement racontée et rencontre un serpent à huit fourches à Idzumo. Il réapparaît ensuite sous les traits du divin Hadès, capricieux et impur, qui semble toutefois conserver un certain pouvoir sur le monde des vivants, puisqu’il investit son descendant de la sixième génération de la souveraineté du Japon. De ce dernier personnage est raconté tout un cycle d’histoires, toutes centrées sur Idzumo. On y apprend ses conversations avec un lièvre et une souris, les prouesses et l’ingéniosité dont il fit preuve lors d’une visite à son ancêtre à Hadès – un lieu bien moins mystérieux, dans ce cycle de traditions, que l’Hadès visité par Izanagi –, ses amours, son triomphe sur ses quatre-vingts frères, sa réconciliation avec son impératrice jalouse, et l’histoire de ses nombreux descendants, dont beaucoup portent des noms particulièrement difficiles à comprendre. On entend aussi dans une tradition, qui se termine de manière inutile, parler d’une divinité microscopique qui traverse la mer pour demander à ce monarque d’Idzumo de partager la souveraineté avec lui.
Cette dernière légende se répète dans la suite. La Déesse du Soleil, qui, lors de sa seconde apparition, est constamment représentée comme agissant de concert avec la « Déité Prodigieuse et Auguste » – l’une des abstractions mentionnées au début des « Archives » – décide d’accorder la souveraineté du Japon à un enfant dont on doute qu’il soit le sien ou celui de son frère, la « Déité Mâle Impétueuse ». Trois ambassades sont envoyées du Ciel à Idzumo pour arranger les choses, mais seule une quatrième réussit, les derniers ambassadeurs obtenant la soumission du monarque [48] ou de la divinité d’Idzumo, qui renonce à sa souveraineté et promet de servir la nouvelle dynastie (apparemment dans le monde souterrain), si un palais ou un temple lui est construit et qu’il est vénéré comme il se doit. Là-dessus, l’enfant de la divinité que la Déesse du Soleil avait initialement souhaité faire souveraine du Japon, descend sur terre, non pas à Idzumo au nord-ouest, comme la séquence logique de l’histoire le laisserait penser, mais au sommet d’une montagne dans l’île de Kiushiu au sud-ouest.
Voici un récit pittoresque expliquant l’ancienneté du bèche-le-mer, puis un autre expliquant la brièveté de la vie des mortels. Après quoi, on nous raconte la naissance, dans des circonstances particulières, des trois fils de la divinité descendue du ciel. Deux d’entre eux, Ho-deri et Howori, dont les noms peuvent être traduits en anglais par « Fire-Shine » et « Fire-Caled », sont les héros d’une légende très curieuse, qui comprend le récit détaillé d’une visite de ce dernier au palais du dieu de l’Océan, et d’une malédiction ou d’un sort qui lui assura la victoire sur son frère aîné et lui permit de vivre paisiblement dans son palais de Takachiho pendant cinq cent quatre-vingts ans. La première mention [p. lxv] ressemble à une date contenue dans les « Archives ». Le fils de ce personnage épousa sa propre tante et devint père de quatre enfants, dont l’un, « marchant sur la crête des vagues, traversa la Terre Éternelle », tandis qu’un second « s’enfonça dans la plaine maritime ». Les deux autres se dirigèrent vers l’est, combattant les chefs de Kibi et de Yamato, vivant des aventures avec des dieux avec et sans queue, aidés par une épée miraculeuse et un corbeau gigantesque, et nommant les différents lieux traversés d’après des incidents de leur propre carrière, comme l’avaient fait « l’Homme Impétueux » et d’autres personnages divins avant eux. L’un de ces frères était Kamu-Yamato-Ihare-Biko, qui (l’autre étant mort avant lui) reçut pour la première fois le titre de Jim-mu Ten – pas plus de quatorze siècles après la date de son décès dans les « Chroniques ».
Dès lors, Yamato, jusqu’alors à peine mentionné, et les provinces adjacentes deviennent le centre du récit, tandis qu’Idzumo retrouve son importance. Une histoire d’amour très indécente relie les deux fragments de la mythologie ; la « Grande Déité de Miwa », identifiée au monarque déchu d’Idzumo, apparaît sur la scène. En effet, durant le reste du récit, cette « Grande Déité de Miwa » et [49] sa collègue la « Petite Déité Auguste » (Sukuna-Mi-Kami [3]), la divinité Izasa-Wake, les trois Dieux des Eaux de Sumi et la « Grande Déité de Kadzuraki », dont la mention est si frappante dans la secte CLVIII, forment, avec la Déesse du Soleil et une certaine épée divine [p. lxvi] conservés au temple d’Isonokami à Yamato, les seuls objets de culte portant un nom particulier, les autres dieux et déesses n’étant plus mentionnés. Cette partie de l’histoire se termine par un récit des troubles qui inaugurèrent le règne du successeur de Jim-mu, Sui-sei, puis survient un trou noir de cinq cents ans (selon la chronologie acceptée), durant lequel on ne nous dit absolument rien, si ce n’est de mornes généalogies, le lieu où chaque souverain résidait et où il était enterré, et l’âge auquel il vivait, ceci après les détails minutieux qui avaient été donnés précédemment concernant les dieux ou monarques successifs jusqu’à Sui-sei inclus. Il convient également de noter que l’âge moyen des dix-sept premiers monarques (en comptant Jim-mu Ten-nō comme le premier selon les idées reçues) est de près de 96 ans si l’on suit les « Archives », et de plus de cent ans si l’on suit la chronologie acceptée, fondée principalement sur les déclarations constamment divergentes contenues dans les « Chroniques ». L’âge de plusieurs monarques dépasse 120 ans. [^59]
L’intervalle de temps presque vide de cinq siècles mentionné ci-dessus nous amène au règne de l’empereur connu dans l’histoire sous le nom de Sū-jin, dont la vie de cent soixante-huit ans (cent vingt selon les « Chroniques ») est censée avoir immédiatement précédé l’ère chrétienne. Sous ce règne, l’ancien monarque d’Idzumo ou dieu de Miwa réapparaît et provoque une peste dont Sū-jin est averti en rêve. Un épisode curieux mais hautement indécent nous raconte comment un personnage appelé Oho-Taka-Ne-Ko était connu pour être le fils de la divinité en question et fut donc nommé grand prêtre de son temple. Sous le règne qui suit, une légende complexe, impliquant des circonstances aussi miraculeuses que celles des premiers chapitres de la mythologie, se concentre à nouveau sur la nécessité de pacifier le grand dieu d’Idzumo. Cette légende, avec les détails des luttes intestines au sein de la famille impériale, des amours du souverain et de l’importation de l’orange de la « Terre Éternelle », nous amène au cycle de traditions dont Yamato-Take, fils de l’empereur Kei-kō, est le héros. Ce prince, après avoir tué l’un de ses frères dans les toilettes, parvient à soumettre l’ouest et l’est du Japon ; et, malgré certains détails peu recommandables au goût européen, son histoire, prise dans son ensemble, est l’une des plus marquantes du livre. Il accomplit des prodiges de bravoure, se déguise en femme pour tuer les brigands, possède une épée magique et un allume-feu, a une épouse dévouée qui apaise la fureur des vagues en s’asseyant à leur surface, rencontre un cerf et un sanglier, véritables dieux déguisés, et meurt finalement en route vers l’ouest avant d’avoir pu atteindre sa demeure de Yamato. Sa mort est suivie d’un récit hautement mythologique de l’ensevelissement de l’oiseau blanc en lequel il finit par se transformer.
Le règne suivant est un blanc, et le suivant nous transporte sans prévenir vers une toute autre scène. La demeure du souverain est désormais à Tsukushi, l’île du sud-ouest de l’archipel japonais, et quatre dieux, par l’intermédiaire de l’épouse du souverain, connue dans l’histoire sous le nom d’impératrice Jin-gō, révèlent l’existence de la terre de Corée, dont ce n’est cependant pas la première mention. L’empereur ne croit pas au message divin et est puni de mort pour son incrédulité. Mais l’impératrice, après une consultation spéciale entre son premier ministre et les dieux, et l’accomplissement de diverses cérémonies religieuses, rassemble sa flotte et, avec l’aide des poissons, grands et petits, et d’une vague miraculeuse, atteint Shirai [^60] (l’une des anciennes divisions de Corée) et la soumet. Elle retourne ensuite au Japon, la légende se terminant par un récit curieusement naïf selon lequel elle était assise un jour en train de pêcher sur un banc de sable de la rivière Wo-gawa à Tsukushi, avec des fils retirés de sa jupe pour en faire des lignes.
La section suivante la montre remontant par mer jusqu’à Yamato, autre point d’ancrage du récit, par lequel le cycle des légendes de Yamato et celui de Tsukushi semblent unifiés. Les « Chroniques du Japon » ont même amélioré ce point en faisant résider les époux de Jingō à Yamato au début de son règne et en les faisant venir à Tsukushi plus tard. Si les « Archives », moins élaborées, n’avaient pas été conservées, les deux fils de la tradition auraient été encore plus difficiles à démêler. L’armée de l’impératrice bat les troupes levées par les rois ou princes indigènes, représentés comme ses beaux-fils ; et à partir de ce moment, l’histoire se poursuit sur un seul fil, toujours centré sur Yamato. La Chine est également mentionnée pour la première fois, des livres auraient été importés du continent, et nous entendons parler de l’introduction progressive de divers arts utiles. Cependant, même les annales du règne d’O-jin, durant lequel cet élan civilisateur venu de l’étranger aurait débuté, ne sont pas exemptes de détails aussi miraculeux que ceux des premières parties du livre. En effet, les sectes CXIV à CXVI de la traduction suivante, qui font partie du récit de son règne, sont consacrées au récit de l’un des récits les plus fantaisistes de toute la mythologie. Le monarque lui-même aurait vécu cent trente ans, tandis que son successeur en aurait vécu quatre-vingt-trois (selon les « Chroniques », O-jin aurait vécu cent dix ans et son successeur Nin-toku aurait régné quatre-vingt-sept ans). Ce n’est qu’au règne suivant que le miracle cesse, un fait qui coïncide significativement avec le règne au cours duquel, selon une déclaration des « Chroniques », « des historiographes furent envoyés pour la première fois dans toutes les provinces afin de consigner les paroles et les événements et de transmettre les archives de toutes parts ». Cela nous amène au début du Ve siècle de notre ère, trois siècles seulement avant la compilation de nos histoires, mais deux siècles seulement avant la compilation de la première histoire dont il soit fait mention. À partir de cette époque, le récit des « Actes », bien que mal raconté, nous offre des images très curieuses et semble fiable. Il est assez complet pendant quelques règnes, après quoi il se réduit à de simples généalogies, nous ramenant au début du VIIe siècle. Les « Chroniques », au contraire, nous donnent des détails complets jusqu’en 701 apr. J.-C., soit jusqu’à dix-neuf ans après la date de leur compilation.
Le lecteur qui a suivi ce résumé, ou qui prendra la peine de lire lui-même l’intégralité du texte, constatera qu’il n’y a aucune rupture dans le récit, du moins aucune rupture chronologique, ni aucune rupture entre le fabuleux et le réel, à moins que ce ne soit au début du Ve siècle de notre ère, c’est-à-dire plus de mille ans après la date généralement admise comme le début de la véritable histoire japonaise. Les seules ruptures ne sont pas chronologiques, mais topographiques.
Ce fait de la continuité de la mythologie et de l’histoire japonaises a été pleinement reconnu par les principaux commentateurs autochtones, dont les opinions sont celles que les shintoïstes modernes considèrent comme orthodoxes ; ils en concluent que tout ce qui figure dans les histoires nationales classiques doit être accepté comme vérité littérale. Cependant, chacun ne peut se forcer à accepter une telle croyance ; et au début du siècle dernier, un écrivain et penseur célèbre, Arawi Hakuseki, publia un ouvrage dans lequel, tout en acceptant la mythologie autochtone comme une authentique chronique des événements, il le faisait sous réserve de prouver à sa propre satisfaction que toutes les parties miraculeuses de celle-ci étaient des allégories et que les dieux n’étaient que des hommes sous un autre nom. À cet égard, l’élasticité du mot japonais pour « divinité », kami, déjà mentionnée, fut un atout précieux pour l’Évhémère oriental. Certaines de ses explications sont cependant extrêmement comiques, et il est évident qu’un tel système permet à celui qui l’utilise de prouver tout ce qu’il veut. [4] Au cours du siècle présent, une forme diluée de la même théorie fut adoptée par Tachibana no Moribe, qui, tout en s’efforçant de rester un shintoïste orthodoxe, décida néanmoins que certains des incidents (pour ainsi dire) inutilement [p. lxxi] miraculeux ne devaient pas être considérés comme des vérités révélées. Tels sont, par exemple, l’histoire de la souris parlante et celle de la coiffe d’Izanagi se transformant en grappe de raisin. Il explique nombre de ces détails par l’hypothèse qu’ils sont ce qu’il appelle wosana-goto, c’est-à-dire des mots enfantins, et pense qu’ils ont été inventés pour fixer l’histoire dans l’esprit des enfants, et ne sont pas contraignants pour les adultes modernes en tant qu’articles de foi. Il est également disposé à admettre que certains passages présentent des traces d’influence chinoise, et il blâme Motowori pour sa défense intransigeante de chaque iota du texte existant des « Registres des Affaires Anciennes ». Appartenant à cette même école de ce que l’on pourrait peut-être appeler les « croyants rationalistes » de la mythologie japonaise, un écrivain chrétien contemporain, M. Takahashi Gorō, doit également être mentionné. Marchant sur les traces d’Arawi Hakuseki, mais apportant aux légendes de son propre pays une certaine connaissance de la mythologie d’autres terres, il explique par exemple les traditions de la Déesse-Soleil et du Serpent à Huit Fourches de Yamada en postulant l’existence d’une ancienne reine appelée Soleil, dont le frère, après avoir été banni de son royaume pour sa conduite inappropriée, tua un ennemi dont le nom était Serpent, etc., tandis que des affirmations telles que la divinité microscopique qui est venue par-dessus les vagues pour partager la souveraineté d’Idzumo ne voulait pas dire son nom, s’expliquent par l’affirmation que, étant étranger, il était inintelligible pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il ait appris la langue.Il est certes étrange que de tels théoriciens ne voient pas qu’ils sapent d’une main ce qu’ils s’efforcent de soutenir de l’autre, et que leur propre imagination devient pour eux la seule référence de la vérité historique. Pourtant, M. Takahashi affirme avec assurance que « ses explications n’ont rien de forcé ni de fantaisiste » et qu’elles « ne peuvent manquer de dissiper les doutes, même des plus sceptiques ». [5]
L’habitude générale des Japonais les plus sceptiques d’aujourd’hui, c’est-à-dire de quatre-vingt-dix-neuf personnes instruites sur cent, semble être de rejeter, ou du moins d’ignorer, l’histoire des dieux, tout en acceptant implicitement l’histoire des empereurs depuis Jim-mu jusqu’à nos jours. Ce faisant, ils ont été suivis sans grande réserve par la plupart des Européens : almanachs, histoires et cyclopédies continuent tous à répéter, sur l’autorité désuète d’écrivains tels que Kaempfer et Titsingh, que le Japon possède une histoire authentique couvrant plus de deux mille ans, tandis que Siebold et Hoffmann vont jusqu’à discuter de l’avènement de Jim-mu en 660 av. J.-C. ! Telle est l’attitude d’esprit aujourd’hui consacrée par la classe dirigeante. Ainsi, dans les compilations historiques utilisées dans les manuels scolaires, [54] les histoires des dieux, c’est-à-dire les traditions japonaises jusqu’à Jim-mu exclusif, sont soit passées sous silence, soit balayées en quelques phrases, tandis que les annales des souverains humains, c’est-à-dire les traditions japonaises depuis Jim-mu inclus, sont traitées exactement comme si les événements qui y sont relatés s’étaient produits hier et étaient aussi incontestablement historiques que les déclarations ultérieures, pour lesquelles il existe des preuves contemporaines. Le même plan est poursuivi ailleurs dans les publications officielles. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres, les commissaires impériaux de l’Exposition universelle de Vienne, dans leur [p. lxxiii] “Notice sur l’Empire du Japon”, nous dit que "L’histoire de la dynastie impériale remonte très-haut. L’obscurité entoure ses débuts, vu l’absence de documents réguliers ou d’un calendrier parfait. Le premier Empereur de la dynastie présente, dont il reste des annales dignes de confiance, est Jin-mou-ten-nō [6] qui organisa un soulèvement dans la province de Hiuga, marche à l’Est avec ses compagnons, fonda sa capitale dans la vallée de Kashihara dans le Yamato, et monta sur le trône comme Empereur que descend, par une succession régulière, la présente famille régnante du Japon.
Français Quant à l’ère Japonaise mentionnée par les commissaires, il est permis d’observer qu’elle n’a été introduite que par un édit du 15 décembre 1872 [7], c’est-à-dire juste quinze jours avant la publication de leur rapport. Et cette ère, cette accession, est placée avec assurance treize ou quatorze siècles avant la première histoire qui la rapporte, neuf siècles avant (selon les calculs les plus anciens) l’art d’écrire fut introduit dans le pays, et sur la seule autorité de livres fourmillant de légendes miraculeuses ! Un tel procédé a-t-il besoin d’un commentaire après avoir été formulé en termes précis, et une personne impartiale peut-elle continuer à accepter la chronologie japonaise ancienne et les mille premières années de la soi-disant histoire du Japon.
* * *
Laissons de côté cette discussion et voyons si les pages des « Archives » et des « Chroniques » nous permettent de tirer des informations sur l’état religieux et politique des Japonais à leurs débuts. On y trouve des fragments d’information de deux sortes : certains sont d’une importance évidente, d’autres relèvent plutôt de la déduction et de la discussion. Commençons par les fragments positifs : les remarques concernant les idées cosmologiques, les rêves, les prières, etc.
La première chose qui frappe l’étudiant est que ce que, faute d’un nom plus approprié, nous devons appeler la religion des premiers Japonais, n’était pas une religion organisée. Nous n’y découvrons rien qui corresponde au corpus dogmatique, au code moral et au livre sacré les appliquant avec autorité, que nous connaissons dans les religions civilisées telles que le bouddhisme, le christianisme et l’islam. Ce que nous découvrons est un amas de superstitions diverses plutôt qu’un système coordonné. Les rêves étaient manifestement très importants, l’avenir étant censé y être prédit et la volonté des dieux révélée. Parfois même un objet réel, comme une épée merveilleuse, était envoyé en rêve, mêlant ainsi à nos idées le matériel au spirituel. Le sujet ne se présentait cependant pas sous cet angle aux premiers Japonais, pour qui il n’existait manifestement qu’un seul ordre de phénomènes : ce que nous appellerions l’ordre naturel. Le Ciel, ou plutôt le Ciel, était un lieu réel, pas plus éthéré que la terre, ni considéré comme la demeure des bienheureux après la mort, mais simplement une « haute plaine » située au-dessus du Japon et communiquant avec celui-ci par un pont ou une échelle, et formant la résidence de certains de ces puissants personnages appelés kami, mot que nous devons nous arranger pour traduire par « dieu » [p. lxxv] ou « déesse » ou « divinité ». Une flèche tirée de la terre pouvait atteindre le Ciel et y faire un trou. Il y avait au moins une montagne au Ciel, et une rivière au large lit rocheux comme celles que le voyageur au Japon connaît, une ou deux grottes, un ou plusieurs puits, des animaux et des arbres. Il existe cependant une certaine confusion quant à la montagne – le célèbre mont Kagu – car il en existe une portant ce nom dans la province de Yamato.
Certains dieux résidaient sur terre, ou descendaient du Ciel, et avaient des enfants de femmes humaines. Tel était, par exemple, l’arrière-grand-père de l’empereur Jim-mu. Quelques dieux possédaient une queue ou étaient personnellement remarquables [56] ; et des « divinités sauvages » sont souvent mentionnées comme habitant certaines régions du Japon, tant à l’époque dite « divine » que sous les règnes des empereurs humains jusqu’à une époque correspondant, selon la chronologie généralement admise, au premier ou au deuxième siècle de l’ère chrétienne. De plus, les empereurs humains eux-mêmes étaient parfois qualifiés de divinités, et faisaient même usage de cette appellation. Les dieux se transformaient parfois en animaux, et à d’autres moments, de simples objets tangibles étaient appelés dieux – ou du moins, on les appelait kami ; car on ne saurait trop rappeler l’abîme qui sépare le terme japonais du terme anglais. Le mot kami, comme mentionné précédemment, signifie proprement « supérieur », et ce serait aller trop loin que de dire que les premiers Japonais « déifiaient » – au sens où nous l’entendons – les pêches qu’Izanagi utilisait pour bombarder ses assaillants, ou tout autre objet naturel. Ce serait, en effet, leur attribuer une imagination débordante dont ils étaient incapables, et une habitude de personnification peu en accord avec le génie de leur langue. Certains dieux sont mentionnés collectivement comme « divinités mauvaises, semblables aux mouches de la cinquième lune » ; mais rien ne se rapproche d’une division systématique entre bons et mauvais esprits. En fait, le mot « esprit » lui-même ne s’applique absolument pas aux dieux du Japon archaïque. Ils étaient, comme les dieux grecs, perçus uniquement comme des êtres humains plus puissants. Ils naquirent, et certains moururent, bien qu’ici encore il y ait une incohérence, car la mort de certains d’entre eux est évoquée d’une manière qui laisse supposer qu’ils étaient alors conçus comme ayant atteint leur fin, alors que dans d’autres cas, cette mort semble simplement indiquer un transfert vers l’Hadès, ou vers ce qu’on appelle « la Route Unique », que l’on croit synonyme d’Hadès. Parfois encore, un voyage vers l’Hadès est entrepris par un dieu sans aucune référence à sa mort. Rien, en effet, ne saurait être moins cohérent que les divers détails.
Hadès [8] lui-même est un autre exemple de cette incohérence. Dans la légende d’Oho-Kuni-Nushi (le « Maître du Grand Pays »), l’une des légendes du cycle Idzumo, Hadès est décrit exactement comme s’il faisait partie du monde des vivants, ou exactement comme s’il était le Ciel, ce qui revient au même. Il a ses arbres, ses maisons, ses querelles de famille, etc., etc. Dans la légende d’Izanagi, en revanche, Hadès désigne simplement le lieu de l’horrible putréfaction et des morts vindicatifs, et est décrit à juste titre par le dieu lui-même qui s’y est aventuré comme « une terre hideuse et polluée ». Le seul point sur lequel les légendes concordent est l’emplacement entre la surface de la terre et Hadès d’une barrière appelée le « Col (ou Col) d’Hadès ». L’état des morts en général n’est nulle part évoqué, et les mourants ne font jamais référence à un monde futur, qu’il soit bon ou mauvais.
Les objets du culte étaient bien sûr les dieux, ou certains d’entre eux. Il a déjà été dit que dans les dernières parties du récit, dont la scène se déroule presque exclusivement sur terre, seules la Déesse du Soleil, la divinité Izasa-Wake, l’Épée Divine d’Isonokami, la Petite Déité Auguste (Sukuna-Mi-Kami), les « Grands Dieux » de Miwa et de Kadzuraki et les trois Déités de l’Eau de Sumi sont mentionnés comme ayant fait l’objet d’un culte particulier. Parmi celles-ci, la première et la dernière apparaissent ensemble, formant une sorte de quaternion, tandis que les cinq autres apparaissent séparément et n’ont aucun lien entre elles. Les divinités des montagnes, des rivières, de la mer, etc., sont également mentionnées ensemble, de même que les divinités célestes et terrestres ; et l’impératrice Jin-gō est représentée comme les conciliant tous avant son départ pour la Corée en mettant dans une gourde les cendres « d’un arbre maki, [^66] et en fabriquant également une quantité de baguettes et aussi « de plats de feuilles, et en les dispersant tous sur les vagues ».
Ceci nous amène au sujet des rites religieux, un sujet sur lequel nous aspirons à des informations plus complètes que celles que les textes nous fournissent. [9] La citation qui vient d’être faite laisse supposer que les offrandes conciliantes faites aux dieux étaient de nature diverse. Néanmoins, une méthode très naturelle était généralement suivie ; car les gens offraient les choses auxquelles ils attachaient le plus d’importance, comme nous le rapportons à une époque tardive du poète Tsurayuki, alors qu’il était en mer lors d’une tempête, jetant son miroir dans les vagues parce qu’il n’en avait qu’un. Les premiers Japonais faisaient des offrandes [58] de deux sortes de tissus, l’un en chanvre et l’autre en écorce de mûrier à papier, offrandes très précieuses à leurs yeux, mais qui, à l’époque moderne, ont été laissées dégénérer en bandes de papier inutiles. Ils offraient également des boucliers, des lances et d’autres objets. On offrait de la nourriture aussi bien aux dieux qu’aux morts ; en effet, le palais ou le tombeau du monarque défunt et le temple du dieu ne peuvent pas toujours être distingués l’un de l’autre, et, comme on l’a déjà mentionné, les Japonais utilisent le même mot miya pour « palais » et pour « temple ». Signifiant étymologiquement « maison auguste », il est naturellement susceptible de ce qui sont pour nous deux significations distinctes.
À une exception près, [10] les « Archives » ne nous donnent les paroles d’aucune prière (ou, comme le terme japonais norito a été traduit ailleurs, « rituels »). Les conversations avec les dieux sont certes détaillées, mais aucune expression dévotionnelle. Heureusement, cependant, un certain nombre de prières très anciennes ont été préservées dans d’autres livres, et des traductions de certaines d’entre elles par M. Satow se trouvent disséminées dans les volumes des Transactions de cette Société. Elles consistent principalement en des déclarations de louanges et des déclarations d’offrandes faites, soit en échange de faveurs reçues, soit sous condition que des faveurs soient accordées. Elles sont toutes en prose, et les hymnes ne semblent pas avoir été utilisés. En effet, sur les cent onze [p. lxxix] chants conservés dans les « Archives », aucun n’a de référence religieuse.
Le rite sacré le plus souvent mentionné est la purification par l’eau. L’épreuve de l’eau chaude est également évoquée dans les deux récits, mais seulement à une époque postérieure, avouons-le, au début des relations avec le continent. On parle également de pactes occasionnels conclus avec un dieu, qui ressemblent quelque peu à nos paris, serments ou malédictions européens. Les prêtres sont mentionnés dans quelques passages, mais sans plus de détails. On n’entend pas parler de leurs fonctions de médiateur, et l’impression donnée est qu’ils n’existaient pas très tôt en tant que classe distincte. Lorsqu’ils apparurent, la profession devint rapidement héréditaire, conformément à la tendance générale au Japon vers l’hérédité des fonctions et des professions.
Diverses superstitions surgissent en de nombreux endroits. Certaines d’entre elles étaient manifestement obsolètes ou inintelligibles [59] à l’époque où les légendes ont pris leur forme actuelle, et où des histoires prétendent en donner l’origine sont racontées. Ainsi, nous apprenons, soit dans les « Archives », soit dans les « Chroniques », ou dans les deux ouvrages, pourquoi il est malheureux de n’utiliser qu’une seule lumière, de casser les dents d’un peigne la nuit et d’entrer dans une maison avec un chapeau de paille et un imperméable. La crainte mondiale d’aller contre le soleil est liée à la légende de Jim-mu et se retrouve ailleurs. [11] Nous entendons également parler de charmes, par exemple de [p. lxxx] le merveilleux « Sabre Anti-Herbes » trouvé par Susa-no-Wo (la « Divinité Mâle Impétueuse ») à l’intérieur de la queue d’un serpent et encore conservé comme l’un des insignes impériaux. D’autres charmes de ce type étaient le « joyau de la marée montante » et le « joyau de la marée descendante », qui ont valu au grand-père de Jim-mu la victoire sur son frère aîné, ainsi que l’hameçon qui figure si souvent dans la même légende. [^70] La divination au moyen de l’omoplate d’un cerf était un moyen favori pour s’assurer de la volonté des dieux. Parfois aussi, les êtres humains semblent avoir été crédités de manière vague du pouvoir de parole prophétique. Des pots en terre cuite étaient enterrés au point de départ par un voyageur potentiel. Lors d’un combat, la flèche initiale était considérée avec une crainte superstitieuse. Les grandes précautions avec lesquelles l’impératrice Jin-gō aurait entrepris son expédition en Corée ont déjà été évoquées, et en effet le début de toute action ou entreprise semble avoir reçu une importance particulière.
Pour conclure cet aperçu des croyances religieuses des premiers Japonais en se référant, comme cela a été le cas pour les arts de la vie, à certains traits notables qui brillent par leur absence, il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’il n’existe aucune tradition de déluge, aucun témoignage d’un quelconque effet produit sur l’imagination par les tremblements de terre dont les insulaires japonais souffrent si constamment, aucune trace de culte des étoiles, aucune notion d’incarnation ou de transmigration. Cette dernière remarque montre que la mythologie japonaise avait pris sa forme actuelle avant que le premier écho du bouddhisme ne se répercute sur ces rivages. Mais l’absence de toute tradition de déluge ou d’inondation est encore plus remarquable, à la fois parce que de telles catastrophes sont susceptibles de se produire occasionnellement dans tous les pays, et parce que l’imagination de la plupart des nations semble avoir été fortement impressionnée par leur survenue. De plus, ce que nous connaissons spécifiquement sous le nom de Déluge a récemment été présenté comme un ancien mythe altaïque. Pourtant, nous avons ici la plus ancienne des nations incontestablement altaïques, dépourvue de toute légende de ce genre. Quant à l’oubli des étoiles, autour desquelles l’imagination d’autres races a tissé des idées si fantaisistes, il est aussi caractéristique du Japon moderne que du Japon archaïque. Les désignations chinoises des constellations, et quelques légendes chinoises s’y rapportant, ont été empruntées aux temps historiques ; mais aucun écrivain japonais n’a jamais pensé à chercher dans les étoiles « la poésie du ciel ». Autre détail digne de mention : le nombre sept, considéré comme sacré dans tant de pays, n’est ici nullement mis en avant, remplacé par le nombre huit. Ainsi, nous avons Huit Grandes Îles, un Serpent à Huit Fourches, une barbe longue de Quatre-Vingts Largeurs de Main, un Dieu nommé « Huit Mille Lances », Quatre-Vingt ou Huit Cents Myriades de Divinités, etc., etc. Les commentateurs estiment nécessaire de nous préciser que ces huit et quatre-vingts ne doivent pas être pris au pied de la lettre, car ils signifient simplement un grand nombre. Il n’en demeure pas moins que le nombre huit avait, pour une raison inconnue, une signification particulière qui lui était attachée ; et comme les documents qui mentionnent huit mentionnent également neuf et dix, en plus de nombres plus élevés, et comme dans certains cas types, comme celui des Huit Grandes Îles, chacun des huit est énuméré séparément, il est clair que lorsque les premiers Japonais disaient huit, ils voulaient dire huit, même s’ils ont sans doute utilisé ce nombre de manière vague, comme nous le faisons pour une douzaine, une centaine et un millier.
Il n’y a pas lieu de commenter à quel point tout cela diffère des récits fantaisistes du Shintō donnés par certains auteurs populaires récents. Ainsi, l’un d’eux, qu’un autre cite comme une autorité, [^71] nous dit que le Shintō « consiste dans la croyance que l’esprit éthéré productif se répandant dans tout l’univers, chaque partie en est à un certain degré imprégnée, et donc chaque partie est à un certain degré le siège de la divinité ; d’où les dieux et déesses locaux adorés partout, et par conséquent multipliés sans fin. Comme les anciens Romains et les Grecs, ils reconnaissent un Être suprême, le premier, le suprême, l’intellectuel, par lequel les hommes ont été ramenés de la rudesse et de la barbarie à l’élégance et au raffinement, et ont appris par des hommes et des femmes privilégiés, non seulement à vivre dans un plus grand confort, mais à mourir avec de meilleures espérances. » (!) En vérité, quand on lit des affirmations aussi totalement infondées – car celle citée ici n’en est qu’une parmi tant d’autres – on est tenté de croire que le XIXe siècle doit faire partie de l’âge mythique primitif.
Quant à la question du gouvernement, nous n’apprenons guère grand-chose, si ce n’est de vagues déclarations comme celle selon laquelle un tel aurait été concédé par ses quatre-vingts frères à la souveraineté du pays d’Idzumo, ou qu’Izanagi aurait divisé le domaine [p. lxxiii] sur toutes choses entre ses trois enfants, conférant à l’un la « Plaine du Haut Ciel », à un autre le Domaine de la Nuit, et au troisième la « Plaine Maritime ». Mais les légendes les plus anciennes ne montrent pas une telle souveraineté réellement administrée. Les dieux célestes semblent plutôt avoir été conçus comme formant une sorte de république, qui décidait des choses en se réunissant en conseil dans le lit rocheux du « Fleuve du Ciel », et en suivant les conseils des plus astucieux d’entre eux. En effet, les diverses assemblées divines auxquelles nous introduit le récit des « Annales » et des « Chroniques » ne nous rappellent rien tant que les assemblées villageoises des tribus primitives dans de nombreuses parties du monde, où l’intelligence de l’un et la volonté générale de suivre ses suggestions remplacent l’organisation plus définie des temps ultérieurs.
Descendant du ciel sur terre, on ne trouve guère, durant ce qu’on appelle « l’Âge Divin », que des récits d’individus et de familles isolés ; et ce n’est qu’avec le récit des guerres des premiers empereurs qu’apparaît une quelconque forme d’organisation politique. On entend alors parler de chefs dans chaque localité, qui mènent leurs hommes au combat et sont apparemment les seuls dépositaires du pouvoir, chacun dans sa sphère microscopique. La légende de Jim-mu elle-même suffit cependant à démontrer que l’autocratie, telle que nous la concevons, n’était pas caractéristique du gouvernement des tribus Tsukushi ; car Jim-mu et son frère, jusqu’à la mort de ce dernier, sont représentés comme les chefs conjoints de leur armée. De même, on constate que les « propriétaires territoriaux » de Yamato et les « dirigeants » d’Idzumo, que Jim-mu ou ses successeurs auraient soumis, sont constamment mentionnés au pluriel, [p. lxxxiv] comme pour suggérer qu’ils exerçaient une souveraineté divisée. Durant toute la période dite « Âge Humain », nous rencontrons, tant dans les régions du pays déjà soumises à la domination impériale que dans d’autres qui n’étaient pas encore annexées, des magnats locaux portant les mêmes titres de « propriétaires territoriaux », « dirigeants », « chefs », etc. ; et l’impression laissée dans l’esprit est qu’aux premiers temps historiques, le pouvoir du souverain ne s’exerçait pas directement sur toutes les régions du Japon, mais que dans de nombreux cas, les chefs locaux continuaient de dominer tout en étant sous une forme ou une autre fidèles à l’empereur du Yamato, tandis que dans d’autres, l’empereur était assez puissant pour destituer ces dirigeants locaux et mettre à leur place ses propres parents ou serviteurs, qui exerçaient cependant une autorité illimitée dans leurs propres districts et utilisaient les mêmes titres que ceux portés par les anciens dirigeants indigènes ; qu’en fait, le gouvernement était féodal plutôt que centralisé. Cette caractéristique de l’organisation politique du Japon primitif n’a pas totalement échappé à l’attention des commentateurs autochtones. En effet, le grand érudit shintoïste Hirata non seulement le reconnaît, mais s’efforce de prouver que le système de centralisation en vigueur aux VIIIe, IXe, Xe, XIe et une partie du XIIe siècles, et qui a été réactivé de nos jours, n’est qu’une imitation du système bureaucratique chinois ; il affirme qu’un féodalisme organisé, semblable à celui qui a existé du XIIe siècle à 1867, était la seule forme de gouvernement japonais véritablement ancienne et nationale. Le traducteur ne peut suivre Hirata aussi loin, car il ne voit aucune trace dans les premiers récits historiques de l’organisation complexe du Japon médiéval. Mais au-delà des limites immédiates du domaine impérial,Le gouvernement ressemblait indiscutablement à un féodalisme plutôt qu’à une centralisation. [63] Il est également vrai que le VIIe siècle a été témoin d’une évolution soudaine vers l’organisation bureaucratique, nombre des titres qui avaient jusqu’alors désigné les chefs provinciaux étant alors soit supprimés, soit réduits à de simples « noms de gentils ». Une autre remarque, suggérée par une lecture attentive des deux histoires anciennes, est que la succession impériale était très irrégulière aux premiers temps historiques. D’étranges lacunes se produisent jusqu’au VIe siècle de notre ère ; et même lorsque c’était l’un des enfants qui héritait du trône de son père, cet enfant était rarement le fils aîné.
* * *
Que pouvons-nous déduire de cette analyse des aspects religieux et politiques révélés par l’étude des livres contenant les traditions japonaises anciennes, quant à l’histoire encore plus ancienne et aux divisions tribales du Japon, ainsi qu’à l’origine des légendes japonaises ? Il y a peut-être peu de certitudes, mais, de l’avis de l’auteur, deux ou trois probabilités intéressantes.
Français Compte tenu de la multiplicité des dieux et des complications des soi-disant traditions historiques, il pense qu’il serait a priori difficile de croire que le développement de la civilisation japonaise ait suivi un seul courant, interrompu seulement au IIIe siècle par le début des relations avec le continent asiatique. Nous ne sommes cependant pas livrés à une telle considération purement théorique. Il existe des indications claires de l’existence de trois centres de cycles légendaires, trois courants qui se sont mêlés pour former le Japon qui nous rencontre [p. lxxxvi] à l’aube de l’histoire authentique au Ve siècle de notre ère. L’un de ces centres, le plus important dans la mythologie, est Idzumo ; le deuxième est Yamato ; le troisième est Tsukushi, appelé à l’époque moderne Kiushiu. Le Japon oriental et le Japon septentrional ne comptent pour rien ; En effet, une grande partie du Nord-Est et du Nord était, jusqu’à une époque relativement récente, occupée par les barbares Ainos, ou, comme les appellent les Japonais, Yemishi, Yebisu ou Yezo. Que les légendes ou traditions issues des trois parties du pays mentionnées ici ne concordent qu’imparfaitement est une opinion à laquelle il a déjà été fait allusion, et qui pourrait peut-être être éclaircie par une analyse plus approfondie des mythes et croyances classés selon ce triple système. La question de l’ancienne division du Japon en plusieurs États indépendants n’est cependant pas entièrement une question d’opinion. Français Car nous avons dans le « Shan Hai Ching » [^72] une déclaration positive concernant un Yamato du Nord et un Yamato du Sud (  ), et les annales chinoises des deux dynasties Han nous parlent de la division du pays en un nombre beaucoup plus grand de royaumes, dont, selon les annales de la dynastie Han ultérieure, le Yamato (
), et les annales chinoises des deux dynasties Han nous parlent de la division du pays en un nombre beaucoup plus grand de royaumes, dont, selon les annales de la dynastie Han ultérieure, le Yamato (  ) était le plus puissant. Un historien officiel chinois ultérieur nous dit aussi que Jih-pên (
) était le plus puissant. Un historien officiel chinois ultérieur nous dit aussi que Jih-pên (  , notre Japon) et Yamato avaient été deux États différents, et que Jih-pên aurait englouti Yamato. Par Jih-pên, l’auteur entendait manifestement parler de l’île de Tsukushi, ou d’une partie de celle-ci. Que les Chinois connaissaient assez bien le Japon est démontré par la présence, dans la littérature chinoise ancienne, de plus d’une mention du « pays du peuple velu au-delà des montagnes, à l’est et au nord », c’est-à-dire des Yemishi ou Ainos. Aucun livre chinois ne semble mentionner l’Idzumo comme ayant formé un pays distinct ; et cette preuve doit être prise en compte dans toute sa force. Il est bien sûr possible qu’Idzumo ait été incorporé au Yamato avant la conquête de ce dernier par le peuple Tsukushi.et dans ce cas, certaines incohérences de l’histoire peuvent être imputées à une confusion entre les traditions concernant la conquête d’Idzumo par Yamato et celles concernant la conquête de Yamato par Tsukushi. Peut-être aussi (car il est presque impossible de reconstituer l’histoire à partir de légendes) n’y a-t-il pas, après tout, de fondement suffisant pour croire à l’existence antérieure d’Idzumo en tant qu’État distinct, bien qu’il semble certainement difficile d’expliquer autrement la place particulière qu’il occupe dans les récits mythiques. Quoi qu’il en soit, et quelle que soit la lumière qui sera apportée ultérieurement sur cette question très obscure, il faut se rappeler que, pour autant que les preuves documentaires autochtones claires parviennent, 400 après J.-C. constitue approximativement la limite la plus élevée de l’histoire japonaise fiable. Au-delà de cette date, nous sommes immédiatement confrontés au miraculeux ; et si des faits relatifs au Japon ancien doivent être extraits des pages des « Archives » et des « Chroniques », ce doit être par un processus bien différent de celui consistant à simplement lire et à prendre leurs affirmations pour argent comptant.
, notre Japon) et Yamato avaient été deux États différents, et que Jih-pên aurait englouti Yamato. Par Jih-pên, l’auteur entendait manifestement parler de l’île de Tsukushi, ou d’une partie de celle-ci. Que les Chinois connaissaient assez bien le Japon est démontré par la présence, dans la littérature chinoise ancienne, de plus d’une mention du « pays du peuple velu au-delà des montagnes, à l’est et au nord », c’est-à-dire des Yemishi ou Ainos. Aucun livre chinois ne semble mentionner l’Idzumo comme ayant formé un pays distinct ; et cette preuve doit être prise en compte dans toute sa force. Il est bien sûr possible qu’Idzumo ait été incorporé au Yamato avant la conquête de ce dernier par le peuple Tsukushi.et dans ce cas, certaines incohérences de l’histoire peuvent être imputées à une confusion entre les traditions concernant la conquête d’Idzumo par Yamato et celles concernant la conquête de Yamato par Tsukushi. Peut-être aussi (car il est presque impossible de reconstituer l’histoire à partir de légendes) n’y a-t-il pas, après tout, de fondement suffisant pour croire à l’existence antérieure d’Idzumo en tant qu’État distinct, bien qu’il semble certainement difficile d’expliquer autrement la place particulière qu’il occupe dans les récits mythiques. Quoi qu’il en soit, et quelle que soit la lumière qui sera apportée ultérieurement sur cette question très obscure, il faut se rappeler que, pour autant que les preuves documentaires autochtones claires parviennent, 400 après J.-C. constitue approximativement la limite la plus élevée de l’histoire japonaise fiable. Au-delà de cette date, nous sommes immédiatement confrontés au miraculeux ; et si des faits relatifs au Japon ancien doivent être extraits des pages des « Archives » et des « Chroniques », ce doit être par un processus bien différent de celui consistant à simplement lire et à prendre leurs affirmations pour argent comptant.
Quant à l’origine, ou plutôt à la signification, des parties manifestement fantaisistes des légendes japonaises, la question soulevée ici de la probabilité [65] que la mythologie japonaise soit mixte nous invite à une prudence accrue dans son interprétation. En fait, elle nous invite à attendre pour l’interpréter que des recherches plus approfondies aient permis de déterminer quelles légendes se rejoignent. Car si elles sont d’origine hétérogène, il est vain de tenter d’établir un arbre généalogique des dieux, et l’expression même, si souvent entendue dans les discussions sur ce sujet, « les croyances religieuses originelles des Japonais », perd tout sens précis ; car différentes croyances peuvent avoir été tout aussi anciennes et originales, tout en se distinguant géographiquement par leur appartenance à différentes régions du pays. De plus, il n’est peut-être pas superflu d’attirer l’attention sur le fait que les dieux mentionnés dans les premières phrases des récits historiques tels que nous les connaissons aujourd’hui ne sont pas nécessairement ceux qui étaient vénérés le plus anciennement. Certes, dans les religions comme dans les livres, ce n’est pas souvent la préface qui est écrite en premier. Pourtant, cette simple considération a été constamment négligée, et, l’un après l’autre, les auteurs européens, connaissant un peu la mythologie japonaise, nous parlent de Dualités, Trinités et Déités Suprêmes originelles, sans même s’arrêter pour remarquer que les deux seules autorités en la matière, à savoir les « Annales » et les « Chroniques », diffèrent considérablement dans les listes de dieux primaires qu’elles fournissent. Si l’auteur se permettait d’avancer une suggestion là où tant d’affirmations aléatoires ont été avancées, ce serait que les diverses abstractions qui figurent au début des « Annales » et des « Chroniques » étaient probablement des créations ultérieures, voire de simples inventions de prêtres. Rien, ni dans les histoires ni dans les rituels shintoïstes, ne permet de penser que ces dieux, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, aient été autrefois, comme on l’a parfois supposé, l’objet d’un culte pur, qui fut ensuite obscurci par les légendes d’Izanagi, d’Izanami et de leurs nombreux descendants. Au contraire, à l’exception de la divinité Taka-Mi-Musu-Bi, [12] ils ne sont pas plus tôt mentionnés qu’ils disparaissent dans l’espace.
Qu’il soit intrinsèquement probable qu’une race aussi primitive [66] que les premiers Japonais, et aussi peu portée à la spéculation métaphysique que les Japonais à toutes les époques de leur histoire, ait débuté par un culte hautement abstrait qu’elle a ensuite complètement abandonné, est une question qu’il vaut mieux laisser à ceux dont la connaissance générale des peuples primitifs et des croyances religieuses anciennes justifie le respect de leurs décisions. De même, même après la décomposition de la mythologie japonaise en ses différentes composantes, le spécialiste doit faire appel à leur aide pour déterminer quelle part de cette mythologie doit être interprétée selon la méthode « solaire » aujourd’hui si populaire en Angleterre, quelle part doit être acceptée comme de l’histoire plus ou moins pervertie, quelle part doit être considérée comme incarnant des tentatives d’explication des faits naturels, et quelle part peut être rejetée comme une simple invention du sacerdoce à une époque relativement récente. [13] Ceux qui connaissent personnellement le caractère japonais seront probablement enclins à élargir la zone des trois divisions ultérieures plus qu’il ne serait prudent dans le cas des Aryens très imaginatifs, et à souligner que, bien que quelques portions de légendes japonaises [p. xc] puissent être rattachées à des étymologies inventées pour expliquer des noms de lieux, et soient donc de véritables mythes au sens strict du terme, le processus apparenté par lequel une personnalité est attribuée à des objets inanimés – un processus qui se trouve à la racine même de la mythologie aryenne – est totalement étranger au génie japonais, et même à l’esprit extrême-oriental en général. La mythologie ainsi née a été décrite à juste titre comme une « maladie du langage ». Mais tout le monde n’est pas susceptible d’attraper la même maladie, et vraisemblablement toutes les langues non plus ; et il est difficile de comprendre comment une maladie linguistique consistant à prendre une métaphore pour une réalité puisse s’attaquer à une langue pour laquelle la métaphore, même sous sa forme la plus anodine, est presque totalement étrangère. Ainsi, non seulement les noms japonais sont sans genre et les verbes sans personne, mais les noms d’objets inanimés ne peuvent même pas être utilisés comme sujets de verbes transitifs. Nulle part, par exemple, en japonais, qu’il soit archaïque, classique ou moderne, on ne trouve des expressions métaphoriques, voire mythologiques, telles que « le vent chaud fait fondre la glace » ou « sa conversation me ravit », où les mots « vent » et « conversation » sont utilisés comme s’ils étaient des agents personnels. Non, l’idée est invariablement rendue d’une manière différente et impersonnelle. Pourtant, quelle distance sépare de telles affirmations, dans lesquelles le lecteur européen ordinaire, ignorant toute langue altaïque, reconnaîtrait à peine l’existence d’une quelconque personnification, des envolées plus audacieuses de la métaphore aryenne ! En effet, bien que l’Asie altaïque ait produit très peu de sages,Français les mots de ses langues correspondent étroitement à la définition des mots comme « les compteurs du sage » ; car ils sont incolores et terre-à-terre, et élèvent rarement, voire jamais, celui qui les prononce au-dessus du niveau de la réalité sobre. En même temps, il est évident que le soleil joue un certain rôle dans la mythologie japonaise ; et même la légende du prince Yamato-Take, qui a jusqu’ici été généralement acceptée comme historique ou semi-historique, présente une telle ressemblance avec des légendes d’autres pays qui ont été déclarées solaires par de grandes autorités qu’il peut au moins valoir la peine de la soumettre à une enquête de ce point de vue. [^75] L’auteur de cet article a déjà exprimé sa conviction que cette question n’est pas du ressort du spécialiste seul. Il voudrait seulement, du point de vue japonais, suggérer une prudence très particulière dans l’application à la légende japonaise d’une méthode d’interprétation qui a donné d’excellents résultats ailleurs.
Un autre détail qui mérite d’être souligné est le fait presque certain d’une recension des diverses traditions à une date relativement tardive. Ceci est en partie démontré par la quantité de connaissances géographiques déployées dans l’énumération des différentes îles supposées avoir été créées par Izanagi et Izanami (« l’Homme qui invite » et la « Femme qui invite »), une quantité et une exactitude de connaissances inaccessibles à une époque antérieure à l’union sous un même règne de toutes les provinces mentionnées, et qui, de manière significative, ne s’étendaient guère au-delà de ces provinces. Une telle recension peut également être déduite, si l’on accepte l’opinion de l’origine multiple des traditions japonaises, de la manière assez ingénieuse dont leurs éléments constitutifs ont généralement été soudés ensemble. La façon dont une ou deux légendes, par exemple celle de la curieuse malédiction prononcée [68] [p. xcii] par le frère cadet Ho-wori sur l’aîné Ho-deri, sont répétées plus d’une fois illustre une révision moins intelligente. [14] Sous On pourrait peut-être inclure dans cette rubrique les légendes de la conquête du Yamato par l’empereur Jim-mu et de la conquête du même pays par l’impératrice Jin-go, qui présentent assurément une ressemblance suspecte. Il convient de noter que les histoires chinoise et coréenne, pour autant que nous les connaissions, n’en font aucune mention, et même les dates, telles qu’elles sont données plus précisément dans les « Chroniques », montrent clairement l’incohérence de l’histoire dans son ensemble. En effet, le mari de Jin-gō, l’empereur Chiū-ai, serait né la 19e année du règne de Sei-mu, soit en 149 apr. J.-C., tandis que son père, le prince Yamato-Take, serait mort la 43e année de Kei-kō, soit en 113 apr. J.-C., de sorte qu’il y a un intervalle de trente-six ans entre la mort du père et la naissance du fils ! [15]
Une information particulièrement intéressante, tirée d’une étude attentive des « Archives » et des « Chroniques » (bien que les commentateurs patriotiques japonais gardent un silence complet sur ce sujet), est que, dès la période la plus reculée, à laquelle remonte le crépuscule de la légende, l’influence chinoise avait déjà commencé à se faire sentir dans ces îles, transmettant aux habitants des outils et des idées. Il s’agit là d’un fait d’une importance toute particulière, qui renforce la masse de preuves démontrant que, dans presque tous les cas connus, la culture a été introduite de l’étranger et ne s’est pas développée spontanément. Les traces de l’influence chinoise sont certes peu nombreuses, mais elles sont indéniables. Ainsi, les baguettes sont mentionnées à la fois dans l’Idzumo et dans le cycle légendaire de Kiushu. Français La légende de la naissance de la Déesse-Soleil [69] et du Dieu-Lune des yeux d’Izanagi est un fragment à peine modifié du mythe chinois de P’an Ku ; la superstition selon laquelle les pêches avaient aidé Izanagi à repousser les armées d’Hadès peut presque certainement être attribuée à une source chinoise, et les servantes de la Déesse-Soleil japonaise sont mentionnées sous le titre exact de la Demoiselle Fileuse du mythe chinois (  ), tandis que la Rivière du Ciel (
), tandis que la Rivière du Ciel (  ), qui figure dans la même légende ; est également chinoise, car les deux noms ne peuvent certainement pas être de simples coïncidences. Une remarque similaire s’applique au nom de la Déité de la Cuisine et à la manière dont cette divinité est mentionnée. [16] L’art de fabriquer une boisson enivrante est mentionné dans les toutes premières légendes japonaises. Devons-nous croire que son invention ici fut indépendante de son invention sur le continent ? En l’occurrence, les histoires anciennes témoignent contre elles-mêmes ; car elles mentionnent cette même boisson en des termes montrant qu’elle était d’une curieuse rareté dans ce qui, selon la chronologie acceptée, correspond au siècle précédant immédiatement l’ère chrétienne, et de nouveau au troisième siècle de cette ère. Toute l’histoire [p. xciv] du palais du Dieu de la Mer a une connotation chinoise, et le « cassia » (
), qui figure dans la même légende ; est également chinoise, car les deux noms ne peuvent certainement pas être de simples coïncidences. Une remarque similaire s’applique au nom de la Déité de la Cuisine et à la manière dont cette divinité est mentionnée. [16] L’art de fabriquer une boisson enivrante est mentionné dans les toutes premières légendes japonaises. Devons-nous croire que son invention ici fut indépendante de son invention sur le continent ? En l’occurrence, les histoires anciennes témoignent contre elles-mêmes ; car elles mentionnent cette même boisson en des termes montrant qu’elle était d’une curieuse rareté dans ce qui, selon la chronologie acceptée, correspond au siècle précédant immédiatement l’ère chrétienne, et de nouveau au troisième siècle de cette ère. Toute l’histoire [p. xciv] du palais du Dieu de la Mer a une connotation chinoise, et le « cassia » (  ) qui y est mentionné est certainement chinois, tout comme les crocodiles. M. Henry von Siebold soupçonnait déjà que les maga-tama, ou « joyaux incurvés », si présents dans la mythologie japonaise et dont se paraient les premiers Japonais, provenaient de Chine ; et, tout récemment, M. Milne a apporté un éclairage inattendu sur ce sujet. Il a remarqué que le jade, ou la pierre semblable au jade dont sont faits nombre de maga-tama,est un minéral qui n’a jamais été rencontré au Japon. Nous savons donc qu’au moins une partie des « joyaux incurvés » ou de leur matériau provenaient du continent, et la probabilité que l’idée de sculpter ces ornements aux formes très étranges en ait également été importée augmente. Le type particulier de flèche appelé nari-kabura (
) qui y est mentionné est certainement chinois, tout comme les crocodiles. M. Henry von Siebold soupçonnait déjà que les maga-tama, ou « joyaux incurvés », si présents dans la mythologie japonaise et dont se paraient les premiers Japonais, provenaient de Chine ; et, tout récemment, M. Milne a apporté un éclairage inattendu sur ce sujet. Il a remarqué que le jade, ou la pierre semblable au jade dont sont faits nombre de maga-tama,est un minéral qui n’a jamais été rencontré au Japon. Nous savons donc qu’au moins une partie des « joyaux incurvés » ou de leur matériau provenaient du continent, et la probabilité que l’idée de sculpter ces ornements aux formes très étranges en ait également été importée augmente. Le type particulier de flèche appelé nari-kabura (  ) est une autre trace de l’influence chinoise dans l’ordre matériel, et une recherche approfondie par un érudit chinois compétent en révélerait peut-être d’autres. Mais on en a au moins dit assez pour démontrer l’existence indiscutable de cette influence. D’autres sources nous apprennent que l’imaginaire mythique plus récent du Japon s’est montré aussi peu impénétrable à une telle influence que les mœurs et coutumes du peuple. La seule différence est que l’assimilation s’est récemment faite avec beaucoup plus de rapidité.
) est une autre trace de l’influence chinoise dans l’ordre matériel, et une recherche approfondie par un érudit chinois compétent en révélerait peut-être d’autres. Mais on en a au moins dit assez pour démontrer l’existence indiscutable de cette influence. D’autres sources nous apprennent que l’imaginaire mythique plus récent du Japon s’est montré aussi peu impénétrable à une telle influence que les mœurs et coutumes du peuple. La seule différence est que l’assimilation s’est récemment faite avec beaucoup plus de rapidité.
Cette langue offre un autre guide ; bien que les traces décelables de l’influence chinoise soient relativement peu nombreuses dans le dialecte archaïque, elles existent néanmoins. C’est un sujet qui a été à peine abordé jusqu’à présent. Deux auteurs japonais d’une génération plus ancienne, Kahibara et [p. xcv] Arawi Hakuseki, ont effectivement signalé l’existence de telles traces. Mais ils n’en ont tiré aucune conclusion, ils n’ont pas cherché à en découvrir de nouvelles, et leurs indications, sauf dans un ou deux cas évidents, ont reçu peu d’attention de la part des auteurs ultérieurs, qu’ils soient natifs ou étrangers. Mais lorsque nous comparons des mots tels que kane, kume, kuni, saka, tana, uma et bien d’autres avec la prononciation donnée maintenant, ou avec celle que les lois phonétiques de la langue à son stade antérieur auraient fait donner, à leurs équivalents chinois  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  , etc., l’idée s’impose que de telles coïncidences de son et de sens ne peuvent pas toutes être purement accidentelles ; et lorsque, de plus, nous constatons que la grande majorité des mots en question désignent des choses ou des idées qui ont presque certainement été importées, nous comprenons qu’un examen plus approfondi du japonais archaïque (en particulier des noms botaniques et zoologiques, ainsi que des noms d’outils et d’objets manufacturés) serait probablement le meilleur moyen de découvrir au moins les aspects négatifs d’une antiquité plus ancienne que tous les documents écrits, plus ancienne même que la cristallisation des légendes que ces documents ont préservées. En traitant les mots coréens trouvés dans le japonais archaïque, nous abordons un terrain plus délicat ; car nous avons là une langue qui, contrairement au chinois, est étroitement liée au japonais, ce qui montre clairement que de nombreuses coïncidences de son et de sens doivent être attribuées à une affinité radicale plutôt qu’à des échanges ultérieurs. En même temps, il paraît plus probable que, par exemple, des termes japonais apparemment indigènes tels que Hotoke, « Bouddha » et tera, « temple bouddhiste », aient été en fait empruntés aux mots coréens correspondants Puchhö et [p. xcvi] chöl, plutôt que de supposer que les deux nations aient choisi indépendamment des homonymes pour désigner les mêmes idées étrangères. En effet, il ne serait peut-être pas trop audacieux de supposer que [71] dans le cas de Hotoke, « Bouddha », nous avons devant nous un mot dont le voyage comporte de nombreuses étapes, ayant d’abord été importé d’Inde en Chine, puis de Chine en Corée, et enfin de Corée au Japon, où finalement l’ingéniosité des philologues lui a découvert une étymologie japonaise (hito ke, « esprit humain ») avec lequel en réalité il n’a absolument rien à voir.
, etc., l’idée s’impose que de telles coïncidences de son et de sens ne peuvent pas toutes être purement accidentelles ; et lorsque, de plus, nous constatons que la grande majorité des mots en question désignent des choses ou des idées qui ont presque certainement été importées, nous comprenons qu’un examen plus approfondi du japonais archaïque (en particulier des noms botaniques et zoologiques, ainsi que des noms d’outils et d’objets manufacturés) serait probablement le meilleur moyen de découvrir au moins les aspects négatifs d’une antiquité plus ancienne que tous les documents écrits, plus ancienne même que la cristallisation des légendes que ces documents ont préservées. En traitant les mots coréens trouvés dans le japonais archaïque, nous abordons un terrain plus délicat ; car nous avons là une langue qui, contrairement au chinois, est étroitement liée au japonais, ce qui montre clairement que de nombreuses coïncidences de son et de sens doivent être attribuées à une affinité radicale plutôt qu’à des échanges ultérieurs. En même temps, il paraît plus probable que, par exemple, des termes japonais apparemment indigènes tels que Hotoke, « Bouddha » et tera, « temple bouddhiste », aient été en fait empruntés aux mots coréens correspondants Puchhö et [p. xcvi] chöl, plutôt que de supposer que les deux nations aient choisi indépendamment des homonymes pour désigner les mêmes idées étrangères. En effet, il ne serait peut-être pas trop audacieux de supposer que [71] dans le cas de Hotoke, « Bouddha », nous avons devant nous un mot dont le voyage comporte de nombreuses étapes, ayant d’abord été importé d’Inde en Chine, puis de Chine en Corée, et enfin de Corée au Japon, où finalement l’ingéniosité des philologues lui a découvert une étymologie japonaise (hito ke, « esprit humain ») avec lequel en réalité il n’a absolument rien à voir.
Ces remarques introductives ont déjà été si longues qu’il convient de ne pas évoquer le cas étonnamment parallèle d’emprunts de coutumes et d’idées présenté par les Aïnos de ce même archipel. En conclusion, il suffit de remarquer qu’une simple traduction d’un seul livre, telle que celle proposée ici, est loin d’épuiser le travail qui pourrait être consacré à l’élucidation de ce seul ouvrage, et encore moins de combler le fossé qui nous sépare encore d’une connaissance approfondie de l’antiquité japonaise. Pour ce faire, la coopération de l’archéologue est indispensable, tandis que, même dans le domaine de l’analyse documentaire, il reste encore beaucoup à faire. Il faut non seulement exploiter toutes les sources japonaises disponibles pour révéler les informations qu’elles contiennent, mais aussi faire appel aux archives chinoises et coréennes. Une grande quantité de littérature chinoise a déjà été fouillée dans un but similaire par Matsushita Ken-rin, dont la traduction d’une partie de la très utile compilation intitulée « Exposition des notices étrangères du Japon » (  ) serait une aide précieuse pour acquérir la connaissance souhaitée. En fait, [p. xcvii] il reste encore à faire pour l’antiquité japonaise de notre point de vue ce que Hirata a fait pour elle du point de vue d’un shintoïste japonais. À l’exception de quelques articles de M. Satow publiés dans ces « Transactions », le sujet n’a guère été étudié dans cet esprit, et il est possible que les membres japonais de notre Société soient quelque peu alarmés par l’idée que leur histoire nationale soit traitée avec si peu de respect. Peut-être, cependant, la découverte de l’intérêt de ce domaine d’étude, qui ne demande qu’à être exploré, les réconciliera-t-elle avec le point de vue ici avancé. Quoi qu’il en soit, si l’histoire ancienne du Japon n’est pas entièrement vraie, aucune illusion ne peut la rendre vraie. Ce que nous aimerions faire, c’est trier le vrai du faux. Comme l’a récemment déclaré un éminent anthropologue [17] : « La critique historique, c’est-à-dire le jugement, est pratiquée [[72]] non pas pour incrédulité, mais pour croyance. Son objectif n’est pas de critiquer l’auteur, mais de déterminer dans quelle mesure ses propos peuvent raisonnablement être tenus pour vrais. » De plus, même ce qui ne peut être accepté comme un fait historique recèle souvent de nombreux éléments précieux sous d’autres angles. Si nous perdons donc mille ans de ce qu’on appelle l’histoire japonaise, il ne faut pas oublier que la mythologie japonaise demeure le plus ancien produit existant de l’esprit altaïque.
) serait une aide précieuse pour acquérir la connaissance souhaitée. En fait, [p. xcvii] il reste encore à faire pour l’antiquité japonaise de notre point de vue ce que Hirata a fait pour elle du point de vue d’un shintoïste japonais. À l’exception de quelques articles de M. Satow publiés dans ces « Transactions », le sujet n’a guère été étudié dans cet esprit, et il est possible que les membres japonais de notre Société soient quelque peu alarmés par l’idée que leur histoire nationale soit traitée avec si peu de respect. Peut-être, cependant, la découverte de l’intérêt de ce domaine d’étude, qui ne demande qu’à être exploré, les réconciliera-t-elle avec le point de vue ici avancé. Quoi qu’il en soit, si l’histoire ancienne du Japon n’est pas entièrement vraie, aucune illusion ne peut la rendre vraie. Ce que nous aimerions faire, c’est trier le vrai du faux. Comme l’a récemment déclaré un éminent anthropologue [17] : « La critique historique, c’est-à-dire le jugement, est pratiquée [[72]] non pas pour incrédulité, mais pour croyance. Son objectif n’est pas de critiquer l’auteur, mais de déterminer dans quelle mesure ses propos peuvent raisonnablement être tenus pour vrais. » De plus, même ce qui ne peut être accepté comme un fait historique recèle souvent de nombreux éléments précieux sous d’autres angles. Si nous perdons donc mille ans de ce qu’on appelle l’histoire japonaise, il ne faut pas oublier que la mythologie japonaise demeure le plus ancien produit existant de l’esprit altaïque.
* * *
Voici la liste de tous les ouvrages japonais cités dans cette introduction et dans les notes de traduction. Pour la commodité du lecteur anglophone, tous les titres ont été traduits, à l’exception de quelques [p. xcviii] qui, principalement en raison de leurs allusions obscures, ne peuvent être traduits :
- Catalogue des noms de famille,
 , par le prince Mata [18]
, par le prince Mata [18] - Chroniques du Japon (généralement citées comme les « Chroniques »)
 ou
ou  par le prince Toneri et d’autres.
par le prince Toneri et d’autres. - Chroniques du Japon suite,
 , par Sugano Ason Mamichi, Fujihara no Ason TSUGUNAHA et autres.
, par Sugano Ason Mamichi, Fujihara no Ason TSUGUNAHA et autres. - Les Chroniques du Japon expliquées,
 , par URABE no Yasukata.
, par URABE no Yasukata. - Chroniques des vieilles choses des âges passés,
 , paternité incertaine.
, paternité incertaine. - Collection d’une myriade de feuilles,
 , par TACHIBANA NO MORAYE (probablement).
, par TACHIBANA NO MORAYE (probablement). - Recueil de chansons japonaises anciennes et modernes,
 , par Kino TSURAYUKI et autres.
, par Kino TSURAYUKI et autres. - Commentaire sur la Collection d’une myriade de feuilles,
 , par Kamo no MABUCHI.
, par Kamo no MABUCHI. - [73] Commentaire sur les drames lyriques,
 ,par Jinkō.
,par Jinkō. - Commentaire sur le Rituel de la Purification Générale,
 , MOTOWORI Norinaga.
, MOTOWORI Norinaga. - Récit correct de l’âge divin,
 , par MOTOWORI Norinaga.
, par MOTOWORI Norinaga. - Dictionnaire des mots-oreillers,
 , par Kamo no MABUCHI.
, par Kamo no MABUCHI. - Recueil des généalogies impériales,
 , par Yokoyama Yoshikiyo et Kurokaha Saneyori.[p. xcix]
, par Yokoyama Yoshikiyo et Kurokaha Saneyori.[p. xcix] - Discussion des objections à l’enquête sur la véritable chronologie,
 , par MOTOWORI Norinaga.
, par MOTOWORI Norinaga. - Examen des mots difficiles,
 , par Tachibana no MORIBE.
, par Tachibana no MORIBE. - Examen des synonymes du Japon,
 , par MOTOWORI Norinaga.
, par MOTOWORI Norinaga. - Explication des noms japonais,
 , par KAHIBARA Tokushin.
, par KAHIBARA Tokushin. - Explication des chansons dans les Chroniques du Japon,
 , par Arikida no HISAOI.
, par Arikida no HISAOI. - Exposition des histoires anciennes,
 , par HIRATA Atsutane.
, par HIRATA Atsutane. - Exposition des notices étrangères du Japon,
 , par Matsushita Ken-rin.
, par Matsushita Ken-rin. - Exposition des archives des matières anciennes (généralement) citée simplement comme « Commentaire de Motowori »),
 , par MOTOWORI Norinaga.
, par MOTOWORI Norinaga. - Exposition du récit des choses anciennes critiquées (généralement citée comme « Critique de Moribe sur le commentaire de Motowori »)
 , par Tachibana no MORIBE.
, par Tachibana no MORIBE. - Extraits d’une histoire ancienne,
 , par Imibe no HIRONARI.
, par Imibe no HIRONARI. - Idzu no Chi-Waki,
 , par Tachibana no MORIBE.
, par Tachibana no MORIBE. - Idzu no Koto-waki,
 , par (fin de la phrase—JBH)
, par (fin de la phrase—JBH) - Enquête sur la signification des noms des provinces (MS.),
 , par Fujihara no Hitomaro.
, par Fujihara no Hitomaro. - Enquête sur la véritable chronologie,
 , par MOTOWORI Norinaga.
, par MOTOWORI Norinaga. - Mots japonais classés et expliqués,
 , par MINAMO NO SHITAGAFU.
, par MINAMO NO SHITAGAFU. - Ko-Chi Tsū,
 , par ARAI Kumbi HAKUSEKI.
, par ARAI Kumbi HAKUSEKI. - Ko-Gan Shō, (MS.),
 , par KEI-CHIYU. [p. c]
, par KEI-CHIYU. [p. c] - [74] Commentaire perpétuel sur les Chroniques du Japon (généralement cité comme « Commentaire de Tanigaha Shisei »)
 , par TANIGAHA SHISEI.
, par TANIGAHA SHISEI. - Records of Ancient Matters (souvent cités simplement comme les « Records »),
 , par Futo no YASUMARO.
, par Futo no YASUMARO. - Archives des questions anciennes dans le caractère divin,
 , par Fujihara no Masaoki.
, par Fujihara no Masaoki. - Registres des affaires anciennes dans le caractère syllabique.
 , par Sakata no Kaneyasu.
, par Sakata no Kaneyasu. - Archives des affaires anciennes révisées,
 , Anonyme.
, Anonyme. - Records of Ancient Matters With Marginal Notes (généralement cité comme « l’édition de 1687 »),
 , par Deguchi NOBUYOSHI.
, par Deguchi NOBUYOSHI. - Registres des affaires anciennes avec la lecture ancienne,
 , par Nagase no Masachi (publié avec l’autorisation de Motowori)
, par Nagase no Masachi (publié avec l’autorisation de Motowori) - Registres de questions anciennes avec lectures marginales,
 , par Murakami Tadayoshi.
, par Murakami Tadayoshi. - Rituel de la Purification Générale,
 , Auteur incertain.
, Auteur incertain. - Shintō discuté à nouveau,
 , par Takahashi Gorō.
, par Takahashi Gorō. - Sources des histoires anciennes,
 , par HIRATA Atsutane.
, par HIRATA Atsutane. - Conte d’un coupeur de bambou,
 Auteur incertain.
Auteur incertain. - Tama-Katsuma,
 , par MOTOWORI Norinaga.
, par MOTOWORI Norinaga. - Tokihara-Gusa (le titre complet est Jin-Dai-Sei-Go Tokiha-Gusa),
 , (
, ( 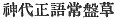 ), Hosoda TOMINOBU.
), Hosoda TOMINOBU. - Topographie de Yamashiro,
 , Auteur incertain.
, Auteur incertain. - Tō-Ga (MS.),
 , par ARAI Kumbi HAKUSEKI.
, par ARAI Kumbi HAKUSEKI. - Wa-Kun Shiwori,
 , par TANIGAWA SHISEI. [p. ci]
, par TANIGAWA SHISEI. [p. ci] - Contes de Yamato,
 , Auteur incertain.
, Auteur incertain.
Outre ces deux ou trois ouvrages chinois standard, on fait référence au « Yi Chin » ou « Livre des Mutations » (  ), et au « Shan Hai Ching » ou « Classique de la Montagne et de la Mer » (
), et au « Shan Hai Ching » ou « Classique de la Montagne et de la Mer » (  ) ; mais ils sont très peu nombreux et si facilement reconnaissables qu’il serait inutile de les énumérer. Tous les mots japonais proprement dits sont translittérés selon le « système orthographique » de M. Satow, qui, tout en représentant l’orthographe native, ne diffère pas beaucoup de la prononciation moderne. Dans le cas des mots sinico-japonais, où la divergence entre l’orthographe « orthographique » et la prononciation est souvent considérable, une orthographe phonétique a été préférée. À deux ou trois exceptions près, qui ont été particulièrement signalées, les mots sinico-japonais ne se trouvent que dans les noms propres mentionnés dans la préface, ainsi que dans l’introduction, les notes de bas de page et les titres de section du traducteur. Les quelques mots chinois présents dans l’introduction et les notes sont translittérés selon la méthode introduite par Sir Thomas Wade, aujourd’hui si largement utilisée par les étudiants en chinois.
) ; mais ils sont très peu nombreux et si facilement reconnaissables qu’il serait inutile de les énumérer. Tous les mots japonais proprement dits sont translittérés selon le « système orthographique » de M. Satow, qui, tout en représentant l’orthographe native, ne diffère pas beaucoup de la prononciation moderne. Dans le cas des mots sinico-japonais, où la divergence entre l’orthographe « orthographique » et la prononciation est souvent considérable, une orthographe phonétique a été préférée. À deux ou trois exceptions près, qui ont été particulièrement signalées, les mots sinico-japonais ne se trouvent que dans les noms propres mentionnés dans la préface, ainsi que dans l’introduction, les notes de bas de page et les titres de section du traducteur. Les quelques mots chinois présents dans l’introduction et les notes sont translittérés selon la méthode introduite par Sir Thomas Wade, aujourd’hui si largement utilisée par les étudiants en chinois.
¶ Notes de bas de page
[^59] : lxvi:60 Voir Annexe II.
[^60] : lxviii:61  .
.
[^66] : lxxvii :67 Podocarpus macrophylla.
[^70] : lxxx:71 Voir Sectes. XXXIX à XLI. Pour le «Sabre anti-herbes», voir Sectes ; XVIII et LXXXII, et. séq.
[^71] : lxxxii:72 Général Le Gendre, cité par Sir Edward Reed.
[^72] : lxxxvi:73  .
.
[^75] : xci:76 Voir Sectes. LXXIX-XCI.
lix:57 Les caractères chinois utilisés pour écrire ce mot sont
 , qui signifient la « Voie des Dieux ». Le terme a été adopté afin de distinguer les anciennes croyances indigènes du bouddhisme et du confucianisme. ↩︎
, qui signifient la « Voie des Dieux ». Le terme a été adopté afin de distinguer les anciennes croyances indigènes du bouddhisme et du confucianisme. ↩︎lxii:58 Conf. p. xvii, dernier paragraphe pour le sens modifié dans lequel seul le mot « déification » peut être utilisé pour parler du culte japonais primitif. ↩︎
lxv:59 Dans la Sect. XXVII, où cette divinité est mentionnée pour la première fois, il est appelé Sukuna Biko-Na-no-Kami, le « Petit Prince, la divinité renommée ». ↩︎
lxx:62 Pour avoir un aperçu de la souplesse de son système, il est recommandé au lecteur familier de la langue et des légendes japonaises de parcourir les pages 13 à 24 du premier volume de « Ko Shi Tsū » d’Arawi Hakuseki (
 ) où une interprétation rationaliste élaborée est appliquée à l’histoire des amours d’Izanagi et d’Izanami. C’est amusant dans sa gravité même, et il est difficile de croire que l’auteur ait pu être sérieux lorsqu’il l’a écrite. ↩︎
) où une interprétation rationaliste élaborée est appliquée à l’histoire des amours d’Izanagi et d’Izanami. C’est amusant dans sa gravité même, et il est difficile de croire que l’auteur ait pu être sérieux lorsqu’il l’a écrite. ↩︎lxxii:63 Le livre de M. Takahashi Gorō auquel il est fait ici allusion est son « Shintō Discussed Afresh ». ↩︎
lxxiii:64 C’est-à-dire l’empereur Jim-mu,—ten-nō, écrit
 , étant simplement le mot sinico-japonais pour « empereur ». ↩︎
, étant simplement le mot sinico-japonais pour « empereur ». ↩︎lxxiii:65 15e jour de la 11e lune de la 5e année de Meiji. ↩︎
lxxvi:66 Pour l’utilisation de ce mot pour représenter le Yomo ou Yomi japonais, voir Sect. IX, Note 1. ↩︎
lxxvii:68 Le compte rendu le moins maigre se trouve dans les Sect. XVI et XXXII. ↩︎
lxxviii:69 Se trouve à la fin de la Sect. XXXII. ↩︎
lxxix:70 Dans la légende de Jim-mu, nous avons la forme la plus courante de la superstition, à savoir qu’il est malchanceux d’aller d’ouest en est, ce qui est le contraire de la course suivie par le soleil. Dans la sect. CLIII, d’autre part, l’empereur Yū-riaku est critiqué pour avoir agi exactement de manière inverse, à savoir, pour aller d’est en ouest, p. lxxx c’est-à-dire dos au soleil. L’idée est la même, bien que son application pratique puisse ainsi différer diamétralement, l’objection fondamentale étant d’aller contre le soleil, quelle que soit la manière dont le mot contre, à ou une expression apparentée peut être interprété. ↩︎
lxxxix:74 c’est-à-dire la Grande et Auguste Divinité Produisant la Merveille. Il est le deuxième personnage divin dont la naissance est mentionnée dans les « Archives » (voir Sect. I. Note 5). Dans le récit de la création donné dans les « Chroniques », il n’apparaît que dans « Un récit ». ↩︎
lxxxix:75 La Sect. XXXVII est un bon exemple de la troisième de ces catégories. Pour un mythe élaboré fondé sur le nom d’un lieu, voir la Sect. LXV. Des exemples moins importants se trouvent dans les Sect. XLIV, LXV et LXXIII. ↩︎
xcii:77 Voyez cette légende telle qu’elle est donnée pour la première fois dans les Sectes XL et XLI, puis dans un tout autre contexte dans la Secte CXVI. La manière dont « Un récit » des « Chroniques du Japon » raconte l’histoire des ravages commis sur les champs de la Déesse-Soleil par son frère, la « Déité Mâle Impétueuse », pourrait peut-être justifier l’opinion qu’il s’agit là du même récit sous une autre forme. La légende est évidemment très importante. ↩︎
xcii:78 L’attention du traducteur a été attirée sur l’incohérence de ces dates par M. Ernest Satow. ↩︎
xciii:79 Voir Sect XXIX, Note 16. ↩︎
xcvii:80 Dr. Tylor dans son « Anthropologie », chap. XV. ↩︎
xcviii:81 Les noms en petites capitales sont ceux sous lesquels les auteurs (ou compilateurs) sont le plus connus, et sont généralement soit leur nom de famille, soit leur nom personnel. L’usage japonais est cependant très fluctuant, et autorise en outre l’utilisation d’une variété de noms de plume. Ainsi, Motowori est non seulement souvent mentionné sous son nom personnel Norinaga, mais aussi sous la désignation de Suzunoya no Ushi, Mabuchi sous la désignation de Agatawi no Ushi, etc. ↩︎