[ p. 28 ]
¶ SECT. VI.—NAISSANCE DES DIFFÉRENTES DIVINITÉS.
Lorsqu’ils eurent fini de donner naissance à des pays, ils commencèrent à donner naissance à des divinités. Ainsi, le nom de la divinité à laquelle ils donnèrent naissance était la divinité Grand-Mâle-de-la-Grande-Chose ; [1] ensuite ils donnèrent naissance à la divinité Prince-Rocher-Terre ; [2] ensuite ils donnèrent naissance à la divinité Princesse-Nid-Rocher ; [3] [26] ensuite ils donnèrent naissance à la divinité Jeunesse-Soleil-Grande-Porte ; [4] ensuite ils donnèrent naissance à la divinité Mâle-Souffle-Céleste ; [5] ensuite ils donnèrent naissance à la divinité Prince-Grande-Maison ; [6] ensuite ils donnèrent naissance à la divinité Jeunesse-du-Souffle-du-Vent-le-Grand-Mâle ; [7] ensuite ils donnèrent naissance à la divinité Mer, dont le nom est la divinité Grand-Possesseur-de-l’Océan ; [8] Ensuite, ils donnèrent naissance à la Déité des Portes d’Eau, [9] dont le nom est la Déité Prince-de-l’Automne Rapide ; [10] Ensuite, ils donnèrent naissance à sa sœur cadette, la Déité Princesse-de-l’Automne Rapide. (Dix Déités en tout, de la Déité-Grand-Mâle-de-la-Grande-Chose à la Déité Princesse-de-l’Automne.) [11] Les noms des Déités données par ces deux Déités Prince-de-l’Automne Rapide et [27] Princesse-de-l’Automne Rapide de leurs domaines séparés de rivière et de mer étaient : la Déité Écume-Calme ; [12] Ensuite, la Déité Écume-Vagues ; Ensuite, la Déité Bulle-Calme ; Ensuite, la Déité Bulle-Vagues ; Ensuite, la Déité Divinité Divinité Céleste-Diviseure-De-L’Eau ; [^204] Ensuite, la Déité Terrestre-Diviseuse d’Eau ; Ensuite, la Déité Céleste-Puissante-d’Eau-Posseuse-de-Courge ; [13] Ensuite, la Déité Terrestre-Puissante d’Eau-Posseuse-de-Courge. (Huit Déités en tout, de la Déité Prince-Écume à la Déité Terrestre-Puissante d’Eau-Posseuse-de-Courge.) Ensuite, ils donnèrent naissance à la Déité du Vent, dont le nom est la Déité Prince-du-Long-Vent. [14] Ensuite, ils donnèrent naissance à la Déité des Arbres, dont le nom est la Déité Ancien-Souche, [15] Ensuite, [ p. 29 ] ils donnèrent naissance à la Déité des Montagnes, dont le nom est la Déité Possesseur de la Grande-Montagne. [^208] Ensuite, ils donnèrent naissance à la Déité des Landes, dont le nom est la Déité Princesse-Chaume-Lande, [16] dont un autre nom est la Déité Ancien-de-la-Lande. (Quatre Déités en tout, de la Déité Prince-du-Long-Vent à l’Ancien-de-la-Lande.) Les noms des Déités données [28] par ces deux Déités, la Déité Possesseur-de-la-Grande-Montagne et la Déité Ancien-de-la-Lande, de leurs domaines séparés de montagne et de lande, étaient : la Déité Ancien-Céleste-des-Cols ; ensuite la Déité Ancien-Terrestre-des-Cols ; [17] ensuite la Déité Frontière-du-Col-Céleste, ensuite la Déité Frontière-du-Col-Terrestre ; [18] ensuite la Déité Porte-Sombre-Céleste ; ensuite la Déité Porte-Sombre-Terrestre ; [^212] ensuite la Déité Grand-Val-Prince ; ensuite la Déité Grand-Val-Princesse. [19] (Huit Déités en tout, de la Déité Céleste-Aîné-des-Cols à la Déité Grand-Val-Princesse.) Le nom de la Déité à laquelle ils [20] donnèrent naissance ensuite était la Déité Rocher-de-l’Oiseau-Barque-Camphre, [21] dont un autre nom est le Barque-Oiseau-Céleste.Ensuite, ils donnèrent naissance à la Déité Princesse-de-la-Grande-Nourriture. [22] Ensuite, ils donnèrent [29] naissance à la Déité-Mâle-Brûlant-de-Feu, [23] dont un autre nom est la Déité Prince-Brillant-de-Feu, et un autre nom est la Déité Ancien-Brillant-de-Feu.
[ p. 30 ]
[ p. 31 ]
[ p. 32 ]
¶ SECTION VII.—RETRAITE DE SON AUGUSTE LA PRINCESSE-QUI-INVITE.
Français En donnant naissance à cet enfant, ses augustes parties intimes furent brûlées, et elle tomba malade et s’allongea. [24] Les noms des Déités nées de son vomi étaient la Déité Prince-Montagne-Métal, puis la Déité Princesse-Montagne-Métal. [25] Les noms des Déités nées de ses excréments étaient la Déité Prince-Argile-Viscose, puis la Déité Princesse-Argile-Viscose. [^220] Les noms des Déités nées ensuite de son urine étaient la Déité Mitsuhanome [26], puis la Déité-Produisant-Jeune-Merveille. [^222] L’enfant de cette Déité fut appelé [ p. 33 ] la Déité Princesse-Nourriture-Luxuriante. [^223] Ainsi la Déité [30] la Femelle-Qui-Invite, en donnant naissance à la Déité-du-Feu, se retira enfin divinement. [27] (Huit Déités en tout, du Bateau-Oiseau-Céleste à la Déité Princesse-Nourriture-Luxuriante. [28])
Le nombre total d’îles données naissance conjointement par les deux Déités, l’Homme-Qui-Invite et la Femme-Qui-Invite, était de quatorze, et de Déités trente-cinq. (Ce sont celles qui furent données naissance avant que la Déité Princesse-Qui-Invite ne se retire divinement. Seule l’Île d’Onogoro ne fut pas donnée naissance. [29] et de plus, l’Enfant-Sangsue [30] et l’Île d’Aha ne sont pas comptées parmi les enfants).
Alors Son Auguste, l’Homme-Qui-Invite, dit : « Oh ! Ton Auguste, ma charmante sœur cadette ! Oh, si seulement je t’avais échangée contre cet enfant ! » [31] Et tandis qu’il rampait autour de son auguste oreiller, et [31] tandis qu’il rampait autour de ses augustes pieds en pleurant, naquit de ses augustes larmes la Déité qui réside à Konomoto, près d’Unewo, sur le Mont Kagu, [32] et dont le nom est la Déité-Féminine-Pleureuse. [33] Il enterra donc la Déité-Féminine-Qui-Invite, divinement retirée [34], sur le Mont Hiba [35], à la frontière du Pays d’Idzumo [36] et du Pays de Hahaki. [37]
[ p. 34 ]
[ p. 35 ]
¶ SECT. VIII.—LE MEURTRE DE LA DIVINITÉ DU FEU.
Alors Son Auguste le Mâle-Qui-Invite, dégaina le sabre à dix poignées [38] dont il était augustement ceint, [32] coupa la tête de son enfant, la Déité Ancien-Scintillant. Sur ce, les noms des Déités nées du sang collé à la pointe de l’auguste épée [ p. 36 ] et éclaboussées par les innombrables coups de pierre furent : la Déité Fendeuse-de-Roche, [39] ensuite la Déité Fendeuse-de-Racines, puis la Déité-Mâle-Possédant-la-Roche. [40] Les noms des divinités qui naquirent ensuite du sang qui colla à la partie supérieure [41] de l’épée auguste et éclaboussa à nouveau les innombrables masses rocheuses furent : la divinité terriblement rapide, [^239] ensuite la divinité du feu rapide, [^240] ensuite la divinité mâle courageuse et terriblement possessive, [42] encore appelée divinité courageuse et claquante, [43] et enfin la divinité luxuriante et claquante. Les noms des divinités qui naquirent ensuite du sang qui s’accumula [33] sur la poignée de l’épée auguste et s’écoula entre ses doigts furent : la divinité Kura-okami, puis la divinité Kura-mitsuha. [44]
Les huit divinités de la liste ci-dessus, de la divinité Fendeuse de Roche à la divinité Kura-mitsuha, sont des divinités nées de l’auguste épée.
Le nom de la Déité née de la tête de la Déité Ancien-Scintillant, qui avait été tuée, était la Déité Possesseur-des-Montagnes-du-Vrai-Col. [45] Le nom de la Déité née ensuite de sa poitrine était la Déité Possesseur-des-Montagnes-Descendantes. [46] Le nom de la Déité née ensuite de son ventre était la Déité Possesseur-des-Montagnes-les-Plus-Intérieures. [47] Le nom de la Déité née ensuite de ses parties intimes était la Déité Possesseur-des-Montagnes-Sombres. Le nom de la Déité née ensuite de sa main gauche [^247] était la Déité Possesseur-des-Montagnes-Denses[ly-Wooded]-Denses. Le nom de la Déité qui naquit ensuite de sa main droite [^247] était la Déité Possesseur des Montagnes Périphériques. Le nom de la Déité qui naquit ensuite de son pied gauche [48] était la Déité Possesseur des Montagnes de la Lande. [ p. 37 ] Le nom de la Déité qui naquit ensuite de son pied droit [49] était la Déité Possesseur des Montagnes Extérieures. (Huit Déités en tout, de la Déité Possesseur des Montagnes du Vrai Col à la Déité Possesseur des Montagnes Extérieures). Ainsi, le nom de l’épée avec laquelle [l’Homme-Qui-Invite] coupa [la tête de son fils] était Lame-Pointe-Céleste-Étendue, et un autre nom était Lame-Pointe-Étendue-Majestueux. [50]
[ p. 38 ]
¶ SECTION IX.—LE PAYS D’HADÈS.
Français Là-dessus, [Son Auguste l’Homme-Qui-Invite], désirant rencontrer et voir sa sœur cadette Son Auguste la Femme-Qui-Invite, la suivit jusqu’au Pays d’Hadès. [51] Alors, lorsqu’elle sortit du palais et sortit à sa rencontre, [52] Son Auguste l’Homme-Qui-Invite parla, disant : « Ton Auguste, ma charmante sœur cadette ! Les terres que toi et moi avons créées ne sont pas encore finies ; alors reviens ! » Alors Son Auguste la Femme-Qui-Invite répondit, disant : [ p. 39 ] « C’est vraiment lamentable que tu ne sois pas venu plus tôt ! J’ai mangé de la fournaise de l’Hadès. [53] Néanmoins, comme je révère [54] l’entrée ici de Ton Auguste, mon charmant frère aîné, je souhaite revenir. [55] De plus [56] j’en discuterai particulièrement avec les Divinités de l’Hadès. [57] Ne me regarde pas ! » Ayant ainsi parlé, elle retourna à l’intérieur du palais ; et comme elle y resta très longtemps, il ne put attendre. Alors, ayant pris et cassé une des dents du bout [58] du peigne multiforme et aux dents serrées planté dans l’auguste mèche gauche [de ses cheveux], il alluma une lumière [59] et entra et regarda. Les asticots grouillaient. et [elle] pourrissait, et dans sa tête demeurait le Grand-Tonnerre, [36] dans sa poitrine demeurait le Tonnerre de Feu, dans sa main gauche [60] demeurait le Jeune-Tonnerre, dans sa main droite [60:1] demeurait le Tonnerre-Terrestre, dans son pied gauche [^261] demeurait le Tonnerre-Grondant, dans son pied droit [^261] demeurait le Tonnerre-Couchant : — en tout huit Déités-du-Tonnerre étaient nées et demeuraient là. [61] Là-dessus, Son Auguste le Mâle-Qui-Invite, effrayée par la vue, s’enfuit en arrière, sur quoi sa jeune sœur Son Auguste la Femelle-Qui-Invite dit : « Tu m’as fait honte », et envoya aussitôt la Laide-Femme-d’Hadès [^263] à sa poursuite. Alors Son Auguste l’Homme-Qui-Invite prit sa coiffe noire et auguste [62] et la jeta à terre, et elle se transforma instantanément en raisins. Tandis qu’elle les ramassait et les mangeait, il s’enfuit ; mais comme elle le poursuivait toujours, il prit et brisa le peigne nombreux et serré dans la bonne touffe [de ses cheveux] et le jeta à terre, et il se transforma instantanément en pousses de bambou. Tandis qu’elle les arrachait et les mangeait, il s’enfuit. Plus tard, [sa sœur cadette] envoya les huit Divinités du Tonnerre avec mille cinq cents guerriers d’Hadès à sa poursuite [37] [ p. 40 ]. Alors, tirant le sabre à dix poignées qu’il portait augustement, il s’enfuit en avant, le brandissant de la main arrière ; [63] Et comme ils le poursuivaient toujours, il prit, en atteignant la base du Passage Égal de l’Hadès, [^266] trois pêches qui poussaient à sa base, et attendit et frappa [ses poursuivants avec], de sorte qu’ils s’enfuirent tous. Alors Son Auguste le Mâle-Qui-Invite annonça aux pêches : « Comme vous m’avez aidé,« Ainsi devez-vous aider tous les vivants [64] du Pays Central des Plaines de Roseaux [65] lorsqu’ils se retrouveront dans des circonstances difficiles et seront harcelés ! » — et il donna aux pêches le nom de Leurs Augustes, Grand-Divin-Fruit. [66] Enfin, sa sœur cadette, Son Auguste, la Princesse-Qui-Invite, se lança à leur poursuite. Il tira donc un rocher aux mille courants d’air, [67] et, avec lui, barra le Passage Égal d’Hadès, et plaça le rocher au milieu ; ils se tinrent face à face et échangèrent des adieux ; [68] et Son Auguste, la Femelle-Qui-Invite, dit : « Mon beau frère aîné, ton Auguste ! Si tu agis ainsi, j’étranglerai à mort en un jour mille des habitants de ton pays. » Alors Son Auguste, l’Homme-Qui-Invite, répondit : « Ma charmante jeune sœur, Ton Auguste ! Si tu fais cela, je créerai en un jour mille cinq cents maisons d’accouchement. [69] De cette manière, chaque jour, mille personnes naîtraient sûrement. » Français Ainsi, Son Augusteté, la Femelle-Qui-Invite, est appelée la Grande-Déité-de-l’Hadès. [70] On dit encore que, parce qu’elle a poursuivi et atteint [son frère aîné], elle est appelée la Grande-Déité-Atteindre-la-Route. [71] De même, le rocher avec lequel il a bloqué le Passage de l’Hadès est appelé la Grande-Déité-du-Chemin-Retournant, [72] [ p. 41 ] et de nouveau il est appelé la Grande-Déité-Bloqueuse-de-la-Porte-de-l’Hadès. [73] Ainsi, ce qui était appelé le Passage-Égal-de-l’Hadès est maintenant appelé le Passage-d’Ifuya [74] dans le Pays d’Idzumo.41] et encore on l’appelle la Grande Déité Bloquante de la Porte de l’Hadès. [73:1] Ainsi, ce qui était appelé le Passage-Égal-de-l’Hadès est maintenant appelé le Passage-d’Ifuya [74:1] dans le Pays d’Idzumo.41] et encore on l’appelle la Grande Déité Bloquante de la Porte de l’Hadès. [73:2] Ainsi, ce qui était appelé le Passage-Égal-de-l’Hadès est maintenant appelé le Passage-d’Ifuya [74:2] dans le Pays d’Idzumo.
[ p. 42 ]
[ p. 43 ]
[ p. 44 ]
¶ SECT. X.—LA PURIFICATION DE LA PERSONNE AUGUSTE.
Alors la Grande Déité le Mâle-Qui-Invite dit : « Non ! hideux ! Je suis venu sur une terre hideuse et polluée, — vraiment ! [75] Je vais donc purifier mon auguste personne. » Il se rendit donc dans une plaine [couverte d] ahagi [^279] à l’embouchure d’une petite rivière près de Tachibana [76] à Himuka [77] dans [l’île de] Tsukushi, et se purifia et se purifia. Ainsi, le nom de la Déité née du bâton auguste qu’il lança était la Déité Poussée-Dressée-Ne-Viens-Pas-Endroit. [78] Le nom de [40] la Déité née de la ceinture auguste qu’il lança ensuite était la Déité Route-Long-Espace. [79] [ p. 45 ] Le nom de la Déité qui naquit de la jupe auguste qu’il jeta ensuite était la Déité Desserre-Met. [80] Le nom de la Déité qui naquit de l’auguste vêtement supérieur qu’il jeta ensuite était la Déité Maître-des-Troubles. [81] Le nom de la Déité qui naquit de l’auguste pantalon qu’il jeta ensuite était la Déité-Bifurcation. [82] Le nom de la Déité qui naquit de l’auguste chapeau qu’il jeta ensuite était la Déité Maître-de-la-Bouche-Ouverte. [83] Les noms des Déités qui naquirent du bracelet de son auguste main gauche [^288] qu’il jeta ensuite étaient les Déités Prochainement-Lointain, [^289] ensuite la Déité Lave-Prince-du-Prochainement, ensuite la Déité Intermédiaire-Direction-du-Prochainement. Les noms des Déités qui naquirent du bracelet de son auguste main droite [41] qu’il jeta ensuite furent : la Déité Rivage-Lointain, ensuite la Déité Lavage-Prince-du-Rivage, ensuite la Déité Intermédiaire-Direction-du-Rivage.
Les douze Déités mentionnées dans la liste précédente [84], depuis la Déité Venue-Non-Lieu jusqu’à la Déité Direction-Intermédiaire-du-Rivage, sont des Déités qui sont nées du fait qu’il a enlevé les choses qui étaient sur sa personne.
Français Alors, disant : « L’eau du cours supérieur est trop rapide ; l’eau du cours inférieur est trop lente », il descendit et plongea dans le cours moyen ; et, tandis qu’il se lavait, naquit d’abord la Déité Merveilleuse des Quatre-Vingts Maux, puis la Déité Merveilleuse des Grands Maux. [85] Ces deux Déités sont les Déités qui furent nées de la saleté qu’il contracta lorsqu’il se rendit sur cette terre polluée et hideuse. [86] Les noms des Déités qui naquirent ensuite pour rectifier ces maux furent : [ p. 46 ] la Déité Merveilleuse-Dieu-Rectificatrice, puis la Déité Merveilleuse-Grande-Rectificatrice, [87] ensuite la Déité-Féminine-Idzu. [^294] Les noms des divinités qui naquirent ensuite, alors qu’il se baignait au fond de l’eau, furent : la divinité Possesseur-du-Fond-de-l’Océan, [88] puis son Auguste Ancien-Mâle-du-Fond. Les noms des divinités qui naquirent alors qu’il se baignait au milieu de l’eau furent : la divinité Possesseur-du-Milieu-de-l’Océan, puis son Auguste Ancien-Mâle-du-Milieu. Les noms des divinités qui naquirent alors qu’il se baignait à la surface de l’eau furent la divinité Possesseur-de-la-Surface-de-l’Océan, puis son Auguste Ancien-Mâle-de-la-Surface. Ces trois divinités Possesseurs de l’Océan sont les divinités vénérées comme leurs divinités ancestrales par les chefs d’Adzumi. [89] Ainsi, les chefs d’Adzumi sont les descendants de son auguste Utsushi-hi-gana-saku, [90] un enfant de ces divinités possédant l’océan. [91] Ces trois divinités, son auguste mâle aîné du fond, son auguste mâle aîné du milieu et son auguste mâle aîné de la surface, sont les trois grandes divinités de la crique de Sumi. [92] Le nom de la divinité qui naquit alors qu’il lava son auguste œil gauche était la grande auguste divinité resplendissante du ciel. [93] Le nom de la divinité qui naquit ensuite alors qu’il lava son auguste œil droit était son auguste, possesseur de la nuit de lune. [94] Le nom de la divinité qui naquit ensuite alors qu’il lava son auguste nez était son auguste mâle courageux et impétueux. [95]
Les quatorze divinités de la liste précédente, depuis la merveilleuse divinité des quatre-vingts maux jusqu’à son auguste mâle impétueux et rapide, sont des divinités nées du bain de son auguste personne.
[ p. 47 ]
[ p. 48 ]
[ p. 49 ]
¶ Notes de bas de page
[^204] : 28:13 Ame-no-mi-kumari-no-kami. La divinité suivante est Kuni-nomi-kumari-no-kami.
[^208] : 29:17 Oho-yama-tsuna-ka-mi.
[^212] : 29:21 p. 32 Ame-no-kura-do-no-kami et Kuni-no-kura-do-no-kami. Motowori explique kura (  , « sombre ») par tani (
, « sombre ») par tani (  , « vallée »), et to « porte » par tokoro (
, « vallée »), et to « porte » par tokoro (  , « lieu »).
, « lieu »).
[^220] : 32:3 Hani-yasu-biko-no-kami et Hani-yasu-bime-no-kami.
[^222] : 32:5 Waku-musu-bi-no-kami.
[^223] : 33:6 Toyo-uke-bime-no-kami.
[^239] : 36:5 Mika-haya-bi-no-kami. Motowori semble avoir raison de considérer mika comme équivalent à ika, la racine de ikameshiki, « sévère », « horrible » et bi comme racine de buru, un suffixe verbalisant.
[^240] : 36:6 _Salut-haya-bi-no-kami_.
[^266] : 39:13 Yomo-tsu-shiko-me.
[^279] : 41:26 Sayari-masu-yomi-do-no-oho-kami.
[^288] : 45:8 Wadzurahi-no-ushi-no-kami.
[^289] : 45:9 Chi-mata-no-kami.
[^294] : 45:14 Les noms de ces deux divinités dans l’original sont Ya-so-maga-tsu-bi-no-kami et Oho-maga-tsu-bi-no-kami.
28:1 p. 29 Oho-koto-oshi-wo-no-kami. « Les Grandes Choses Mâles-Persistantes » serait une traduction possible, mais moins bonne. Ce dieu est identifié par Motowori à Koto-toke-no-wo mentionné dans « Un récit » des « Chroniques du Japon ». ↩︎
28:2 L’original Ika-tsuchi-biko-no-kami (
 ) est identifié par Motowori avec Uha-zutsu-no-wo, (
) est identifié par Motowori avec Uha-zutsu-no-wo, (  ) mentionné dans la Sect. X (Note 18). Il interpréterait le premier tsu (dzu) comme la particule génitive et le second comme identique à « l’appellation honorifique ji des hommes », telle que Hikoji, Oho-to-no-ji, etc. Si cette supposition était correcte, le nom entier signifierait Prince-Seigneur-Supérieur ; mais il est plus sûr de se laisser guider par les caractères du texte. ↩︎
) mentionné dans la Sect. X (Note 18). Il interpréterait le premier tsu (dzu) comme la particule génitive et le second comme identique à « l’appellation honorifique ji des hommes », telle que Hikoji, Oho-to-no-ji, etc. Si cette supposition était correcte, le nom entier signifierait Prince-Seigneur-Supérieur ; mais il est plus sûr de se laisser guider par les caractères du texte. ↩︎28:3 p. 30 Iha-zu-bime-no-kami. Ici aussi, Motowori considère la syllabe zu- comme « liée » aux syllabes tsu-tsu interprétées comme ci-dessus, oubliant apparemment que le deuxième tsu (ji) n’apparaît que dans les noms masculins. ↩︎
28:4 Oho-to-bi-wake-na-kami, un nom que Motowori, en supposant des corruptions du texte et en faisant un usage abondant du système souple et puissant de dérivation avec lequel les étymologistes japonais assiègent les difficultés de leur langue, identifie avec Oho-naho-bi-no-kami, « la Grande-Déité-Merveilleuse-Rectificatrice », mentionnée dans la Sect. X (Note 16). ↩︎
28:5 Ame-no-fuki-wo-no-kami, identifié par Motowori avec I-buki-do-nushi mentionné dans le « Rituel de la Purification Générale ». (Voir son Commentaire sur ce Rituel, Vol. II, pp. 29-32.) ↩︎
28:6 Ohoyabikonokami, identifié par Motowori avec Oho-aya-tsui-bi mentionné dans « Un récit » des « Chroniques ». ↩︎
28:7 Kaza-ge-tsu-wake-no-oshi-wo-no-kami. L’interprétation conjecturale de Motowori a été suivie ; mais la lecture et la signification de l’original sont toutes deux entachées de difficultés. Motowori identifie cette divinité à Soko-sasura-hime mentionnée dans le « Rituel de la Purification Générale ». ↩︎
28:8 Oho-wata-tsu-mi-no-kami. L’interprétation de mochi, « possesseur », bien que pas absolument sûre, a pour elle le poids de l’autorité et de la vraisemblance. ↩︎
28:9 C’est-à-dire, embouchures de rivières, estuaires ou ports. Dans l’original Minato-no-kami. ↩︎
28:10 Haya-aki-dzu-hiko. Aki, dont la signification exacte est « automne », pourrait aussi, par métonymie, être interprété comme signifiant « libellule » ou « Japon ». Motowori, à propos de ce nom, se lance dans des dérivations et des identifications très audacieuses avec les noms d’autres dieux. L’original de la divinité sœur est Haya-aki-dzu-hime-no-kami. ↩︎
28:11 Le texte ici omet le mot « Swift » de ce nom. ↩︎
28:12 Les noms originaux de cette divinité et des trois suivants sont Awa-nagi-no-kami, Awa-nami-no-kami, Tsura-nagi-no-kami et Tsura-nami, no-kami. L’interprétation des parties composantes est sujette à caution, mais celle adoptée ici fait autorité selon Motowori et Hirata. ↩︎
28:14 p. 31 Cette divinité et la suivante figurent dans les versions originales Ame-no-ku-hiza-mochi-no-kami et Kuni-ito-ku-hiza-mochi-no-kami. L’étymologie est obtenue par comparaison avec un passage du « Rituel pour éviter le feu » (
 ). ↩︎
). ↩︎28:15 Shina-tsu-hiko-no-kami. L’origine de ce nom est expliquée par Motowori, qui fonde son interprétation sur deux passages du « Collection d’une myriade de feuilles », signifiant Prince-au-Long-Souffle_. Mais le traducteur est convaincu que shi-na, interprété par lui au sens de « long souffle » (ou plutôt « long souffle »), doit être relié à shi, un ancien mot pour vent que l’on retrouve dans ara-shi (« vent de tempête »), ni-shi (« vent d’ouest »), hi-gashi (« vent d’est »), et peut-être sous une forme légèrement modifiée dans kaze, « vent », alors que shi n’apparaît nulle part dans le sens de « souffle ». Hirata note avec approbation cette étymologie de shi (« Exposition des Histoires Anciennes », vol. III, p. 63), sans toutefois s’aventurer à contredire catégoriquement la décision de son prédécesseur quant à la signification du nom en question. La différence de sens est somme toute minime. Na doit être pris comme une forme apocopée de nagaki, « long ». Plus tard, Shinato a été utilisé pour désigner le vent du nord-ouest. ↩︎
28:16 Tel semble être le sens du Kuku-no-chi-no-kami original. ↩︎
29:18 Kaya-nu-kimi-no-kami. L’étymologie du nom personnel alternatif (dans l’original Nu-dzu-chi-no-kami) n’est pas tout à fait certaine. ↩︎
29:19 L’original de ces deux noms est Ame-no-sa-dzu-chi-no-kami et Kuni-no-sa-dzu-chi-no-kami. Leur signification est obscure, mais le traducteur a, après quelques hésitations, suivi l’interprétation de Motowori. Les mots « céleste » et « terrestre » devraient probablement être considérés comme qualifiant des « cols ». Ce mot « col », utilisé ici et ailleurs pour traduire le terme japonais saka (sa), doit être compris comme incluant des ascensions moins importantes que celles, très ardues, que seul le mot « col » désigne dans le langage courant anglais. Dans la langue japonaise plus récente, le mot tauge (tōge) désigne généralement les « cols » proprement dits, tandis que saka se limite à la signification de petites ascensions ou de collines. Mais cette distinction n’est en aucun cas strictement respectée. ↩︎
29:20 Ame-no-sa-giri-no-kami et Kuni-no-sagiri-no-kami. Sa semble être considéré à juste titre, comme dans les deux noms précédents, comme une forme archaïque de saka (à proprement parler sa-ka, « lieu-colline »), et giri comme une forme apocopée de kagiri, (à proprement parler ka-giri, « lieu-coupant »), « limite » ou « frontière ». Cependant, Hirata, suivant le caractère chinois avec lequel kiri s’écrit, l’interprète dans le sens de « brume ». ↩︎
29:22 Telle semble être l’interprétation correcte de l’original de ces deux noms, Oko-tomato-hiko-no-kami et Oho-tomato-hime-no-kami, tomate étant vraisemblablement associé à towomaru et tawamu. Il est difficile de trouver un mot anglais pour décrire exactement cette idée, qui évoque plutôt un léger pli montagneux que le creux plus étroit et plus escarpé que nous appelons « vallée ». ↩︎
29:23 C’est-à-dire, le Prince-Qui-Invite et la Princesse-Qui-Invite (Izanagi et Iza-nami). ↩︎
29:24 Tori-no-iha-kusa-bune-no-kami. L’autre nom est Ame-no-tori-bune, dont le titre de Déité est omis. Il convient de consulter le Commentaire de Motowori, vol. V, pp. 52-53, à propos de cette divinité. ↩︎
29:25 Homonyme du nom personnel alternatif de l’île d’Aha. (Voir Sect. V, Note 8). ↩︎
29:26 Hi-no-haya-yagi-wo-no-kami. Si, comme cela semble probable, yagi est une interprétation incorrecte de kagi, nous devrions traduire par « brillant » le mot ici rendu par « brûlant ». Les autres noms sont Hino-kaga-biko-no-kami et Hino-kaga-tsuchi-no-kami. Dans « Un récit » des « Chroniques » et ailleurs dans les « Rituels », ce dieu du feu est appelé Ho-musubi, c’est-à-dire le Producteur de Feu. ↩︎
32:1 p. 33 « Allongée » (koyasu) est un terme souvent utilisé dans la langue archaïque dans le sens de « mourir ». Mais ici, il faut le prendre au sens littéral, la mort (« retraite divine ») de la déesse étant relatée quelques pages plus loin. ↩︎
32:2 Kana-yama-biko-no-kami et Kana-yama-bime-no-kami. La traduction de ces deux noms suit le sens courant des caractères
 avec lesquels ils sont écrits, et qui semble assez approprié, se situant entre la divinité du feu et les divinités de l’argile. Cependant, Motowori, déclarant que les deux caractères sont purement phonétiques, dérive kana-yama de korena-yamasu, « faire flétrir et souffrir ». Et interprète les noms en conséquence. C’est en tout cas ingénieux. ↩︎
avec lesquels ils sont écrits, et qui semble assez approprié, se situant entre la divinité du feu et les divinités de l’argile. Cependant, Motowori, déclarant que les deux caractères sont purement phonétiques, dérive kana-yama de korena-yamasu, « faire flétrir et souffrir ». Et interprète les noms en conséquence. C’est en tout cas ingénieux. ↩︎32:4 p. 34 La signification de ce nom n’est pas à déterminer. Dans le texte, il est écrit phonétiquement
 , et deux passages des « Chroniques », où cette divinité est mentionnée comme
, et deux passages des « Chroniques », où cette divinité est mentionnée comme  et
et 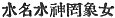 avec des instructions dans chaque cas pour lire le nom avec les sons qui lui sont donnés ici, ne nous aident pas beaucoup, sauf dans la mesure où ils montrent que Mitsuhanome était conçue comme la divinité de l’eau et comme une femme. ↩︎
avec des instructions dans chaque cas pour lire le nom avec les sons qui lui sont donnés ici, ne nous aident pas beaucoup, sauf dans la mesure où ils montrent que Mitsuhanome était conçue comme la divinité de l’eau et comme une femme. ↩︎33:7 C’est-à-dire, « mort ». ↩︎
33:8 Il y a ici une erreur de calcul, car neuf divinités sont mentionnées. Le total de trente-cinq divinités donné immédiatement après est encore plus erroné, car pas moins de quarante sont nommées dans le passage précédent. Motowori fait un effort ingénieux pour concilier l’arithmétique et la révélation en supposant que les cinq paires de frères et sœurs portant des noms parallèles ont été considérées comme ne formant chacune qu’un seul jour. ↩︎
33:9 Voir Sect. III. Cette île n’est pas née, mais est née spontanément de gouttes de saumure. ↩︎
33:10 Hiru-go. Voir la dernière partie de la Sect. IV pour ces deux noms. Hiru-go ne fut pas compté parmi les enfants de ces divinités car ces dernières l’abandonnèrent dès sa naissance, étant un échec. La raison de l’omission d’Aha dans le calcul n’est pas très claire. ↩︎
33:11 Le texte ici est très particulier, les caractères
 rendus par « enfant unique » étant là où l’on devrait s’attendre à
rendus par « enfant unique » étant là où l’on devrait s’attendre à  ou
ou  . Hirata propose de considérer
. Hirata propose de considérer  , « arbre », tandis que la plupart des érudits s’accordent à lire ke au lieu de ki à cet endroit, comme phonétique de ke (
, « arbre », tandis que la plupart des érudits s’accordent à lire ke au lieu de ki à cet endroit, comme phonétique de ke (  ) « cheveux », et d’interpréter les paroles du dieu comme signifiant qu’il n’accorde pas plus de valeur à l’enfant qu’à un seul cheveu en comparaison de l’épouse que la naissance de cet enfant lui a perdue. Moribe, dans son « Examen des mots difficiles ». sv Ko no hito-tsu ki (Vol. I. p. 8 et suiv.), soutient ingénieusement que ki était un ancien « numéro auxiliaire » japonais natif pour les animaux, remplacé par le mot chinois à consonance similaire hiki (
) « cheveux », et d’interpréter les paroles du dieu comme signifiant qu’il n’accorde pas plus de valeur à l’enfant qu’à un seul cheveu en comparaison de l’épouse que la naissance de cet enfant lui a perdue. Moribe, dans son « Examen des mots difficiles ». sv Ko no hito-tsu ki (Vol. I. p. 8 et suiv.), soutient ingénieusement que ki était un ancien « numéro auxiliaire » japonais natif pour les animaux, remplacé par le mot chinois à consonance similaire hiki (  ) qui est maintenant d’usage courant, et que le dieu emploie ce chiffre auxiliaire dégradant pour parler de son enfant en raison du ressentiment qu’il éprouve à son égard. D’autre part, nous déduisons des « Chroniques du Japon expliquées » que
) qui est maintenant d’usage courant, et que le dieu emploie ce chiffre auxiliaire dégradant pour parler de son enfant en raison du ressentiment qu’il éprouve à son égard. D’autre part, nous déduisons des « Chroniques du Japon expliquées » que  était utilisé dans son sens naturel comme « numéro auxiliaire » pour les dieux et les hommes de rang élevé. Cela semble au traducteur la meilleure interprétation à suivre, et elle est corroborée par l’utilisation de p. 35
était utilisé dans son sens naturel comme « numéro auxiliaire » pour les dieux et les hommes de rang élevé. Cela semble au traducteur la meilleure interprétation à suivre, et elle est corroborée par l’utilisation de p. 35  hashira, comme « numéro auxiliaire » habituel pour les personnages divins. Le passage parallèle des « Chroniques » indique simplement
hashira, comme « numéro auxiliaire » habituel pour les personnages divins. Le passage parallèle des « Chroniques » indique simplement  « un enfant ». ↩︎
« un enfant ». ↩︎33:12 Cette traduction n’est qu’une hypothèse ; car il n’est pas certain que Hirata, dont le point de vue a été adopté, ait raison de considérer Konomoto et Unewo comme des noms de lieux. Si l’on suivait les autorités plus anciennes, il faudrait traduire ainsi : « La divinité qui réside au pied des arbres, sur le versant de l’éperon du mont Kagu. » L’étymologie du nom de cette célèbre montagne (également connue sous le nom d’Ame-no-kagu-yama ou Ama-no-kagu-yama, c’est-à-dire « Mont Kagu céleste ») est controversée. Mais l’opinion de Hirata, selon laquelle il devrait être rattaché à kago, « cerf », est la plus plausible. Si cela était établi, nous serions tentés de le suivre et de traduire par « possesseur de cerfs » le nom de la divinité Kagu-tsu-chi, de laquelle sont nés les huit dieux des montagnes, et dont le meurtre constitue le titre de la section suivante. Que la divinité du feu soit liée aux divinités des montagnes, et donc aux cerfs qui errent dans les montagnes et fournissent au chasseur un motif pour pénétrer dans leurs recoins, est bien sûr tout naturel. Le caractère
 avec lequel Kagu est écrit signifie « parfumé » ; mais il a été suggéré que le mot japonais pourrait être lié à une expression signifiant « descendu du ciel », en allusion à l’origine supposée de la montagne telle que relatée dans un ancien ouvrage géographique (aujourd’hui perdu) traitant de la province d’Iyo. ↩︎
avec lequel Kagu est écrit signifie « parfumé » ; mais il a été suggéré que le mot japonais pourrait être lié à une expression signifiant « descendu du ciel », en allusion à l’origine supposée de la montagne telle que relatée dans un ancien ouvrage géographique (aujourd’hui perdu) traitant de la province d’Iyo. ↩︎33:13 Naki-saha-me-no-kami. Le sens du deuxième mot du composé est « marais » ou « ruisseau », mais Motowori semble avoir raison de considérer que le caractère
 est ici utilisé phonétiquement comme une abréviation de isaha de isatsu, « pleurer ». ↩︎
est ici utilisé phonétiquement comme une abréviation de isaha de isatsu, « pleurer ». ↩︎33:14 C’est-à-dire, mort. ↩︎
33:15 Étymologie incertaine. ↩︎
33:16 Pour ce nom, voir Sect. XIX, Note 6. ↩︎
33:17 Étymologie incertaine. ↩︎
35:1 p. 37 Une « prise » est définie comme « la largeur de quatre doigts lorsque la main est serrée », de sorte que le sens voulu est celui d’un grand sabre de dix paumes de main. La longueur des sabres et des barbes était mesurée par de telles « prises » ou « poignées ». ↩︎
36:2 Les noms originaux de cette divinité et de la suivante sont Iha-saku-no-kami et Ne-saki-no-kami. ↩︎
36:3 Ou l’Ancien du Rocher, c’est-à-dire la Déité Masculine l’Ancien des Rochers, si avec Motowori nous considérons le second tsu du nom original Iha-tsutsu-no-wo-no-kami comme étant équivalent à chi ou ji, supposé être « l’appellation honorifique des hommes » rendue ailleurs par « aîné ». La traduction dans le texte procède sur l’hypothèse que ce tsu représente mochi : La signification du nom reste à peu près la même quelle que soit l’une de ces deux vues adoptées. ↩︎
36:4 Expliqué en référence au passage parallèle des « Chroniques » par un caractère signifiant « le bouton à l’extrémité de la garde de l’épée. » — (Williams’ ”Syllabic Dictionary.") ↩︎
36:7 Take-mika-dzu-chi-no-wo-no-kami, écrit avec les caractères
 . Le traducteur a suivi sans trop d’hésitation l’interprétation de Motowori. ↩︎
. Le traducteur a suivi sans trop d’hésitation l’interprétation de Motowori. ↩︎36:8 Take-futsu-no-kami. Le nom du texte est Toyo-futsu-no-kami. Futsu est interprété dans le sens de « bruit de claquement » en référence à un passage des « Chroniques » où il apparaît écrit à la fois idéographiquement et phonétiquement au nom de la divinité Futsu-no-mi-tama. ↩︎
36:9 L’étymologie de ces deux noms est obscure. Kura, le premier élément de chaque composé, signifie « sombre ». ↩︎
36:10 p. 38 Voici l’explication du nom original Ma-saka-yama-tsu-mi-no-kami qui est donné dans le « Secret des Chroniques du Japon », et qui est approuvé par les commentateurs ultérieurs. ↩︎
36:11 Odo-yama-tsu-mi-no-kami. La traduction française est incertaine, car elle repose uniquement sur une conjecture de Motowori, dérivant odo de ori do (
 ), « lieu descendant », « chemin vers le bas ». ↩︎
), « lieu descendant », « chemin vers le bas ». ↩︎36:12 Les noms originaux de cette divinité et des cinq suivantes sont : Oku-yama-tsumi-no-kami, Kura-yama-tsu-mi-no-kami, Shigi-yama-tsu-mi-no-kami, Ha-yama-tsu-mi-no-kami, Hayama-tsu-mi-no-kami et To-yama-tsumi-no-kami. Shigi, traduit ici par « dense », semble presque certainement être une contraction de Shigeki, qui a cette signification. Ha-yama est un terme pour lequel il est difficile de trouver un équivalent exact en français. Il désigne les collines de moindre importance ou les premières élévations visibles formant l’approche d’une chaîne de montagnes. La signification de to dans le nom de famille de l’ensemble est controversée. Mabuchi l’interprète au sens de « porte ». Le traducteur privilégie le point de vue de Motowori : mais après tout, la différence de sens est minime. Une troisième dérivation proposée par Motowori est tawa-yama, c’est-à-dire « montagnes plissées ». ↩︎
36:13 Ou « bras ». ↩︎
36:14 Ou « jambe ». ↩︎
37:14 Ou « jambe ». ↩︎
37:15 Ces deux noms figurent dans les versions originales Ame-no-wo-ha-bori et Itsu-no-wo-ha-bori. Leur signification n’est pas tout à fait claire, mais ils semblent désigner une arme large vers la pointe, telle que représentée dans les illustrations des vol. I, pp. 19-20 et vol. II, pp. 4-5 du « Tokiha-Gusa_ ». ↩︎
38:1 p. 41 Les caractères de l’original qui sont ici rendus par Hadès sont
 , lit. « Ruisseau Jaune », un nom chinois pour le Monde Souterrain auquel une remarque de Mencius et une histoire du « Tso Chuan » semblent avoir donné naissance. Ils représentent ici le mot japonais Yomo ou Yomi, que l’on retrouve phonétiquement écrit avec les caractères
, lit. « Ruisseau Jaune », un nom chinois pour le Monde Souterrain auquel une remarque de Mencius et une histoire du « Tso Chuan » semblent avoir donné naissance. Ils représentent ici le mot japonais Yomo ou Yomi, que l’on retrouve phonétiquement écrit avec les caractères  dans le nom de Yomo-tsu-shiko-me un peu plus loin, et qui est défini par Motowori comme « un monde souterrain,… la demeure des morts,… la terre où, après leur mort, vont tous les hommes, qu’ils soient nobles ou mesquins, vertueux ou méchants. » La dérivation japonaise orthodoxe de Yomi vient de Yoru, « nuit », ce qui donnerait pour Yomo-tsu-kuni une traduction du genre « Pays des Ténèbres ». Une suggestion citée par Arawi Hakuseki (« Tōga_ », art. Idzumi) selon laquelle le mot pourrait n’être qu’une prononciation erronée de Yama, le nom sanscrit du dieu bouddhiste de l’enfer, mérite cependant d’être prise en considération ; mais il semble préférable, dans l’ensemble, de traduire Yomi ou Yomo par « Hadès », terme dont l’origine est elle-même incertaine, et dont la signification ressemble beaucoup à la notion japonaise shinto du monde au-delà, ou plutôt sous la tombe. ↩︎
dans le nom de Yomo-tsu-shiko-me un peu plus loin, et qui est défini par Motowori comme « un monde souterrain,… la demeure des morts,… la terre où, après leur mort, vont tous les hommes, qu’ils soient nobles ou mesquins, vertueux ou méchants. » La dérivation japonaise orthodoxe de Yomi vient de Yoru, « nuit », ce qui donnerait pour Yomo-tsu-kuni une traduction du genre « Pays des Ténèbres ». Une suggestion citée par Arawi Hakuseki (« Tōga_ », art. Idzumi) selon laquelle le mot pourrait n’être qu’une prononciation erronée de Yama, le nom sanscrit du dieu bouddhiste de l’enfer, mérite cependant d’être prise en considération ; mais il semble préférable, dans l’ensemble, de traduire Yomi ou Yomo par « Hadès », terme dont l’origine est elle-même incertaine, et dont la signification ressemble beaucoup à la notion japonaise shinto du monde au-delà, ou plutôt sous la tombe. ↩︎38:2 Le texte original
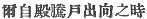 semble corrompu, et Motowori, incapable d’en tirer quoi que ce soit
semble corrompu, et Motowori, incapable d’en tirer quoi que ce soit  laisse
laisse  sans aucune lecture japonaise (voir les remarques dans son Commentaire, Vol. VI. pp. 5-6). M. Aston, dans la version de ce passage donnée dans la Chrestomathie annexée à sa « Grammaire de la langue écrite japonaise », suit Motowori en ne traduisant pas
sans aucune lecture japonaise (voir les remarques dans son Commentaire, Vol. VI. pp. 5-6). M. Aston, dans la version de ce passage donnée dans la Chrestomathie annexée à sa « Grammaire de la langue écrite japonaise », suit Motowori en ne traduisant pas  , mais ne fait pas allusion à la difficulté. ↩︎
, mais ne fait pas allusion à la difficulté. ↩︎39:3 I.e. « de la nourriture de l’Hadès. » Il serait plus évident (en suivant le texte) de traduire « J’ai mangé dans les portes [i.e. dans la maison] de l’Hadès ; — mais le caractère
 à cet endroit représente presque certainement
à cet endroit représente presque certainement  , « un lieu pour cuisiner », « un four ». ↩︎
, « un lieu pour cuisiner », « un four ». ↩︎39:4 Le mot kashikoshi (
 ), traduit ici par « révérence », correspond exactement à l’idiome poli moderne osore-iri-mashita, pour lequel il n’existe pas d’équivalent précis en anglais, mais qui exprime un sentiment tel que « Je suis bouleversé par l’honneur que vous me faites », « Je suis désolé que vous ayez pris la peine de le faire ». ↩︎
), traduit ici par « révérence », correspond exactement à l’idiome poli moderne osore-iri-mashita, pour lequel il n’existe pas d’équivalent précis en anglais, mais qui exprime un sentiment tel que « Je suis bouleversé par l’honneur que vous me faites », « Je suis désolé que vous ayez pris la peine de le faire ». ↩︎39:5 Q.d. « avec toi sur la terre des vivants. » ↩︎
39:6 p. 42 L’original contient ici le caractère
 qui signifie « de plus » comme dans cette traduction, et la correction proposée par Motowori pour
qui signifie « de plus » comme dans cette traduction, et la correction proposée par Motowori pour  ne bénéficie de l’autorité d’aucun manuscrit ni d’aucune édition imprimée antérieure. Dans ses « Mémoires sur les choses anciennes avec la lecture ancienne », il substitue en réalité cette nouvelle lecture, l’accompagnant en kana des mots japonais ashita ni, « le matin ». Mais que deviendra le texte si nous sommes libres de le modifier à notre convenance, car il existe plus d’un autre passage où
ne bénéficie de l’autorité d’aucun manuscrit ni d’aucune édition imprimée antérieure. Dans ses « Mémoires sur les choses anciennes avec la lecture ancienne », il substitue en réalité cette nouvelle lecture, l’accompagnant en kana des mots japonais ashita ni, « le matin ». Mais que deviendra le texte si nous sommes libres de le modifier à notre convenance, car il existe plus d’un autre passage où  est utilisé de la même manière ? ↩︎
est utilisé de la même manière ? ↩︎39:7 Yomo-tsu-kami. Motowori et Hirata utilisent tous deux le mot « Déités » au pluriel, et le traducteur le traduit donc avec ce nombre, bien que le singulier convienne au moins aussi bien au texte tel qu’il est. On ne sait que peu, voire rien, des Déités d’Hadès. Voir note 23 de cette section. ↩︎
39:8 Littéralement « le pilier mâle », c’est-à-dire la grande dent dont il y a une à chaque extrémité du peigne. ↩︎
39:9 L’emploi de l’expression « allumer une seule lumière », là où il aurait été plus naturel de dire simplement « allumer une lumière », s’explique par une glose des « Chroniques », qui nous informe qu’« aujourd’hui », allumer une seule lumière est considéré comme malchanceux, tout comme jeter un peigne la nuit. Il est admis que cette glose est un ajout tardif, et son affirmation pourrait peut-être être considérée comme une simple invention destinée à expliquer l’expression particulière du texte. Motowori nous apprend cependant que « les indigènes disent » que ces actions sont encore (fin du XVIIIe siècle) considérées comme malchanceuses dans la province d’Ihami, et la même superstition survit également, comme le traducteur l’assure, à Yedo même. Il faut comprendre que c’est la grande dent cassée du peigne que le dieu a allumée. ↩︎ ↩︎
39:10 Ou « bras ». ↩︎
39:11 Ou « jambe ». ↩︎
39:12 Les noms japonais des huit Déités du Tonnerre sont : Oho-ikadzuchi, Ho-no-ikadzuchi, Kuro-ikadzuchi, Saka-ikadzuchi, Waki-ikadzuchi, Tsuchi-ikadzuchi, Naru-ikadzuchi et Fushi-ikadzuchi. Moribe, dans sa Critique du Commentaire de Motowori, fait quelques observations sur la pertinence de chacun de ces noms, que l’étudiant fera bien de consulter si l’ouvrage est publié. ↩︎
39:14 On pourrait peut-être, avec la même justesse, traduire par « couronne » le mot traduit ici par « coiffure », les feuilles et les fleurs ayant été les premiers ornements pour les cheveux. Plus tard, cependant, ce mot a été utilisé (p. 43) pour désigner toute sorte de coiffure, et c’est aussi le sens que le dictionnaire donne au caractère chinois avec lequel il est écrit. Les mots japonais pour « coiffure » et « plante grimpante » sont homonymes, et le premier n’est probablement qu’une acception spécialisée du second. ↩︎
40:15 C’est-à-dire, en le brandissant derrière lui. ↩︎
40:16 Ou la Colline Plate de l’Hadès, Yomo-tsu-hira-saka, que Motowori considère comme la frontière entre l’Hadès et le Monde des Vivants. Voir aussi la Note 27 de cette Section. ↩︎
40:17 Les trois caractères
 ici rendus par « personnes » sont évidemment (malgré Motowori) censés être équivalents à l’expression chinoise courante
ici rendus par « personnes » sont évidemment (malgré Motowori) censés être équivalents à l’expression chinoise courante  , qui a cette signification. Le mot traduit par « vivant » signifie littéralement « présent », « visible ». ↩︎
, qui a cette signification. Le mot traduit par « vivant » signifie littéralement « présent », « visible ». ↩︎40:18 Ashi-hara-no-naka-tsu-kuni, une désignation périphrastique courante du Japon. Il est préférable de traduire ce nom ainsi plutôt que de le rendre par « le Pays au Milieu des Plaines de Roseaux », interprétation forcée que Motowori et Hirata semblent n’adopter que pour dissimuler le fait que l’un des noms les plus anciens et les plus vénérés de leur pays natal a été imité de celui de la Chine, tout ce qui est chinois étant une abomination aux yeux de ces ardents shintoïstes. Yamazaki Suiga, cité par Tanigaha Shisei, est plus sensé lorsqu’il remarque que chaque pays se considère naturellement comme central et les pays étrangers comme barbares, et que le Japon n’a rien de particulier à être considéré par ses habitants comme le centre de l’univers. C’est également le point de vue des autres érudits antérieurs. ↩︎
40:19 Oho-kamu-dzumi-no-mikoto. La différence entre singulier et pluriel est rarement présente à l’esprit japonais, et même s’il y avait trois pêches, nous pourrions tout aussi bien traduire leur nom par « Son Auguste, etc. », considérant que les trois ne forment qu’une seule divinité. L’interprétation du nom adoptée ici est celle, simple et naturelle, que Motowori a empruntée à Tanigaha Shisei. ↩︎
40:20 C’est-à-dire, un rocher qu’il faudrait mille hommes pour soulever. ↩︎
40:21 Il semble certain qu’une sorte de séparation soit voulue ; mais la signification précise des caractères
 dans le texte reste incertaine. Il convient de consulter le « Commentaire » de Motowori, vol. VI, pp. 29-30 et vol. X, pp. 52-55, pour une discussion approfondie des diverses interprétations qui peuvent leur être données. Moribe, dans sa Critique de ce commentaire, soutient que « divorcés l’un de l’autre » est la signification correcte de ces mots, et appuie son opinion par le passage parallèle des « Chroniques ». ↩︎
dans le texte reste incertaine. Il convient de consulter le « Commentaire » de Motowori, vol. VI, pp. 29-30 et vol. X, pp. 52-55, pour une discussion approfondie des diverses interprétations qui peuvent leur être données. Moribe, dans sa Critique de ce commentaire, soutient que « divorcés l’un de l’autre » est la signification correcte de ces mots, et appuie son opinion par le passage parallèle des « Chroniques ». ↩︎40:22 p. 44 C’est-à-dire, « Je ferai en sorte que quinze cents femmes donnent naissance à des enfants. » Pour la coutume d’ériger une hutte séparée pour une femme sur le point d’accoucher, voir Introduction, p. xxviii.) ↩︎
40:23 Yomo-tsu-oho-kami. Motowori reste silencieux sur cette déclaration plutôt embarrassante, et Hirata dit simplement : « On doit supposer que les « Déités d’Hadès » mentionnées précédemment avaient été ses « Grandes Déités » jusqu’à cette époque, une position qui fut désormais assumée par Son Auguste Izana-mi (la Femme-Qui-Invite). » Voir note 7 de cette section. ↩︎ ↩︎ ↩︎
40:24 Chi-shiki-no-oho-kami. [C’est la lecture de Motowori. On pourrait aussi lire Michi-shiki-no-oho-kami_]. Motowori prouve de manière concluante que le mot shiki, ainsi traduit ici, signifie « atteindre ». Le fait qu’il soit déjà obscur à l’époque de la compilation de ces « Archives » est toutefois démontré par son écriture syllabique dans le premier cas, et avec un « caractère emprunté » (c’est-à-dire un mot homonyme) dans le second. ↩︎ ↩︎ ↩︎
40:25 Parce que la déesse fut repoussée par lui sur la route où elle poursuivait son frère-époux. L’original est Chi-gaheshi [ou Michi-gaheshi]-no-oho-kami. ↩︎
41:27 Ifuya-zaka. Moribe dans son « Idzu-no-chi-waki » conjecture qu’Ifuya pourrait dériver de Yufu-yami, « obscurité du soir », une étymologie qui a au moins le mérite de correspondre à la légende. ↩︎
44:1 p. 47 Les mots « j’ai » ainsi répétés sont une tentative de traduire les derniers mots de la phrase dans l’original, ari keri, auxquels, bien qu’ils n’aient pas de sens particulier, l’auteur accorde manifestement une grande importance, car il les écrit syllabiquement. On peut considérer qu’ils soulignent ce qui précède et, dit Motowori, « transmettent l’idée de lamentation ». L’idiome apparaît une demi-douzaine de fois au cours du présent ouvrage. ↩︎
44:2 Ce nom botanique est identifié par Arawi Hakuseki et Hirata au nom moderne de hagi, ou « trèfle des buissons » (lespdeza de diverses espèces). L’opinion reçue était qu’il s’agissait ici de l’awoki (Aucuba Japonica). ↩︎
44:3 Tachibana est compris comme la désignation générale des arbres de la tribu des orangers. (Voir cependant Sect. LXXIV, Note 7). Ici, il est utilisé comme nom propre. ↩︎
44:4 Ce nom, qui signifie « face au soleil », a été attribué, sans surprise, à une province de la partie orientale de la plus occidentale des grandes îles japonaises, car on pourrait la concevoir comme située « face au soleil ». On a cependant supposé qu’il désignait à l’origine l’ensemble de l’île en question. Quoi qu’il en soit, ce nom n’est pas inapproprié, car l’île possède une longue côte orientale. ↩︎
44:5 Dans notre texte, Tsuki-tatsu-funa-do. Mais funa devrait presque certainement être ku-na, et le nom (qui a été traduit ici en conséquence) est ensuite illustré par la version plus longue de ce mythe, donnée dans les « Chroniques », où l’on lit que le dieu (s’adressant probablement à sa sœur) jeta son bâton en disant : « N’allez pas plus loin. » « Tenez-vous debout » doit être compris dans un sens transitif : le dieu redressa son bâton en l’enfonçant dans le sable. ↩︎
44:6 Voici l’explication de Moribe (« Idzu-no-Chi-waki. Vol. IV, p. 44) de la signification du nom original Michi-no-naga-chiha-no-kami, dont la syllabe ha est considérée par lui comme une forme alternative de ma (
 , « espace »). Il s’agit cependant d’un point crucial, et Motowori avoue son incapacité à l’expliquer de manière satisfaisante. D’autres points de vue sur la signification de la syllabe en question se trouvent dans « Jin-dai no maki Mo-shiho-gusa. Vol. II. p. 29. ↩︎
, « espace »). Il s’agit cependant d’un point crucial, et Motowori avoue son incapacité à l’expliquer de manière satisfaisante. D’autres points de vue sur la signification de la syllabe en question se trouvent dans « Jin-dai no maki Mo-shiho-gusa. Vol. II. p. 29. ↩︎45:7 Cela semble être la signification du nom original, si l’on conserve la lecture Toki-okashi-no-kami. Voir cependant les remarques de Motowori in loco. ↩︎
45:10 p. 48 Aki-guhi-no-ushi-no-kami. La traduction anglaise de ce nom obscur part du principe que Motowori a raison lorsqu’il propose de considérer kuhi comme équivalent ici à kuchi, « bouche ». Le pantalon béant, que les jambes de la divinité ne comblent plus, suggère peut-être l’idée d’une bouche ouverte, bien qu’il ne s’agisse pas de la divinité dont on dit qu’elle est réellement née de cette partie du vêtement. ↩︎
45:11 ou « bras ». ↩︎
45:12 Les noms de cette divinité et des cinq suivantes sont dans l’original Oki-zakaru-no-kami, Oki-tsu-nagisa-biko-no-kami, Oki-tsu-kahi-bera-no-kami, He-zakaru-no-kami, He-tsu-nagisa-biko-no-kami et He-tsu-kahi-bera-no-kami. Le mot « laver », par lequel, faute d’un meilleur terme, le substantif nagisa a été traduit, doit être compris comme signifiant la partie la plus proche du rivage de la mer ou d’une rivière, la limite des vagues. Les troisième et sixième noms de cette série, dans lesquels les syllabes kahi-bera (représentées ici par « Direction Intermédiaire ») présentent une grande difficulté, ont été traduits conformément à l’explication de Motowori quant à leur signification probable. ↩︎
45:13 Littéralement « droite ». Dans les compositions chinoises et japonaises, les lignes se suivent de droite à gauche et non de haut en bas comme chez nous. « Droite » signifie donc « précédant » et « gauche » « suivant ». ↩︎
45:15 Viv. à Hadès. ↩︎
46:16 Les noms de ces deux divinités dans l’original sont Kamu-naho-bi-no-kami et Oho-na-ho-bi-no-kami. ↩︎
46:17 Idzu-no-me-no-kami. Le mot Idzu est incompréhensible, à moins que, suivant Motowori, nous n’identifiions cette déesse au dieu et à la déesse Haya-aki-dzu-hiko et Haya-aki-dsu-hime mentionnés dans la Sect. VI, Note 10, et que nous considérions idzu comme remplaçant par aphérèse aki-dsu. ↩︎
46:18 Les noms originaux de cette divinité et des cinq suivantes sont Soko-tsu-wata-tsu-mi-no-kami, Soko-dzutsu-no-wo-no-mi-koto, Naka-tsu-wata-tsu-mi-no-kami, Naka-dzutsu-no-wo-mikoto, Uha-tsu-wata-tsu-mi-no-kami et Uha-dzutsu-no-wo-no-mikoto. On s’interroge généralement sur la signification de la syllabe tsu dans les deuxième, quatrième et dernier noms. Si elle signifie réellement « possesseur » et non « aîné », on devrait traduire par « le Mâle Possédant le Bas », etc. ↩︎
46:19 Adumi-no-murazhi. Motowori dit que ce nom provient d’un lieu de la province de Shinano. Mais Moribe montre (p. 49) que l’étymologie du mot remonte à ama-tsu-mochi, « Possesseurs de pêcheurs ». ↩︎
46:20 Il est impossible de traduire ce nom qui, selon Motowori, dérive de ceux de deux districts de Shinano auxquels est préfixé le mot utsushi (pour utsutsu, « présent » ou « vivant »). ↩︎
46:21 Il convient de souligner à nouveau le flou de la perception japonaise de la distinction entre singulier et pluriel. Comme trois divinités sont mentionnées particulièrement et à plusieurs reprises dans le texte précédent, nous sommes contraints de traduire ce passage au pluriel ; et pourtant, comment un enfant pourrait-il avoir trois pères ? ↩︎
46:22 Sumi-no-ye, également appelé Sumi-yoshi, c’est-à-dire, par un jeu de mots, « agréable à habiter ». La véritable étymologie de sumi n’est pas certaine. — Au lieu de « les trois Grandes Déités », nous pourrions traduire par « les Grandes Déités des Trois Sanctuaires ». ↩︎