[ p. 114 ]
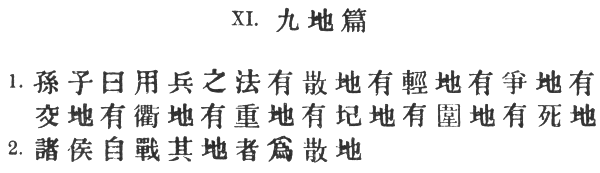
[^576].
1. Sun Tzŭ a dit : L’art de la guerre reconnaît neuf variétés de terrains : (1) les terrains dispersés ; (2) les terrains faciles ; (3) les terrains litigieux ; (4) les terrains ouverts ; (5) les terrains d’intersection de routes ; (6) les terrains sérieux ; (7) les terrains difficiles ; (8) les terrains enclavés ; (9) les terrains désespérés.
2. Lorsqu’un chef combat sur son propre territoire, il s’agit d’un terrain de dispersion. [1]
[ p. 115 ]
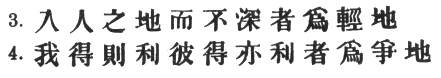
3. Lorsqu’il a pénétré en territoire hostile, mais sur une courte distance, c’est un terrain facile. [2]
4. Un terrain dont la possession apporte un grand avantage à l’une ou l’autre partie est un terrain litigieux. [3]
[ p. 116 ]
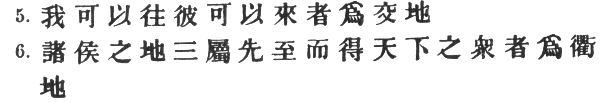
5. Le terrain sur lequel chaque camp a liberté de mouvement est un terrain découvert. [4]
6. Le terrain qui forme la clé de trois États contigus, [5] de sorte que celui qui l’occupe le premier a la plus grande partie de l’Empire à sa disposition, [6] est un terrain d’intersection de routes. [7]
[ p. 117 ]
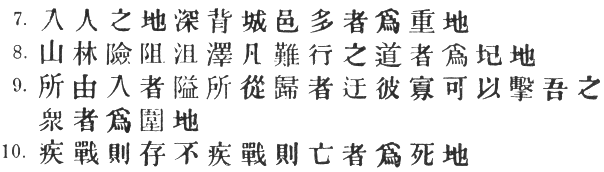
7. Lorsqu’une armée a pénétré au cœur d’un pays hostile, laissant derrière elle un certain nombre de villes fortifiées, [8] c’est un terrain sérieux. [9]
8. Forêts de montagne, [10] pentes abruptes, marais et tourbières, autant de régions difficiles à traverser : c’est un terrain difficile. [11]
9. Terrain où l’on atteint par des gorges étroites, et d’où l’on ne peut se retirer que par des sentiers tortueux, de sorte qu’un petit nombre d’ennemis suffirait à écraser un grand nombre des nôtres : c’est un terrain encaissé.
10. Le terrain sur lequel nous ne pouvons être sauvés de la destruction qu’en combattant sans délai est un terrain désespéré. [12]
[ p. 118 ]
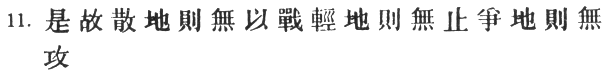
11. Sur un terrain de dispersion, ne combattez donc pas. Sur un terrain facile, ne vous arrêtez pas. Sur un terrain conflictuel, n’attaquez pas. [13]
[ p. 119 ]
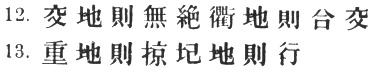
12. En terrain découvert, n’essayez pas de bloquer le passage de l’ennemi. [14] Sur les terrains où se croisent les autoroutes, joignez-vous à vos alliés. [15]
13. Sur un terrain sérieux, rassemblez du butin. [16]
[ p. 120 ]
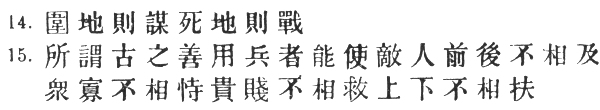
[le paragraphe continue] Sur un terrain difficile, continuez à marcher avec constance. [17]
14. Sur un terrain enclavé, recourez à la ruse. [18] Sur un terrain désespéré, combattez. [19]
15. Ceux qu’on appelait autrefois les chefs habiles [20] savaient comment enfoncer un coin entre le front et l’arrière de l’ennemi ; [21]
[ p. 121 ]
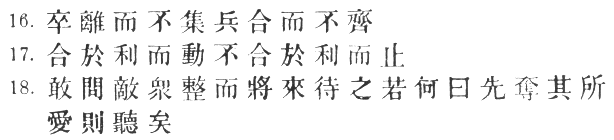
pour empêcher la coopération entre ses grandes et petites divisions ; pour empêcher les bonnes troupes de secourir les mauvaises, [22] les officiers de rallier leurs hommes. [23]
16. Lorsque les hommes de l’ennemi étaient dispersés, ils les empêchaient de se concentrer ; [24] même lorsque leurs forces étaient unies, ils parvenaient à les maintenir en désordre. [25]
17. Quand cela était à leur avantage, ils avançaient ; quand cela était dans leur intérêt, ils s’arrêtaient. [26]
18. Si l’on me demandait comment faire face à une grande armée ennemie, bien rangée et prête à attaquer, [27] je répondrais : « Commencez par vous emparer de quelque chose qui est cher à votre adversaire ; il sera alors soumis à votre volonté. » [28]
[ p. 122 ]
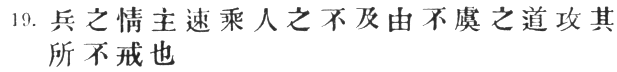
19. La rapidité est l’essence de la guerre : [29]
[ p. 123 ]
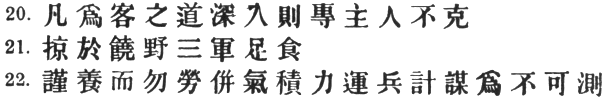
Profitez du manque de préparation de l’ennemi, empruntez des routes inattendues et attaquez des endroits non gardés.
20. Voici les principes que doit observer une force d’invasion : Plus vous pénétrerez dans un pays, plus grande sera la solidarité de vos troupes, et ainsi les défenseurs ne prévaudront pas contre vous.
21. Faites des incursions dans les pays fertiles afin de ravitailler votre armée en nourriture. [30]
22. Étudiez attentivement le bien-être de vos hommes, [31] [ p. 124 ] et ne les surchargez pas. Concentrez votre énergie et accumulez vos forces. [32] Maintenez votre armée en mouvement permanent, [33] et élaborez des plans insondables. [34]
[ p. 125 ]
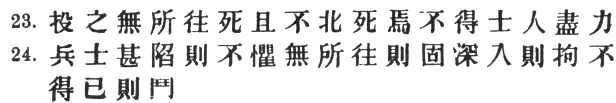
23. Jetez vos soldats dans des positions d’où ils ne pourront s’échapper, et ils préféreront la mort à la fuite. [35] S’ils affrontent la mort, ils pourront tout accomplir. [36] Officiers et soldats déploieront toute leur force [37]
24. Les soldats, en proie au désespoir, perdent le sens de la peur. S’ils n’ont aucun refuge, ils tiennent bon. S’ils sont au cœur d’un pays hostile, ils font preuve d’obstination. [38] S’ils ne trouvent aucune aide, ils combattront avec acharnement.
[ p. 126 ]
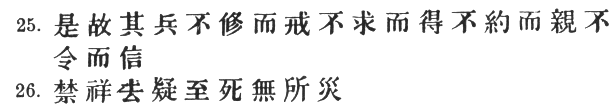
25. Ainsi, sans attendre d’être rassemblés, les soldats seront constamment sur le qui-vive ; [39] sans attendre qu’on les sollicite, ils feront votre volonté ; [40] sans restrictions, ils seront fidèles ; [41] sans donner d’ordres, on peut leur faire confiance. [42]
26. Interdisez de présager et éliminez les doutes superstitieux. [43] Alors, jusqu’à ce que la mort elle-même vienne, aucune calamité n’est à craindre. [44]
[ p. 127 ]
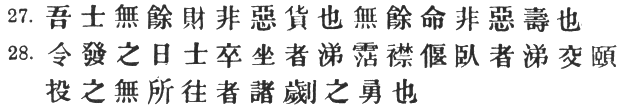
27. Si nos soldats ne sont pas surchargés d’argent, ce n’est pas qu’ils aient du dégoût pour les richesses ; si leur vie n’est pas excessivement longue, ce n’est pas qu’ils soient peu enclins à la longévité. [45]
28. Le jour où ils reçoivent l’ordre de partir au combat, vos soldats peuvent pleurer, [46] ceux qui sont assis en arrosant leurs vêtements de rosée, et ceux qui sont couchés en laissant couler leurs larmes sur leurs joues. [47]
[ p. 128 ]
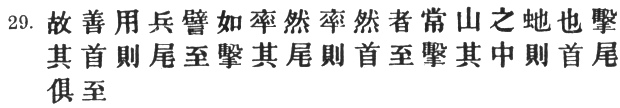
[le paragraphe continue] Mais qu’ils soient une fois mis à distance, et ils feront preuve du courage d’un Chu ou d’un Kuei. [48]
29. L’habile tacticien peut être comparé au shuai-jan. Or, le shuai-jan est un serpent que l’on trouve dans les monts Chang. [49]
[ p. 129 ]
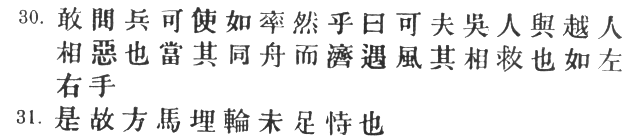
[le paragraphe continue] Frappez sa tête, et vous serez attaqué par sa queue ; frappez sa queue, et vous serez attaqué par sa tête ; frappez son milieu. [50] et vous serez attaqué par la tête et la queue à la fois.
30. À la question de savoir si une armée peut être formée pour imiter le shuai-jan, [51] je répondrais que oui. Car les hommes de Wu et ceux de Yüeh sont ennemis ; [52] pourtant, s’ils traversent une rivière dans le même bateau et sont surpris par une tempête, ils s’entraideront, tout comme la main gauche aide la main droite. [53]
31. Il ne suffit donc pas de se fier à l’attache des chevaux, [54] et à l’enfouissement des roues des chars dans le sol. [55]
[ p. 130 ]
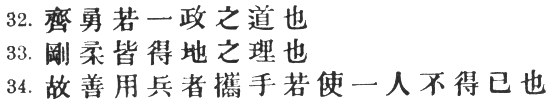
32. Le principe sur lequel se baser pour gérer une armée est d’établir un standard de courage que tous doivent atteindre. [56]
33. Comment tirer le meilleur parti des forces et des faiblesses ? C’est une question qui implique une utilisation appropriée du terrain. [57]
34. Ainsi, le général habile conduit son armée comme s’il conduisait un seul homme, bon gré mal gré, par la main. [58]
[ p. 131 ]
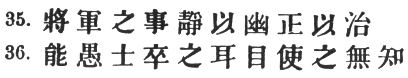
35. C’est le rôle d’un général d’être tranquille et ainsi d’assurer le secret ; intègre et juste, et ainsi de maintenir l’ordre. [59]
36. Il doit être capable de mystifier ses officiers et ses hommes par de faux rapports et de fausses apparences, [60] et ainsi les maintenir dans une ignorance totale. [61]
[ p. 132 ]
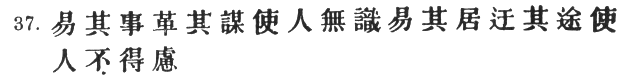
37. En modifiant ses dispositions et en changeant ses plans, [62] il maintient l’ennemi dans l’ignorance définitive. [63]
[ p. 133 ]
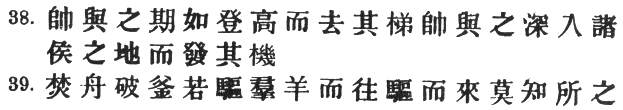
[le paragraphe continue] En déplaçant son camp et en empruntant des itinéraires détournés, il empêche l’ennemi d’anticiper son dessein. [64]
38. Au moment critique, le chef d’une armée agit comme quelqu’un qui a grimpé sur une hauteur et qui repousse l’échelle derrière lui. [65] Il entraîne ses hommes au cœur du territoire hostile avant de montrer son jeu. [66]
39. Il brûle ses bateaux et brise ses marmites ; [67] comme un berger conduisant son troupeau de moutons, il conduit ses hommes d’un côté à l’autre, et personne ne sait où il va. [68]
[ p. 134 ]
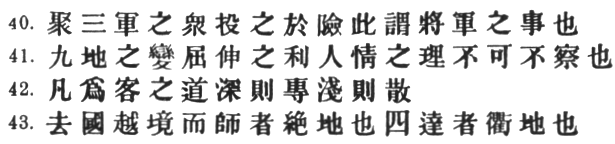
40. Rassembler son armée et la mettre en danger : c’est là, peut-on dire, la tâche du général. [69]
41. Les différentes mesures adaptées aux neuf variétés de terrains ; [70] l’opportunité des tactiques agressives ou défensives ; [71] et les lois fondamentales de la nature humaine : ce sont là des choses qu’il faut absolument étudier.
42. Lors de l’invasion d’un territoire hostile, le principe général est que pénétrer en profondeur apporte la cohésion ; pénétrer mais sur une courte distance signifie la dispersion. [72]
43. Lorsque vous quittez votre propre pays et que vous conduisez votre armée à travers le territoire voisin, [73] vous vous trouvez sur un terrain critique. [74]
[ p. 135 ]
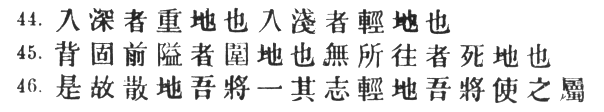
[le paragraphe continue] Lorsqu’il y a des moyens de communication [75] sur les quatre côtés, le terrain est celui d’autoroutes qui se croisent. [76]
44. Quand on pénètre profondément dans un pays, c’est un terrain sérieux. Quand on y pénètre un peu, c’est un terrain facile.
45. Quand on a les bastions ennemis sur ses arrières, [77] et des passages étroits devant soi, on est en terrain encerclé. Lorsqu’il n’y a aucun refuge, on est en terrain désespéré.
46. Par conséquent, sur un terrain de dispersion, j’inspirerais à mes hommes l’unité de but. [78]
[ p. 136 ]
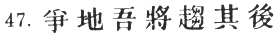
[le paragraphe continue] Sur un terrain facile, je veillerais à ce qu’il y ait une connexion étroite entre toutes les parties de mon armée. [79]
47. Sur un terrain litigieux, je hâterais mes arrières. [80]
[ p. 137 ]
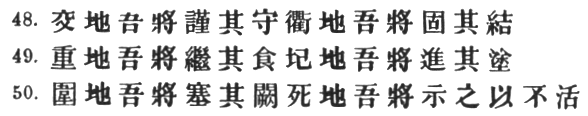
48. En terrain découvert, je surveillerais mes défenses avec vigilance. [81] Sur un terrain où se croisent des routes, je consoliderais mes alliances. [82]
49. Sur un terrain difficile, je m’efforcerais d’assurer un approvisionnement continu. [83] Sur un terrain difficile, je continuerais à avancer sur la route [84]
50. Sur un terrain enclavé, je bloquerais toute voie de retraite. [85] [ p. 138 ] Sur un terrain désespéré, je proclamerais à mes soldats l’impossibilité de sauver leur vie. [86]
[ p. 139 ]
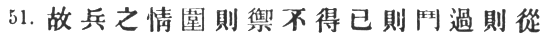
51. Car c’est la disposition du soldat à offrir une résistance obstinée lorsqu’il est encerclé, à combattre avec acharnement lorsqu’il ne peut s’aider lui-même et à obéir promptement lorsqu’il est en danger. [87]
[ p. 140 ]
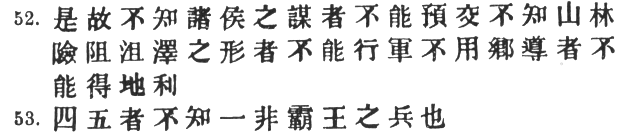
52. Nous ne pouvons conclure d’alliance avec les princes voisins sans connaître leurs desseins. Nous ne sommes pas aptes à mener une armée en marche si nous ne connaissons pas l’aspect du pays : ses montagnes et ses forêts, ses pièges et ses précipices, ses marais et ses marécages. Nous ne pourrons exploiter les avantages de la nature que si nous faisons appel à des guides locaux. [88]
53. Ignorer l’un quelconque des quatre ou cinq principes suivants [89] ne convient pas à un prince guerrier. [90]
[ p. 141 ]
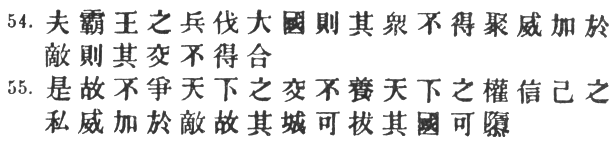
54. Lorsqu’un prince guerrier attaque un État puissant, son talent de général se manifeste en empêchant la concentration des forces ennemies. Il impressionne ses adversaires, [91] et empêche leurs alliés de se liguer contre lui. [92]
55. C’est pourquoi il ne s’efforce pas [93]
[ p. 142 ]
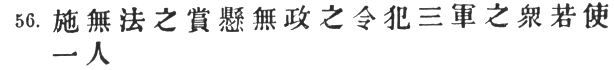
Il s’allie à tous, [94] et ne favorise pas la puissance des autres États. Il poursuit ses propres desseins secrets, [95] maintenant ses adversaires dans la crainte. [96] Il parvient ainsi à s’emparer de leurs villes et à renverser leurs royaumes. [97]
56. Accorder des récompenses sans tenir compte des règles, [98] donner des ordres [99] sans tenir compte des accords antérieurs [100]
[ p. 143 ]
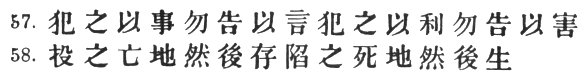
et vous pourrez manier toute une armée [101] comme si vous n’aviez affaire qu’à un seul homme. [102]
57. Confrontez vos soldats à l’acte lui-même ; ne leur faites jamais connaître votre dessein. [103] Quand les perspectives sont brillantes, mettez-les devant leurs yeux ; mais ne leur dites rien quand la situation est sombre.
58. Placez votre armée en danger mortel, et elle survivra ; plongez-la dans une situation désespérée, et elle s’en sortira saine et sauve. [104]
[ p. 144 ]
[ p. 145 ]
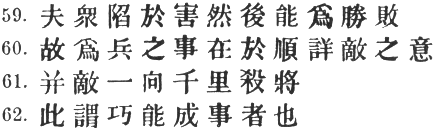
59. Car c’est précisément lorsqu’une force est en danger qu’elle est capable de porter un coup victorieux. [105]
60. Le succès dans la guerre s’obtient en s’adaptant soigneusement aux objectifs de l’ennemi. [106]
61. En persistant à nous accrocher au flanc de l’ennemi, [107] nous réussirons à la longue [108] à tuer le commandant en chef. [109]
62. C’est ce qu’on appelle la capacité d’accomplir une chose par pure ruse. [110]
[ p. 146 ]
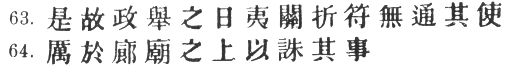
63. Le jour de votre prise de commandement, [111] bloquez les passages frontaliers, [112] détruisez les registres officiels, [113] et bloquez le passage de tous les émissaires, que ce soit à destination ou en provenance du pays ennemi.
64. Soyez sévère dans la salle du conseil, [114] afin de pouvoir contrôler la situation.
[ p. 147 ]
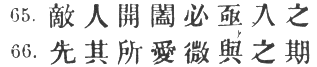
65. Si l’ennemi laisse une porte ouverte, vous devez vous précipiter à l’intérieur. [115]
66. Prévenez votre adversaire en saisissant ce qui lui est cher, [116] et essayez subtilement de chronométrer son arrivée sur le terrain. [117]
[ p. 148 ]
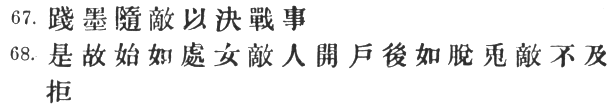
67. Suivez le chemin défini par la règle [118] et adaptez-vous à l’ennemi jusqu’à ce que vous puissiez livrer une bataille décisive. [119]
68. Au début, montrez donc la timidité d’une jeune fille, jusqu’à ce que l’ennemi vous donne une ouverture ; ensuite, imitez la rapidité d’un lièvre qui court, et il sera trop tard pour que l’ennemi vous résiste. [120]
[ p. 149 ]
¶ Notes de bas de page
114:1 Li Ch’üan n’a pas tout à fait raison de les appeler #. Comme nous le verrons, certains d’entre eux sont très désavantageux du point de vue militaire. Wang Hsi dit plus correctement : # « Il y a neuf situations militaires, bonnes et mauvaises. » On aimerait distinguer les # des six # du chap. X en disant que ces derniers se réfèrent à la formation naturelle ou aux caractéristiques géographiques du pays, tandis que les # ont davantage à voir avec l’état de l’armée, étant des # « situations » par opposition à des « terrains ». Mais il s’avère bientôt impossible d’effectuer la distinction. Les deux sont des divisions transversales, car parmi les # nous avons des « terrains de temporisation » côte à côte avec des « cols étroits », alors que dans le présent chapitre, la confusion est encore plus grande. ↩︎
114:2 Ainsi appelés parce que les soldats, étant près de chez eux et désireux de voir leurs femmes et leurs enfants, sont susceptibles de saisir l’occasion offerte par une bataille et de se disperser dans toutes les directions. « Dans leur avance », observe Tu Mu, « ils manqueront de courage et, lorsqu’ils se retireront, ils trouveront des havres de refuge. » Le #, qui apparaît dans le T’u Shu, semble avoir été omis par accident dans mon édition du texte standard. ↩︎
115:1 Li Ch’üan et Ho Shih disent #: « en raison de la facilité de retraite », et les autres commentateurs donnent des explications similaires. Tu Mu remarque : # « Lorsque votre armée aura traversé la frontière, vous devrez brûler vos bateaux et vos ponts, afin de faire comprendre à tout le monde que vous n’avez aucune nostalgie de votre patrie. » Je ne pense pas que « terrain perturbateur », la traduction de # par le capitaine Calthrop, ait quoi que ce soit pour le justifier. Si une traduction idiomatique est hors de question, il faut au moins tenter d’être littéral. ↩︎
115:2 Je dois m’excuser d’utiliser ce mot dans un sens inconnu du dictionnaire, c’est-à-dire « à disputer » — le # de Tu Mu. Ts’ao Kung dit : # « un terrain sur lequel la minorité et les faibles peuvent vaincre la multitude et les forts », comme # « le col d’un col », cité par Li Ch’üan. Ainsi, les Thermopyles étaient un #, car leur possession, même pour quelques jours seulement, signifiait tenir en échec toute l’armée d’invasion et ainsi gagner un temps précieux. Cf. Wu Tzŭ, ch. V. ad init. : # « Pour ceux qui doivent se battre à un contre dix, il n’y a rien de mieux qu’un col étroit. » Alors que # Lü Kuang revenait de son expédition triomphale au Turkestan en 385 après J.-C., et qu’il était arrivé jusqu’à # I-ho, chargé de butin, # Liang Hsi, administrateur de # Liang-chou, profitant de la mort de Fu Chien, roi de Ch’in, complota contre lui et voulut lui barrer l’accès à la province. Yang Han, gouverneur de Kao-ch’ang, lui donna ce conseil : « Lü Kuang est tout juste sorti de ses victoires à l’ouest, et ses soldats sont vigoureux et courageux. Si nous nous opposons à lui dans les sables mouvants du désert, nous ne serons pas de taille, et nous devons donc essayer un autre plan. Hâtons-nous d’occuper le défilé à l’entrée du col de Kao-wu, le coupant ainsi de ses réserves d’eau, et lorsque ses troupes seront assoiffées de sang, nous pourrons dicter nos conditions sans bouger. Ou, si vous pensez que le col que je mentionne est trop éloigné, nous pourrions lui tenir tête au col d’I-wu, qui est plus proche. La ruse et les ressources de Tzŭ-fang lui-même seraient vaines face à l’énorme puissance de ces deux positions. » Liang Hsi, refusant d’agir selon ce conseil, fut submergé et balayé par l’envahisseur. [Voir, #, ch. 122, fol. 3 _r_°, et #, ch. 43, fol. 26.] ↩︎
116:1 Il s’agit d’une traduction approximative de #, qui, selon Ts’ao Kung, signifie # « terrain couvert d’un réseau de routes », comme un échiquier. Une autre interprétation, suggérée par Ho Shih, est # « terrain sur lequel les communications sont faciles ». Dans les deux cas, il doit évidemment s’agir de # « pays plat », et donc # « ne peut être bloqué ». Cf. #, X. § 2. ↩︎
116:2 # « Notre pays jouxtant celui de l’ennemi et un troisième pays limitrophe des deux. » [Ts’ao Kung.] Mêng Shih cite en exemple la petite principauté de # Chêng, qui était délimitée au nord-est par # Ch’i, à l’ouest par # Chin et au sud par # Ch’u. ↩︎
116:3 # désigne bien sûr la confédération lâche d’États en laquelle la Chine était divisée sous la dynastie des Tcheou. Le belligérant qui détient cette position dominante peut contraindre la plupart d’entre eux à devenir ses alliés. Voir infra, § 48. # semble à première vue désigner « les masses » ou la « population » de l’Empire, mais il s’agit plus probablement, comme le dit Tu Yu, de #. ↩︎
116:4 Le « terrain jonché de sentiers » du capitaine Calthrop pourrait bien correspondre au point # ci-dessus, mais il ne fait pas ressortir la force du point #, qui dénote clairement la position centrale où se rencontrent les autoroutes importantes. ↩︎
117:1 Après #, le T’ung Tien intercale la glose #. ↩︎
117:2 Wang Hsi explique le nom en disant que # « lorsqu’une armée a atteint un tel point, sa situation est grave. » Li Chüan cite en exemple (1) la marche victorieuse de # Yo I dans la capitale de Ch’i en 284 av. J.-C., et (2) l’attaque de Ch’u, six ans plus tard, par le général Chin # Po Ch’i. ↩︎
117:3 Ou simplement, « forêts ». Je suis le T’u Shu en omettant le # avant #, donné dans le texte standard, qui est non seulement oiseux mais gâche le rythme de la phrase. ↩︎
117:4 # _p’i_3 (à distinguer de # i4) est défini par K’ang Hsi (d’après le Shuo Wên) comme # « détruire ». Ainsi Chia Lin explique # comme un sol # « qui a été ruiné par l’eau qui l’a parcouru », et Tu Yu simplement comme # « un sol marécageux ». Mais Ch’ên Hao dit que le mot s’applique spécialement aux creux profonds — ce que Chu-ko Liang, nous dit-il, désignait par le terme expressif #, « les enfers terrestres ». Comparez le # du IX. §55. ↩︎
117:5 p. 118 La situation, telle que décrite par Ts’ao Kung, est très similaire à la #, sauf qu’ici la fuite n’est plus possible : # « Une haute montagne devant, une grande rivière derrière, avance impossible, retraite bloquée. » Ch’ên Hao dit : # « être sur un « terrain désespéré », c’est comme s’asseoir dans un bateau qui prend l’eau ou s’accroupir dans une maison en feu. » Tu Mu cite Li Ching, une description saisissante de la situation critique d’une armée ainsi piégée : « Imaginez une armée envahissant un territoire hostile sans l’aide de guides locaux : elle tombe dans un piège mortel et est à la merci de l’ennemi. Un ravin à gauche, une montagne à droite, un chemin si périlleux qu’il faut attacher les chevaux et porter les chars en fronde, aucun passage ouvert devant, la retraite coupée derrière, pas d’autre choix que d’avancer en file indienne (#). Puis, avant que nous ayons le temps de ranger nos soldats en bataille, l’ennemi, en force écrasante, apparaît soudainement sur la scène. En avançant, nous ne pouvons respirer nulle part ; en reculant, nous n’avons aucun refuge. Nous cherchons une bataille rangée, mais en vain ; pourtant, sur la défensive, aucun de nous n’a un instant de répit. Si nous nous contentons de maintenir notre position, des jours et des mois entiers s’écouleront ; dès que nous bougeons, nous devons soutenir les attaques ennemies de front et d’arrière. Le pays est sauvage, dépourvus d’eau et de plantes ; l’armée manque du nécessaire, les chevaux sont fatigués et les hommes épuisés, toutes les ressources de force et d’habileté sont vaines, le passage est si étroit qu’un seul homme le défendant peut arrêter l’assaut de dix mille hommes ; tous les moyens d’attaque sont aux mains de l’ennemi, tous les points d’avantage sont déjà perdus par nous : dans cette terrible situation, même si nous avions les soldats les plus vaillants et les armes les plus acérées, comment pourraient-ils être utilisés avec le moindre effet ? » Les étudiants en histoire grecque se souviendront peut-être de la fin terrible de l’expédition de Sicile et de l’agonie des Athéniens sous Nicias et Démosthène. [Voir Thucydide, VII. 78 sqq.]. ↩︎
118:1 Mais concentrez-vous plutôt sur l’occupation de la position avantageuse. Ainsi, Ts’ao Kung, Li Ch’üan et d’autres, cependant, supposent que l’ennemi nous a déjà devancés, de sorte qu’attaquer serait pure folie. Dans le #, lorsque le roi de Wu demande ce qu’il convient de faire dans ce cas, Sun Tzŭ répond : « La règle concernant les terrains litigieux est que ceux qui sont en possession ont l’avantage sur l’autre camp. Si une position de ce genre est d’abord prise par l’ennemi, gardez-vous de l’attaquer. Attirez-le en faisant semblant de fuir, montrez vos bannières et faites résonner vos tambours, précipitez-vous vers d’autres endroits qu’il ne peut se permettre de perdre, arrachez des broussailles fragiles et soulevez de la poussière, confondez ses oreilles et ses yeux, détachez un corps de vos meilleures troupes et placez-le secrètement en embuscade. Alors votre adversaire sortira à la rescousse. » ↩︎
119:1 Parce que la tentative serait vaine et exposerait la force de blocage elle-même à de graves risques. Il existe deux interprétations de #, suivez celle de Chang Yü (#). L’autre est indiquée dans la brève note de Ts’ao Kung : # « Rapprochez-vous » — c’est-à-dire, veillez à ce qu’une partie de votre propre armée ne soit pas isolée. Wang Hsi souligne que # n’est qu’un autre nom pour le #, « terrain accessible » de X. § 2, et dit que le conseil donné ici est simplement une variante de # « gardez un œil attentif sur la ligne de ravitaillement », veillez à ce que vos communications ne soient pas coupées. Le T’ung Tien lit #. ↩︎
119:2 Ou peut-être, « former des alliances avec les États voisins ». Ainsi, Ts’ao Kung a : #. Le « cultiver des relations » du capitaine Calthrop est beaucoup trop timide et vague. Le texte original dit #. ↩︎
119:3 À ce propos, Li Ch’üan a la note délicieuse suivante : # « Lorsqu’une armée pénètre loin dans le pays ennemi, il faut prendre soin de ne pas aliéner le peuple par un traitement injuste. Suivez l’exemple de l’empereur Han Kao Tsu, dont la marche sur le territoire des Ch’in ne fut marquée par aucune violation des femmes ni pillage d’objets de valeur. [Nota bene : c’était en 207 av. J.-C., et pourrait bien nous faire rougir pour les armées chrétiennes qui entrèrent à Pékin en 1900 apr. J.-C.] Ainsi, il gagna le cœur de tous. Dans le présent passage, donc, je pense que la véritable lecture doit être, non pas # ‘piller’, mais # ‘ne pas piller’. » Hélas, je crains qu’en l’occurrence les sentiments du digne commentateur n’aient dépassé son jugement. Tu Mu, p. 120 du moins, ne se fait pas de telles illusions. Il dit : « Lorsqu’on campe sur un « terrain sérieux », sans aucune incitation à avancer davantage et sans possibilité de retraite, on doit prendre des mesures pour une résistance prolongée en apportant des provisions de tous côtés et en surveillant étroitement l’ennemi. » Cf. aussi II. § 9 : #. ↩︎
120:1 Ou, selon les termes de VIII. 52, # « ne campez pas. » ↩︎
120:2 Ts’ao Kung dit : # « Essayez l’effet d’un artifice inhabituel » ; et Tu Yu amplifie cela en disant : # « Dans une telle situation, il faut concevoir un plan qui convienne aux circonstances, et si nous parvenons à tromper l’ennemi, le péril pourra être évité. » C’est exactement ce qui se passa lors de la célèbre occasion où Hannibal fut encerclé dans les montagnes sur la route de Casilinum, et selon toute apparence piégé par le dictateur Fabius. Le stratagème qu’Hannibal imagina pour déjouer ses ennemis ressemblait remarquablement à celui que T’ien Tan avait également employé avec succès exactement 62 ans auparavant. [Voir IX. § 24, note.] À la nuit tombée, des fagots de brindilles furent attachés aux cornes de quelque 2 000 bœufs et incendiés, les animaux terrifiés étant alors rapidement chassés le long du flanc de la montagne vers les cols assiégés par l’ennemi. L’étrange spectacle de ces lumières se déplaçant rapidement alarma et déconcerta tellement les Romains qu’ils se retirèrent, et l’armée d’Hannibal traversa le défilé sans encombre. [Voir Polybe, III. 93, 94 ; Tite-Live, XXII. 16, 17.] ↩︎
120:3 Car; comme le remarque Chia Lin : # « si vous vous battez de toutes vos forces, il y a une chance de vie ; alors que la mort est certaine si vous vous accrochez à votre coin. » ↩︎
120:4 # est omis dans le texte T’u Shu. ↩︎
120:5 Plus littéralement, « faire perdre le contact entre l’avant et l’arrière ». ↩︎
121:1 Je doute que # puisse signifier « officiers et hommes », comme le traduit le capitaine Calthrop. Ceci est recherché pour #. ↩︎
121:2 La lecture #, dérivée du Yü Lan, doit être considérée comme très douteuse. Le texte original a #, et le T’u Shu #. ↩︎
121:3 Le capitaine Calthrop traduit # « ils ont dispersé l’ennemi », ce qui ne peut pas être correct. ↩︎
121:4 La note de Mei Yao-ch’ên rend le sens clair : #. Toutes ces clauses, bien sûr, jusqu’à #, dépendent de # dans le § 15. ↩︎
121:5 Mei Yao-ch’ên relie ceci à ce qui précède : # « Ayant réussi à disloquer ainsi l’ennemi, ils avançaient afin de s’assurer tout avantage à gagner ; s’il n’y avait aucun avantage à gagner, ils restaient où ils étaient. » ↩︎
121:6 # est comme #, introduisant une question supposée. ↩︎
121:7 p. 122 Les opinions divergent quant à ce que Sun Tzŭ avait en tête. Ts’ao Kung pense qu’il s’agit de # « un avantage stratégique dont dépend l’ennemi ». Tu Mu dit : # « Les trois choses qu’un ennemi est désireux de faire, et de l’accomplissement desquelles dépend son succès, sont : (1) capturer nos positions favorables ; (2) ravager nos terres cultivées ; (3) garder ses propres communications. » Notre objectif doit donc être de contrecarrer ses plans dans ces trois directions et ainsi le rendre impuissant. [Cf. III. § 3.] Mais cette exégèse force indûment le sens de # et # et je suis d’accord avec Ch’en Hao, qui dit que # ne se réfère pas seulement à des avantages stratégiques, mais à toute personne ou chose qui peut se révéler importante pour l’ennemi. En prenant hardiment l’initiative de cette manière, vous mettez immédiatement l’autre camp sur la défensive. ↩︎
122:1 # signifie « les conditions de la guerre », et non, comme le dit le capitaine Calthrop, « l’esprit des troupes ». Selon Tu Mu, # « ceci est un résumé des principes directeurs de la guerre », et il ajoute : # « Ce sont les vérités les plus profondes de la science militaire, et la principale affaire du général. » Les anecdotes suivantes, racontées par Ho Shih, montrent l’importance attachée à la rapidité par deux des plus grands généraux de Chine. En 227 après J.-C., # Mêng Ta, gouverneur de # Hsin-ch’êng sous l’empereur Wei Wên Ti, méditait de faire défection à la maison de Shu et était entré en correspondance avec Chu-ko Liang, premier ministre de cet État. Le général Wei Ssŭ-ma Ier était alors gouverneur militaire de # Wan, et, ayant vent de la trahison de Mêng Ta, il partit aussitôt avec une armée pour anticiper sa révolte, après l’avoir préalablement cajolé par un message spécieux d’importance amicale. Les officiers de Ssŭ-ma vinrent le trouver et lui dirent : « Si Mêng Ta s’est allié à Wu et Shu, il faut enquêter minutieusement avant d’agir. » Ssŭ-ma I répondit : « Mêng Ta est un homme sans scrupules, et nous devons aller le punir immédiatement, tant qu’il hésite encore et avant qu’il ne se soit débarrassé de son masque. » Puis, par une série de marches forcées, il amena son armée sous les murs de Hsin-ch’êng en l’espace de huit jours. Or, Mêng Ta avait précédemment écrit dans une lettre à Chu-ko Liang : « Wan est à 1 200 li d’ici. Lorsque la nouvelle de ma révolte parviendra à Ssŭ-ma I, il en informera immédiatement son maître impérial, mais il faudra un mois entier avant que des mesures puissent être prises, et d’ici là, ma ville sera bien fortifiée. De plus, Ssŭ-ma I est sûr de ne pas venir lui-même, et les généraux qui seront envoyés contre nous ne méritent pas qu’on s’en préoccupe. » La lettre suivante, cependant, était pleine de consternation : « Bien que huit jours seulement se soient écoulés depuis que j’ai renoncé à mon allégeance, une armée est déjà aux portes de la ville. Quelle rapidité miraculeuse ! » Quinze jours plus tard, Hsin-ch’êng était tombé et Mêng Ta avait perdu la tête. [Voir Chin Shu, ch. 1, f. 3.] En 621, Li Ching fut envoyé de # K’uei-chou, dans le Ssŭ-ch’uan, pour réduire le rebelle victorieux # Hsiao Hsien, qui s’était installé comme empereur à l’actuelle # Ching-chou Fu, dans le Hupeh. C’était l’automne, et le Yangzi Jiang était alors en crue, Hsiao Hsien n’imaginait pas que son adversaire oserait descendre par les gorges et ne fit donc aucun préparatif. Mais Li Ching embarqua son armée sans perdre de temps, et s’apprêtait à partir lorsque les autres généraux le supplièrent de reporter son départ jusqu’à ce que le fleuve soit moins dangereux pour la navigation. Li Ching répondit : « Pour le soldat, une vitesse fulgurante est primordiale, et il ne doit jamais rater une occasion. Il est temps de frapper, avant même que Hsiao Hsien ne sache que nous avons rassemblé une armée. Si nous saisissons l’instant présent, alors que le fleuve est en crue, nous apparaîtrons devant sa capitale avec une soudaineté surprenante. »Comme le tonnerre qui retentit avant même d’avoir eu le temps de se boucher les oreilles. [Voir VII, § 19, note.] Tel est le grand principe de la guerre. Même s’il apprend notre approche, il devra lever ses soldats avec une telle hâte qu’ils ne seront pas en état de nous opposer. Ainsi, nous récolterons tous les fruits de la victoire. » Tout se passa comme il l’avait prédit, et Hsiao Hsien fut contraint de se rendre, stipulant noblement que son peuple serait épargné et que lui seul subirait la peine de mort. [Voir Hsin Tang Shu, ch. 93, f. 1 _v_°.] ↩︎
123:1 Cf. supra, § 13. Li Ch’üan ne s’aventure pas ici sur une note. ↩︎
123:2 p. 124 #, selon Wang Hsi, signifie : # « Caressez-les, faites-leur plaisir, donnez-leur beaucoup de nourriture et de boisson, et prenez soin d’eux en général. » ↩︎
124:1 Tu Mu explique ces mots dans un distique rimé : #; et Ch’ên rappelle la ligne d’action adoptée en 224 av. J.-C. par le célèbre général # Wang Chien, dont le génie militaire contribua largement au succès du Premier Empereur. Il avait envahi l’État Ch’u, où une levée universelle fut faite pour s’opposer à lui. Mais, doutant du caractère de ses troupes, il déclina toutes les invitations à combattre et resta strictement sur la défensive. En vain le général Ch’u essaya de forcer la bataille : jour après jour, Wang Chien resta à l’intérieur de ses murs et ne voulut pas en sortir, mais consacra tout son temps et toute son énergie à gagner l’affection et la confiance de ses hommes. Il veilla à ce qu’ils soient bien nourris, partageant ses propres repas avec eux, leur fournissant des installations pour les bains et employant toutes les méthodes d’indulgence judicieuse pour les souder en un corps loyal et homogène. Au bout d’un certain temps, il réprimanda certaines personnes pour savoir comment les hommes s’amusaient. La réponse fut qu’ils s’affrontaient au poids et au saut en longueur (#). Lorsque Wang Chien apprit qu’ils se livraient à ces activités sportives, il comprit que leur moral était à son comble et qu’ils étaient prêts au combat. À ce moment-là, l’armée Ch’u, après avoir répété son défi à maintes reprises, s’était retirée vers l’est, dégoûtée. Le général Ch’in leva immédiatement son camp et les suivit, et la bataille qui s’ensuivit les mit en déroute, causant un grand massacre. Peu après, tout le Ch’u fut conquis par Ch’in, et le roi # Fu-ch’u fut emmené en captivité. [Voir Shih Chi, ch. 73, f. 5 _r_°. Il convient de noter que, # étant un caractère tabou sous la dynastie Ch’in, le nom apparaît sous la forme # partout.] ↩︎
124:2 Afin que l’ennemi ne sache jamais exactement où vous êtes. Il m’est apparu, cependant, que la bonne interprétation pourrait être, non pas #, mais # « lier votre armée » [cf. supra § 46, #], ce qui serait plus en accord avec #. Le capitaine Calthrop tranche le nœud gordien en omettant complètement ces mots. ↩︎
124:3 La paraphrase de Chang Yü est : #. ↩︎
125:1 Cf. Discours de Nicias aux Athéniens : Sachez, ô hommes de guerre, que si vous faites le bien, vous devez faire le bien, car il n’y a pas d’étrangers près de vous, et si vous êtes adoucis, vous serez sauvés, etc. [Jeu. VII. 77. vii.] ↩︎
125:2 # constitue à lui seul la protase, et # est l’interrogatif = #. Le capitaine Calthrop termine la protase par # : « S’il n’y a pas d’autre alternative que la mort. » Mais je ne vois pas comment on peut extraire cela des Chinois. Chang Yü donne une paraphrase claire : # et cite son favori, Wei Liao Tzŭ (ch. 3) : # « Si un homme se déchaînait avec une épée sur la place du marché, et que tous les autres essayaient de lui échapper, je ne dirais pas que cet homme seul avait du courage et que tous les autres étaient de méprisables lâches. La vérité est qu’un désespéré et un homme qui accorde une certaine valeur à sa vie ne se rencontrent pas sur un pied d’égalité. » ↩︎
125:3 # semble représenter le # plus habituel. Chang Yü dit # « S’ils se trouvent ensemble dans une situation délicate, ils utiliseront sûrement leur force unie pour s’en sortir. » ↩︎
125:4 Le capitaine Calthrop dit faiblement : « il y a unité », comme si le texte était #, comme dans le § 20. Mais # introduit une idée tout à fait nouvelle — celle de ténacité — que Ts’ao Kung essaie d’expliquer par le mot # « lier fermement ». ↩︎
126:1 Tu Mu dit : # Le capitaine Calthrop traduit mal # « sans avertissement ». ↩︎
126:2 Littéralement, « sans demander, vous obtiendrez. » La paraphrase de Chang Yü est : #. ↩︎
126:3 Chang Yü dit : #. ↩︎
126:4 Cette dernière clause est très similaire en sens à la précédente, sauf que # indique l’attachement des soldats à leur chef, et # l’attitude de ce dernier à leur égard. Je doute fort que # puisse signifier « ils auront confiance en leur chef », comme le commentaire semble l’indiquer. De cette façon, le sens est loin d’être aussi bon. D’un autre côté, il est tout à fait possible qu’ici, comme dans VIII. § 8 et infra, § 55, # puisse # « sans ordre, ils exécuteront [les plans de leur chef] ». L’ensemble de ce paragraphe, bien sûr, fait référence à un « terrain désespéré ». ↩︎
126:5 # est amplifié par Ts’ao Kung en #, et en #. Cf. le Ssŭ-ma Fa, ch. 3 : #. ↩︎
126:6 Les superstitieux, « liés à des doutes et des peurs insolentes », dégénèrent en lâches et « meurent plusieurs fois avant leur mort ». Tu Mu cite Huang Shih-kung : # « ‘Les sorts et les incantations doivent être strictement interdits, et aucun officier ne doit être autorisé à s’enquérir par divination du sort d’une armée, de peur que l’esprit du soldat ne soit sérieusement perturbé.’ Le sens est », poursuit-il, « que si tous les doutes et scrupules sont écartés, p. 128 vos hommes ne faibliront jamais dans leur résolution jusqu’à leur mort. » La lecture du texte standard est # « il n’y aura pas de refuge », ce qui ne convient pas ici. Je préfère donc adopter la variante #, qui figurait manifestement dans le texte de Li Ch’üan. ↩︎
127:1 Chang Yü a la meilleure note sur ce passage : # « La richesse et une longue vie sont des choses pour lesquelles tous les hommes ont une inclination naturelle. Par conséquent, s’ils brûlent ou jettent des objets de valeur et sacrifient leur propre vie, ce n’est pas qu’ils les détestent, mais simplement qu’ils n’ont pas le choix. » Sun Tzŭ insinue sournoisement que, les soldats n’étant que des êtres humains, il appartient au général de veiller à ce que les tentations de se dérober au combat et de s’enrichir ne se présentent pas à eux. Le capitaine Calthrop, prenant # pour l’adjectif, a : « non pas parce que l’argent est une mauvaise chose… non pas parce que la longue vie est un mal. » ↩︎
127:2 Le mot en chinois est # « pleurnicher ». Cela est interprété comme indiquant un chagrin plus authentique que de simples larmes. ↩︎
127:* p. 128 Dictionnaire biographique de Giles, n° 399. ↩︎
128:1 # était le nom personnel de # Chuan Chu, originaire de l’État de Wu et contemporain de Sun Tzŭ lui-même, qui fut employé par # Kung-tzŭ Kuang, plus connu sous le nom de Ho Lü Wang, pour assassiner son souverain # Wang Liao avec un poignard qu’il avait caché dans le ventre d’un poisson servi lors d’un banquet. Il réussit sa tentative, mais fut immédiatement mis en pièces par le garde du corps du roi. C’était en 515 av. J.-C. L’autre héros mentionné, # Ts’ao Kuei (ou Ts’ao # Mo), accomplit l’exploit qui a rendu son nom célèbre 166 ans plus tôt, en 681 av. J.-C. Lu avait été vaincu trois fois par Ch’i, et était sur le point de conclure un traité cédant une grande partie du territoire, lorsque Ts’ao Kuei s’empara soudainement de # Huan Kung, le duc de Ch’i, alors qu’il se tenait sur les marches de l’autel et tenait un poignard contre sa poitrine. Aucun des serviteurs du duc n’osa bouger, et Ts’ao Kuei exigea une restitution intégrale, déclarant que Lu était injustement traitée parce qu’elle était un État plus petit et plus faible. Huan Kung, au péril de sa vie, fut contraint d’y consentir, sur quoi Ts’ao Kuei jeta son poignard et reprit tranquillement sa place au milieu de l’assemblée terrifiée, sans même avoir changé de couleur. Comme on pouvait s’y attendre, le duc voulut ensuite revenir sur le marché, mais son vieux et sage conseiller # Kuan Chung lui fit remarquer l’impolitesse de manquer à sa parole, et le résultat fut que ce coup audacieux permit à Lu de récupérer la totalité de ce qu’elle avait perdu en trois batailles rangées. [Pour une autre anecdote sur Ts’ao Kuei, voir VII. § 27, note ; et pour les biographies de ces trois braves, Ts’ao, Chuan et Ching, voir Shih Chi, ch. 86.] ↩︎
128:2 # signifie « soudainement » ou « rapidement », et le serpent en question était sans doute appelé ainsi en raison de la rapidité de ses mouvements. Suite à ce passage, le terme est désormais utilisé dans le sens de « manœuvres militaires ». Les # n’ont apparemment pas été identifiés. ↩︎
129:1 Une autre lecture dans le Yü Lan pour # est # « ventre ». ↩︎
129:2 C’est-à-dire, comme le dit Mei Yao-ch’ên, # « Est-il possible de faire en sorte que l’avant et l’arrière d’une armée réagissent rapidement à l’attaque de l’autre, comme s’ils faisaient partie d’un seul corps vivant ? » ↩︎
129:3 Cf. VI. § 21. ↩︎
129:4 Le sens est le suivant : Si deux ennemis s’entraident en cas de péril commun, à combien plus forte raison deux parties d’une même armée, unies comme elles le sont par tous les liens d’intérêt et de solidarité. Or, il est notoire que de nombreuses campagnes ont été ruinées par manque de coopération, surtout entre armées alliées. ↩︎
129:5 # dit ici être équivalent à #. ↩︎
129:6 Ces étranges procédés pour empêcher son armée de s’enfuir rappellent le héros athénien Sôphanes, qui emporta une ancre avec lui à la bataille de Platées, grâce à laquelle il s’attacha solidement à un point. [Voir Hérodote, IX. 74.] Il ne suffit pas, dit Sun Tzŭ, de rendre la fuite impossible par de tels moyens mécaniques. Vous ne réussirez pas si vos hommes ne font pas preuve de ténacité, d’unité d’intention et, par-dessus tout, d’un esprit de coopération sympathique. Telle est la leçon que l’on peut tirer du shuai-jan. ↩︎
130:1 Littéralement, « niveler le courage [de tous] comme s’il s’agissait de celui d’un seul. » Si l’armée idéale doit former un tout organique unique, il s’ensuit que la résolution et l’esprit de ses composantes doivent être de même qualité, ou du moins ne doivent pas tomber en dessous d’un certain niveau. La description apparemment ingrate de Wellington de son armée à Waterloo comme « la pire qu’il ait jamais commandée » ne signifiait rien de plus que son manque de cet important point : l’unité d’esprit et de courage. S’il n’avait pas prévu les défections belges et soigneusement maintenu ces troupes à l’écart, il aurait presque certainement perdu la partie. ↩︎
130:2 Cette phrase est assez dure à première vue, mais la clé se trouve d’abord dans la pause après #, puis dans le sens de # lui-même. Le meilleur équivalent qui me vienne à l’esprit est l’allemand « zur Geltung kommen ». La paraphrase de Mei Yao-ch’ên est : # « Le moyen d’éliminer les différences entre force et faiblesse et de rendre les deux utiles est d’utiliser les caractéristiques accidentelles du terrain. » Des troupes moins fiables, postées sur des positions fortes, tiendront aussi longtemps que des troupes plus performantes sur un terrain plus exposé. L’avantage de la position neutralise l’infériorité en endurance et en courage. Le colonel Henderson déclare : « Avec tout le respect que je dois aux manuels et à l’enseignement tactique ordinaire, je suis enclin à penser que l’étude du terrain est souvent négligée et qu’on n’accorde pas suffisamment d’importance au choix des positions… et aux immenses avantages que l’on peut tirer, que l’on défende ou que l’on attaque, de l’utilisation judicieuse des caractéristiques naturelles. » [122] ↩︎
130:3 p. 131 Tu Mu dit : # « La comparaison fait référence à la facilité avec laquelle il le fait. » # signifie qu’il rend impossible à ses troupes de faire autrement qu’obéir. Chang Yü cite une comptine, que l’on trouve dans Wu Tzŭ, ch. 4 : #. ↩︎
131:1 # semble combiner les significations « silencieux » et « imperturbable », deux attributs qui conduiraient bien sûr au secret. Tu Mu explique # comme # « profond et impénétrable » et # comme # « juste et impartial ». Seul Mei Yao-ch’ên parmi les commentateurs prend # dans le sens de n # « maîtrisé ». # et # sont causalement liés à # et # respectivement. Cela n’est pas du tout mis en évidence dans la traduction du capitaine Calthrop : « Le général doit être calme, impénétrable, juste et prudent. » De plus, le dernier adjectif ne peut en aucun cas être considéré comme représentant #. ↩︎
131:2 Littéralement, « tromper leurs yeux et leurs oreilles » — # étant ici utilisé comme verbe au sens de #. ↩︎
131:* « Stonewall Jackson », vol. 1, p. 421. ↩︎
132:1 Wang Hsi pense que cela signifie ne pas utiliser deux fois le même stratagème. Il dit : #. ↩︎
132:2 Notez que # désigne l’ennemi, contrairement au # du § 36. Le capitaine Calthrop, ne s’en apercevant pas, fusionne les deux paragraphes en un seul. Chang Yü cite # comme disant : # « L’axiome selon lequel la guerre est fondée sur la tromperie ne s’applique pas seulement à la tromperie de l’ennemi. Vous devez tromper même vos propres soldats. Faites-les vous suivre, mais sans leur dire pourquoi. » ↩︎
133:1 Wang Hsi paraphrase # par # « camper sur un terrain facile », et Chang Yü le suit en disant : #. Mais c’est une vision totalement intenable. Pour # cf. VII. 4. Chia Lin, conservant son ancienne interprétation de ces mots, est maintenant obligé d’expliquer # par « faire changer de camp l’ennemi », ce qui est extrêmement maladroit. ↩︎
133:2 Je dois avouer franchement que je ne comprends pas la syntaxe de #, bien que sa signification soit assez claire. La difficulté a été ressentie, car Tu Mu nous dit qu’un texte omet #. Il est plus probable, cependant, que quelques caractères aient disparu. ↩︎
133:3 #, littéralement, « libère le ressort » (voir V. § 15), c’est-à-dire prend une mesure décisive qui rend impossible le retour de l’armée – comme # Hsiang Yü, qui coula ses navires après avoir traversé une rivière. Ch’ên Hao, suivi de Chia Lin, comprend moins bien les mots que # « déploie tous les artifices à sa disposition ». Mais # ce sens dérivé n’apparaît nulle part ailleurs dans Sun Tzŭ. ↩︎
133:4 Omis dans le T’u Shu. ↩︎
133:5 Le T’u Shu insère un autre # après #. Tu Mu dit : # « L’armée n’a connaissance que des ordres d’avancer ou de reculer ; elle ignore les fins ultérieures de l’attaque et de la conquête. » ↩︎
134:1 Sun Tzŭ veut dire qu’après la mobilisation, il ne faut pas tarder à porter un coup au cœur de l’ennemi. Avec # cf. supra, §. 23: #. Notez comment il revient sans cesse sur ce point. Parmi les États belligérants de la Chine ancienne, la désertion était sans doute une crainte et un mal bien plus présent et grave qu’elle ne l’est dans les armées d’aujourd’hui. ↩︎
134:2 Chang Yü dit : #, "Il ne faut pas être borné dans l’interprétation des règles relatives aux neuf variétés de terrain. ↩︎
134:3 L’utilisation de # « contraction et expansion » peut être illustrée par le dicton #, qui correspond presque exactement au français « il faut reculer pour mieux sauter ». [124] Le capitaine Calthrop, more suo, évite une vraie traduction et a : « l’adéquation des moyens à l’occasion ». ↩︎
134:* Voir Giles’ Dictionary, n° 9817. ↩︎
134:5 La paraphrase de Chang Yü est #. ↩︎
134:6 p. 135 Ce « terrain » est brièvement mentionné au VIII. § 2, mais il ne figure pas parmi les Neuf # de ce chapitre ni parmi les Six # du chap. X. On pourrait d’abord le traduire par « terrain lointain » (# est couramment utilisé dans le sens de « terres lointaines »), mais, si l’on en croit les commentateurs, c’est précisément ce qui n’est pas visé ici. Mei Yao-ch’ên dit qu’il s’agit de # « d’une position ni assez avancée pour être qualifiée de « facile », ni assez proche de chez soi pour être qualifiée de « dispersive », mais quelque chose entre les deux. » Cela, bien sûr, n’explique pas le nom #, qui semble impliquer que le général a coupé ses communications et s’est temporairement coupé de sa base. Ainsi, Wang Hsi dit : « C’est un terrain séparé de chez soi par un État intermédiaire, dont nous avons dû traverser le territoire pour l’atteindre. Il nous incombe donc d’y régler nos affaires rapidement. » Il ajoute que cette position est rare, ce qui explique pourquoi elle n’est pas incluse dans le #. Le capitaine Calthrop ne donne qu’une mauvaise traduction de cette phrase : « Quitter son domicile et traverser les frontières, c’est être libre de toute interférence. » ↩︎
135:1 Le T’u Shu lit # pour #. ↩︎
135:2 Du numéro # jusqu’à la fin du § 45, nous avons certaines des définitions de la première partie du chapitre répétées dans un langage légèrement différent. Le capitaine Calthrop les omet complètement. ↩︎
135:3 # = #. ↩︎
135:4 p. 136 Ce but, selon Tu Mu, est mieux atteint en restant sur la défensive et en évitant la bataille. Cf. supra, § 11. ↩︎
136:1 Le T’ung Tien a # au lieu de #. La lecture actuelle est appuyée par le # de Chang Yü-hsien. Comme le dit Tu Mu, l’objectif est de se prémunir contre deux éventualités possibles : # « (1) la désertion de nos propres troupes ; (2) une attaque soudaine de la part de l’ennemi. » Cf. VII…§ 17:, #. Mei Yao-ch’ên dit : # « En marche, les régiments doivent être en contact étroit ; dans un campement, il doit y avoir une continuité entre les fortifications. » Il semble d’ailleurs avoir oublié ce que Sun Tzŭ dit plus haut : #. ↩︎
136:2 C’est l’interprétation de Ts’ao Kung. Chang Yü l’adopte en disant : #, « Nous devons vite fermer l’arrière, afin que la tête et la queue puissent toutes deux atteindre le but. » Autrement dit, il ne faut pas les laisser s’éloigner trop loin l’une de l’autre. Mei Yao-ch’ên propose une autre explication tout aussi plausible : # « En supposant que l’ennemi n’ait pas encore atteint la position convoitée, et que nous soyons derrière lui, nous devrions avancer à toute vitesse afin de lui disputer sa possession. » # désignerait ainsi l’ennemi, # étant la préposition, et # conserverait son sens intransitif habituel. Cf. VII. § 4 : #. Ch’ên Hao, d’autre part, en supposant que l’ennemi a eu le temps de choisir son propre terrain, cite VI. § 1, où Sun Tzŭ nous met en garde contre le fait de venir épuisé à l’attaque. Sa propre idée de la situation est exprimée assez vaguement : # « S’il y a une position favorable devant vous, détachez un corps de troupes d’élite pour l’occuper ; alors si l’ennemi, comptant sur son nombre, arrive pour se battre pour elle, vous pourrez tomber rapidement sur ses derrières avec votre corps principal, et la victoire sera assurée. » C’est ainsi, ajoute-t-il, que Chao Shê battit l’armée de Ch’in. [Voir p. 57.] Li Ch’üan lirait # pour #:, il n’est pas facile de comprendre pourquoi. ↩︎
137:1 Comme le dit Wang Hsi, # « craignant une attaque surprise ». Le T’ung Tien dit ici # (voir la phrase suivante). ↩︎
137:2 Le T’ung Tien lit #, que Tu Yu explique comme « surveiller les villes de marché », # « les foyers de la révolution ». Le capitaine Calthrop traduit # par les mêmes mots que # dans § 12 : « cultiver les relations ». ↩︎
137:3 Les commentateurs considèrent qu’il s’agit de pillage et de butin, et non, comme on pourrait s’y attendre, d’une communication ininterrompue avec une base. Un texte, en effet, donne la lecture #. Cf. § 13. Le « attention aux approvisionnements » du capitaine Calthrop ne rend pas la force de #. ↩︎
137:4 Le « ne vous attardez pas » du capitaine Calthrop ne peut pas être qualifié de traduction, mais seulement de paraphrase de la paraphrase proposée par Ts’ao Kung : # « Éloignez-vous-en en toute hâte. » ↩︎
137:5 # « Pour faire croire que je veux défendre la position, alors que mon intention réelle est de percer soudainement les lignes ennemies » [Mêng Shih]; # « afin de forcer mes soldats à se battre avec désespoir » [Mei Yao-ch’ên]; # « craignant que mes hommes ne soient tentés de s’enfuir » [Wang Hsi]. Tu Mu souligne que c’est l’inverse de VII. § 36, où c’est l’ennemi qui est encerclé. En 532 après J.-C., # Kao Huan, plus tard empereur et canonisé sous le nom de # Shen-wu, fut encerclé par une grande armée sous # Êrh-chu Chao et d’autres. Sa propre force était relativement petite, composée seulement de 2 000 cavaliers et d’un peu moins de 30 000 fantassins. Les lignes d’investissement n’avaient pas été tracées très étroitement, des trous étant laissés à certains endroits. Mais Kao Huan, au lieu de tenter de s’échapper, prit la décision de bloquer lui-même toutes les issues restantes en y enfonçant des bœufs et des ânes attachés ensemble. Dès que ses officiers et ses hommes comprirent qu’il n’y avait plus qu’à vaincre ou à mourir, leur courage atteignit un degré extraordinaire d’exaltation et ils chargèrent avec une telle férocité désespérée que les rangs adverses se brisèrent et s’écroulèrent sous leur assaut. [Voir le commentaire de Tu Mu, et # ch. 1, fol. 6.] ↩︎
138:1 Tu Yu dit : # « Brûlez vos bagages et vos encombrements, jetez vos provisions et vos provisions, bouchez les puits, détruisez vos fourneaux et faites comprendre à vos hommes qu’ils ne peuvent survivre, mais doivent se battre jusqu’à la mort. » Mei Yao-ch’ên dit de manière épigrammatique : # « La seule chance de vivre est d’abandonner tout espoir. » Ceci conclut ce que Sun Tzŭ a à dire sur les « terrains » et les « variations » qui leur correspondent. En examinant les passages qui portent sur cet important sujet, nous ne pouvons qu’être frappés par la manière décousue et peu méthodique dont il est traité. Sun Tzŭ commence brusquement au VIII. § 2 à énumérer les « variations » avant d’aborder les « terrains », mais n’en mentionne que cinq, à savoir les numéros 7, 5, 8 et 9 de la liste suivante, et une qui n’y est pas incluse. Quelques variétés de motifs sont traitées dans la première partie du chapitre IX, puis le chapitre X présente six nouveaux motifs, assortis de six variantes de plan. Aucun d’entre eux n’est mentionné à nouveau, bien que le premier soit difficile à distinguer du motif n° 4 du chapitre suivant. Enfin, au chapitre XI, nous arrivons aux Neuf Motifs par excellence, immédiatement suivis des variantes. Cela nous amène au § 14. Aux §§ 43-45, de nouvelles définitions sont fournies pour les n° 5, 6, 2, 8 et 9 (dans l’ordre indiqué), ainsi que pour le dixième motif mentionné au chapitre VIII ; et enfin, les neuf variantes sont à nouveau énumérées du début à la fin, toutes, à l’exception des 5, 6 et 7, étant différentes de celles données précédemment. Bien qu’il soit impossible d’expliquer l’état actuel du texte de Sun Tzŭ, quelques faits significatifs peuvent être mis en évidence : (1) Le chap. Le chapitre VIII, d’après son titre, devrait traiter de neuf variations, alors que seulement cinq apparaissent. (2) C’est un chapitre anormalement court. (3) Le chapitre XI est intitulé Les Neuf Motifs. Plusieurs d’entre eux sont définis deux fois, en plus de deux listes distinctes des variations correspondantes. (4) La longueur du chapitre est disproportionnée, étant le double de celle de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre IX. Je ne me propose pas de tirer de conclusions de ces faits, au-delà de la conclusion générale que l’œuvre de Sun Tzŭ ne peut nous être parvenue sous la forme dans laquelle elle est sortie de ses mains : le chapitre VIII est manifestement défectueux et probablement déplacé, tandis que le chapitre XI semble contenir des éléments qui ont été ajoutés par une main ultérieure ou qui devraient apparaître ailleurs. ↩︎
139:1 # est rendu par le capitaine Calthrop : « poursuivre l’ennemi s’il bat en retraite. » Mais # ne peut pas signifier « battre en retraite ». Son sens premier est de dépasser, donc d’aller trop loin, de dépasser ou de se tromper. Ici, cependant, le mot a perdu toute implication de censure et semble signifier « franchir la ligne de démarcation séparant la sécurité du danger », ou, comme le dit Chang Yü, # « être profondément impliqué dans une position périlleuse ». Ce dernier commentateur fait allusion à la conduite des fidèles partisans de Pan Ch’ao en 73 après J.-C. L’histoire se déroule ainsi dans le Hou Han Shu, ch. 47, fol. 1 _v_° : « Lorsque Pan Ch’ao arriva à # Shan-shan, # Kuang, le roi du pays, le reçut d’abord avec beaucoup de politesse et de respect ; mais peu après, son comportement changea soudainement, et il devint négligent et insouciant. Pan Ch’ao en parla aux officiers de sa suite : « N’avez-vous pas remarqué, dit-il, que les intentions polies de Kuang sont en déclin ? Cela doit signifier que des envoyés sont arrivés des barbares du Nord, et que, par conséquent, il est dans un état d’indécision, ne sachant pas de quel côté se ranger. C’est sûrement la raison. L’homme vraiment sage, nous dit-on, peut percevoir les choses avant qu’elles ne se produisent ; combien plus, alors, celles qui sont déjà manifestes ! » Il appela alors un des indigènes qui avait été affecté à son service et lui tendit un piège en disant : « Où sont ces envoyés des Hsiung-nu qui sont arrivés il y a quelques jours ? » L’homme fut si surpris qu’entre surprise et peur, il ouvrit aussitôt toute la vérité. Pan Ch’ao, gardant son informateur soigneusement sous clé, convoqua alors une assemblée générale de ses officiers, trente-six en tout, et commença à boire avec eux. Lorsque le vin leur fut un peu monté à la tête, il tenta de les réconforter encore davantage en s’adressant à eux ainsi : « Messieurs, nous voici au cœur d’une région isolée, désireux d’acquérir richesses et honneurs par quelque grand exploit. Or, il se trouve qu’un ambassadeur des Hsiung-nu est arrivé dans ce royaume il y a quelques jours seulement, et le résultat est que la courtoisie respectueuse dont nous avons fait preuve notre hôte royal a disparu. Si cet envoyé le convainc de s’emparer de notre groupe et de nous livrer aux Hsiung-nu (p. 140), nos os deviendront la pâture des loups du désert. Que devons-nous faire ? » D’un commun accord, les officiers répondirent : « En péril de nos vies, nous suivrons notre commandant à travers la vie et la mort » (#). » Pour la suite de cette aventure, voir chap. XII. § 1, note. ↩︎
140:1 Ces trois phrases sont reprises de VII. §§ 12–14 — afin de souligner leur importance, semblent penser les commentateurs. Je préfère les considérer comme interpolées ici afin de former un antécédent aux mots suivants. Concernant les guides locaux, Sun Tzŭ aurait pu ajouter qu’il y a toujours un risque de se tromper, soit par trahison, soit par un malentendu comme le rapporte Tite-Live (XXII. 13) : Hannibal, nous dit-on, ordonna à un guide de le conduire dans les environs de Casinum, où il y avait un passage important à occuper ; mais son accent carthaginois, inadapté à la prononciation des noms latins, fit comprendre au guide Casilinum au lieu de Casinum, et, se détournant de sa route normale, il conduisit l’armée dans cette direction, l’erreur ne étant découverte qu’à leur arrivée. ↩︎
140:2 Se référant, je pense, à ce qui est contenu dans les §§ 54, 55. Ts’ao Kung, pensant peut-être au # dans VIII. § 6, les prend pour # « les avantages et les inconvénients accompagnant les neuf variétés de terrain ». Le T’u Shu se lit #. ↩︎
140:3 #, « celui qui gouverne par la force », était un terme spécialement utilisé pour désigner les princes qui établissaient leur hégémonie sur d’autres États féodaux. Les p. 141 # célèbres du VIIe siècle av. J.-C. étaient (1) # le duc Huan de Ch’i (2) # le duc Wên de Chin, (3) # le duc Hsiang de Sung, (4) # le prince Chuang de Ch’u, (5) # le duc Mu de Ch’in. Leurs règnes couvraient la période 685-591 av. J.-C. ↩︎
141:1 Ici et dans la phrase suivante, le Yü Lan insère # après #. ↩︎
141:2 Mei Yao-ch’ên construit l’une des chaînes de raisonnement qui sont si influencées par les Chinois : « En attaquant un État puissant, si vous pouvez diviser ses forces, vous aurez une supériorité en force ; si vous avez une supériorité en force, vous impressionnerez l’ennemi ; si vous impressionnez l’ennemi, les États voisins seront effrayés ; et si les États voisins sont effrayés, les alliés de l’ennemi seront empêchés de la rejoindre. » Ce qui suit donne un sens plus fort à # « Si le grand État a été vaincu une fois (avant qu’il n’ait eu le temps de rassembler ses alliés), alors les États plus petits se tiendront à l’écart et s’abstiendront de masser leurs forces. » Ch’ên Hao et Chang Yü interprètent la phrase d’une toute autre manière. Le premier dit : « Aussi puissant soit-il, un prince, s’il attaque un grand État, sera incapable de lever suffisamment de troupes et devra compter dans une certaine mesure sur une aide extérieure ; s’il s’en passe et, avec une confiance excessive en sa propre force, tente simplement d’intimider l’ennemi, il sera certainement vaincu. » Chang Yü exprime son point de vue ainsi : « Si nous attaquons imprudemment un grand État, notre propre peuple sera mécontent et reculera. Mais si (comme ce sera alors le cas) notre démonstration de force militaire est inférieure de moitié à celle de l’ennemi, les autres chefs prendront peur et refuseront de nous rejoindre. » Selon cette interprétation, # ne désignerait pas le #, mais le # lui-même. ↩︎
141:3 Pour le Yü Lan se lit #. ↩︎
142:1 #, comme dans § 6, désigne # « les princes féodaux », ou les États gouvernés par eux. ↩︎
142:2 Car (lire _shên_1) dans le sens de #, cf. VIII. § 8. Les commentateurs sont unanimes sur ce point, et il faut donc se garder de traduire # par « secrètement sûr de lui » ou autre. Le capitaine Calth rop (en omettant #) a : « il a confiance en lui-même ». ↩︎
142:3 Le raisonnement semble être le suivant : à l’abri d’une combinaison de ses ennemis, # « il peut se permettre de rejeter les alliances complexes et de simplement poursuivre ses propres desseins secrets, son prestige lui permettant de se passer d’amitiés extérieures. » (Li Ch’üan.) ↩︎
142:4 Ce paragraphe, bien qu’écrit bien des années avant que l’État de Ch’in ne devienne une menace sérieuse, résume assez bien la politique par laquelle les célèbres Six Chanceliers ont progressivement ouvert la voie à son triomphe final sous Shih Huang Ti. Chang Yü, poursuivant sa note précédente, pense que Sun Tzŭ condamne cette attitude d’égoïsme froid et d’isolement hautain. Il fait à nouveau référence au prince guerrier, laissant ainsi entendre qu’il est voué à succomber. ↩︎
142:5 Wu Tzŭ (ch. 3) dit moins sagement : # « Que l’avancée soit richement récompensée et la retraite lourdement punie. » ↩︎
142:6 #, littéralement, « accrocher » ou « publier ». ↩︎
142:7 # « Afin d’empêcher la trahison », dit Wang Hsi. Le sens général est rendu clair par la citation de Ts’ao Kung tirée du Ssŭ-ma Fa, p. 143 : # « Ne donnez des instructions qu’en apercevant l’ennemi ; ne récompensez que lorsque vous voyez des actes méritoires. » #, cependant, présente une certaine difficulté. La paraphrase de Ts’ao Kung #, je comprends qu’elle signifie : « Les instructions finales que vous donnez à votre armée ne doivent pas correspondre à celles qui ont été précédemment affichées. » Chang Yü simplifie cela en : « vos dispositions ne doivent pas être divulguées à l’avance. » Et Chia Lin dit : # « il ne doit y avoir aucune fixité dans vos règles et dispositions. » Non seulement il est dangereux de révéler ses plans, mais la guerre nécessite souvent de les renverser complètement au dernier moment. ↩︎
143:1 #, selon Ts’ao Kong, est ici égal à #. La signification exacte est explicitée plus clairement dans le paragraphe suivant. ↩︎
143:2 Cf. supra, § 34. ↩︎
143:3 Littéralement, « ne leur dites pas de mots » ; c’est-à-dire, ne donnez pas les raisons de vos ordres. Lord Mansfield a un jour dit à un collègue subalterne de « ne pas donner de raisons » à ses décisions, et cette maxime s’applique encore plus à un général qu’à un juge. Le capitaine Calthrop traduit cette phrase avec une belle simplicité : « Les ordres doivent diriger les soldats. » C’est tout. ↩︎
143:4 Comparer au dicton paradoxal #. Ces paroles de Sun Tzŭ furent un jour citées par Han Hsin pour expliquer la tactique qu’il employa lors d’une de ses plus brillantes batailles, déjà évoquée à la p. 28. En 204 av. J.-C., il fut envoyé contre l’armée du Chao et s’arrêta à dix milles de l’embouchure du col de # Ching-hsing, où l’ennemi s’était rassemblé en force. Là, à minuit, il détacha un corps de 2 000 cavaliers légers, chaque homme étant muni p. 144 d’un drapeau rouge. Leurs instructions étaient de se frayer un chemin à travers d’étroits défilés et de surveiller secrètement l’ennemi. « Quand les hommes du Chao me verront en pleine fuite », dit Han Hsin, « ils abandonneront leurs fortifications et me poursuivront. Ce doit être le signe qu’il faut se précipiter, arracher les étendards du Chao et dresser à leur place les bannières rouges du # Han. » Se tournant ensuite vers ses autres officiers, il fit remarquer : « Notre adversaire occupe une position solide et ne sortira probablement pas et ne nous attaquera pas avant d’avoir vu l’étendard et les tambours du commandant en chef, de peur que je ne fasse demi-tour et ne m’échappe à travers les montagnes. » Ce disant, il envoya d’abord une division de 10 000 hommes et leur ordonna de se former en ligne de bataille, dos à la rivière Ti. Voyant cette manœuvre, toute l’armée de Chao éclata de rire. Il faisait alors grand jour et Han Hsin, arborant le drapeau du généralissime, sortit du col au son des tambours et fut immédiatement engagé par l’ennemi. Une grande bataille s’ensuivit, qui dura un certain temps ; jusqu’à ce qu’enfin Han Hsin et son collègue Chang Ni, laissant tambours et bannière sur le terrain, s’enfuirent vers la division sur la rive, où une autre bataille acharnée faisait rage. L’ennemi se précipita à leur poursuite et s’empara des trophées, dépouillant ainsi leurs remparts de leurs hommes ; Mais les deux généraux réussirent à rejoindre l’autre armée, qui combattait avec le plus grand désespoir. Le temps était venu pour les 2 000 cavaliers de jouer leur rôle. Dès qu’ils virent les hommes du Chao poursuivre leur avantage, ils galopèrent derrière les murs déserts, arrachèrent les drapeaux ennemis et les remplacèrent par ceux des Han. Lorsque l’armée du Chao se retourna, la vue de ces drapeaux rouges les frappa de terreur. Convaincus que les Han étaient entrés et avaient maîtrisé leur roi, ils se dispersèrent dans un désordre sauvage, tous les efforts de leur chef pour contenir la panique étant vains. Alors, l’armée des Han fondit sur eux des deux côtés et acheva la déroute, tuant un grand nombre de personnes et capturant les autres, parmi lesquelles se trouvait le roi # Ya en personne. … Après la bataille, des officiers de Han Hsin vinrent le trouver et lui dirent : « L’Art de la guerre nous prescrit d’avoir une colline ou un tumulus à l’arrière droit, et une rivière ou un marais à l’avant gauche. [Cela semble être un mélange de Sun Tzŭ et de T’ai Lung. Voir IX. § 9, et note.] Vous, au contraire, nous avez ordonné de déployer nos troupes avec la rivière derrière nous. Dans ces conditions,Comment avez-vous réussi à remporter la victoire ? Le général répondit : « Je crains, messieurs, que vous n’ayez pas étudié l’art de la guerre avec suffisamment d’attention. N’est-il pas écrit : « Plongez votre armée dans une situation désespérée et elle s’en sortira saine et sauve ; placez-la dans un péril mortel et elle survivra » ? Si j’avais suivi la voie habituelle, je n’aurais jamais pu convaincre mes collègues. Que dit le Classique militaire (#) ? — « Foncez sur la place du marché et chassez les hommes au combat » (#). [Ce passage n’apparaît pas dans le texte actuel de Sun Tzŭ.] Si je n’avais pas placé mes troupes dans une position où elles étaient obligées de se battre pour leur vie, mais que j’avais laissé chacun suivre son propre jugement, il y aurait eu une débandade générale, et il aurait été impossible de faire quoi que ce soit avec elles. » Les officiers ont admis la force de son argument et ont dit : « Ce sont des tactiques plus élevées que nous aurions été capables d’appliquer. » [Voir Ch’ien Han Shu, ch. 34, suiv. 4, 5.] ↩︎
145:1 Le danger a un effet tonifiant. ↩︎
145:2 Ts’ao Kung dit : # « Feindre la stupidité » — en faisant semblant de céder et de se plier aux désirs de l’ennemi. La note de Chang Yü clarifie le sens : « Si l’ennemi semble vouloir avancer, incitez-le à le faire ; s’il est impatient de battre en retraite, retardez-le volontairement afin qu’il puisse mettre son intention à exécution. » L’objectif est de le rendre négligent et méprisant avant de lancer notre attaque. ↩︎
145:3 Je comprends les quatre premiers mots comme signifiant « accompagner l’ennemi dans une direction ». Ts’ao Kung dit : # « unir les soldats et se diriger vers l’ennemi. » Mais un déplacement aussi violent des caractères est tout à fait indéfendable. Mei Yao-ch’ên est le seul commentateur qui semble en avoir saisi le sens : # Le T’u Shu dit #. ↩︎
145:4 Littéralement, « après mille li ». ↩︎
145:5 Toujours un bon point avec les Chinois. ↩︎
145:6 Le T’u Shu a #, et une autre interprétation, p. 146, mentionnée par Ts’ao Kung, est #. Le capitaine Calthrop omet cette phrase, après avoir traduit ainsi les deux précédentes : « Découvrez les intentions de l’ennemi en vous conformant à ses mouvements. Lorsque celles-ci sont découvertes, alors, d’un seul coup, le général peut être tué, même s’il se trouve à cent lieues. » ↩︎
146:1 # ne signifie pas « quand la guerre est déclarée », comme le dit le capitaine Calthrop, ni exactement, comme le paraphrase Ts’ao Kung, # « quand vos plans sont fixés », lorsque vous avez planifié votre campagne. Cette expression n’est pas donnée dans le P’ei Wên Yün Fu. Aucun lien de causalité n’étant décelable entre cette phrase et la précédente, # doit nécessairement rester non traduit. ↩︎
146:2 # est expliqué par Mei Yao-ch’ên comme #. ↩︎
146:3 Le locus classicus pour ces décomptes est Chou Li, XIV. fol. 40 (édition impériale) : #. Le terme générique semble donc être #, # étant le type spécial utilisé aux portes des villes et à la frontière. Il s’agissait de tablettes de bambou ou de bois, dont la moitié était délivrée comme permis ou passeport par le fonctionnaire responsable d’une porte (# ou .#. Cf. le # « garde-frontière » de Lun Yü III. 24, qui pouvait avoir des fonctions similaires.) Lorsque cette moitié lui était rendue, dans un délai déterminé, il était autorisé à ouvrir la porte et à laisser passer le voyageur. ↩︎
146:4 Ne montrez aucune faiblesse et insistez pour que vos plans soient ratifiés par le souverain. # indique une salle ou un temple du Palais. Cf. I. § 26. Il n’est pas clair si d’autres officiers seraient présents. On ne peut guère tirer de conclusions de #, la lecture du texte standard, aussi ai-je adopté la conjecture # de Tu Mu, qui apparaît dans le T’u Shu. p. 147 Ts’ao Kung explique # par #, et Ho Shih par #. Une autre lecture est #, et Mei Yao-ch’ên, l’adoptant, comprend la phrase entière comme signifiant : Prenez les précautions les plus strictes pour assurer le secret de vos délibérations. Le capitaine Calthrop glisse un peu trop facilement sur les terrains accidentés. Sa traduction est : « conduisez les affaires du gouvernement avec vigilance. » ↩︎
147:1 Cette phrase paraît très simple, et pourtant Ts’ao Kung est le seul commentateur à la prendre comme je l’ai fait. Mêng Shih, suivi de Mei Yao-ch’ên et Chang Yü, définit # comme # « espions » et fait de # un verbe actif : « Si des espions viennent de l’ennemi, nous devons les laisser entrer rapidement. » Mais je ne trouve pas que les mots # aient ce sens ailleurs. D’un autre côté, ils peuvent être pris comme deux verbes, #, exprimant l’indécision de l’ennemi quant à savoir s’il doit avancer ou reculer, ce qui est le meilleur moment pour l’attaquer. [Cf. Tao Tê Ching, chap. X : # ; aussi # Li Chi, XII, I. ii. 25.] Il n’est pas facile de choisir entre cette explication et celle de Ts’ao Kung ; le fait que # apparaisse peu après, au § 68, pourrait être invoqué à l’appui de l’une ou l’autre. Le # doit être compris au sens de # ou #. La seule façon d’éviter cela est de mettre # entre virgules et de traduire : « Si nous laissons une porte ouverte, l’ennemi s’y précipitera à coup sûr. » ↩︎
147:2 Cf. supra, § 18. ↩︎
147:3 Le capitaine Calthrop ne tente guère de traduire ce paragraphe difficile, mais invente plutôt ce qui suit : « Découvrez ce qu’il apprécie le plus et planifiez de vous en emparer. » L’explication de Ch’ên Hao, cependant, est suffisamment claire : # « Si je parviens à m’emparer d’une position favorable, mais que l’ennemi n’apparaît pas sur la scène, l’avantage ainsi obtenu ne peut être utilisé à aucune fin pratique. Celui qui a donc l’intention d’occuper une position importante pour l’ennemi, doit commencer par prendre un rendez-vous astucieux, p. 148 pour ainsi dire, avec son antagoniste, et le cajoler pour qu’il s’y rende également. » Mei Yao-ch’ên explique que ce « rendez-vous astucieux » doit être pris par l’intermédiaire des propres espions de l’ennemi, qui rapporteront exactement la quantité d’informations que nous choisirons de leur donner. Ensuite, après avoir astucieusement dévoilé nos intentions, # « nous devons réussir, bien que partant après l’ennemi, à arriver avant lui » (VII. § 4). Il faut le poursuivre pour assurer sa marche vers cet endroit ; il faut arriver avant lui pour s’emparer de la place sans difficulté. Ainsi interprété, le présent passage conforte l’interprétation du § 47 par Mei Yao-ch’ên. ↩︎
148:1 # signifie # « une ligne de marquage », donc une règle de conduite. Voir Mencius VII. 1. xli. 2. Ts’ao Kung l’explique par la métaphore similaire # « équerre et compas ». La simplicité du sentiment m’incline plutôt à privilégier la lecture # adoptée par Chia Lin à la place de #, qui donne un sens exactement opposé, à savoir : « Abandonnez les règles strictes et immuables. » Chia Lin dit : # « La victoire est la seule chose qui compte, et elle ne peut être obtenue en adhérant aux canons conventionnels. » Il est regrettable que cette variante repose sur une autorité très faible, car le sens donné est certainement beaucoup plus satisfaisant. Napoléon, comme nous le savons, d’après les vétérans de la vieille école qu’il a vaincus, a gagné ses batailles en violant tous les canons acceptés de la guerre. ↩︎
148:2 Les quatre derniers mots du chinois sont omis par le capitaine Calthrop. Tu Mu dit : # « Conformez-vous à la tactique de l’ennemi jusqu’à ce qu’une opportunité favorable se présente ; alors avancez et engagez une bataille qui s’avérera décisive. » ↩︎
127:3 Non pas parce qu’ils ont peur, mais parce que, comme le dit Ts’ao Kung, # « tous ont adopté la ferme résolution de faire ou de mourir ». On se souvient que les héros de l’Iliade étaient tout aussi enfantins dans la manifestation de leur émotion. Chang Yü fait allusion à la séparation douloureuse à la rivière # I entre # Ching K’o et ses amis, lorsque le premier fut envoyé pour attenter à la vie du roi de Ch’in (futur Premier Empereur) en 227 av. J.-C. Les larmes de tous coulèrent comme la pluie lorsqu’il leur fit ses adieux et prononça les vers suivants : # p. 128 # « Le souffle strident souffle, Glaciale la brûlure ; Votre champion s’en va – Pour ne pas revenir. » [121] ↩︎
130:* p. 130 « La science de la guerre », p. 333. ↩︎
131:3 Ts’ao Kung nous donne l’un de ses excellents apophthegmes : # « Les troupes ne doivent pas être autorisées à partager vos plans au début ; elles ne peuvent que se réjouir avec vous de leur heureuse issue. » « Mystifier, tromper et surprendre l’ennemi » est l’un des premiers principes de la guerre, comme cela a été fréquemment souligné. Mais qu’en est-il de l’autre processus : la mystification de ses propres hommes ? Ceux qui pourraient penser que Sun Tzŭ est trop emphatique sur ce point feraient bien de lire les remarques du colonel Henderson sur la campagne de Stonewall Jackson dans la vallée : « Les peines infinies », dit-il, « avec lesquelles Jackson a cherché à dissimuler, même à ses officiers d’état-major les plus fiables, ses mouvements, ses intentions et ses pensées, un commandant moins minutieux les aurait déclarées inutiles » — etc. etc. [123] En l’an 88 après J.-C., comme nous le lisons au ch. 47 p. 132 du Hou Han Shu, « Pan Ch’ao entra en campagne avec 25 000 hommes de Khotan et d’autres États d’Asie centrale dans le but d’écraser Yarkand. Le roi de Kutcha répondit en envoyant son commandant en chef au secours de la place avec une armée composée de 50 000 hommes des royaumes de Wên-su, Ku-mo et Wei-t’ou. Pan Ch’ao convoqua ses officiers ainsi que le roi de Khotan à un conseil de guerre et déclara : « Nos forces sont désormais en infériorité numérique et incapables de tenir tête à l’ennemi. Le meilleur plan, alors, est de nous séparer et de nous disperser, chacun dans une direction différente. Le roi de Khotan partira par l’est, et je retournerai ensuite vers l’ouest. Attendons que le tambour du soir retentisse pour commencer. » Pan Ch’ao libéra alors secrètement les prisonniers qu’il avait capturés vivants, et le roi de Kutcha fut ainsi informé de ses plans. Enthousiasmé par la nouvelle, ce dernier partit aussitôt à la tête de 10 000 cavaliers pour barrer la retraite de Pan Ch’ao à l’ouest, tandis que le roi de Wên-su chevauchait vers l’est avec 8 000 cavaliers afin d’intercepter le roi de Khotan. Dès que Pan Ch’ao apprit le départ des deux chefs, il rassembla ses divisions, les prit en main et, au chant du coq, les lança contre l’armée de Yarkand, alors qu’elle campait. Pris de panique, les barbares prirent la fuite, confus, et furent poursuivis de près par Pan Ch’ao. Plus de 5 000 têtes furent rapportées comme trophées, ainsi qu’un immense butin composé de chevaux, de bétail et d’objets de valeur de toutes sortes. Yarkand capitulant alors, Kutcha et les autres royaumes rassemblèrent leurs forces respectives. Dès lors, En avant, le prestige de Pan Ch’ao a complètement impressionné les pays occidentaux. » Dans ce cas, nous voyons que le général chinois a non seulement gardé ses propres officiers dans l’ignorance de ses véritables plans, mais a en fait pris la décision audacieuse de diviser son armée afin de tromper l’ennemi. ↩︎
134:4 Cf. supra, § 20. ↩︎