[ p. 80 ]
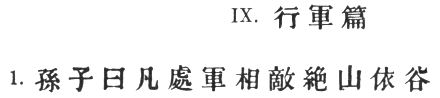
[^433].
1. Sun Tzŭ dit : Nous en venons maintenant à la question du campement de l’armée et de l’observation des signes de l’ennemi. [1] Traversez rapidement les montagnes, [2] et restez à proximité des vallées. [3]
[ p. 81 ]
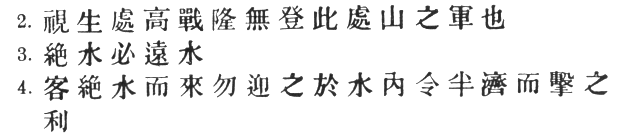
2. Campez en hauteur, [4] face au soleil. [5] Ne grimpez pas en hauteur pour combattre. [6] Voilà pour la guerre en montagne. [7]
3. Après avoir traversé une rivière, vous devez vous en éloigner. [8]
4. Lorsqu’une force d’invasion traverse une rivière en marche, n’avancez pas à sa rencontre au milieu du fleuve. Il est préférable de laisser la moitié de l’armée traverser, puis de lancer votre attaque. [9]
[ p. 82 ]
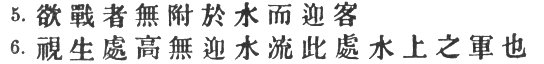
5. Si vous êtes désireux de combattre, vous ne devriez pas aller à la rencontre de l’envahisseur près d’une rivière qu’il doit traverser. [10]
6. Amarrez votre embarcation plus haut que l’ennemi et face au soleil. [11] Ne remontez pas le courant pour affronter l’ennemi. [12]
[ p. 83 ]
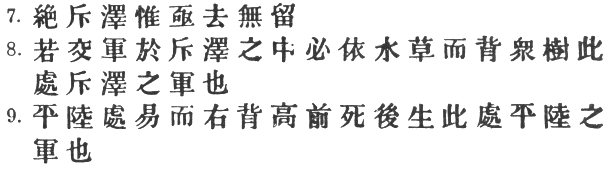
[le paragraphe continue] Voilà pour la guerre fluviale.
7. En traversant les marais salants, votre seul souci doit être de les franchir rapidement, sans délai. [13]
8. Si vous êtes obligé de combattre dans un marais salant, vous devriez avoir de l’eau et de l’herbe à proximité et vous adosser à un groupe d’arbres. [14] Voilà pour les opérations dans les marais salants.
9. En terrain sec et plat, prenez une position facilement accessible [15] avec un terrain en pente à votre droite et sur votre arrière,
[ p. 84 ]
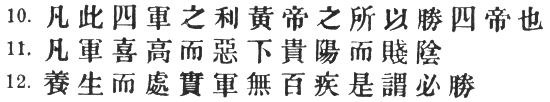
afin que le danger soit devant et la sécurité derrière. [16] Voilà pour la campagne en plaine.
10. Ce sont les quatre branches utiles des connaissances militaires [17] qui ont permis à l’Empereur Jaune de vaincre quatre souverains différents. [18]
11. Toutes les armées préfèrent les terrains élevés aux terrains bas, [19] et les endroits ensoleillés aux endroits sombres.
12. Si vous faites attention à vos hommes, [20]
[ p. 85 ]
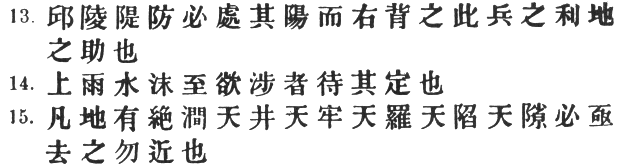
et camper sur un terrain dur, [21] l’armée sera exempte de maladies de toute sorte, [22] et cela signifiera la victoire.
13. Lorsque vous arrivez sur une colline ou un talus, occupez-vous du côté ensoleillé, la pente sur votre arrière-droite. Vous agirez ainsi immédiatement pour le bien de vos soldats et profiterez des avantages naturels du terrain.
14. Lorsque, par suite de fortes pluies à l’intérieur des terres, une rivière que vous souhaitez traverser à gué est gonflée et tachetée d’écume, vous devez attendre qu’elle se retire. [23]
15. Pays où il y a des falaises abruptes entre lesquelles coulent des torrents, [24] des creux naturels profonds, [^458] des endroits confinés, [25]
[ p. 86 ]
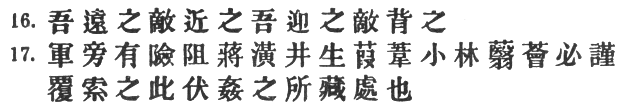
les fourrés emmêlés, [26] les bourbiers [27] et les crevasses [28] doivent être quittés le plus rapidement possible et ne pas être approchés.
16. Tandis que nous nous tenons à l’écart de ces endroits, nous devons inciter l’ennemi à s’en approcher ; tandis que nous leur faisons face, nous devons laisser l’ennemi les avoir sur ses derrières.
17 Si dans les environs de votre camp [29]
[ p. 87 ]
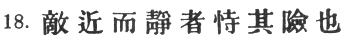
il doit y avoir un pays montagneux, [30] des étangs entourés d’herbes aquatiques, des bassins creux remplis de roseaux, [31] ou des bois avec un sous-bois épais, [32] ils doivent être soigneusement dépistés et fouillés ; car ce sont des endroits où des hommes en embuscade ou des espions insidieux sont susceptibles de se cacher. [33]
18. Lorsque l’ennemi est proche et reste silencieux, il s’appuie sur la force naturelle de sa position. [34]
[ p. 88 ]
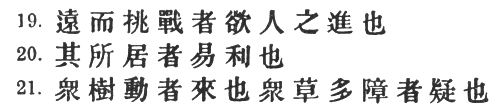
19. Lorsqu’il se tient à l’écart et tente de provoquer une bataille, il est impatient que l’autre camp avance. [35]
20. Si son lieu de campement est facile d’accès, il tend un appât. [36]
21. Le mouvement parmi les arbres d’une forêt indique que l’ennemi avance. [37] L’apparition de plusieurs écrans au milieu d’une herbe épaisse signifie que l’ennemi veut nous rendre méfiants. [38]
[ p. 89 ]
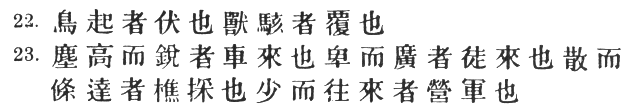
22. Le sursaut des oiseaux en vol est le signe d’une embuscade. [39] Des bêtes effrayées indiquent qu’une attaque soudaine est imminente. [40]
23. Lorsqu’une colonne de poussière s’élève, c’est le signe de l’avancée des chars ; lorsqu’elle est basse, mais répandue sur une large zone, elle annonce l’approche de l’infanterie. [41] Lorsqu’elle se ramifie dans différentes directions, elle indique que des équipes ont été envoyées ramasser du bois de chauffage. [42]
[ p. 90 ]
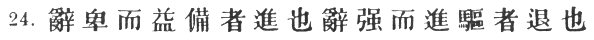
[le paragraphe continue] Quelques nuages de poussière se déplaçant dans tous les sens signifient que l’armée campe. [43]
24. Des paroles humbles et des préparatifs accrus sont des signes que l’ennemi est sur le point d’avancer. [44]
[ p. 91 ]
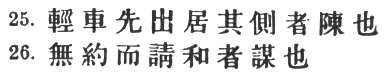
[le paragraphe continue] Un langage violent et une poussée en avant comme pour attaquer sont des signes qu’il va battre en retraite. [45] Lorsque les chars légers [46] sortent les premiers et prennent position sur les ailes, c’est un signe que l’ennemi se prépare pour la bataille. [47]
26. Les propositions de paix non accompagnées d’un engagement juré indiquent un complot. [48]
[ p. 92 ]
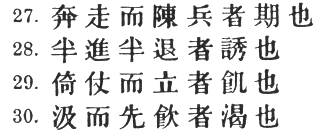
27. Quand il y a beaucoup de circulation [49] et que les soldats se mettent en rang, [50] cela signifie que le moment critique est arrivé. [51]
28. Quand on voit certains avancer et d’autres reculer, c’est un leurre. [52]
29. Lorsque les soldats s’appuient sur leurs lances, ils s’évanouissent par manque de nourriture. [53]
30. Si ceux qui sont envoyés puiser de l’eau commencent par boire eux-mêmes, l’armée souffre de la soif. [54]
[ p. 93 ]
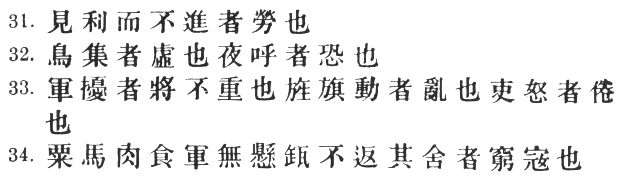
31. Si l’ennemi voit un avantage à gagner [55] et ne fait aucun effort pour l’obtenir, les soldats sont épuisés.
32. Si les oiseaux se rassemblent à un endroit, celui-ci est inoccupé. [56] Un bruit nocturne indique une certaine nervosité. [57]
33. S’il y a des troubles dans le camp, l’autorité du général est faible. Si les bannières et les drapeaux sont agités, la sédition est en marche. [58] Si les officiers sont en colère, cela signifie que les hommes sont las. [59]
34. Lorsqu’une armée nourrit ses chevaux avec du grain et tue son bétail pour se nourrir, [60] et lorsque les hommes ne suspendent pas leurs marmites [61]
[ p. 94 ]

au-dessus des feux de camp, montrant qu’ils ne retourneront pas dans leurs tentes, [62] vous pouvez savoir qu’ils sont déterminés à se battre jusqu’à la mort. [63]
35. La vue d’hommes chuchotant ensemble [64] en petits groupes [65]
[ p. 95 ]
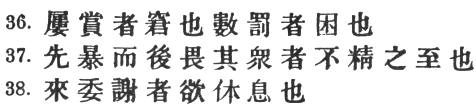
ou parler à voix basse [66] indique une désaffection parmi la base. [67]
36. Des récompenses trop fréquentes signifient que l’ennemi est à bout de ressources ; [68] trop de punitions trahissent un état de détresse extrême. [69]
37. Commencer par des fanfaronnades, puis s’effrayer du nombre de l’ennemi, démontre un manque d’intelligence extrême. [70]
38. Lorsque des émissaires sont envoyés avec des compliments à la bouche, c’est un signe que l’ennemi souhaite une trêve. [71]
[ p. 96 ]
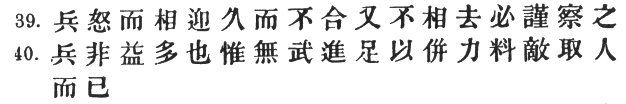
39. Si les troupes ennemies marchent avec colère et restent longtemps face aux nôtres sans engager le combat ni se retirer, la situation est telle qu’elle exige une grande vigilance et une grande circonspection. [72]
40. Si nos troupes ne sont pas plus nombreuses que celles de l’ennemi, cela suffit amplement ; [73] cela signifie simplement qu’aucune attaque directe ne peut être menée. [74] Ce que nous pouvons faire, c’est simplement concentrer toutes nos forces disponibles, surveiller l’ennemi de près et obtenir des renforts. [75]
[ p. 97 ]
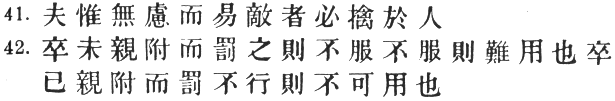
41. Celui qui ne fait preuve d’aucune prévoyance mais se moque de ses adversaires est sûr d’être capturé par eux. [76]
42. Si les soldats sont punis avant d’avoir grandi
[ p. 98 ]
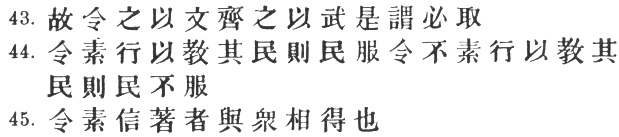
S’ils sont attachés à vous, ils ne se montreront pas soumis ; et, à moins de l’être, ils seront pratiquement inutiles. Si, une fois attachés à vous, les soldats ne sont pas punis, ils resteront inutiles. [77]
43. Il faut donc traiter les soldats en premier lieu avec humanité, mais les maintenir sous contrôle au moyen d’une discipline de fer. [78] C’est un chemin certain vers la victoire.
44. Si, à l’entraînement, les soldats appliquent systématiquement les ordres, l’armée sera bien disciplinée ; sinon, sa discipline sera mauvaise. [79]
45. Si un général fait confiance à ses hommes mais insiste toujours pour que ses ordres soient obéis, [80] [ p. 99 ] le gain sera mutuel. [81]
¶ Notes de bas de page
Le Yü Lan lit à nouveau # pour #. Tu Mu cite T’ai Kung qui a dit : « Une armée doit avoir un ruisseau ou un marais à sa gauche, et une colline ou un tumulus à sa droite. »
[^458] : 85:4 #, expliqué par Mei Yao-ch’ên comme #.
80:1 Le contenu de cet intéressant chapitre est mieux indiqué dans le § 1 que par ce titre. ↩︎
80:2 La discussion de #, comme le souligne Chang Yü, s’étend d’ici jusqu’à # (§§ 1–17), et de # de ce point jusqu’à # (§§ 18–39). Le reste du chapitre consiste en quelques remarques décousues, principalement sur le sujet de la discipline. ↩︎
80:3 Pour cet usage de #, cf. infra, § 3. Voir aussi #, ch. 1. fol. 2 (édition standard de 1876) : #; Shih Chi, ch. 27 ad init.: #. ↩︎
80:4 Tu Mu dit que # ici = #. L’idée n’est pas de s’attarder sur les hautes terres arides, mais de rester à proximité des réserves d’eau et d’herbe. Le capitaine Calthrop traduit « camper dans les vallées », sans tenir compte de la phrase suivante. Cf. Wu Tzŭ, ch. 3 : # « Ne demeurez pas dans les fours naturels », c’est-à-dire # « les ouvertures des grandes vallées. » Chang Yü raconte l’anecdote suivante : « # Wu-tu Ch’iang était un capitaine de brigands à l’époque des Han postérieurs, et # Ma Yüan fut envoyé pour exterminer sa bande. Ch’iang ayant trouvé refuge dans les collines, Ma Yüan ne tenta pas de provoquer la bataille, mais s’empara de toutes les positions favorables commandant des réserves d’eau et de fourrage. Ch’iang se trouva bientôt dans une situation si désespérée, faute de provisions, qu’il fut contraint de se rendre totalement. Il ne connaissait pas l’avantage de rester à proximité des vallées. » ↩︎
81:1 Non pas sur de hautes collines, mais sur des buttes ou des collines élevées au-dessus du pays environnant. ↩︎
81:2 #. Tu Mu prend cela pour « faire face au sud », et Ch’ên Hao « faire face à l’est ». Cf. infra, §§ 11, 53. ↩︎
81:3 # ici simplement équivalent à #. Le T’ung Tien et Yü Lan se lisent #. ↩︎
81:4 Après #, T’ung Tien et Yü Lan insèrent #. ↩︎
81:5 « Afin de tenter l’ennemi de traverser après vous », selon Ts’ao Kung, et aussi, dit Chang Yü, « afin de ne pas être gêné dans vos évolutions. » Le T’ung Tien dit # Si l’ennemi traverse une rivière", etc. Mais au vu de la phrase suivante, il s’agit presque certainement d’une interpolation. ↩︎
81:6 Le T’ung Tien et le Yü Lan se lisent # pour #, sans changement de sens. Wu Tzŭ plagie ce passage à deux reprises : ch. II ad fin., # ; ch. V, #. Li Ch’üan fait allusion à la grande victoire remportée par Han Hsin sur # Lung Chü à la rivière # Wei. Passons au Ch’ien Han Shu, ch. 34, fol. Au verso, la bataille est décrite ainsi : « Les deux armées étaient déployées de part et d’autre de la rivière. Dans la nuit, Han Hsin ordonna à ses hommes de prendre une dizaine de milliers de sacs de sable et de construire un barrage un peu plus haut. Puis, menant la moitié de son armée de l’autre côté, il attaqua Lung Chü ; mais au bout d’un moment, feignant l’échec, il se retira précipitamment sur l’autre rive. Lung Chü fut ravi de ce succès inattendu et s’exclama : « J’étais sûr que Han Hsin était vraiment un lâche ! » Il le poursuivit et traversa la rivière à son tour. Han Hsin envoya alors un détachement pour ouvrir les sacs de sable, libérant ainsi un important volume d’eau qui s’abattit et empêcha la majeure partie de l’armée de Lung Chü de traverser. Il se retourna alors contre les forces isolées et les anéantit, Lung Chü lui-même étant parmi les victimes. Le reste de l’armée, sur l’autre rive, se dispersa également et s’enfuit dans toutes les directions. ↩︎
82:1 Par crainte d’empêcher sa traversée, le capitaine Calthrop rend l’injonction ridicule en omettant un #. ↩︎
82:2 Voir supra, § 2. La répétition de ces mots en rapport avec l’eau est très maladroite. Chang Yü a la note : # « Se dit soit des troupes rassemblées sur la rive, soit des bateaux ancrés dans le courant lui-même ; dans les deux cas, il est essentiel d’être plus haut que l’ennemi et face au soleil. » Les autres commentateurs ne sont pas du tout explicites. On est très tenté de rejeter complètement leur explication de # et de la comprendre simplement comme « recherche de sécurité ». [Cf. # dans VIII. § 12, et infra, § 9.] Il est vrai que cela implique de prendre # à un temps inhabituel, mais pas, je pense, impossible. Bien sûr, le passage précédent devrait alors être traduit de la même manière. ↩︎
82:3 Tu Mu dit : « Comme l’eau coule vers le bas, nous ne devons pas installer notre camp sur le cours inférieur d’une rivière, de peur que l’ennemi n’ouvre les écluses et ne nous emporte dans une inondation. Ceci est implicite dans les mots # ci-dessus. Chu-ko Wu-hou a fait remarquer que « dans la guerre fluviale, nous ne devons pas avancer à contre-courant », ce qui revient à dire que notre flotte ne doit pas être ancrée en dessous de celle de l’ennemi, car il pourrait alors profiter du courant et nous éliminer rapidement. » Il y a aussi le danger, noté par d’autres commentateurs, p. 83, que l’ennemi jette maintenant du poison sur l’eau pour l’amener jusqu’à nous. La première version du capitaine Calthrop était : « Ne traversez pas les rivières face au courant » – un conseil judicieux, qui a suscité la curiosité de savoir quelle était la bonne façon de traverser les rivières. Il a maintenant amélioré cela en : « Ne combattez pas lorsque l’ennemi est entre l’armée et la source de la rivière. » ↩︎
83:1 En raison du manque d’eau douce, de la mauvaise qualité de l’herbe et, enfin et surtout, parce qu’ils sont bas, plats et exposés aux attaques. ↩︎
83:2 Li Ch’üan remarque que le terrain est moins susceptible d’être traître là où il y a des arbres, tandis que Tu Yu dit qu’ils serviront à protéger l’arrière. Le capitaine Calthrop, avec un génie parfait pour se tromper, dit « dans le voisinage d’un marais ». Car # les T’ung Tien et Yü Lan lisent mal #, et ce dernier a également # au lieu de #. ↩︎
83:3 Il s’agit sans doute de la force de #, son opposé étant #. Ainsi, Tu Mu l’explique comme # « un terrain lisse et ferme », donc adapté à la cavalerie ; Chang Yü comme # « un terrain plat, exempt de dépressions et de creux ». Il ajoute plus loin que, bien que Sun Tzŭ parle de terrain plat, il y aura néanmoins de légères élévations et des collines. p. 84 ↩︎
84:1 Wang Hsi pense que # contredit le dicton # du § 2, et soupçonne donc une erreur dans le texte. ↩︎
84:2 Ceux qui concernent (1) les montagnes, (2) les rivières, (3) les marais et (4) les plaines. Comparer aux « Maximes militaires » de Napoléon, n° 1. ↩︎
84:3 Mei Yao-ch’ên demande, avec une certaine plausibilité, si # n’est pas une erreur pour # « armées », car on ne sait rien de la conquête de quatre autres empereurs par Huang Ti. Le Shih Chi, (ch. I ad init.) ne parle que de ses victoires sur # Yen Ti et # Ch’ih Yu. Dans le #, il est mentionné qu’il « a livré soixante-dix batailles et pacifié l’Empire ». L’explication de Ts’ao Kung est que l’Empereur Jaune fut le premier à instituer le système féodal des princes vassaux, dont chacun (au nombre de quatre) portait à l’origine le titre d’Empereur. Li Ch’üan nous dit que l’art de la guerre est né sous Huang Ti, qui l’a reçu de son ministre # Fêng Hou. ↩︎
84:4 « Les terrains élevés, dit Mei Yao-ch’ên, sont non seulement plus agréables et salubres, mais plus pratiques d’un point de vue militaire ; les terrains bas sont non seulement humides et malsains, mais aussi désavantageux pour le combat. » Le texte original et le T’u Shu ont # au lieu de #. ↩︎
84:5 Ts’ao Kung dit : # « Allez chercher de l’eau fraîche et des pâturages, où vous pourrez faire paître vos animaux. » Et p. 85 les autres commentateurs le suivent, prenant apparemment # comme = #. Cf. Mencius, V. 1. ix. 1, où # signifie un gardien de bétail. Mais ici # fait sûrement référence à la santé des troupes. C’est le titre du troisième chapitre de Tchouang-tseu, où il désigne le bien-être moral plutôt que physique. ↩︎
85:1 # doit signifier un sol sec et solide, par opposition à un sol humide et marécageux. On le trouve généralement en hauteur, c’est pourquoi les commentateurs expliquent que # est pratiquement équivalent à #. ↩︎
85:2 Chang Yü dit : « La sécheresse du climat empêchera l’apparition de maladies. » ↩︎
85:3 Les T’ung Tien et Yü Lan ont un # superflu avant #. ↩︎
85:5 #, expliqué comme # « des endroits entourés de tous côtés par des rives abruptes, avec des flaques d’eau au fond. » ↩︎
85:6 p. 86 # « enclos naturels ou prisons », expliqués comme # « des endroits entourés de précipices sur trois côtés, faciles d’accès, mais difficiles d’en sortir. » ↩︎
86:1 #, expliqué comme # « des endroits couverts d’un sous-bois si dense que les lances ne peuvent pas être utilisées. » ↩︎
86:2 #, expliqué comme # « des endroits bas, si lourds de boue qu’ils sont impraticables pour les chars et les cavaliers. » ↩︎
86:3 est expliqué par Mei Yao-ch’ên comme # « un chemin étroit et difficile entre des falaises abruptes », mais Ts’ao Kung dit #, ce qui semble désigner quelque chose de bien plus petit. La note de Tu Mu est # « un terrain couvert d’arbres et de rochers, et entrecoupé de nombreux ravins et pièges ». C’est très vague, mais Chia Lin l’explique assez clairement comme un défilé ou un passage étroit : #, et Chang Yü partage à peu près le même point de vue. Dans l’ensemble, la majorité des commentateurs penche certainement vers la traduction par « défilé ». Mais le sens ordinaire de # (une fissure) et le fait que # ci-dessus doit être quelque chose de la nature d’un défilé, me font penser que Sun Tzŭ parle ici de crevasses. Le T’ung Tien et le Yü Lan lisent # pour #, avec le même sens ; ce dernier a également # après # – une glose palpable. ↩︎
86:4 Le texte original contient #, mais # a été généralement adopté car il donne un sens bien meilleur. ↩︎
87:1 # est #, selon Chang Yü. ↩︎
87:2 Le texte original omet # et #, de sorte que # et # se rejoignent pour former une paire : « étangs et bassins ». Cela est assez plausible à première vue, mais il y a plusieurs objections à cela : (1) il est peu probable que # soit entré dans le texte comme une glose sur # ; (2) il est facile de supposer, d’autre part, que # et ensuite # (pour rétablir l’équilibre de la phrase) ont été omis par un copiste qui a hâtivement conclu que # et # devaient aller ensemble ; (3) le sens, quand on y réfléchit, nécessite en fait #, car il est absurde de parler d’étangs et de mares comme d’endroits appropriés en soi pour une embuscade ; (4) Li Ching (571–649 après J.-C.) dans son # « L’Art de la guerre » a les mots : #. Il s’agit évidemment d’une réminiscence de Sun Tzŭ, il ne fait donc aucun doute que # figurait dans le texte à cette date ancienne. On peut ajouter que le T’ung Tien et le Yü Lan ont tous deux #, et ce dernier se lit également # pour #. ↩︎
87:3 Je lis # avec le Yü Lan de préférence à #, donné dans le texte original, qui est accepté sans discussion par les commentateurs. Le texte du T’u Shu jusqu’à présent est le suivant : #. ↩︎
87:4 Le texte original omet #, qui a été restauré à partir du T’ung Tien et du Yü Lan. Le T’u Shu omet également #, faisant de # un substantif. Sur #, Chang Yü a la note : # « Nous devons également nous méfier des traîtres qui pourraient se cacher, espionner secrètement nos faiblesses et écouter nos instructions. Fu et chien doivent être traités séparément. » ↩︎
87:5 p. 88 Ici commencent les remarques de Sun Tzŭ sur la lecture des signes, dont une grande partie est si bonne qu’elle pourrait presque être incluse dans un manuel moderne comme « Aids to Scouting » du général Baden-Powell. ↩︎
88:1 Probablement parce que nous sommes en position de force, d’où il souhaite nous déloger. « S’il s’approchait de nous », dit Tu Mu, « et tentait de nous forcer la bataille, il semblerait nous mépriser, et il y aurait moins de chances que nous répondions au défi. » ↩︎
88:2 # est ici l’opposé de # dans § 18. La lecture du T’ung Tien et du Yü Lan, #, est manifestement corrompue. Le texte original, qui transpose # et #, pourrait très probablement être correct. Tu Mu nous dit qu’il existe encore une autre lecture : #. ↩︎
88:3 Ts’ao Kung explique cela comme « abattre des arbres pour se frayer un passage », et Chang Yü dit : « Chaque armée envoie des éclaireurs escalader les hauteurs et observer l’ennemi. Si un éclaireur voit les arbres d’une forêt bouger et trembler, il peut savoir qu’ils sont abattus pour ouvrir un passage à l’ennemi. » ↩︎
88:4 Chaque fois que le sens d’un passage s’avère quelque peu insaisissable, le capitaine Calthrop semble se considérer justifié de laisser libre cours à son imagination. Ainsi, bien que son texte soit ici identique au nôtre, il traduit ce qui précède : « Les branches cassées et l’herbe piétinée, comme le passage d’une armée nombreuse, doivent être considérées avec suspicion. » L’explication de Tu Yu, empruntée à Ts’ao Kung, est la suivante : « La présence de plusieurs écrans ou abris au milieu d’une végétation épaisse est un signe certain que l’ennemi a fui et, craignant d’être poursuivi, a construit ces cachettes p. 89 afin de nous faire soupçonner une embuscade. » Il semble que ces « écrans » aient été assemblés à la hâte avec les hautes herbes que l’ennemi en retraite rencontrait. ↩︎
89:1 L’explication de Chang Yü est sans aucun doute juste : « Lorsque des oiseaux qui volent en ligne droite s’élancent soudainement vers le haut, cela signifie que des soldats sont en embuscade à l’endroit en dessous. » ↩︎
89:2 On trouve un exemple de # _fou_4 dans le sens d’« embuscade » dans le Tso Chuan, # 9e année : #. Dans le présent passage, cependant, il faut le distinguer de # juste au-dessus, car il implique un mouvement vers l’avant de la part de la force attaquante. Ainsi, Li Ch’üan le définit comme #, et Tu Mu comme #. ↩︎
89:3 # « haut et pointu », ou s’élevant jusqu’à un sommet, est bien sûr quelque peu exagéré lorsqu’il est appliqué à la poussière. Les commentateurs expliquent le phénomène en disant que les chevaux et les chars, plus lourds que les hommes, soulèvent plus de poussière et se suivent dans la même trajectoire, tandis que les fantassins marchent en rangs, plusieurs de front. Selon Chang Yü, « toute armée en marche doit avoir des éclaireurs (#) quelque part en avant, qui, à l’apercevant de la poussière soulevée par l’ennemi, reviendront au galop et la signaleront au commandant en chef. » Cf. le général Baden-Powell : « Lorsque vous vous déplacez, par exemple, en terrain hostile, vos yeux doivent chercher au loin l’ennemi ou tout signe de sa présence : silhouettes, poussière qui s’élève, oiseaux qui s’élèvent, éclat des armes, etc. » [82] ↩︎
89:* « Aides au scoutisme », p. 26. ↩︎
90:1 Chang Yü dit : « Lors de la répartition des défenses d’un cantonnement, des cavaliers légers seront envoyés pour surveiller la position et identifier les points faibles et forts sur toute sa circonférence. D’où la faible quantité de poussière et son mouvement. » ↩︎
90:2 « Comme s’ils avaient une grande peur de nous », dit Tu Mu. « Leur but est de nous rendre méprisants et négligents, après quoi ils nous attaqueront. » Chang Yü fait allusion à l’histoire de # T’ien Tan de l’État de Ch’i, qui en 279 av. J.-C. fut durement pressé de défendre # Chi-mo contre les forces Yen, dirigées par # Ch’i Chieh. Au ch. 82 du Shih Chi, nous lisons : « T’ien Tan a ouvertement déclaré : ‘Ma seule crainte est que l’armée Yen ne coupe le nez de ses prisonniers Ch’i et ne les place au premier rang pour nous combattre ; ce serait la perte de notre ville.’ L’autre camp, informé de ce discours, s’exécuta aussitôt. Mais les habitants de la ville, furieux de voir leurs compatriotes ainsi mutilés, et craignant seulement qu’ils ne tombent aux mains de l’ennemi, s’enhardirent à se défendre avec plus d’obstination que jamais. Une fois de plus, T’ien Tan renvoya des espions convertis qui rapportèrent ces mots à l’ennemi : « Ce que je redoute le plus, c’est que les hommes de Yen ne déterrent les tombes ancestrales à l’extérieur de la ville et, en infligeant cette indignité à nos ancêtres, ne nous fassent perdre courage. » Aussitôt, les assiégeants déterrèrent toutes les tombes et brûlèrent les cadavres qui gisaient dedans. Les habitants de Chi-mo, témoins de l’outrage depuis les remparts, pleurèrent abondamment et étaient tous impatients de sortir et de combattre, leur fureur étant décuplée. T’ien Tan savait alors que ses soldats étaient prêts à toute entreprise. Mais au lieu d’une épée, il prit lui-même une pioche et ordonna d’en distribuer d’autres à ses meilleurs guerriers, tandis que les rangs se remplissaient de leurs épouses et concubines. Il distribua ensuite toutes les rations restantes et ordonna à ses hommes de manger à leur faim. Les soldats réguliers reçurent l’ordre de se tenir hors de vue, et les remparts furent occupés par les hommes âgés et faibles, ainsi que par les femmes. Ceci fait, des émissaires furent dépêchés au camp ennemi pour négocier les conditions de reddition, après quoi l’armée Yen se mit à crier de joie. T’ien Tan collecta également 20 000 onces d’argent auprès du peuple et demanda aux riches citoyens de Chi-mo de les envoyer à Le général Yen pria pour que, lorsque la ville capitulerait, il ne permette pas que leurs maisons soient pillées ni que leurs femmes soient maltraitées. Ch’i Chieh, de bonne humeur, exauça leur prière ; mais son armée devint de plus en plus lâche et négligente. Pendant ce temps, T’ien Tan rassembla mille bœufs, les para de soie rouge, peignit leurs corps, tels des dragons, de rayures colorées, et fixa des lames acérées à leurs cornes et des joncs bien graissés à leurs queues. À la nuit tombée, il alluma les extrémités des joncs et fit passer les bœufs par les nombreux trous qu’il avait percés dans les murs, les soutenant avec une force de 5 000 guerriers d’élite. Les animaux, fous de douleur, se précipitèrent furieusement dans le camp ennemi, semant la confusion et la consternation ; leurs queues, telles des torches, révélant les motifs hideux de leurs corps.et les armes sur leurs cornes tuaient ou blessaient tous ceux avec qui ils entraient en contact. Pendant ce temps, la bande de 5000 s’était approchée avec des bâillons dans la bouche, et se jetait maintenant sur l’ennemi. Au même moment, un vacarme effroyable s’éleva dans la ville elle-même, tous ceux qui étaient restés en arrière faisant autant de bruit que possible en frappant des tambours et en martelant des récipients en bronze, jusqu’à ce que le ciel et la terre soient convulsés par le tumulte. Frappée de terreur, l’armée Yen s’enfuit en désordre, poursuivie avec acharnement par les hommes de Ch’i, qui réussirent à tuer leur général Ch’i Chieh… Le résultat de la bataille fut la reprise définitive de quelque soixante-dix villes qui avaient appartenu à l’État Ch’i. ↩︎
91:1 Je suis ici le texte original, également adopté par le T’u Shu. Le texte standard lit # en vertu du commentaire de Ts’ao Kung #, qui montre que son texte incluait le mot #. Aussi solide que soit ce motif, je ne pense pas qu’il puisse contrebalancer la supériorité évidente de l’autre lecture en termes de sens. # non seulement ne fournit aucune antithèse à #, mais rend tout le passage absurde ; car si le langage de l’ennemi est calculé pour tromper, il ne peut être considéré comme trompeur sur le moment, et ne peut donc comporter aucun « signe ». De plus, le mot supplémentaire dans # (une locution maladroite, soit dit en passant) gâche le parallélisme avec #. ↩︎
91:2 Le même, selon Tu Yu, que le # de II. § 1. ↩︎
91:3 Le T’ung Tien omet #. ↩︎
91:4 p. 92Tu Yu définit # comme #, et Li Ch’üan comme # « un traité confirmé par serments et otages ». Wang Hsi et Chang Yü, d’un autre côté, disent simplement # « sans raison », « sous un prétexte frivole », comme si # portait le sens plutôt inhabituel d’« important ». Le capitaine Calthrop a « sans consultation », ce qui est trop vague. ↩︎
92:1 Chaque homme se hâtant vers sa place appropriée sous sa propre bannière régimentaire. ↩︎
92:2 Je suis le T’u Shu en omettant # après #. Tu Mu cite le Chou Li, ch. xxix. fol. 31 : #. ↩︎
92:3 Ce que Chia Lin appelle #, par opposition à #. ↩︎
92:4 Le capitaine Calthrop a à peine raison lorsqu’il traduit : « Une avancée, suivie d’une retraite soudaine. » Il s’agit plutôt d’un cas de confusion feinte. Comme le dit Tu Mu : #. ↩︎
92:5 # n’est probablement pas ici un synonyme de #, mais = # « une arme ». Le texte original contient #, qui a été corrigé à partir du T’ung Tien et du Yü Lan. ↩︎
92:6 Comme le remarque Tu Mu : # « On peut connaître l’état de toute une armée à partir du comportement d’un seul homme. » Le # peut signifier soit qu’ils boivent avant de puiser de l’eau pour l’armée, soit avant de retourner au camp. Chang Yü adopte ce dernier point de vue. Le T’ung Tien a la lecture erronée #, et le Yü Lan, pire encore, #. ↩︎
93:1 Pas nécessairement « butin », comme le traduit le capitaine Calthrop. Le T’ung Tien et le Yü Lan se lisent #, etc. ↩︎
93:2 Un fait utile à garder à l’esprit lorsque, par exemple, comme le dit Ch’ên Hao, l’ennemi a secrètement abandonné son camp. ↩︎
93:3 En raison de fausses alertes ; ou, comme l’explique Tu Mu : # « La peur rend les hommes agités ; alors ils se mettent à crier la nuit afin de garder leur courage. » Le T’ung Tien insère # avant #. ↩︎
93:4 Le T’ung Tien et le Yü Lan omettent #. ↩︎
93:5 Et donc, comme le dit le capitaine Calthrop, lent à obéir. Tu Yu interprète la phrase différemment : « Si tous les officiers d’une armée sont en colère contre leur général, cela signifie qu’ils sont épuisés par la fatigue » [à cause des efforts qu’il leur a demandés]. ↩︎
93:6 # est développé par Mei Yao-ch’ên (à la suite de Tu Mu) en #, qui est le sens que j’ai donné plus haut. Dans le cours normal des choses, les hommes seraient nourris de céréales et les chevaux principalement d’herbe. ↩︎
93:7 p. 94 Le T’ung Tien se lit #, ce qui est à peu près la même chose que #, et le Yü Lan #, ce qui est manifestement faux. ↩︎
94:1 Pour #, le T’ung Tien et le Yü Lan se lisent tous deux #. ↩︎
94:2 Pour # voir VII. § 36. Je peux citer ici le passage illustratif du Hou Han Shu, ch. 71, donné sous forme abrégée par le P’ei Wên Yün Fu :_ « Le rebelle. # Wang Kuo de # Liang assiégeait la ville de # Ch’ên-ts’ang, et # Huang-fu Sung, qui était au commandement suprême, et # Tung Cho furent envoyés contre lui. Ce dernier insista pour des mesures hâtives, mais Sung fit la sourde oreille à ses conseils. Finalement, les rebelles furent complètement épuisés et commencèrent à jeter leurs armes de leur propre chef. Sung était maintenant pour avancer à l’attaque, mais Cho dit : « C’est un principe de guerre de ne pas poursuivre des hommes désespérés et de ne pas presser une armée en retraite. » Sung répondit : « Cela ne s’applique pas ici. Ce que je m’apprête à attaquer est une armée blasée, et non une armée en retraite ; avec des troupes disciplinées, je m’attaque à une multitude désorganisée, et non à une bande d’hommes désespérés. » Il passa alors à l’attaque, sans le soutien de son collègue, et mit l’ennemi en déroute, tuant Wang Kuo. » La lecture inférieure du T’u Shu pour le § 34 est la suivante : #. La première clause me paraît plutôt superficielle pour Sun Tzŭ, et il est difficile de tirer quoi que ce soit du # dans la seconde sans la négation. Le capitaine Calthrop, sans se laisser décourager, nota dans sa première édition : « Lorsqu’ils jetèrent leurs marmites. » Il a maintenant : « Lorsque les marmites seront accrochées au mur. » ↩︎
94:3 # est bien expliqué par Tu Mu comme # « parler en retenant son souffle ». ↩︎
94:4 Le Shuo Wên définit assez étrangement # par le mot #, mais le Êrh Ya dit # « joindre » ou « contracter », ce qui est sans doute son sens premier. Chang Yü a donc raison de l’expliquer ici par le mot #. Les autres commentateurs sont très perdus : Ts’ao Kung dit #, Tu Yu #, Tu Mu #, Chia Lin #, Mei Yao-ch’ên #, Wang Hsi #. ↩︎
95:1 # est censé être identique à #. ↩︎
95:2 # équivaut à #, le sujet étant bien sûr « le général », sous-entendu. Dans le texte original, qui semble être suivi par plusieurs commentateurs, le passage entier se présente ainsi : #. Ici, c’est le général qui parle à ses hommes, et non les hommes entre eux. Pour #, qui constitue le principal obstacle à cette lecture, le T’u Shu donne la correction très plausible # (également lu hsi, et défini par K’ang Hsi comme # « parler vite »). Mais cela est inutile si l’on s’en tient au texte standard. ↩︎
95:3 Car, quand une armée est sous pression, comme le dit Tu Mu, il y a toujours une crainte de mutinerie, et des récompenses généreuses sont données pour garder les hommes de bonne humeur. ↩︎
95:4 Car dans un tel cas, la discipline se relâche et une sévérité inhabituelle est nécessaire pour maintenir les hommes dans leur devoir. ↩︎
95:5 Je suis d’accord avec l’interprétation de Ts’ao Kung : #, également adoptée par Li Ch’üan, Tu Mu et Chang Yü. Une autre signification possible, proposée par Tu Yu, Chia Lin, Mei Yao-ch’ên et Wang Hsi, est : « Le général qui est d’abord tyrannique envers ses hommes, puis terrorisé par la crainte de leur mutinerie, etc. » Cela relierait la phrase à ce qui précède concernant les récompenses et les punitions. Le T’ung Tien et le Yü Lan lisent # « affection » au lieu de #. ↩︎
95:6 p. 96 Tu Mu dit : # « Si l’ennemi ouvre des relations amicales en envoyant des otages, c’est un signe qu’il est désireux d’un armistice, soit parce que ses forces sont épuisées, soit pour une autre raison. » Mais il n’est guère besoin d’un Sun Tzŭ pour tirer une conclusion aussi évidente ; et bien que Tu Mu soit soutenu par Mei Yao-ch’ên et Chang Yü, je ne peux pas penser que les otages soient indiqués par le mot #. ↩︎
96:1 Le capitaine Calthrop tombe dans un piège qui se cache souvent dans le mot #. Il traduit : « Lorsque les deux camps, avides de combat, se font face pendant un temps considérable, sans avancer ni reculer », etc. S’il avait un peu réfléchi, il aurait vu que cela n’a aucun sens s’agissant d’un commandant qui contrôle les mouvements de ses propres troupes. #, alors, ne signifie pas que les deux armées vont à la rencontre, mais simplement que l’autre camp vient à nous. De même avec #. Si cela n’était pas parfaitement clair en soi, la paraphrase de Mei Yao-ch’ên le rendrait ainsi : #, etc. Comme le souligne Ts’ao Kung, une manœuvre de ce genre peut n’être qu’une ruse pour gagner du temps en vue d’une attaque de flanc inattendue ou de la préparation d’une embuscade. ↩︎
96:2 La paraphrase de Wang Hsi, en partie empruntée à Ts’ao Kung, est #. Une autre interprétation, adoptée par Chia Liu et le T’u Shu, est #, que le capitaine Calthrop traduit, de manière beaucoup trop approximative : « Le nombre n’est pas une marque certaine de force. » ↩︎
96:3 Littéralement, « aucune avancée martiale ». C’est-à-dire que les tactiques de # « chêng » et les attaques frontales doivent être évitées et que des stratagèmes doivent être utilisés à la place. ↩︎
96:4 p. 97 C’est une phrase obscure, et aucun des commentateurs ne parvient à en tirer un sens très clair. La difficulté réside principalement dans les mots #, qui ont été interprétés dans tous les sens possibles. Je suis Li Ch’üan, qui semble offrir l’explication la plus simple : # « Seul le camp qui aura le plus d’hommes gagnera. » La note de Ts’ao Kung, concise comme d’habitude au bord de l’incompréhensible, est #. Heureusement, nous avons Chang Yü pour nous en expliquer le sens dans un langage qui est la lucidité même : # « Lorsque les nombres sont égaux et qu’aucune ouverture favorable ne se présente, même si nous ne sommes pas assez forts pour lancer une attaque soutenue, nous pouvons trouver des recrues supplémentaires parmi nos vivandiers et nos suiveurs de camp, et alors, en concentrant nos forces et en surveillant de près l’ennemi, nous parviendrons à arracher la victoire. Mais nous devons éviter d’emprunter des soldats étrangers pour nous aider. » Il cite ensuite Wei Liao Tzŭ, ch. 3 : # « L’effectif nominal des troupes mercenaires peut atteindre 100 000 hommes, mais leur valeur réelle ne dépassera pas la moitié de ce chiffre. » Selon cette interprétation, # signifie « recruter », non pas de l’extérieur, mais parmi les éléments qui suivent une grande armée. Cela ne semble pas très militaire, et je suis convaincu que ce n’est pas ce que Sun Tzŭ voulait dire. Chia Lin, quant à lui, prend ces mots dans un sens totalement différent, à savoir « conquérir l’ennemi » (cf. I § 20). Mais dans ce cas, ils pourraient difficilement être suivis de #. Il serait préférable de traduire par « effectuer des captures isolées », plutôt que par # « une attaque générale ». ↩︎
97:1 La force de # n’est pas facile à apprécier. Ch’ên Hao dit #, se référant ainsi au second verbe. Il poursuit, citant le Tso Chuan : # « Si les abeilles et les scorpions sont porteurs de poison, à combien plus forte raison un État hostile le sera-t-il ! [#, XXII. 3.] Même un adversaire insignifiant ne doit donc pas être traité avec mépris. » ↩︎
98:1 Ceci est mal traduit par le capitaine Calthrop : « Si les troupes connaissent le général, mais ne sont pas affectées par ses punitions, elles sont inutiles. » ↩︎
98:2 # et #, selon Ts’ao Kung, sont ici équivalents respectivement à # et #. Comparez nos deux utilisations du mot « civil ». Yen Tzŭ [† BC 493] a dit de # Ssŭ ma Jang-chü : # « Ses vertus civiles le rendaient cher au peuple ; ses prouesses martiales tenaient ses ennemis en respect. » Cf. Wu Tzŭ, ch. 4 init. : # « Le commandant idéal allie la culture à un tempérament guerrier ; la profession des armes exige un mélange de dureté et de tendresse. » Je dois encore une fois critiquer la traduction du capitaine Calthrop : « Par un traitement humain, nous obtenons l’obéissance ; l’autorité apporte l’uniformité. » ↩︎
98:3 Le T’ung Tien et Yü Lan lisent : #. ↩︎
98:4 Le texte original comporte #. # est certainement maladroit sans #, mais d’un autre côté, il est clair que Tu Mu a accepté le texte de T’ung Tien, qui est identique au nôtre. Il dit : « Un général doit p. 99 en temps de paix faire preuve d’une confiance bienveillante envers ses hommes et aussi faire respecter son autorité, afin que lorsqu’ils affrontent l’ennemi, les ordres soient exécutés et la discipline maintenue, car ils lui font tous confiance et l’admirent. » Ce que Sun Tzŭ a dit au § 44, cependant, amènerait plutôt à s’attendre à quelque chose comme ceci : « Si un général est toujours sûr que ses ordres seront exécutés », etc. Je suis donc tenté de penser qu’il a peut-être écrit #. Mais c’est peut-être trop conjectural. ↩︎
89:4 Il y a un doute sur la lecture #. Les T’ung Tien et Yü Lan ont #, et Li Ch’üan propose #. ↩︎